13/10/2008
Nathalie Riera : la parole derrière les verrous Ed. de L'Amandier 2007
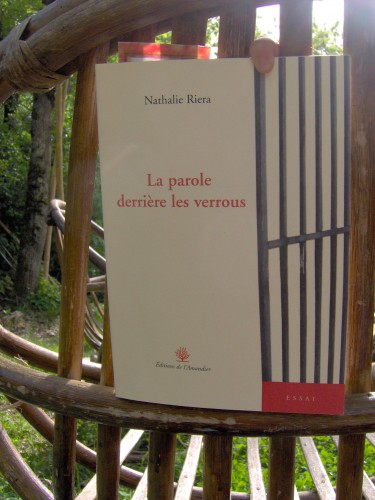
☼
NOTE DE LECTURE
Par Pascal Boulanger
Que peut la parole, et singulièrement la parole poétique, dans un monde où la faute et la culpabilité dominent ? Que peut-elle cette parole face à l’impact émotionnel des événements et comment rendre, un tant soit peu lisible, notre propre opacité ?
Ces questions, et quelques autres toutes aussi capitales, Nathalie Riera nous les pose dans La parole derrière les verrous. Cet essai ne relate pas seulement son expérience, celle des écritures et des pratiques théâtrales en milieu carcéral, il dessine aussi et surtout un art poétique, un art de vivre qui prend appui sur des constats sociologiques et sur des écrits poétiques.
Si les problèmes du langage concernaient, hier encore, une infime minorité – celle des prisonniers notamment – on ne compte plus aujourd’hui ceux qui se débattent dans une langue, et dans des sensations, qu’ils ne maîtrisent plus. Car c’est tout notre société qui est devenue une prison et le corps, quand il est vécu comme instrument et marchandise, est la mise à mort de la parole. Rien de nouveau, en effet, toute construction sociale a toujours été basée sur un crime commis en commun, et c’est contre leur propre esprit que les hommes sont aux aguets, contre leur propre vie qu’ils se mettent à l’affût, dans la résolution maniaque de nier l’autre et de se nier eux-mêmes, de pourrir le don de l’existence.
De quelle privation souffrons-nous, qui rend quelques fois nos désespoirs si monotones et qui contribue à la perte du sens des mots ?
Autrement dit, quel appel nous adresse la vie et comment traduire, dans les faits, cet appel que nous ne savons plus entendre ? Pourquoi faisons-nous si souvent obstacle à la présence ? Pour Nathalie Riera, rendre l’inhabitable habitable et l’irrespirable respirable (Henri Michaux), en refusant toutes les facettes du nihilisme, est tâche de ceux qui tentent d’habiter poétiquement le monde. Parler, et laisser la parole parler, est un engagement qui n’engage pas la langue seule mais surtout sa palette de sens et de sensations.
A l’opposé des tendances actuelles du solipsisme et des paroles insignifiantes qui évaluent et qui dressent des plans comptables, Nathalie Riera en aidant à une prise de conscience, à une prise de parole, participe de plain-pied à une maïeutique qui désobéit au renoncement.
Sa propre voix poétique ne se mêle pas à la foule, par fatigue ou par renoncement à la liberté, elle se situe au contraire au-delà des murs imposés ou consentis, aussi bien dans ce qui fait retour :
Ces retours de la joie, ces rafraîchissements à la mémoire des objets de sensations, voilà exactement ce que j’appelle raisons de vivre. (Francis Ponge cité par l’auteur)
Qu’à travers des revirements de situation où tous les possibles peuvent se déployer :
(…) Il peut être légitime de penser que pour certains individus, il est trop tard, aucun projet ne peut avoir raison de celui qui végète dans la haine. Dans le jargon du théâtre, il y a l’expression de « revirement de situation ». Je crois qu’à tout moment de notre existence, il peut se produire ce que nous désignons par le mot « miracle » (…)
Pour sortir de l’ombre des vies morcelées et brisées, pour déjouer le présent sans présence de ceux dont les paroles sans repère se sont doublées de silence, c’est l’inscape, cette écoute intérieure, qui doit servir de motifs dynamiques en s’incarnant dans le geste et la voix. L’enjeu consiste alors à mettre en partage toute sa charge de vérité. Faire résonner dans sa propre pratique l’écho d’une autre pratique permet de dépasser l’isolement et le clivage. Refuser la logique d’échec, c’est tenter de produire du réel. Et si l’enfer nous ment dans ce qu’il nous révèle d’enfermement, il y a toujours possibilité d’effectuer une traversée dans la voix et dans l’écriture qui témoignent et engagent sa propre existence.
On ne sait jamais d’où vient le mal mais ce qui se trame dans les ténèbres doit bien pouvoir se dire en pleine lumière. Oui, Nathalie Riera qui écrit depuis des années et anime le site « Les carnets d’Eucharis » est comme un rameau d’or à l’entrée des enfers.
Pascal Boulanger
Note de lecture parue dans la revue Europe, N° 954
(octobre 2008)
Bio-Bibliographie
Née en avril 1966, vit en Provence, où elle se consacre un temps à l’animation de théâtre d’atelier en Maison d’arrêt (de 1993 à 2005). L’essentiel de son travail sur le jeu théâtral et ses techniques se déroulera principalement au sein des établissements pénitentiaires du sud de la France.
Du côté de l’écriture : Staccato Morendo, roman sélectionné par la ville de Saint Lô, en 2002 (prix Jean Follain) ; un livret d’opéra À fleur d’eau interprété par l’ensemble Flor de Quintetto (création 2003 de l’Atelier-Studio du Centre National de Création Musicale Marseille), un spectacle son et lumière Blanche Crèche (création pour la ville de Cannes, Noël 2003), organisatrice et modératrice de conférences et de débats sur la création contemporaine et l’art dans l’espace public (1ère édition du Festival du Mai de l’Art, à St Raphaël en 2005, où elle conçoit et anime Jetée en Spirale), anime actuellement Les Carnets d’Eucharis et leurs bulletins Une étape dans la clairière, puis des ateliers de pratique d’écriture et de lecture.
Nathalie Riera
Des extraits de ses textes sont mis en ligne sur différents sites littéraires francophones :
Terre à Ciel
Texte : « Chemin vers le vide »
Francopolis
Texte : A Cheval!
Texte : Sauvages sont les fraises
re-pon-nou
Texte : « Nous sommes l’amour »
Sur le site de Christophe Condello
Extraits des Carnets de campagne I, II, et III
Sur le site de James Noël - COEURITOIRE
Publications :
« La parole derrière les verrous », Editions de l’Amandier, 2007
« Elégéia et autres chants de soleil », (Carnets de Campagne II), Imp’Act - revue littéraire Ici&ailleurs dirigée par Gilbert Bourson et Sylvie Larangeira (4ème trimestre 2008 – N°2).
A paraître (2009) :
« Paysages d’été »
« ClairVision… sur le jersey de laine »
Sites à consulter
Editions de l'Amandier
Europe-revue
Horschamp-Cassandre
Extrait
La parole derrière les verrous
À 25 ans, le cinéaste José Giovanni réfléchissait à ses erreurs derrière les barreaux, tandis qu’une assistante sociale de la prison où il fut écroué se demandait après des années d’exercice de sa profession si elle avait vraiment été utile. José Giovanni reconnaîtra que cette femme avait indéniablement participé à son sauvetage. Je cite ici l’exemple de ce cinéaste, pour la simple et bonne raison que cet homme, à la suite de sa réhabilitation, ne s’est pas uniquement consacré à la réalisation de films, mais s’est principalement voué durant les quarante dernières années de sa vie à intervenir dans plusieurs prisons en vue de rencontrer les détenus. De telles interventions sont nécessaires, car elles font le lien avec le monde extérieur. Et en règle générale, un détenu y est très sensible, très attaché à ce que ces visites se renouvellent, d’autant plus si celles-ci présentent pour lui quelque intérêt, et qu’elles favorisent son travail de réinsertion. Il est, en effet, important de favoriser ces rencontres. Je tenterai, maintenant, d’apporter quelques autres arguments sur la nécessité de ces rencontres.
Dès lors que l’esprit humain est en activité, celui-ci a plus de chances de se développer, plutôt que de diminuer ou de glisser vers la pente de l’infantilisme. Développer son esprit consiste à l’éduquer et à l’aguerrir, afin de rendre à l’être humain « ne serait-ce qu’un instant le réel ; et avec le réel, une chance de vie » (8). La volonté de créer ces rencontres consiste donc à nourrir les esprits, à les orienter vers de nouveaux chemins, vers de nouveaux modes de pensées, vers de nouveaux horizons, et puis également vers de nouvelles plénitudes pour le coeur humain. Je prends ce mot dans le sens de se sentir plein, et non plus en état d’inappétence, lequel laisse toujours prise à l’indifférence par laquelle s’expriment toutes formes incongrues de dérives et de violences, et dont on ne sait que trop ce que ces expressions ont de néfaste sur la vie psychique et sur l’évolution affective de l’individu.
Par ailleurs, et dès lors que l’être humain met sa parole en action et qu’il est en mesure de porter son attention sur la parole d’autrui, dès lors qu’il y a action verbale et attention, il se produit forcément quelque chose.
Ces quelques réflexions me conduisent à enchaîner sur mon choix d’intituler cet ouvrage la parole derrière les verrous.
Dans le petit Robert, la parole est « un élément simple du langage articulé », un « système de signes vocaux (…) qui constitue une langue ». Et le langage se définit comme « fonction d’expression et de communication entre les hommes ».
Pour Giuseppe Ungaretti, « Il y a dans le monde des langages quelque chose qui est définitivement fini…, et la parole même apparaît comme une convention tout de suite usée…, l’homme, dirait-on, ne parvient plus à parler. Il y a une violence dans les choses qui devient sa violence et l’empêche de parler. Une violence plus forte que la parole ». Cette violence plus forte que la parole est typiquement d’actualité. Nous avons effectivement affaire à un monde des langages totalement usé, et la conséquence de cette usure ne permet plus à la parole indivisible de s’affirmer, ou de se faire entendre, ou elle devient simplement impossible, ou définitivement annihilée. Car ce qui s’affirme n’est autre chose que la violence des mots qui désunit, et dont la forte emprise ne permet plus au langage d’assurer son rôle de cohésion ; toutes les opinions qui en découlent s’expriment comme des vérités indiscutables. Devant cette évidence, il reste à se demander de quelle manière pourrions-nous ranimer la parole perdue, celle que je qualifie de vivante, qui appartiendrait à notre réalité profonde. Mais la reviviscence de cette parole est-elle suffisante pour nous aider à rompre avec notre langue emprisonnée ?
Quoi qu’il en soit, il est dans l’intérêt des prisons de multiplier les espaces de parole, ceci m’incitant à dire que les établissements pénitentiaires devraient être beaucoup plus fréquentés, par, notamment, les artistes, les intellectuels, les scientifiques, les philosophes. Or, en prison, l’extérieur est, hélas, absent, et l’on ne se méprendrait certainement pas à considérer la société pénitentiaire comme une cité interdite, un domaine réservé, où toute action humaine se doit d’être cachée des autres, afin de ne pas s’attirer le feu de la foudre.
L’absence de l’extérieur m’interroge sur le sens de la tolérance. Comment peut-on exiger du jeune individu qu’il ait de la tolérance, lorsque celui-ci est directement confronté à la violence de la société moderne, à laquelle il est difficile d’échapper ? Tolérance ou soumission ? Les jeunes auront beau recevoir une éducation et de l’amour, face à tous les paradoxes et à toutes les contradictions sécrétés par la société moderne, ne serait-ce pas plutôt cette violence de la modernité qu’il faudrait avant tout remettre en question ? Une modernité qui parle de la tolérance, mais qui, elle-même, n’est pas toujours dans l’action de la tolérance, mais plutôt dans celle, répétitive, de condamner et d’exclure ce qui se révèlerait différent ou qui n’appartiendrait pas à une norme établie. Comme si la norme était un modèle exemplaire auquel un jeune individu pourrait se référer, autrement dit, sur lequel il aurait raison de se construire, spirituellement, mentalement, et socialement, afin de s’assurer un avenir. Se construire ou se formater ? La norme, qui fait de lui un vrai citoyen ! La norme, comme unique garantie d’une société meilleure ! Mais que peut réellement signifier une société moderne meilleure ? Qu’est-ce qui réellement fait la violence de la jeunesse et nous incite à penser que rien ne peut l’endiguer ? Peut-on dire qu’il y a chez le jeune une absence de tolérance ? Ne sont ce pas plutôt les fléaux de la modernité qui font sa fragilité et sa déshérence ? Par fléaux de la modernité, j’entends, entre autres, cette impossibilité pour une grande partie de la société des hommes à se remettre en question, et de la tendance systématique à accuser l’autre, le reléguer au ban de la société, ou à trouver un autre coupable. Cette modernité, qui se dit progressiste ou novatrice, ouverte au changement, sur quoi ouvre t-elle nos regards naïfs ou ignorants ? Regards perdus, qui à leur tour se transforment en regards d’exclusion !
Contre quoi faut-il s’insurger ? Continuer à tourner le dos aux valeurs éthiques et ontologiques, et laisser celles-ci reculer devant les diktats du marché ! Séduire avec des images qui vont trop vite et font trop de bruits et avec promesses fallacieuses ! Continuer à se demander : mais à quoi peut rêver la jeunesse par-delà la parole mercantile et vénale ?
Pier Paolo Pasolini, poète censuré au temps de l’Italie fasciste, s’était insurgé contre ces rêves colportés par la culture marchande, idéologie de la camelote qui cloue la jeunesse au pilori, et la transforme en «monstresse » névrotique. Pasolini a oeuvré pour la poésie en travaillant pour les causes des minorités dans l’espoir d’une révolution. Mais faut-il dire du poète que sa place est ailleurs et que ses beaux projets ne sont que mièvres utopies ?
La criminalité, dont on nous rebat les oreilles au quotidien, ne serait-elle pas, comme au temps de Pasolini, l’aboutissement ou le résultat d’une impossibilité pour ces jeunes, en rupture économique et sociale, de réaliser ces modèles « exemplaires » qu’on leur impose d’adopter ? Chercherait-on à expliquer la criminalité autrement, ou alors préfère-t-on regarder la chose de loin, laissant à cette danse macabre sa libre expression ?
La jeunesse nous fait-elle peur, au point que le mépris public puisse parfois la vouer aux gémonies ? Car c’est toujours au nom du conformisme moral, bien plus que de la « santé publique », que l’on condamne la délinquance juvénile. La délinquance n’est pas jugée comme une maladie de la société, mais comme un avatar du mal. Quand Sigmund Freud prétend que « Nous ne sommes nous-mêmes qu’une bande d’assassins » (9), pour Alice Miller, l’individu n’est pas « naturellement » destructeur. Il détruit, si autour de lui aucun relais de soutien et d’assistance ne participe à l’édification de son identité et ne l’aide à aller au-devant de sa vérité.
Marguerite Duras désignait la violence du jeune âge sous l’appellation de «la classe de la violence ». « Ce n’est ni le niveau social, ni le niveau de l’instruction des enfants, ou la moralité des parents ou l’amour dont ils ont été privés, etc. Je n’y crois plus, à ça. Non, c’est vraiment la nature même de l’enfance et de la jeunesse dans sa confrontation avec la société moderne, qui crée cette violence que rien ne peut endiguer ». (10)
Toutes ces questions : « À qui la faute ? », « Quels sont les coupables ?» font violence à la société entière. Mais ce n’est certes pas le formatage de la vie qui peut protéger les êtres et les respecter ! Le laxisme et l’hypocrisie d’une société ne sont pas une preuve d’amour et de respect pour son prochain.
Lorsque la violence a valeur de parole, pour Cyrulnik, il s’agit d’endiguer la violence par « la ritualisation de la parole qui permet le travail d’assimilation émotionnelle du corps-à-corps ». Il faut «instituer une gestion de la violence», car lorsque le bouleversement est institué, les civilisations réussissent à évoluer.
Cyrulnik se demande si une culture peut inventer « le bon code, celui où l’homme peut encore s’exprimer, parler et gouverner sans détruire son prochain. Ce code a un nom, c’est la tolérance ».
(8) - Philippe Jaccottet, L’entretien des Muses.
(9) - Sigmund Freud, Essais de psychanalyse.
(10) - La couleur des mots. Entretiens avec Dominique Noguez autour de huit films.
La parole derrière les verrous
Editions de l’Amandier 2007
CONTACT
Nathalie Riera
voyelles.aeiou@free.fr
Les Carnets d’Eucharis/Une étape dans la clairière
11:54 Publié dans COPINAGE | Lien permanent | Commentaires (0)




Les commentaires sont fermés.