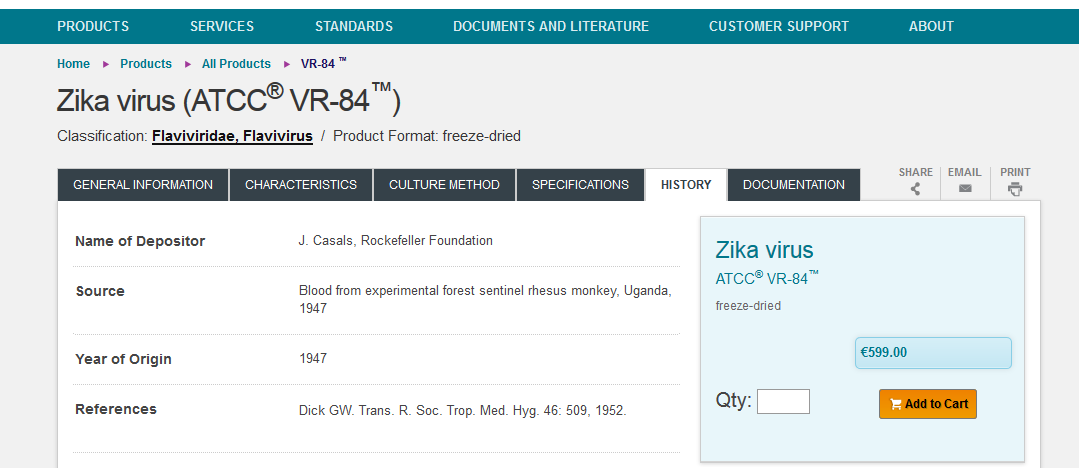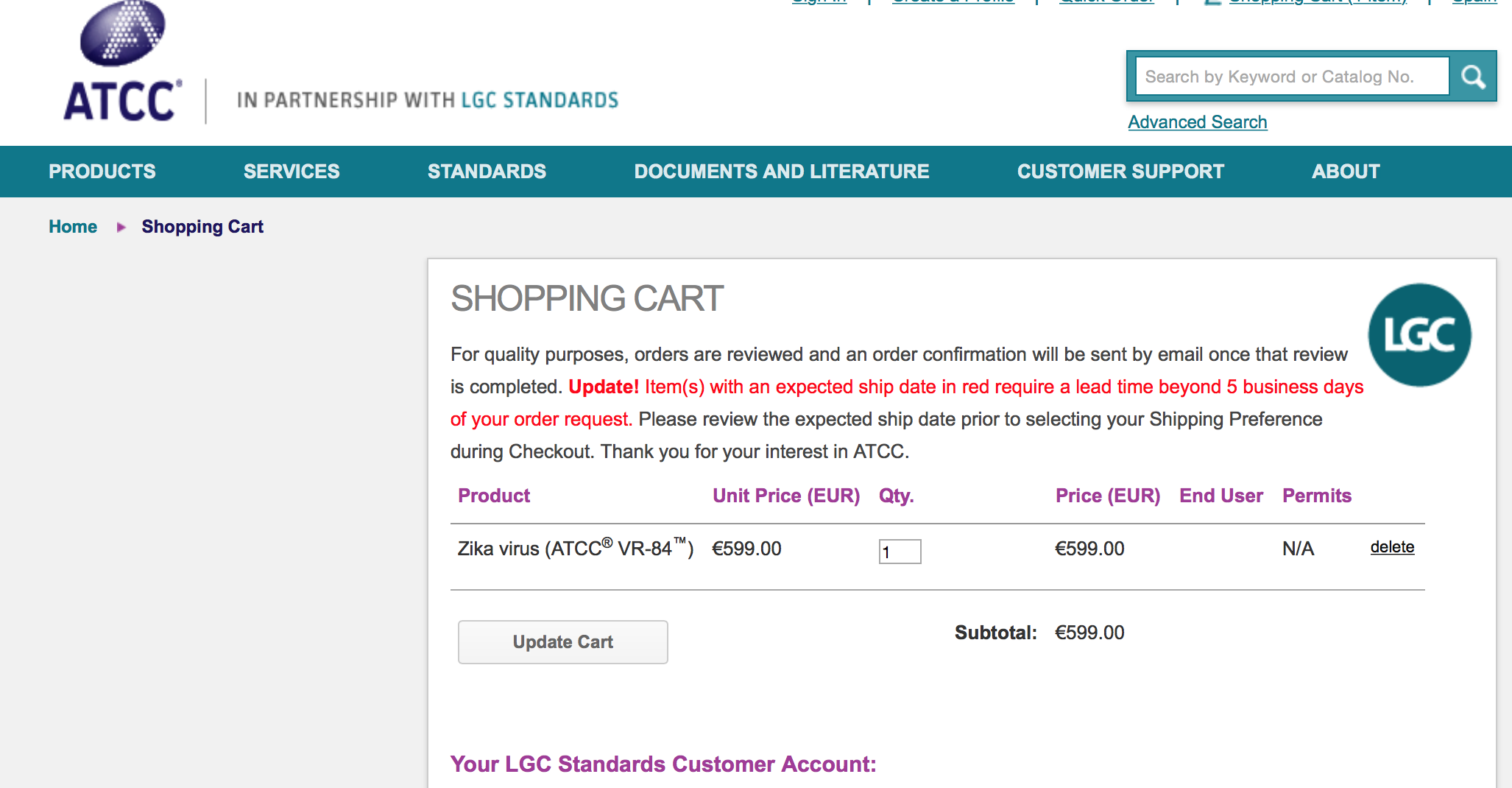Écrire en tant qu'Honduriens contre la haine
« Je voudrais t'offrir (…) le logis de mon crâne, lamentation déchirée, molécule de chair infime jamais humiliée (…). »
Clementina Suárez
Depuis l'âge de sept ans, je me demande pourquoi les discours de haine ont des racines si profondes au Honduras. Bien sûr, je ne le pensais pas en ces termes alors ; ma curiosité se limitait à savoir pourquoi certains de mes camarades de classe avaient autant d'aptitude à humilier les autres – n'hésitant pas à me choisir moi-même comme victime dans certaines occasions.
Les réflexions ne manquent pas sur la violence comme phénomène, mais l'ignorance est assez grande quant aux impacts de la haine qui, je le crains, nous est inoculée et reste imperceptible à nos regards superficiels.
Sa dégradation la plus brutale et la plus évidente se manifeste dans le mépris systématique et flagrant pour la vie humaine, cependant par-delà même cette violence – qui un jour trouvera son terme – la haine marque le pays comme une espèce de vérole dont les cratères et les cicatrices ne disparaîtront jamais.
Cela n'a ni commencé ni terminé avec les massacres ou le coup d’État de 2009, « ce sont de vieilles rancœurs », comme dirait Juan Rulfo.
A la différence de la violence, qui est explosive, la haine dévore les entrailles en attaquant en premier le plus précieux : l'intérieur. Et nous autres, comme société, nous avons toléré qu'elle nous dévore les tripes et souille nos idées avec son eau contaminée.
Nous nous sommes habitués à vivre avec elle et quand il lui arrive, pour une raison ou une autre, de s'absenter, nous nous demandons où elle est et nous la cherchons jusqu'à la retrouver.
La haine indigne, germine, se ramifie, se transforme, se cache, contamine ; la violence agresse et quand elle explose chargée de haine, elle est plus dure encore.
Dans nos sociétés (j'étends cette notion jusqu'à parler du monde entier) la haine occupe une fonction spécifique. Pour commencer, c'est un leitmotiv politique et économique efficace qui profite des résistances et des obstacles qui nous empêchent d'observer les problèmes comme résultant d'une totalité (observable sous différents angles) en nous amenant à conclure qu'il conviendrait plutôt de les aborder de manière séparée et indépendante.
Cette vision a ôté tout espoir aux désirs de pluralité, parce qu'en lieu et place d'un processus d'intégration et de lutte contre les inégalités, nous avons toléré que cet amas de haine, en théorie qui devrait se dissoudre au sein d'un développement humain authentique, au contraire s'accumule, pire encore : se transmute.
Dès l'enfance, nous apprenons que la vie, comme droit fondamental, est une loi qui peut ou même doit, « à titre exceptionnel », être ébranlée. Le simplisme des discours implacables banalisant la vie – et la mort aussi dans le même temps – s'apprend très tôt.
Pas plus l'école que la famille (quand ces deux entités ne font pas simplement défaut) n'ont la force d'octroyer à l'individu les outils nécessaires pour identifier et repousser ces mécanismes sociaux qui détruisent le concept d'être humain. A temps complet, nous sommes exposés à l'inégalité et à traiter les autres ou à être traités par les autres comme des sous-hommes. Dans cette perspective, nous sommes un pays sauvage, où le respect de l'intégrité humaine passe au deuxième ou troisième plan. La première responsabilité de cette faille en incombe à l’État et son système judiciaire désastreux, la deuxième à nous-mêmes.
Nous avons à disposition – malgré toutes les limites de nos capacités à produire un raisonnement – un corpus théorique qui explique et nous met en garde en permanence contre les ramifications de la haine, qui fouille les obscures profondeurs de « l'hondurénité » et qui a cherché, du fond de sa marginalité, à déchiffrer la rudimentaire machine discursive – infaillible – qui a perfectionné ces discours. Sans aucun doute, divers travaux en sciences sociales ou artistiques ont donné des clés permettant de comprendre nos drames, cependant, nous n'avons pas encore entamé le projet nécessaire d'une « archéologie du savoir » qui les reconstitue pour les rendre plus visibles.
La pensée contre la haine est manifeste dans l’œuvre d'un Ezequiel Padilla Ayestas, qui constamment dévoile ces deux fissures, même si la partie la plus intéressante de son œuvre est celle qui nous dépeint comme des êtres fragiles et nus.
Nous sommes nus parce que la brutalité de la haine supprime nos idées, écrase notre pensée, nous met à mal comme êtres humains, pour qu'une fois foutus en l'air nous nous vendions pour quelques miettes.
Si nous n'avons pas conscience de notre fragilité, nous ne pourrons nous défaire de l'emprise de la haine et deviendrons les porte-parole de ce qui nous paraît aujourd'hui injustifiable.
Notre fragilité, nous devons l'assumer comme un exercice permanent, sans jamais nous situer comme victimes, mais comme victimes potentielles, susceptibles de se convertir en bourreaux. Il faut imaginer le mal, comme le disait Hannah Arendt, ou sinon nous nous tournons vers lui sans le savoir.
Les premiers vers du poème « La parole » de José Rivas décrivent un cheminement métaphysique qui s'avère être aussi celui de ce penseur méprisé qui, malgré toute sa profondeur, n'est pas, n'a pas été et craint de ne jamais être écouté suffisamment.
« Poète ? Non. En vérité, je ne crois pas.
Visionnaire ? Non plus. Je sens déjà
Qu'au rythme où dans l'oubli je tombe
L'éternité me vole ce que je vois. »
Deux questions
Je propose une lecture de la haine partant de deux questions qui nous aident à nous élever jusqu'à une vision plus claire de nos racines.
La première question est la suivante : peut-on ou doit-on tuer un ennemi pour libérer le peuple ? Je m'interroge ici sur le raisonnement à la base des processus révolutionnaires (qu'ils aient échoué ou non), depuis la construction du concept de république aux origines de notre fondation nationale, jusqu'à la rhétorique qu'emploient de manière très fréquente les nouveaux représentants de la « gauche ».
A pareille question, on peut répondre en empruntant aux processus et idéologies produits par les expériences de guérilla dans notre pays (au Honduras) et dans les pays voisins (surtout), étant entendu qu'il s'agit là de mécanismes de pensée n'ayant pas connu la moindre évolution – positive – depuis près de quarante ans. D'ailleurs, ce n'est que la silhouette de cette pensée qui s'est maintenue, et non le fond. La réponse habituelle, dans cette perspective, est oui : on peut tuer au nom d'un processus de « libération », il s'agit même d'un « trésor philosophique », certes réservé aux seuls pauvres, mais leur assurant la prise du pouvoir. En d'autres termes : les pauvres se « libèrent », ou bien nous les « libérons », non pas pour qu'ils deviennent des « citoyens » mais des hommes « libres », comme si l'objectif final – et non initial – était de les sortir de l'esclavage. Désir brûlant de « liberté » en somme, et non de « citoyenneté ».
La deuxième question, je la propose depuis l'autre camp : Peut-on, doit-on tuer pour protéger notre liberté ?
La « liberté », dans ce sens-là, n'est pas un concept philosophique, c'est une invention juridique qui repose sur l'acceptation d'un « état des choses » validé par une inégalité assumée et acceptée. Nous revenons jusqu'aux origines du maintien et de la répartition de la propriété, quand certains sont devenus les heureux bénéficiaires et la majorité la main d’œuvre d'un système féodal qui continue à se reproduire de nos jours, appuyé par des structures qui se sont avérées inébranlables. C'est-à-dire que se sont transformées les lois du marché et non les structures du pouvoir. Le libéralisme, le militarisme ou le bipartisme en gestation, ainsi que le néolibéralisme actuel protègent et garantissent cette « liberté ». La réponse est oui : on peut, on doit tuer si notre « liberté » – c'est-à-dire nos biens – se voient tout à coup menacés.
Dans notre cas, sans exclure le fait que la première question a généré de la haine, c'est plutôt la seconde qui a prédominé au long de notre histoire. Les massacres commis par le crime organisé peuvent d'ailleurs également s'interpréter dans cette perspective.
Cela semble évident de dire que, si nous n'introduisons pas dans nos dynamiques politiques, culturelles et sociales un autre type de questionnement, nous continuerons ainsi, sans jamais changer notre histoire. L'idée serait plutôt d'entrer en rupture avec elle, non ?
Tuerons-nous pour qu'ils ne nous tuent pas ? Tuerons-nous pour qu'ils ne nous ôtent pas ce que nous sommes ? Tuerons-nous pour obtenir ce que nous n'avons jamais eu ? Nous tuerons-nous nous-mêmes pour qu'ils ne nous tuent pas ? Les tuerons-nous pour ne pas qu'ils nous tuent ? Les tuerons-nous pour qu'ils ne se tuent pas entre eux ? Nous tuerons-nous nous-mêmes pour ne pas nous tuer nous-mêmes ?...
Un « je » qui se questionne
Adolescent, je rêvais du Che, je me demandais ce qu'il avait bien pu voir, ce qu'il avait bien pu penser au cours de sa vie, comment il avait nourri son idéal révolutionnaire. A l'occasion d'un voyage en Argentine, je suis allé interviewer un vieil ami à lui, Rogelio Garcia Lupo, l'auteur du Métier secret de Che Guevara, ancien ami également de Rodolfo Walsh, grand journaliste dont m'a toujours parlé mon père et qui est mort un pistolet à la main...
Je lui ai demandé : « Quelles étaient, d'après vous, les limites que le Che imposait aux idées, non pas à ses idées en particulier, mais aux idées en général ? Jusqu'où, jusqu'à quel point les idées pouvaient-elles légitimer ses actes ? »
Il a évité ma question avec amabilité, me disant qu'il était fatigué. Je pouvais voir sur son visage le rictus de l'ancien qui craint d'être questionné, pas forcément à cause de moi, peut-être en raison de son âge et de son état de santé qui l'empêchaient d'atteindre son plus haut niveau de réflexion. Mon intention n'était pas de le gêner pourtant, je ne cherchais pas non plus à entacher son parcours ou celui du Che.
Cela m'intéressait simplement d'écouter l'opinion de quelqu'un qui, en plus d'avoir écrit sur lui, avait connu son visage, sa voix, ses yeux, éléments tout sauf anodins qui, face à la personne, aident à mieux découvrir de quoi sont faites ses erreurs et ses réussites.
Je crois que je comprends mieux, maintenant, à quel point le Che, avant de croire en ses idées, s'en éprenait, chose qui, à la lumière de ma propre évolution intellectuelle, me paraît une erreur.
Quand il m'arrive de m'imaginer en train de marcher à ses côtés, je me rends compte que je le respecte, que j'admire son courage, sa volonté, son amour, mais en apercevant le fusil que je tiens dans mes mains, je me demande si je suis vraiment disposé à tuer quelqu'un qui s'oppose en tout point à mes idées, quelqu'un que je considère comme mon « ennemi », quelqu'un que peut-être je ne hais pas – ou peut-être si – mais qu'en raison de cette cruauté de la vie, je dois éliminer si je ne veux pas mourir moi-même ; quelque chose de plus fort que les idées me rend incapable de tirer : la peur et la douleur de ma victime, dont le visage face à moi est tordu d'angoisse.
Accepter la fragilité.
Je me dis que la simple vision d'un visage en train de mourir m'empêcherait d'être la personne que je suis, ébranlerait tout en moi, à commencer par mes idées, parce qu'elles cesseraient d'être le complément de ma vie, pour devenir le carburant m'aidant à combattre ma propre mort. Ce n'est pas la même chose.
Ce n'est pas tant que j'aime le visage de l'autre d'une manière évangélique, encore moins que je sois sujet à la compassion, aucun sentiment chrétien ne doit être relié à ça.
Il s'agit de quelque chose d'intérieur, de profond, leçon à la fois parallèle et opposée à celle de « l'exceptionnalité » de l'assassinat, dont je ne peux non plus arracher les racines en moi, parce que cette fragilité est également brutale et simple. Je ne peux supporter de percevoir l'humiliation sur le visage de quelqu'un.
Et mourir entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est mourir humilié, parce que toute idée ayant pour finalité d'entraîner la mort humiliera toujours la vie d'une manière irréparable, or la vie représente ce qu'à mes yeux nous avons de plus respectable et d'incommensurable.
Jusqu'à quel point peut-on, dès lors, tolérer l'humiliation qu'un être humain inflige à un autre ? Jusqu'à quel point, avant « d'entrer en action », avant de « châtier », avant de « revendiquer », avant de salir à jamais le manteau des idées, avant donc tout cela qu'il faut écrire en guillemets, doit-on supporter l'injustice ?
Personne ne peut prétendre, après avoir ôté la vie à un de ses semblables, quand bien même ce geste aurait visé à éviter une autre mort, qu'il restera le même, intact. Il faut pouvoir l'assumer, cela. Pour ce qui est des autres questions, je ne saurais m'aventurer à y répondre.
Rester debout après avoir tué, continuer à avancer, devenir même plus fort, tout cela ne proviendra jamais du simple instinct vital ; après avoir tué nous apprenons à vivre en nous nourrissant de la mort.
On ne dit pas sans raison que les soldats les plus forts sont ceux qui ont une expérience de terrain, une expérience directe du champ de bataille, parce que ce sont ceux-là qui ont provoqué la mort.
Mais ce que l'on ne peut nier, c'est que ce soldat fort ne peut être poussé exclusivement par un instinct vital, bien au contraire, si c'était le cas, il serait incapable de faire la guerre.
Ce que cette époque funeste est en train de détruire, c'est cet instinct vital, cette idée de la vie innée dans toute société, pour imposer la pulsion de mort, comme si nous étions en guerre, parce que nous sommes en guerre. Notre société se convertit en une nécropole qui s'alimente de la mort pour continuer, bien qu'il y en ait aussi pour croire honnêtement qu'en rendant la mort publique on la supprimera.
Comme je résidais en France au moment des attentats terroristes qui l'ont secouée en 2015, j'ai pu observer comment les discours de haine s'imposent, en nous poussant à tout prix à choisir la mort comme la meilleure issue pour régler les problèmes (tant du côté officiel que des terroristes).
Les villes se construisent dans la haine. Les campagnes se dépeuplent à cause de ce phénomène de migration qui traverse l'horreur pour échapper à la misère et à la souffrance, alors même que le seul gain d'une telle fuite, où que l'on aille, est davantage de destruction et encore moins de vie. La terre sent le départ, la fumée, la faim.
Quand j'ai commencé à écrire de la littérature, la confrontation brutale avec la réalité que nous découvrons en devenant adultes a commencé à souder mes premières images littéraires. La première chose qui est apparue dans ma tête, c'est l'odeur de la guerre. Peu à peu, j'ai commencé à découvrir, alors que je m'étais glissé dans la peau d'un survivant qui parcourait un champ jonché de débris humains, que j'étais le témoin d'un génocide.
Nous avions presque tous été exterminés. Dans cette œuvre de fiction, je sortais un pistolet et je tirais en l'air, dans l'espérance que quelqu'un me réponde par un autre coup de feu. « J'ai besoin que quelqu'un me tue ! » m'exclamais-je, et je continuais à tirer jusqu'à épuiser les balles de mon pistolet, sans que personne, pas même un oiseau, ne se manifeste à l'horizon.
Traduction de Laurent Bouisset





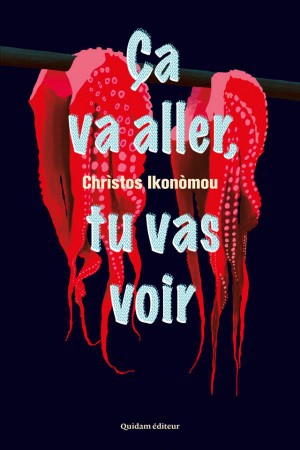













 Sarah Roubato se définit comme " pisteuse de paroles, chercheuse en trans-écritures, écouteuse à temps plein ". Ses champs de réflexion et d'action vont de l'anthropologie à l'écriture, en passant par la musique, avec toujours une même base, le terrain. Elle vit actuellement au Québec et voyage sans cesse, mais Paris reste sa ville de cœur. Sa "Lettre à ma génération", écrite à la suite des attentats du 13 novembre dernier et publiée par Médiapart, y a trouvé un écho retentissant. Son site :
Sarah Roubato se définit comme " pisteuse de paroles, chercheuse en trans-écritures, écouteuse à temps plein ". Ses champs de réflexion et d'action vont de l'anthropologie à l'écriture, en passant par la musique, avec toujours une même base, le terrain. Elle vit actuellement au Québec et voyage sans cesse, mais Paris reste sa ville de cœur. Sa "Lettre à ma génération", écrite à la suite des attentats du 13 novembre dernier et publiée par Médiapart, y a trouvé un écho retentissant. Son site :