Les Zindigné(e)s : Paul Ariès, vous publiez un ouvrage que nous étions nombreux à attendre… puisque vous nous en parliez depuis plus de vingt ans et qu’il correspond largement aux enseignements que vous donnez en histoire, sociologie et psychanalyse de l’alimentation… Depuis vingt ans, des urgences politiques, donc éditoriales, vous obligeaient à faire d’autres choix, alors que tout était déjà là, et à ne pas prendre les six mois nécessaire pour finaliser ce qui, à vos yeux, est sans doute le plus important. Les désillusions politiques ont donc parfois du bon… car elles vous ont permis de prendre du recul et le temps nécessaire pour ce retour aux fondamentaux de l’alimentation donc de l’histoire. Pourquoi écrire une histoire politique de l’alimentation, certes savoureuse mais tout de même sacrément copieuse, puisqu’il vous faut 450 pages pour construire cette grammaire politique de l’alimentation. J’avoue qu’après vous avoir lu je ne mangerai plus comme avant… Disons que je sais un peu mieux ce que manger veut dire…
Paul Ariès : Beaucoup d’histoires de l’alimentation existent mais pas d’histoire politique, comme si nos façons de faire société, de régler nos conflits, de choisir qui sont nos amis et nos ennemis, de déterminer ce que nous considérons nous être commun, n’interféraient pas avec nos conceptions de l’alimentation et nos façons de passer ou de ne pas passer à table, avec nos définitions, toujours changeantes, qui permettent de dire qui a droit de participer au banquet, qui doit recevoir plusieurs parts, une pleine part, une demi-part, voire une mauvaise part.
Les Zindigné(e)s : vous écrivez aussi que l’humanité s’est humanisée à travers sa table et qu’elle pourrait fort bien se déshumaniser en déshumanisant sa table.
Paul Ariès : l’humanité s’est humanisée à travers sa table en interposant entre elle même et ce qu’elle mange et boit toute une série de choix (entre ce qui est consommable et ce qui ne l’est pas, entre ceux qui ont droit au banquet et les autres, entre divers modes de cuisson, etc.), de valeurs (entre celles reconnues aux divers aliments et aux diverses façons de cuisiner, d’assaisonner, de manger), d’objets (du bâton à fouir à la broche et à la marmite), de savoirs et de savoir-faire (en matière de chasse et de cueillette, de stockage, de conservation, d’assaisonnement, de cuisson), de cultures (des cultures populaires aux cultures aristocratiques en passant par les aspects religieux ou scientifiques), de rituels (domestiques, religieux ou politiques), transformant ainsi les nutriments, qui concernent le seul corps biologique, en aliments. L’histoire de l’alimentation est donc d’abord celle de cette mise à distance, de cette ritualisation et symbolisation qui concourent au vivre ensemble.
L’humanité pourrait tout aussi bien se déshumaniser en déshumanisant sa table. Nous n’avons toujours pas appris, en plusieurs millénaires, à garantir le droit au banquet à l’ensemble de l’humanité, ce qui supposerait de concevoir une nouvelle symbolique, une nouvelle ritualité, d’autres pratiques. Au contraire, nous mangeons de plus en plus n’importe quoi, n’importe comment, n’importe quand, n’importe où, avec n’importe qui et pour n’importe quelle raison. Nous n’acceptons plus que la communauté puisse avoir son mot à dire sur nos façons de manger, et déjà de gaspiller, car nous ne savons plus ce que manger veut dire. Nous nous imaginons, contre tout ce que nous apprend l’histoire de l’humanité, que la table serait une affaire individuelle dont nous n’aurions pas à rendre compte ni anthropologiquement, ni socialement ou culturellement, ni, bien sûr, politiquement.
Les Zindigné(e)s : Pourquoi une histoire de l’alimentation ?
Paul Ariès : Notre siècle ne fait pas exception : son principal défi n’est pas la conquête spatiale mais de savoir comment nourrir 8 milliards d’humains sans détruire les écosystèmes. L’histoire aurait dû, à ce sujet, nous vacciner contre une double illusion, hélas meurtrière. Celle selon laquelle la table d’aujourd’hui serait nécessairement mieux que celle d’hier et forcément moins bien que celle de demain. L’histoire de l’alimentation dément cette conception faussement progressiste : on mourait moins de faim dans l’Egypte des pharaons que sous Louis XV, et les mangeurs préhistoriques accédaient à une nourriture plus diversifiée que les Français du XIXe siècle.
Les Zindigné(e)s : Vous avez conscience que vous prenez un peu les lecteurs à contre-pieds…
Paul Ariès : L’histoire de l’alimentation n’est pas celle d’une longue marche triomphante vers un mieux, mais celle de conflits d’usages, avec l’alternative de mutualiser les stocks ou de laisser une minorité se les approprier, ou le choix entre détruire les châtaigneraies pour favoriser les pommes de terre ou le froment, et laisser le peuple vivre bien, à sa façon. En effet, les puissants n’ont pu imposer leur conception de l’agriculture et de l’alimentation qu’en interdisant au plus grand nombre, souvent brutalement, d’autres façons de manger et donc aussi de vivre. Nous ne sommes pas en mesure de dire ce qu’aurait été l’histoire de l’alimentation si ces autres choix populaires avaient été respectés. Les puissants (chefs de tribus, seigneurs, rois, aristocrates, bourgeois capitalistes) ne sont parvenus à leurs fins qu’avec le soutien des religions, et notamment, nous concernant, avec l’appui de l’Eglise catholique, toujours prête à dénoncer les prétentions des pauvres à vouloir manger aussi bien que les riches…Le péché de gula (« gourmandise ») est d’abord une arme de guerre contre les pauvres et non contre les riches.
Les Zindigné(e)s : vous écrivez aussi qu’il faut faire le deuil d’une autre illusion : l’idée que le « progrès technique » et que les innovations en matière agricole seraient à même de répondre aux espoirs.
Paul Ariès : Nos ancêtres se sont bercés de telles illusions depuis les grandes réformes de l’Antiquité jusqu’à la monarchie absolue et la Révolution. La pomme de terre républicaine n’a pas plus émancipé l’humanité que le pain moyenâgeux ou, demain, les biotechnologies alimentaires. Ce n’est pas par hasard si le XIXe siècle « progressiste », dont la mémoire collective n’a retenu que la légende dorée des grands gastronomes, fut un siècle particulièrement noir en matière d’alimentation populaire avec ses projets immondes de nourrir le peuple en utilisant tous les rebuts de l’industrie. Même dans la Grèce antique, les esclaves avaient droit aux délices du vin doux et à des banquets (rarement tout de même) pour honorer leurs morts ! La commensalité eut longtemps pour conséquence de rappeler aux humains qu’ils doivent tous, obligatoirement, manger et boire. Le capitalisme ayant inventé, avec son fonctionnement spécifique de l’argent, une autre équivalence générale entre les choses, Comus et Bacchus se sont trouvés rabaissés, pour ne pas dire simplement désacralisés.
Les Zindigné(e)s : Vous écrivez que faire une histoire de l’alimentation, c’est témoigner de cette profanation du vivant …
Paul Ariès : On peut parler en effet de profanation du vivant lorsque les sociétés ne se pensent plus comme nourricières, lorsque les enrichis ne perçoivent même plus ce qu’il y a d’immoral dans leurs excès et dans la démesure de leurs gaspillages alimentaires (estimés à 40 % de la production), lorsque les dirigeants n’imaginent plus ce que pourraient être des politiques alimentaires, alors que les Anciens avaient su déployer durant des siècles des lois somptuaires pour que les excès des uns ne privent pas les autres, et des lois annonaires pour garantir l’approvisionnement de tous et de chacun. La Révolution française n’est pas née ainsi d’une mauvaise récolte, mais de l’abandon par les puissants de cette « économie morale » que le peuple n’a jamais cessé d’appeler de ses vœux et qu’il appliquait parfois de force lors des réquisitions de grains et des ventes au juste prix.
Les Zindigné(e)s : Pourquoi une histoire politique de l’alimentation ?
Paul Ariès ; L’alimentation a été l’un des domaines où s’est forgée cette dimension humaine à laquelle on donnera bien plus tard le nom de politique. En effet, la politique exista bien avant la démocratie grecque et ses fameux banquets. J’aimerais convaincre le lecteur qu’on peut parler de politiques alimentaires dès la préhistoire et que les choix faits ne furent pas moins intéressés et passionnés que les nôtres. La politique ne naît donc pas avec les premières cités-Etats, comme Babylone, mais avec les grandes chasses, avec le stockage des denrées, avec les premiers banquets végétaux. Cette histoire témoigne d’un bricolage avec parfois des avancées foudroyantes, mais aussi des reculs durables. Ce bricolage a permis de faire vivre quelque chose qui dépasse le cadre des relations familiales, tribales et de simple voisinage. On fera toujours du neuf avec du vieux dans ce domaine, et on bricole à partir d’un « déjà-là ». La commensalité, qui a un sens précis dans le contexte familial, prend ici un autre sens. D’affaire privée, la maîtrise du feu devient l’un des fondements d’une communauté politique qui s’invente, serrée autour d’un commun. Ce n’est d’ailleurs pas tant la communauté qui se serre autour de son feu que ce foyer commun qui crée la communauté, comme ce n’est pas la communauté qui partage un banquet, mais ce banquet qui crée la communauté en tant que corps politique. En même temps, la politique, c’est la constitution de cet espace commun, soustrait aux seules logiques privatives, et la mise au point de modalités particulières de le gérer. La politique fut d’abord une banale affaire alimentaire avant de devenir cette chose abstraite qui exclut le plus grand nombre. Politique, l’apprentissage de la coopération, peut-être déjà au niveau de la cueillette, et, de façon certaine, avec les grandes chasses. Politique, la définition de territoires de cueillette et de chasse à défendre contre d’autres tribus ou contre les prédateurs. Politique, l’apprentissage de la sécurité collective avec la constitution de réserves et l’invention de méthodes variées et efficaces de gestion des stocks alimentaires. Politique, la maîtrise du feu comme fondement des futurs biens communs et des futures cités. Politique, l’invention de la commensalité car elle suppose de faire des choix en matière de répartition des morceaux, mais aussi en termes d’alimentation (ou pas) des plus faibles. Politiques, les premiers repas hospitaliers à la fonction diplomatique certaine ainsi que les premiers banquets funéraires ou sanglants. Que la politique se soit inventée avec des affaires de table, notamment, n’est pas si étonnant puisque la table est, comme la politique, une affaire de mélange (des peuples, des valeurs, des coutumes dans un cas, des arômes, des épices dans l’autre). Les Grecs anciens le savaient bien, qui obligeaient à toujours mélanger son vin avec de l’eau.
Les Zindigné(e)s : Pourquoi une histoire nationale de l’alimentation alors que vous sait passionné par la table chinoise ou hindoue ?
Paul Ariès : Certes, l’histoire de l’alimentation est universelle, mais on ne peut la rendre intelligible qu’en acceptant de la circonscrire dans des territoires à chaque fois particuliers, tant sur les plans climatique, géographique, culturel, social que sur le plan politique. La France, dans son histoire, entretient un rapport spécifique à sa table parce qu’elle est, plus que d’autres, une nation politique. Etudier l’histoire politique française de la table, c’est se donner le maximum de chance de comprendre cet entrelacement du politique et de la nourriture, tel qu’il travaille toutes les sociétés, chacune à sa manière. Convoquer la longue durée, et même la très longue durée, est donc nécessaire puisque la table française reste tributaire des tables antiques bien au-delà du fameux triangle pain-vin-huile et de la tradition des banquets. Ce qui caractérise la table française, c’est ce rapport, toujours continué et renouvelé, entre contenu de l’assiette et politique, entre manières de table et politique, entre (contre-)utopies et politique, et ceci, de l’époque gallo-romaine à celle de l’empire carolingien, de la féodalité à la monarchie absolue, de l’humanisme de la Renaissance à celui de la philosophie des Lumières, de la Révolution de 1789 au xixe siècle, le « siècle noir ».
Les Zindigné(e)s : vous écrivez que le danger aurait été de faire l’histoire politique de l’alimentation des seuls puissants, évacuant ainsi le point de vue, également politique, du peuple sur les affaires de table.
Paul Ariès : Le peuple, loin d’être silencieux, est même plutôt têtu au cours des siècles, allant toujours chercher dans les mêmes directions les solutions aux questions alimentaires… Cette histoire populaire de la table a pourtant toujours été dépréciée, au point de ne retenir que le point de vue des puissants (et des savants), y compris sur des mesures souhaitées et revendiquées par le peuple. Les gens ordinaires n’ont pas principalement souhaité manger la même chose et de la même façon que les puissants, il faudra beaucoup de souffrances pour les faire renoncer à leurs propres conceptions et pratiques de table. La haine des distributions alimentaires gratuites, toujours recommencées depuis la Rome antique, en est un autre bon symptôme.
Les Zindigné(e)s : vous conviez vos lectrices et lecteurs à un très long voyage gastronomique puisqu’il nous conduit jusqu’à la préhistoire où vous évoquez non seulement le contenu de l’alimentation mais aussi la façon de manger. Vous parlez notamment des banquets végétaux bien peu connus. Vous expliquez le passage du paléolithique au néolithique non pas comme une évolution naturelle et pacifique mais comme un coup de force contre les populations indigènes… Pourquoi ce besoin de remonter si loin dans le temps ?
Paul Ariès : j’ai voulu remonter jusqu’à la préhistoire, d’abord par gourmandise, pour déconstruire les idées reçues, mais aussi parce que remonter loin est le meilleur chemin pour parler de demain car cela permet d’entrevoir des invariants.
Les Zindigné(e)s : Vous présentez votre livre à la façon de la vieille table française en proposant, en guise de chapitres, 13 services successifs, mais dans lequel chacun(e) peut puiser à sa guise : les tables préhistoriques, la table mésopotamienne, la table égyptienne, la table grecque, la table romaine, la table gauloise, la table mérovingienne, la table carolingienne, la table clérico-féodale, la table de la monarchie absolue, la table républicaine, la table bourgeoise et enfin les tables industrielles du xxe siècle et du début du xxie siècle. Pouvez-vous pour les lecteurs des Zindigné(e)s nous résumer votre propos ?
Paul Ariès : J’ai pu établir au fil de cette histoire politique de la table que ce qui se joue autour de l’alimentation est autant une histoire d’amour que de désamour de l’humanité. Nos plus anciens ancêtres étaient déjà pleinement des humains au regard de leurs pratiques alimentaires, leur alimentation était beaucoup plus diversifiée qu’on choisit de la croire : ils assaisonnaient les denrées, ils mangeaient des symboles, ils aimaient déjà le gras, ils cuisaient leurs aliments bien avant de maîtriser le feu, ils savaient stocker de façon savante, ils organisaient des festins carnés ou végétaux selon les périodes, des festins funéraires, etc. Tout commença à mal tourner lorsqu’une minorité prétendit être la seule à pouvoir communiquer avec les morts et s’appropria les stocks, les beaux morceaux, les premières boissons enivrantes, excluant le plus grand nombre du droit au banquet. Cette minorité fit des festins autant d’occasions de se jeter des défis, d‘entrer en compétition pour prouver qui dominait les autres. Nos lointains ancêtres ont fait ainsi de la table un enjeu mais aussi un moyen politique. L’humanité, qui a vécu pendant la quasi-totalité de son histoire, de chasse et de cueillette n’était pourtant pas obligée de passer à l’agriculture et il fallut la colonisation de hordes venues de l’est du continent pour que les indigènes se soumettent à ce nouveau mode de vie. Les sociétés protohistoriques qui se développèrent bientôt en Orient n’inventèrent pas le plaisir de la table, mais beaucoup plus banalement la politique faite cuisine et la cuisine faite politique. Le séparatisme alimentaire des puissants ne cessera plus jamais de se développer depuis la constitution des premières cités-Etats, au point que la table prêtée aux dieux dans les légendes n’est qu’une copie des pratiques de table de ceux qui étaient parvenus à dominer les autres. Le pouvoir et la richesse se dirent de façon native à travers des banquets réservés aux puissants mais aussi à travers l’obligation, peu à peu admise, de nourrir à ses frais le petit peuple. Il ne faut pas cependant avoir une vision misérabiliste de l’alimentation du peuple à Sumer, à Babylone, dans la Mésopotamie, qui connurent moins de famines chroniques que la modernité. C’est pourquoi ces civilisations inventèrent toute une grammaire de l’alimentation qui leur subsistera, avec le système des rations ou des champs alimentaires, avec le duo pain/eau puis pain/bière, avec l’opposition croissante entre les aliments des riches et des pauvres.
Les Zindigné(e)s : vous dites que notre alimentation est toujours tributaire de celle de l’antiquité.
Paul Ariès : L’Egypte fut la première civilisation à concevoir sa table comme un véritable langage au point qu’un même hiéroglyphe signifiait manger et parler. On lui doit encore beaucoup de nos symboles alimentaires. La Grèce introduira la notion de partage entre égaux, au point qu’un même mot signifiait manger et partager et que participer au banquet valait citoyenneté. La société qui inventa la démocratie moderne fut celle qui poussa le plus loin possible l’art du banquet, inventant une cuisine du sacrifice, élaborant des rituels. Les façons de passer à table, de s’asseoir ou de se coucher, de découper la viande, de faire circuler la parole avec le vin, de prôner le mélange vin/eau mais aussi d’autres denrées, constituent un langage qui sert à dire que diviser et unir la société se fait dans un même mouvement. La Rome antique hérita bien sûr de la grammaire alimentaire de l’Egypte et de la Grèce, mais elle apportera cependant une dimension essentielle en poussant plus loin la notion de plaisir. La République et l’Empire développeront des politiques alimentaires aux côtés des politiques agricoles, à travers les lois somptuaires limitant les excès de table, à travers aussi le principe des distributions alimentaires qui ne se réduisirent jamais au slogan panem et circenses (« du pain et des jeux »). La grammaire alimentaire, dont nous sommes encore largement les dépositaires, fit un bond considérable durant toute la civilisation romaine avec sa définition du statut politique des aliments, légumes, viandes et pâtisseries avec la pratique du prandium, avec l’importance de la question du pain, avec l’opposition plus politique que culinaire entre grillade, rôti et bouilli. Le convivium romain n’affiche plus certes la dimension politique du symposion grec et les Romains remplaceront le discours sur la frugalité et la simplicité par celui sur l’abondance et le luxe, mais les symboles alimentaires romains sont directement politiques.
Les Zindigné(e)s : J’ai eu le sentiment en vous lisant que les Gaulois savaient déjà dire non à la mal-bouffe...
Paul Ariès : La table gauloise choquera les voyageurs Grecs et Romains tant sa grammaire était différente. La vie politique des différents peuples gaulois était totalement rythmée par l’organisation de grands banquets qui pouvaient durer des semaines et réunir des milliers de convives, tant l’aristocratie avait le devoir non seulement de nourrir sa clientèle (le peuple), mais de gaspiller. Les banquets gaulois ont donc une fonction politique essentielle bien qu’il soit alors interdit de parler politique durant ces agapes et que des magistrats veillaient à cette discipline. Les Gaulois étonneront également Grecs et Romains, pas tant parce qu’ils boivent leur vin pur, mais parce que, bien qu’étant reconnus comme les meilleurs éleveurs et agriculteurs, ils ont toujours choisi de demeurer, parallèlement, des cueilleurs et des chasseurs… Les Romains prendront appui, lors de la conquête des Gaules, sur les riches Gaulois qui adopteront peu ou prou leurs manières de table contre celles que conservera alors le peuple des campagnes. Les « collabos » gaulois comme Ausone se feront les propagandistes de la table romaine créant ainsi un véritable clivage entre l’alimentation des nouvelles élites et celle du peuple.
Les Zindigné(e)s ; vous expliquez que contrairement aux idées reçues l’effondrement de l’Empire romain ne verra pas naître une table « barbare », bien au contraire.
Paul Ariès : La table mérovingienne sera riche et diversifiée grâce à la chasse et à la cueillette qui viendront compléter agréablement et utilement l’agriculture et l’élevage. Les Mérovingiens aimaient manger et boire mais autrement que les Gallo-Romains et les Francs, nouveaux maîtres du pays qui apportèrent avec eux des traditions culinaires assez singulières. La table conserva sa fonction politique comme marqueur identitaire mais aussi par l’organisation de banquets par/pour un roi, d’abord itinérant, traçant ainsi son royaume. Les anciens et les nouveaux maîtres réalisèrent cependant très vite un compromis politique sur le dos du peuple le renvoyant du côté de la barbarie et se réservant le statut de civilisé. Les barbares ne sont plus en effet ceux qui mangent de la viande et boivent du lait, mais ceux qui vivent des forêts, des marais et des landes, bref, également de la cueillette et de la chasse. Certains puissants appartenant à la nouvelle religion chrétienne écrivent alors des traités sur la bonne façon de manger afin de combattre ce qui reste du vieux paganisme gaulois, mais surtout afin de vaincre les hérésies chrétiennes très loin d’être toujours minoritaires en Gaule. L’Eglise va se mettre à prêcher la frugalité au peuple, réservant la gourmandise aux puissants. Sidoine Apollinaire et Anthime se feront même les avocats de la voracité carnée… Un banquet mérovingien sera d’abord le partage d’un cochon, signe d’identité nationale.
Les Zindigné(e)s : je vous sens moins amoureux des tables carolingiennes…
Paul Ariès : Les tables carolingiennes se caractériseront assez vite par l’abandon du principe du roi nourricier (Dieu pourvoit à tout grâce notamment aux aumônes des riches) et par la haine de la chair… Cette christianisation de la table se fera par la répression des traditions alimentaires populaires : le peuple « christianisé » devra cesser de manger quatre fois par jour, il devra accepter de renoncer à désirer des aliments que l’Eglise dit être au-dessus de son rang, il devra bientôt accepter la suprématie, contre laquelle il s’insurgera, du pain contre la viande. « Manger chrétien » est austère du côté des puissants, mais du côté du peuple c’est la misère. La seule exception sera le boire « franc-chrétien » avec l’éloge du bon vin français opposé à la mauvaise bière anglaise.
Les Zindigné(e)s : Vous écrivez que la table qui suit l’époque carolingienne sera une table clérico-féodale reposant sur une dualisation presque complète de la table justifiée par l’Eglise et les médecins.
Paul Ariès : La table servira à dire la puissance du roi et de l’Eglise et la petitesse des gens de peu. L’invention du service à la française sera d’abord conçue comme un dispositif politique. La table clérico-féodale marque le passage du prince nourricier au nouveau prince prédateur. La table de la monarchie absolue sera celle d’un Etat cherchant à assurer son autonomie à l’égard du pape. A la religion gallicane va répondre bientôt l’invention d’une table gallicane fondée sur les contre-modèles que sont les façons espagnoles et britanniques de manger et de boire. Au respect rigide des préceptes de l’Eglise et de sa condamnation de la gula s’opposeront le « manger naturel » et le « manger rationnel » de la Renaissance puis de la philosophie des Lumières. La recherche de la symétrie et de l’esthétique correspond à une sécularisation. La monarchie absolue n’aura de cesse en effet d’inventer la « table absolue » avec de nouveaux produits, mais surtout avec une nouvelle mise en scène savante du repas : le service primera alors longtemps sur la cuisine malgré l’art des sauces et la « pâtisserie architecture ». Cette table « absolue » n’a qu’un seul gros défaut, celui d’abandonner totalement le peuple, en déconstruisant les mécanismes qui permettaient de lui assurer un minimum de subsistances. Le peuple ne cessera jamais de se révolter non pas d’abord parce qu’il avait faim, mais parce qu’il condamnait l’abandon des politiques alimentaires lié au succès des thèses libérales. Le principe de taxation des tarifs ne cessera plus jamais d’être une revendication populaire. La Révolution française s’explique aussi par ce refus de voir disparaître cette économie morale.
Les Zindigné(e)s : vous tirez un bilan ambigüe de la révolution…
Paul Ariès : La révolution tentera d’abord avec/ sous Robespierre de reconnaître le droit à l’existence de chacun, c’est-à-dire d’assurer politiquement, avec les lois sur le maximum, l’approvisionnement alimentaire. On rêve d’une alimentation structurée capable de structurer la pensée, on adopte le repas ternaire, on refuse la cuisine du tiède, celle du mélange car la table doit se faire pédagogique. Thermidor marquera le retour au libéralisme économique et la victoire définitive de la pomme de terre dite faussement « républicaine » contre la châtaigne, emblème d’une alimentation populaire contre laquelle s’élèvent la bonne société bourgeoise et l’Eglise catholique. Le peuple des villes et des campagnes doit trimer pour pouvoir manger et non faire la fête.
Les Zindigné€s : vous écrivez que la table bourgeoise du XIXe siècle sera celle d’un peuple livré aux appétits des gros.
Paul Ariès : Le libéralisme économique couplé à l’aveuglement des élites explique les disettes qui frappent encore la France au xixe siècle et la crise du cheptel français, bien pire qu’ailleurs. Certes, le xixe siècle est l’âge d’or de la table bourgeoise, mais il est encore plus celui des contre-utopies alimentaires, lorsqu’on entend faire manger au peuple des os, avec le soutien constant des plus hautes autorités scientifiques et morales. Le xixe siècle sera celui des falsifications alimentaires que dénoncera Paul Lafargue.
On prônera même de rendre le peuple végétarien pour réduire les coûts de son alimentation et pour le « moraliser ». La grande cuisine prospère, mais comme langage des revanchards, et ce n’est pas par hasard que les grands cuisiniers et gastronomes que ce siècle se donnera furent tous des réactionnaires et des contre-révolutionnaires.
Les Zindigné(€)s : le XXe siècle n’est pas votre plat préféré..
Paul Ariès : Le xxe siècle commence seulement véritablement dans le domaine agricole et alimentaire avec la « révolution verte », c’est-à-dire avec l’adoption d’un modèle industriel. S’il résoudra l’approvisionnement alimentaire de ceux qui feront les Trente Glorieuses (mais cela ne signifie nullement qu’une autre agriculture n’eût pas été déjà possible), ce sera au prix de la fin des paysans, de la destruction des écosystèmes, du pillage du tiers-monde, de la destruction des cultures populaires de la table, et bientôt du retour des grandes peurs alimentaires…
Les Zindigné(e)s : que nous réserve le XIXe siècle ?
Paul Ariès : Le xxie siècle naîtra avec le retour des famines, qui viendront s’ajouter à la malnutrition frappant toujours plus de 1 milliard d’humains, non plus en raison du climat, mais des choix politiques occidentaux d’agriculture et d’alimentation reposant sur l’extractivisme, les pétroaliments, les spéculations sur les matières premières agricoles, la concurrence déloyale d’une agriculture subventionnée au Nord contre celle des petits paysans abandonnés du Sud… L’humanité se trouve donc à la croisée des chemins : soit elle poursuit les tendances actuelles vers toujours plus d’artificialisation des denrées et vers la déstructuration de la table et elle inventera une agriculture sans élevage, grâce aux substituts de viande, et une alimentation sans agriculture digne de ce nom avec la généralisation des fermes verticales, soit elle choisira de reconnaître le droit à la souveraineté alimentaire et développera une véritable agroécologie reposant sur les savoir-faire de 1 milliard et demi de petits paysans. La seule façon d’assurer la transition écologique et donc également l’égalité sociale est de marier des politiques alimentaires qu’il nous faudra réinventer à des politiques agricoles à révolutionner. Nous devons tirer en effet toutes les leçons de l’histoire politique de la table pour compenser la diminution nécessaire du gaspillage énergétique (folie de notre époque : nous consommons 10 calories pour produire une seule calorie alimentaire) par un surcroît de culture. Ce n’est pas par hasard que la table des pays économiquement les plus pauvres est souvent la plus riche sur le plan culturel alors que les nations opulentes ont inventé la junkfood et la malbouffe. Ce choix est éminemment politique car il suppose de repenser la hiérarchie des normes juridiques pour faire toujours primer le droit à l’alimentation (reconnu officiellement dans la Déclaration universelle des droits de l’homme) sur le droit de propriété lucrative, car il exige d’avancer, grâce notamment aux milliards de repas de la restauration sociale, vers une alimentation relocalisée, resaisonnalisée, moins gourmande en eau, moins carnée, assurant la biodiversité, etc. Nous devons reconnaître que les cultures populaires de la table, celles qui subsistent comme celles qu’il faudra bien réinventer, tout comme les cultures paysannes, celles qui viennent du passé comme celles qui émergent, sont au cœur de la fabrique de l’humain. La table est donc bien éminemment politique dans ses deux versants : que mange-t-on ? comment mange-t-on ?, car elle suppose toujours à la fois de dire l’unité dans la division et de construire des communs. Bacchus et Comus doivent donc accéder pleinement à la citoyenneté pour pouvoir demain être à même de nourrir 10 milliards d’humains.
Source : https://www.legrandsoir.info/une-histoire-politique-de-l-...







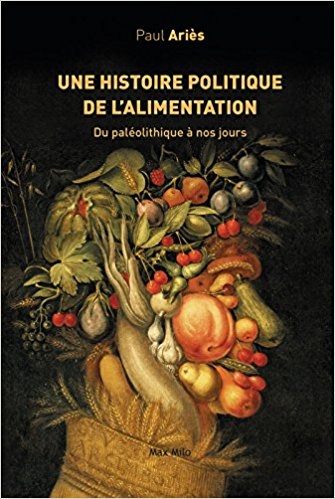






 Murièle Modély est née en 1971 à Saint-Denis, île de la Réunion. Installée à Toulouse depuis une vingtaine d'années, elle écrit depuis toujours, essentiellement de la poésie qu’elle publie régulièrement sur son blog :
Murièle Modély est née en 1971 à Saint-Denis, île de la Réunion. Installée à Toulouse depuis une vingtaine d'années, elle écrit depuis toujours, essentiellement de la poésie qu’elle publie régulièrement sur son blog : 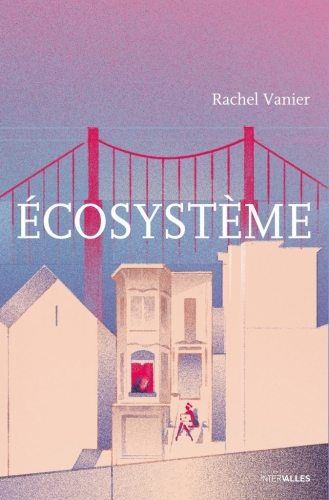
 Rachel Vanier est née à Budapest en 1988. Après avoir grandi à Lille, fait ses études à Paris, s’être échappée à Boston puis avoir crapahuté au Cambodge, elle travaille dans le monde non moins dépaysant de l’innovation et des start-up. Après le remarqué
Rachel Vanier est née à Budapest en 1988. Après avoir grandi à Lille, fait ses études à Paris, s’être échappée à Boston puis avoir crapahuté au Cambodge, elle travaille dans le monde non moins dépaysant de l’innovation et des start-up. Après le remarqué