25/12/2019
Silvano Mello

16:09 Publié dans RÉSONANCES | Lien permanent | Commentaires (0)
20/12/2019
L’œil du paon de Lilia Hassaine
Gallimard, 3 octobre 2019
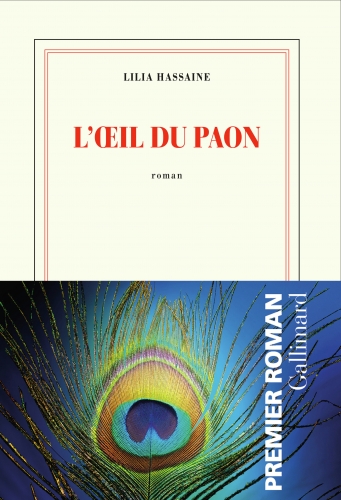
230 pages, 18,50 €.
Très bien écrit, fluide, on se laisse facilement aspirer par L’œil du paon qui trace un portrait acerbe d’un certain milieu parisien plutôt huppé. Dans ce roman qui a quelque chose d’un conte moderne froid et cruel, il y a une esthétique de l’écriture qui tient de la peinture. Il y est d’ailleurs fait mention des tableaux de Hopper, dont l’univers colle assez bien en effet avec l’atmosphère du roman.
Le côté froid, vaniteux, désabusé, à la fois superficiel et pesant de cette vie parisienne, auquel se confronte Héra, la jeune femme, personnage principal du roman, contraste avec la chaleur, la liberté, les couleurs, les parfums de l’île au large de la Croatie, dans laquelle elle a grandi, sorte d’éden à l’abri du monde, peuplé de paons. Oiseau emblématique, délibérément choisi par l’auteur pour ce qu’il évoque : la beauté mais aussi et surtout l’orgueil, caractéristique typiquement humaine, que nous projetons sur lui. Sur cette île où Héra a vécu seule avec son père, gardien de l’île — sa mère étant morte là-bas très prématurément — plane une menaçante légende en lien avec une ancienne abbaye détruite durant les campagnes napoléoniennes.
Lilia Hassaine décortique ses personnages au fil des pages, comme des crevettes qui laisseraient sortir un jus pas toujours appétissant, tout en laissant une part de flou, de mystère, d’inaccessible, car l’humain n’est pas en noir et blanc comme les photographies qu’aime prendre Héra. Chacun est comme absorbé dans son propre monde, ses propres secrets, projetant juste une apparence sur une grande toile de cinéma. La salle reste obscure. Les relations humaines sont tristes, artificielles, le mensonge dissimule le malaise ou pire, nul ne semble être vraiment à sa place mais chacun joue son rôle comme dans un théâtre antique. L’intrigue laisse cependant deviner et c’est dommage, la fin bien trop tôt, mais cela n’empêche pas d’apprécier la lecture quasiment jusqu’au bout. L’œil du paon ayant une originalité certaine que la qualité littéraire de l’ensemble sert au mieux.
L’auteur parvient à ne rendre aucun de ses personnages réellement attachant, ce qui traduit bien l’angoisse sourde qui coule en-dessous de la trame comme un égout. Ici l’humanité est un condensé de tentatives avortés dans une quête de beauté, de perfection, inaccessibles car toujours extérieures à elle. Et puis il y a Hugo, l’unique enfant au centre de la toile, terriblement seul dans un vide qui ne tient plus que par quelques apparences et une bonne dose de cynisme. Quelle place ici pour la fraîcheur, l’innocence ?
L’œil du paon est un premier roman, que l’on peut qualifier de prometteur.
Cathy Garcia
 Lilia Hassaine est journaliste, diplômée en 2015 de l’Institut Français de Presse. Par la suite, elle effectue de nombreux stages dans la presse écrite, notamment pour Le Parisien et à la télévision pour la chaîne Arte, avant de se faire remarquer grâce à son web-documentaire De mèche contre le cancer où elle traite du don de cheveux. En parallèle, elle intègre le groupe TF1 où elle officie en tant que journaliste avant de rejoindre l’équipe de l’émission Quotidien en janvier 2016, équipe qu’elle a quitté pour écrire ce premier roman.
Lilia Hassaine est journaliste, diplômée en 2015 de l’Institut Français de Presse. Par la suite, elle effectue de nombreux stages dans la presse écrite, notamment pour Le Parisien et à la télévision pour la chaîne Arte, avant de se faire remarquer grâce à son web-documentaire De mèche contre le cancer où elle traite du don de cheveux. En parallèle, elle intègre le groupe TF1 où elle officie en tant que journaliste avant de rejoindre l’équipe de l’émission Quotidien en janvier 2016, équipe qu’elle a quitté pour écrire ce premier roman.
13:34 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
16/12/2019
Le soleil sur ma tête (O sol na cabeça) de Geovani Martins
traduit du portugais (Brésil) par Matthieu Dosse
Gallimard 17 octobre 2019

135 pages, 15 €.
« – C’est parce-que le monde entier est foncedé, frère. Comme si tu ne savais pas ça. Je te le répète : une semaine sans came et tout Rio de Janeiro s’arrête. Plus de médecins, plus de chauffeurs de bus, plus d’avocats, plus de policiers, plus d’éboueurs, plus rien. Tout le monde va devenir ouf à cause de l’abstinence. Cocaïne, Rivotril, LSD, ecstasy, crack, cannabis, antidouleurs, peu importe, frère. La came c’est le combustible de la ville. (…)
– La came et la peur, j’ai ajouté.»
Ceci n’est pas un livre qui parle des favelas de Rio, ce sont les favelas qui y prennent la parole et donnent à voir une autre image, bien plus réelle, de cette ville qui fait rêver avec sa façade de carte postale, ses plages faussement paradisiaques, son carnaval à paillettes, sa samba perpétuelle. Rio de Janeiro a un autre visage, un visage balafré par la violence, fille bâtarde de l’exclusion sociale, un visage recouvert de la poussière humaine déposée par les exodes ruraux, populations nordestines et d’ailleurs, fuyant l’aridité extrême de leur existence et dont les espoirs s’échouent dans les quartiers nord et les bidonvilles nommés ici favelas, en mémoire d’une fleur qui pousse – poussait ? - sur les mornes abrupts qui dominent la ville. Visage cependant non dénué de beauté et capable de séduire par sa force et sa vivacité.
Dans ces favelas, génération après génération, grandissent des enfants, des adolescents, pour qui l’avenir offre peu de perspectives. Geovani Martins est de ceux là, de ces enfants qui vivent dans la pauvreté excentrée et dont le quotidien est à la fois bousculé et balisé par la violence des trafics de drogue et celle de la police très corrompue. Dans ces zones que se disputent les factions rivales, ce sont les habitants toujours qui en prennent plein la gueule, les balles qui sifflent et les cadavres au petit matin rythment leur quotidien déjà difficile.
Pour la jeunesse, assignée à faire le guet dès son plus jeune âge pour les dealers, il n’y a que l’amitié, le rire, la fête, les virées à la plage où le touriste inconscient se fait régulièrement dépouiller, pour faire la nique à la mort, au plomb de leur vie mal barrée. Les joints, les acides, la coke, les ecstas, le lança perfume — une drogue à base d'éther très en vogue au Brésil depuis des décennies, au départ comme accessoire de carnaval — tout est bon même si pas bon, pour s’évader et s’amuser. La défonce devient le dénominateur commun de la jeunesse du monde entier, mais ici la pente est raide et rapidement sans-retour. L’enfer est facile d’accès et ceux qui touchent au crack en reviennent rarement. Mais dans Le soleil sur ma tête, Geovani Martins ne fait pas dans le pathos, le sensationnel, il parle simplement et avec talent de ce qu’il connait. Il raconte une jeunesse comme n’importe quelle jeunesse, qui a juste besoin de vivre et de mettre des coups de bombes de couleur à une existence qui sent trop vite l’égout.
L’auteur trempe sa plume dans une encre désabusée mais légère cependant et sensible, le ton est lucide, direct, plein d’humour, de fraîcheur malgré la fièvre de cette ville folle et l’horizon bouché et la langue utilisée est celle de la rue, pas de prise de distance, la littérature est là aussi : dans ce bouillon de la langue populaire.
Geovani Martins est de ceux qui savent la débrouille et le rire envers et contre tout. Cette joie inconditionnelle qui est un passeport pour la survie et l’énergie d’une jeunesse défavorisée qui ne part pas perdante pour autant. Certains s’en sortent, armés pour la vie par des expériences fortes et des difficultés qui les obligent à être plus malins que la mort. Les favelas elles-mêmes peuvent devenir des centres qui produisent leur propre énergie culturelle et économique. Les possibles ressuscitent encore et encore, malgré tout.
Treize nouvelles qui vous font passer là où nul touriste n’est censé se promener, treize nouvelles qui évoquent le quotidien de ces cariocas qui n’apparaissent pas sur les cartes postales, la vie sans paillettes des laissés pour compte d’une des villes les plus inégalitaires au monde. La vie telle qu’elle vient jour après jour et telle qu’il faut faire avec. Et puis la magie aussi, la magie de la macumba, de tous les sangs mêlés, les légendes urbaines, tout un univers populaire carioca haut en couleurs auquel l’auteur donne la dimension qu’il mérite, dans la lignée prometteuse d’un Jorge Amado version XXIe siècle.
Treize nouvelles d’un réel non coupé, d’un pur réel sur la corde raide avec le vide de chaque côté.
Cathy Garcia
 Né en 1991 à Bangu, une favela de la périphérie ouest de Rio de Janeiro, Geovani Martins déménage en 2004, avec sa mère et ses frères à Vidigal, dans la Zona Sul : autre favela, autres règles, autre monde. Le choc provoqué par ce déménagement fut la genèse de chacune de ces treize nouvelles. C’est lors d’une journée en garde à vue, faute d’autre occupation, que découvrant l’œuvre du romancier Roberto Drummond, il prend goût à l’écriture. Après des années de petits boulots et une tentative d'écrire un roman, il travaille à écrire des nouvelles sur une machine à écrire offerte par sa famille et présente son premier recueil à un salon en mars 2017. Il devient un modèle local avec ce premier livre qui connaîtra un grand succès au Brésil avant même d'être publié.
Né en 1991 à Bangu, une favela de la périphérie ouest de Rio de Janeiro, Geovani Martins déménage en 2004, avec sa mère et ses frères à Vidigal, dans la Zona Sul : autre favela, autres règles, autre monde. Le choc provoqué par ce déménagement fut la genèse de chacune de ces treize nouvelles. C’est lors d’une journée en garde à vue, faute d’autre occupation, que découvrant l’œuvre du romancier Roberto Drummond, il prend goût à l’écriture. Après des années de petits boulots et une tentative d'écrire un roman, il travaille à écrire des nouvelles sur une machine à écrire offerte par sa famille et présente son premier recueil à un salon en mars 2017. Il devient un modèle local avec ce premier livre qui connaîtra un grand succès au Brésil avant même d'être publié.
16:39 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
15/12/2019
Le dernier grenadier du monde de Bakhtiar Ali
traduit du kurde sorani par Sandrine Traïdia
Métailié éd., 29 août 2019

336 pages, 22 €.
« Au-dessus de sa tête, il voit les branches d’un grenadier. Il entend le bruit de la destruction et de la pulvérisation des objets, il a entendu parler de la poussière mortelle de verre que le vent répand la nuit sur le monde. »
Un roman bien déstabilisant que nous offre ici cet auteur d’origine kurde, un roman dont le rythme et la narration est tout à fait atypique pour un lecteur occidental, comme une litanie qui s’étire, se distend, se ressasse par des répétitions, comme un conteur qui aurait un peu perdu la tête, une sorte d’errance littéraire traversée de fulgurances d’une beauté telle, que le livre reste collé aux mains du lecteur.
« Regardez, toutes les histoires sont comme un tout petit ruisseau qui, à la fin, vient se jeter dans la vaste mer, riche de milliers d’autres histoires… Et chaque fois qu’un conteur meurt en chemin, il faut qu’un autre conteur prenne sa place et que, rivière après rivière et mer après mer, il poursuive cette histoire. »
Mouzaffar Soubdhdam est un ancien officier supérieur peshmerga que l’on sort soudain de vingt et un an d’emprisonnement et d’isolement quelque part dans le désert. Il s’était livré pour sauver son meilleur ami, un légendaire chef révolutionnaire kurde. Libéré, il est emmené dans un palais vide entouré d’un immense jardin, qui appartient à cet ancien ami qui a bien changé et là il se retrouve isolé à nouveau, mais cette fois, il refuse cette réclusion, aussi dorée soit-elle.
Il a besoin de savoir, de comprendre ce qu’est devenu son pays et aussi de retrouver son fils Saryas Soubdham, son fils qu’il n’a jamais connu. Cette quête lui fait parcourir un pays méconnaissable, que les guerres ont miné de toutes parts et il découvre en chemin, qu’il n’existe pas un seul Saryas Soubdham, mais plusieurs : trois garçons du même âge, portant le même nom, qui n’ont pas vécu au même endroit mais qui sont reliés par un fil énigmatique. Un fil, un arbre — le dernier grenadier du monde — et trois fragiles grenades de verre.
Trois vies défigurées.
« (…) l’histoire des Saryas, du début à la fin, qu’elle que soit la couleur qu’elle prenne, quel que soit le chemin qu’elle emprunte, n’échapperait pas au fait qu’elle est l’histoire de tous ceux qui se sont retrouvés abandonnés sur cette terre au-milieu des tourbillons de poussière. »
Et Mouzaffar Soubdhdam raconte, raconte inlassablement son histoire et surtout ce qu’il a pu découvrir de celle de ces trois Saryas et des personnages que chacun d’eux a rajouté à la trame, dont deux sœurs étranges, les sœurs Spi, qui ont fait un pacte avec l’un d’eux, après avoir fait longtemps avant, un pacte entre elles.
« Lawlaw Spi et Chadarya Spi s’étaient fait très jeunes le serment éternel de ne jamais se marier de leur vie, de ne jamais se couper les cheveux, de ne jamais chanter l’une sans l’autre et de ne porter que des robes blanches. »
Et quand Mouzaffar raconte, c’est la nuit sur une embarcation en plein milieu de la Méditerranée, une parmi ces centaines et centaines qui se jettent sur l’eau à destination de l’Europe.
Le dernier grenadier du monde est un roman indescriptible, poétique, tragique, lancinant, comme une lente, très lente traversée d’un espace mélancolique et interminable, celui d’une humanité désertée de toute possibilité d’avenir, une humanité corrompue et détruite de l’intérieur par sa propre folie.
« Les grandes catastrophes donnent à la vie un cours qu’il n’est plus possible de remanier par la suite. (…) Une nuit, nous nous sommes réveillés et nous avons vu qu’il ne restait plus un carré de ciel au-dessus de nos têtes. Nous avons fui sur les ossements et sur les crânes de nos amis. »
Le dernier grenadier du monde est l’histoire de tous les innocents broyés par cette folie, l’histoire de tous les enfants renversés par les guerres et sur la nécessité, l’impérieuse nécessité cependant d’un amour fou, un amour qui n’abandonne jamais. Et le long tissu de la langue qui se déroule, avec ces motifs qui se répètent encore et encore, est comme un voile de pudeur qui revêt la trop brutale réalité.
Et puis il y a cet arbre, cet arbre légendaire et salvateur que trois adolescents, perdus dans une de « ces nuits où la réalité enfonce ses dents les plus laides dans le corps de l’homme », peuvent atteindre.
« (…) le dernier grenadier du monde, ce grenadier était le seul représentant de leurs rêves, à la frontière qui se trouve entre le ciel et la terre, ce rêve auquel ils ne pouvaient pas donner de nom, le rêve d’une compréhension mutuelle entre les hommes, les frères et les ennemis. »
Quand les pères sont happés par le tumulte et la violence de l’Histoire, les fils errent en aveugle.
« Cette nuit-là je compris les malheurs que la disparition et l’impréparation d’un homme pouvait causer. Je compris combien était grande, étrange et importante la place de l’homme sur cette terre. L’homme qui, une fois qu’il est né, laisse pour toujours des traces claires dans la vie des autres. La vie n’est rien d’autre qu’une chaîne éternelle, continue, ininterrompue.»
« Je sais que l’homme est un être pour qui les chemins se brouillent vite, je sais que l’homme ne trouve pas les chemins. Aucun être sur terre ne perd autant sa route que l’homme… »
Et cette histoire, c’est donc aussi la nôtre et « c’est un sale temps, une époque dont l‘odeur n’est pas meilleure que celle du cul d’un âne. » et c’est cependant envers et contre tout, un message d’espoir que porte Mouzaffar Soubdham, un message qui espère illuminer cette longue nuit noire de l’humanité perdue.
« Non, ne dites pas que nous sommes fatigués de cette mer et ne demandez pas jusqu’à quand nous devrons tourner en rond sur cette mer. Demandez-moi pourquoi je suis devenu comme le prophète des souffrances. Pendant vingt et un ans, jour et nuit, j’ai regardé le désert de ma fenêtre et je l’ai appelé à l’aide. Depuis cette fenêtre, j’ai vu quelque chose. Une chose sans laquelle je n’aurais pas survécu… Depuis cette fenêtre, j’ai vu le bonheur du désert, j’ai vu le jeu entre le sable et la lumière. Si, durant ces vingt et un ans, je n’avais pas cru voir une beauté immense et infinie dans ce sable, je m’y serais noyé. Jusqu’à son dernier souffle, jusqu’après sa mort même, l’homme ne doit pas perdre la foi dans son bonheur, il ne doit pas perdre la foi en la beauté… Non je ne suis pas un homme à deux visages. Moi aussi, comme chacun de vous, j’ai crié de tout mon cœur contre toutes les absurdités. Moi aussi j’étais très désespéré. Souvent, j’ai été vaincu, je me suis incliné et j’ai été anéanti. Mais je parle de la lumière qui jaillit après tout désespoir. »
Cathy Garcia
 Bakhtiar ALI est né à Sulaimaniya, dans le Kurdistan irakien, en 1966. Il est devenu un romancier important dans les années 90. Ses livres sont des best-sellers en Iran et en Irak, il a reçu de nombreux prix littéraires au Moyen-Orient. Il est un des auteurs kurdes contemporains les plus connus. Il vit à Cologne depuis 1998. Il est traduit en farsi, en anglais, en allemand, en italien et en arabe.
Bakhtiar ALI est né à Sulaimaniya, dans le Kurdistan irakien, en 1966. Il est devenu un romancier important dans les années 90. Ses livres sont des best-sellers en Iran et en Irak, il a reçu de nombreux prix littéraires au Moyen-Orient. Il est un des auteurs kurdes contemporains les plus connus. Il vit à Cologne depuis 1998. Il est traduit en farsi, en anglais, en allemand, en italien et en arabe.
22:54 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
11/12/2019
CROISSANCE : 2 % AVANT LA FIN DU MONDE
"En tant que jeunes ingénieurs on nous répète que le progrès technique et la croissance sont les solutions aux problèmes de notre société. Face à la crise écologique comment peut-on continuer à croire que l'innovation rendra la croissance infinie possible ? Le paradigme de la croissance du PIB et le mythe du progrès technique font parti du discours dominant dans les sociétés capitalistes, pourtant nous constatons un manque de recul critique à l'égard de l'innovation. Les interviews de ce documentaire présentent une réflexion nécessaire sur la neutralité de la technique, les limites physiques de notre planète et les choix structurants d'organisation de la société. Et si les solutions étaient politiques plutôt que techniques ? --------------------------------
Une réalisation associative : Ingénieur·e·s Engagé·e·s Lyon, La Mouette, Objectif21 Avec la participation de : Monsieur Bidouille, Philippe Bihouix, Alexandre Monnin, Baptiste Mylondo, Baptiste Nominé et Clément Poudret. Les interviews complètes de chaque intervenant seront publiées plus tard sur cette chaîne ! Peertube : https://pe.ertu.be/videos/watch/667c2...
Mastodon : @docu@pe.ertu.be Nous contacter : ie.contact@asso-insa-lyon.fr"
21:37 Publié dans ALTERNATIVES, RÉSONANCES | Lien permanent | Commentaires (0)
Interview de Mathieu Rigouste, sociologue et essayiste le 13/02/2018
10:08 Publié dans COMPRENDRE LE MONDE | Lien permanent | Commentaires (0)
10/12/2019
Kalushi: The Story of Solomon Mahlangu de Mandla Dube (2017)
Basé sur un fait vécu, Kalushi relate l’histoire de Solomon Mahlangu, un marchand ambulant de dix-neuf ans issu des rues de Mamelodi, un ghetto situé en marge de Pretoria, en Afrique du Sud. Brutalement battu par la police, Kalushi s’exile pour joindre le mouvement de libération à la suite des émeutes de Soweto en 1976. Alors que lui et son camarade Mondy revenaient d’une formation militaire à Angola, en route vers leur lieu d’assignation, Mondy perd le contrôle et tire sur deux innocents sur la rue Goch, à Johannesburg. Mondy est violemment battu et torturé tandis que Kalushi fait l’objet d’un procès régi par la doctrine de la communauté d’intérêts. L’État se prononce en faveur d’une mort par pendaison, la sentence la plus sévère qui soit. Adossé contre le mur, Kalushi utilise la salle d’audience comme dernier champ de bataille. Son sacrifice fera de lui un héros de guerre et une figure marquante des événements du 16 juin 1976, connue sur la scène internationale.
23:08 Publié dans FILMS & DOCUMENTAIRES A VOIR & A REVOIR | Lien permanent | Commentaires (0)
08/12/2019
La garde de nuit (enfer hospitalier) Acte I
- 8 déc. 2019
- Par LAURENT THINES
- Blog : Le blog de LAURENT THINES
Prologue
Quand le dragon vole.
Long soir d’été.
Un dragon insomniaque, déterminé, détonnant et oblong, escarboucle lumineuse au front, escalade en flammes rouges et vertes l’à-pic de mon jardin d’étoiles pour mieux se précipiter à l’assaut du fleuve.
Tournesol guerrier saigné au flanc, il tourne ses pétales au son doux et velouté d’un elfe crachant lentement sa soupe de lamier blanc.
Il découpe de ses pales sombres la voie lactée qui retombe en goutte-à-goutte d’étoiles filantes dans les veines de l’être qu’il porte au ventre, bien loin du sol, au delà de la forêt des ombres.
Cette âme pâle et souffrante, heurtée et paralysée comme cette lune d’été, il l’a gobée sur la plaine, au milieu des tôles froissées. Il la régurgitera bientôt sur l’esplanade ronde de la Tour des miracles.
Ici, l’air du soir, à nouveau calme, se recouche. La Garde veillera d’un œil intranquille sur le silence des remparts de ma nuit.
Au cœur de mes rêves, l’écran s’embrase de bleu et alors monte l’alerte…
Premier Acte :
La pierre
La Tour
Informe architecturale, elle trône tel une diva sous sa peau criblée par le vitriol des ans. Neuf bourrelets de souffrance étagée seyant sur un fondement au sous-sol sismique.
Dans ses entrailles grises ou colorées, presque désamiantées, des trachées artères pompent de leurs plèvres cancéreuses un air retraité, qu’elles exsufflent par leurs gueules grillagées.
Des veines translucides ramènent, par pulsations rythmées, les capsules de sang étiquetées vers le cœur du laboratoire de la méga cité.
Des barges, poussées par des cygnes bleus, portent les malades et glissent, au flux péristaltique des canaux hospitaliers, aux mains de gondoliers asservis à leurs tablettes connectées.
Sur les berges escarpées, on observe la ronde perpétuelle des spectres d’humanité - rose morose, verte de rage, blanche de saignée - qui filent au rythme des machines à pointer. Âmes garrotées puis vidées de leur vocation, encloîtrées entre leur vœu d’Hospitalité et la boulimie de la bête à rentabilité.
Pourtant, aux parois de ses boyaux sombres, on voit encore flamboyer quelques torches de générosité. En ombres chinoises, donneurs et greffés, main dans la main, échangent leurs amitiés, dans une dernière valse de fraternité.
Ainsi, sous les emblèmes d’Eros et Thanatos réunis, la Tour domine tout : ses saigneurs et ses serfs, ses remparts et ses tourelles. De Planoise en contrebas, toute une volée de passerelles rampe sur son pas.
Les cheminées d’évacuation et les feux sentinelles fument au toit. Aux alentours, les odeurs de chair humaine se mêlent à celles du bois.
Et au crépuscule, le vol immobile d’une crécerelle sonne le glas.
Princes du sang
A la table ronde des conciliabules pluridisciplinaires, sous leurs armoiries de bistouris ou de cathéters, les saigneurs s’affrontent en joutes orales passionnées, défendent leur maison ou leur chapelle puis transigent avant de partir avec leur ost pour la bataille.
--- Leurs campagnes : rebâtir les canaux vasculaires, lutter contre l’extravasation et dégorger les plaines inondées ; éventrer les barrages ischémiques, libérer le flux artériel des fleuves et irriguer les aires cérébrales asséchées
--- Leurs gloires : ligaturer les vouivres anévrysmales, sauver les noyés des lacs sanguinaires, décapiter les hydres artério-veineuses, étouffer les guivres fistuleuses.
--- Leur Sainte Mission: préserver nos corps de l’hémorragie en refondant notre calice vasculaire.
--- Leur Saint Graal : vaincre la Maladie, sans verser le sang des blessés ou des morts.
Ici, je suis.
Ici, je suis chevalier Hospitalier, moine soldat, mercenaire, vassal, dans l’allégeance à la Tour.
Ici, je sais écrire, trancher et recoudre, publier les bans, convoquer l’ost, mener mes troupes, faire fructifier mon fief, et par dessus tout, offrir ma vie au champ de bataille hospitalier.
Ici, je porte encore l’exhaustion de ces années de combats larvés pour une victoire acérée sur les terres d’un prince noir. Perfidement adoubé chevalier puis homme-lige. Dans l’Immixtio manuum, vassal aux mains choyées. In fine, féal aux doigts broyés, désavoué sous le miroir brisé, emprisonné dans le vertige des arcanes d’une autre Tour.
L’honneur en étendard et l’exil pour seule survie, je m’exfiltrai in extremis.
Ici, je suis le chevalier errant, le vainqueur inféodé venu du Nord, et personne n’imagine le trésor d’énergie vitale dont il m’avait déjà patiemment spolié.
Chaque matin
Mains heureuses d’enfant joueur qui, dans le jardin des salles opératoires, font voler des papillons en papier d’emballage stérile.
Puis la matière pensante de mon cerveau, par ces mains prolongée, opère d’autres cerveaux - éveillés.
Artisan de l’humain (neuro-chir-urgien)
Mains fermes de forgerons, elles empoignent, frappent et soudent le titaneaux colonnes écroulées. Mains calleuses de menuisier, elles redressent, chevillent et vissent le bois des nuques brisées. Mains appliquées de tuyauteur, elles détectent, calfatent et tarissent les fuites de liquide méningé. Mains blanches de mosaïste, elles récupèrent, réassemblent et jointent les puzzles de crânes éparpillés.
Mains agiles de poissonnier, elles ligaturent, sectionnent et enlèvent leurs tentacules aux hydres vasculaires. Mains féroces de volailler, elles saisissent, étranglent et asphyxient au col les crêtes anévrismales. Mains tranchantes d’équarrisseur, elles excisent, parent et ficellent les chefs aux chairs scalpées. Mains rouges de boucher, elles taillent, désossent et s’essuient au bleu des tabliers.
Mains savantes de puisatier, elles forent, pompent et drainent le fluide des nappes sous-crâniennes. Mains vigiles d’aiguadier, elles dérivent, vident et assèchent de leur sang les zones inondées. Mains créatrices et architectes, elles dessinent, déroutent et aqueduquent le cœur aux hémisphères abandonnés. Mains bleues de fontainier, elles ponctionnent, guident et recueillent l’eau de roche à la source des lombes.
Mains têtues de maraicher, elles séparent, coupent et cueillent des méningiomes gros comme des oranges. Mains soigneuses d’horticulteur, elles visent, greffent et plantent des électrodes aux noyaux gris des cerveaux. Mains cloquées de cantonnier, elles creusent, élargissent et égalisent l’os arthrosique des canaux rachidiens. Mains vertes de jardinier, elles traitent, élaguent et déracinent les ramées de gliomes cancéreux.
Mains douces de coiffeuse, elles peignent, rasent et tressent au cuir les cheveux horripilés. Mains patientes de couturière, elles découpent, cousent et rapiècent de Goretex les méninges déchirées. Mains ciseleuses de joaillière, elles assemblent et attachent des colliers de veines au cou des artères. Mains mauves de lavandières, elles lavent, rincent et essorent aux soleils scialytiques les têtes de leurs victimes.
Mains charcutières dans le ventre de la bête.
Mains ouvrières dans le rouage de la machine.
Mains téméraires dans les tréfonds de la Tour.
L’apprenti sourcier
Deux êtres tremblants, chacun dans leur tranchée, de chaque côté du lit de la rivière blanche qui les sépare. Face tournée au sol, le patient courbe l’échine, se recroqueville en serrant son coussin de misère sur ses dents. L’apprenti sourcier, lui, officie nerveusement et calcule sa trajectoire, méticuleusement.
Une bise glaciale s’abat alors sur la plaine des reins. Tressaillement dans les rangs, au premier bataillon antiseptique. Un drapeau bleu perforé a été déployé. Au centre, on aperçoit une clairière, rose comme un champ de bataille. Cercle d’effroi dans les lombes qui délimite la cible. Raidissement, au deuxième bataillon antiseptique.
Palpation appuyée d’une phalange, humide sous les gants, qui fouille profondément les ligaments. On énumère les épineuses questions. Où est la moelle ? Où trouver la voie ? Où créer la brèche ?
Puis, l’alerte d’une attaque par le ciel et la peur sur les deux fronts. Derrière celui du patient, sonnent les clairons de son instinct de survie. Se réfugier dans les galeries de son courage. Se boucher les oreilles. Fermer les yeux. Serrer les dents. Serrer les poings. Et attendre…
Le bâton aiguisé et brillant de l’apprenti sourcier tremble, tremble, tremble sous la lune pâle. Il lui indique le chemin de la source. Soudain dans le bas du dos de son patient, comme la trace stridente et acérée d’une flèche brûlante. Spasme des muscles paravertébraux suivi d’un fin craquement d’outre.
Ses yeux s’éclairent alors. Son cœur ralentit. Entre ses doigts, la joie fleurit. Dans les mains du nouveau sourcier, l’eau de roche jaillit, pure. De l’autre côté du champ de bataille, on attend encore inquiet l’annonce du cessez-le-feu par l’arrachement de terre, dans un dernier trismus, de l’étendard de la victoire.
Enfin, on pansera la plaie punctiforme du blessé.
Le chêne sacré
Elle est là, qui attend tremblante, comme la frondaison sous le vent mauvais, à l’heure du rendez-vous d’annonce.
Elle est là, qui angoisse au creux de ses cernes pour son Homme à l’écorce du crâne scarifiée. Elle pressent le Mal qui lui ronge la cervelle, comme la vermine dans l’aubier.
Lui, le grand abatteur d’arbres, autrefois libre comme la forêt comtoise, autrefois puissant comme le chêne millénaire, et à présent, posé las, à son tour, branche ballante, racines instables, fibres cérébrales entaillées, dans ce corps qui penche et menace, comme un arbre vermoulu, sous la cognée du cancer.
Elle est là, qui s’effondre au coup vil asséné par le coin de la sentence diagnostique: glioblastome, la gale du cerveau qui pousse et poussera son Homme au chablis. Condamnation à perpétuité.
Elle est là, qui pleure à nouveau la sève amère, infiltrée dans ses veines depuis la mort du petit, noyé durant trente trois lunes, autre cher de sa chair, tombé et rongé avant elle.
Dans le désespoir, je serre son bois de cœur, tendre et sombre, dans ma main, et nous buvons sa douleur à l’ombre du grand chêne.
Sur le fil
Encore une journée qui s’achève, dans le bonheur masochiste de ne pas avoir encore touché un seul instant le sol.
Imprudent funambule que je suis, en équilibre, toujours instable, sur le fil à couper le bord de ma vie, tendue au travers du gouffre hospitalier.
Encore une journée qui m‘achève.
Laurent Thines
(qu'on peut lire aussi dans le dernier n° de la revue Nouveaux délits, le 64)
21:09 Publié dans LA REVUE NOUVEAUX DELITS, RÉSONANCES | Lien permanent | Commentaires (0)
01/12/2019
Avalé avalant par Laurent Albarracin
https://revuecatastrophes.wordpress.com/2019/11/29/avale-...
.
.
Il se pourrait que le poète fût une sorte de Jonas, une sorte de prophète empêché de prophétie, qui n’ait plus rien à révéler de l’avenir aux hommes, et pour cause : il n’y a plus de dieu, plus de mission, plus de châtiment, plus d’avenir non plus ni d’absence d’avenir d’ailleurs mais un éternel présent, à la fois catastrophique et habitable, tout ensemble désastreux et confortable. Un Jonas, parce qu’il est un prophète en exil dans le cœur du présent, et parce qu’il trouve son refuge au sein du danger même, dans la gueule accueillante du grand poisson. Le poète est un renverseur de signes.
Enfermé volontaire, emprisonné satisfait, il a troqué la tour d’ivoire pour la baleine blanche et sombre. À la position de surplomb au dessus de la mêlée, il préfère se lover dans chacun des nœuds de l’emmêlement général, dans le cœur intime et obscur des choses dont il explore indéfiniment l’intimité foisonnante. Gaston Bachelard fait de Jonas la figure même du rêveur d’intimité [1]. Il est celui qui se repose et qui, se reposant, se nourrit, s’agrandit de songes. Il vit chaudement les intériorités. S’ouvre alors à lui l’horizon de la profondeur. Il ne connaît qu’un infini, celui des poupées gigognes. Il a devant lui une seule immensité, celle des emboîtements sans fin. Jeté dans le ventre du monstre, il en est paradoxalement protégé ; il jouit d’une protection maximale et absolue (car elle est paradoxale) et il récupère en quelque sorte sa force de digestion et d’assimilation. Nombre de poètes ont rêvé cette situation de dévoré heureux baignant dans un liquide amniotique et ce prestige de l’avalé avalant, avatar positif de l’arroseur arrosé. Être heureux, c’est précisément jouir d’une intimité qu’on transforme à volonté en vastitude qu’on métabolise, au sens digestif. Ainsi de Jean-Paul de Dadelsen :
Autour de nos reins les parois de la nuit sont rondes et sonores.
Dans la rumeur des artères heureuses et du sang contenté le cœur
Écoute s’ouvrir l’espace intérieur.
Les yeux fermés, regarde, telle une image dans une eau sombre,
À l’inverse de la fuite des mondes tournoyer des constellations obscures
Sous les voûtes de notre sang.
Les ténèbres du temple charnel sont vastes comme les profondeurs des cieux. [2]
Exemple parmi tant d’autres d’un avalement heureux, de l’exploration d’une intériorité océanique. Être avalé tel Jonas, c’est être pris dans un processus sans fin d’avalement, et c’est se faire soi-même avalant, avaleur. Ce n’est pas seulement être mangé, c’est aussi devenir peu à peu le mangeur, c’est participer à la lente rumination des mondes qui se fait dans toutes les intimités heureuses. Être contenu, c’est être inséré dans une chaîne continue de contenance, dans un emboîtement généralisé. Comme si être dedans les choses, c’était se découvrir au seuil d’un dedans infiniment répété, dont chacun recommence la promesse de bonheur.
Jonas est celui qui change une hostilité en une hospitalité. C’est aussi celui qui, par son inaction, par sa situation d’empêchement, est en état de réceptivité maximale. Jonas nous rappelle qu’il y a des passivités fécondes, des attentes génératrices, des végétativités nourricières, des rêveries dont on se relève rien de moins qu’accouché.
.
Accéder au sommaire
Télécharger le pdf complet de Catastrophes 22
.
[1] Cf. « Le complexe de Jonas », in La Terre et les rêveries du repos, José Corti, 1992, p. 129 sq.
[2] Jean-Paul de Dadelsen, Jonas, Poésie/Gallimard, 2005, p. 54.
13:54 Publié dans RÉSONANCES | Lien permanent | Commentaires (0)



