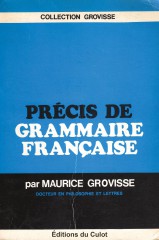Une suite d’informations, d’observations ou de faits glanés au fil de mes lectures, de la vie et de ses hasards. Je les propose de manière brute, sans commentaires, car les choses me semblent parfois parler d’elles-mêmes, ou par les résonances et les échos provenant de leur simple mise en miroir.
Selon une étude de l’ONG Oxfam, les 67 personnes les plus riches de la planète détiendraient autant que les 3,5 milliards les plus pauvres.
Aux États-Unis, depuis le début de la crise, 95 % du peu de croissance créée a été accaparé par les 1 % les plus riches.
Lorsqu’ils collent un mot sur le rideau de fer du magasin afin d’expliquer une fermeture exceptionnelle, les propriétaires du petit bazar en bas de chez moi, qui ne sont que deux (mari et femme) prennent toujours le soin de signer « La direction ».
Vue à la télé, une adolescente expliquant que son seul rêve dans la vie serait de pouvoir dépenser sans compter.
Le traité de libre-échange transatlantique, en cours de discussion dans le plus grand secret entre les États-Unis et l’Union Européenne, prévoit la possibilité pour les investisseurs d’attaquer en justice les États qui prendraient des décisions nuisibles à leurs intérêts et à leurs profits (normes sanitaires trop lourdes, droit du travail trop contraignant, nouvelle législation environnementale, instauration d’un salaire minimum…).
Une enquête interne menée au début des années 2000 au sein de la Commission européenne aurait permis de déceler des traces de cocaïne dans 59 des 61 toilettes examinées.
Des logiciels malveillants introduits par la NSA dans des millions d’ordinateurs lui auraient permis d’en contrôler les caméras et les micros, sans que rien n’en témoigne, afin d’écouter les conversations et de prendre des photos dans la pièce où ils se trouvent.
Dès l’après-guerre, certains constructeurs automobiles américains ont travaillé le bruit de fermeture des portières afin qu’il soit « rassurant ».
Aux États-Unis, il existe des plages réservées à la pêche, surveillées par la police de la pêche, où le seul fait de s’asseoir sans pêcher constitue un délit.
Depuis 2011, en Allemagne, une loi protège le droit des enfants à faire du bruit, des crèches ayant dû fermer suite à la plainte de citoyens pour lesquels les cris des enfants créaient une souffrance, qui avait pour conséquence de déprécier leur bien immobilier.
En Belgique, une centaine de prisonniers volontaires (n’ayant commis aucun délit) a accepté de passer un week-end derrière les barreaux pour tester la nouvelle prison de Beveren.
Dans la rue, croisé un punk fumant une cigarette électronique.
*
Cette brève pensée d’Eric Chevillard : « Misérable, éphémère, de passage, bien peu de chose certainement ; je constate néanmoins qu’il faut tout un océan pour effacer la trace de mon pied sur le sable. »
*
Tout un océan, oui. Encore faut-il qu’il y ait la possibilité d’une trace. Encore faut-il qu’on puisse se projeter dans le monde pour y laisser son empreinte. Tant de gens semblent coupés d’eux-mêmes qu’elle paraît incertaine. Impossible, interdite, comme effacée d’avance. Il ne peut y avoir de projection dans le monde sans appartenance à soi : aucun moyen d’échapper à ce préalable. Rien ne peut être envisagé hors de ce regain d’être. Pour pouvoir être au monde, il faut d’abord être à soi.
*
Je relis rarement L’Autrement Dit. Non seulement parce que l’expérience m’est généralement peu agréable, mais surtout pour éviter de tomber dans certains pièges ; comme celui de vouloir sembler à tout prix cohérent. Si je me relisais trop souvent, je m’appuierais certainement sur les idées déjà formulées, m’en servant comme de jalons, incité à rester dans leurs sillons, privilégiant celles susceptibles de rester dans la ligne (il m’est déjà arrivé plusieurs fois de me censurer moi-même, sur le mode du « je ne peux tout de même pas dire ça après avoir écrit ça »), alors qu’il faut savoir lâcher la bride à la pensée et à ses éventuelles contradictions. Elles sont les reflets fidèles du tumulte intérieur dont elles sont aussi l’expression. L’écriture permet (entre bien d’autres choses) d’organiser la pensée, d’essayer, par la recherche du mot juste, d’être au plus près de ce que l’on pense. Mais la consistance qu’on cherche à lui donner ne doit pas masquer la part d’hésitations et de doutes dont elle est également constituée (il me faut passer par tant d’échecs et de tâtonnements avant de pouvoir accoucher d’une idée qui tienne un tant soit peu la route !). Ce que l’on pense n’est jamais absolument et définitivement ce que l’on pense ; la tentation d’une parfaite cohérence peut écarter de la discontinuité naturelle de la pensée, et de l’instabilité intérieure dont elle témoigne.
*
Ne pas se relire peut donc mener à se contredire, mais également à son contraire : se répéter. Cette redondance n’est d’ailleurs pas forcément un défaut : il peut m’arriver de me répéter volontairement, de manière à préciser ou à approfondir les choses ; sans compter les clous que l’envie me vient d’enfoncer. Ainsi l’ai-je déjà dit : l’emploi disparaît. Toujours sous l’effet des gains de productivité, des délocalisations et de la recherche de profits, de plus en plus en raison de la robotisation et du développement de l’économie de l’immatériel (une étude réalisée par deux chercheurs de l’université d’Oxford aboutit à la conclusion que lors des vingt prochaines années, 47 % des emplois actuels seront remplacés par des ordinateurs). On peut soit le regretter – voire s’en effrayer, réaction jusqu’à présent la plus commune – soit en profiter pour voir les choses autrement, se décidant enfin à prendre en compte les mutations en cours et les perspectives nouvelles que celles-ci pourraient offrir (nouveaux modes d’existence, plus grande appartenance à soi, revenus découplés du travail, temps libéré, esprit libéré, vie libérée…). Quoi qu’il en soit et en vertu de ce contexte, exiger des demandeurs d’emploi qu’ils trouvent à tout prix un travail semble garder peu de sens ; tout comme d’ailleurs exiger des entreprises qu’elles en créent.
*
Ce slogan relevé sur le site d’Yves Pagès : « Work in regress / Dream in progress », en écho à ce propos d’André Gorz : « Une perspective nouvelle s’ouvre ainsi à nous : la construction d’une civilisation du temps libéré. Mais, au lieu d’y voir une tâche exaltante, nos sociétés tournent le dos à cette perspective et présentent la libération du temps comme une calamité. Au lieu de se demander comment faire pour qu’à l’avenir tout le monde puisse travailler beaucoup moins, beaucoup mieux, tout en recevant sa part des richesses socialement produites, les dirigeants, dans leur immense majorité, se demandent comment faire pour que le système consomme davantage de travail – comment faire pour que les immenses quantités de travail économisées dans la production puissent être gaspillées dans des petits boulots dont la principale fonction est d’occuper les gens. »
*
Les occuper pourquoi ? Pour les distraire de quoi ? Les contraindre au néant qui les entoure ? Les contenir dans les filets du grand bizness globalisé ? Les conserver laborieux dans leur formol ? Je crois moins à une vaste opération de contrôle planifiée qu’à un enfermement de l’esprit généralisé, chez les dirigeants comme chez les dirigés. Tout le monde trempe dans le même bain. Chacun se noie dans un océan qui recouvre tout : plus d’ailleurs, plus d’issue, plus de rêve ; plus de sable, plus de plage, plus de grève. Ce ne sont plus les traces laissées sur le sable que cet océan-là efface, mais la possibilité même d’y laisser une trace. Le non-être plonge ses racines dans les eaux troublées du non-sens. Au point où l’on en est, penser, rêver, vivre, aimer paraît un engagement.
*
De Flaubert : « Mais ne lisez pas comme les enfants lisent, pour vous amuser, ni comme les ambitieux lisent, pour vous instruire. Non, lisez pour vivre. »
*
Il suffit d’un beau vers, d’une belle phrase, d’une belle image pour que les larmes me viennent. Parfois d’un élément de pensée, saisissant et lumineux. J’ai alors l’impression que c’est le monde entier qui m’est offert. J’ai le sentiment aigu de ce qui m’est donné et j’en suis bouleversé. Mais ce sentiment dépasse de loin la simple volupté : il naît de la rencontre entre ce que je viens de lire ou d’entendre et quelque chose qui le dépasse. Comme si la beauté reçue était un écho à l’harmonie du monde. Comme si sa perception m’élevait à mon tour à sa hauteur. Tout à coup le présent s’élargit et je me sens transporté au cœur des choses. L’émotion est la conséquence et le moyen de ce transport ; je la sens qui se diffuse en moi, elle se déploie, s’écoule et se répand comme le jus d’un fruit dans lequel on vient de mordre. Je suis touché au plus profond et au plus précieux de ma sensibilité. Une multitude de choses entrent alors en résonance. Mes yeux s’embuent et l’émotion me serre la gorge. J’ai le cœur léger et lourd à la fois. Il m’arrive d’éclater en sanglots, sans plus savoir si c’est de tristesse ou de joie.
*
Ces lignes d’Andreï Tarkovshi, extraites de son livre Le temps scellé : « Je ne parviens pas à croire qu’un artiste puisse créer uniquement pour « l’expression de soi ». Cette idée d’une expression qui ne tienne pas compte de l’autre est absurde. Chercher un rapport spirituel avec les autres est un acte éprouvant, non rentable, qui exige le sacrifice. Et tant d’efforts en vaudraient-ils la peine si ce n’était que pour entendre son propre écho ? »
*
Pour la première fois depuis bien longtemps, cette année, j’ai apprécié les décorations de Noël. Non qu’elles aient été fondamentalement différentes des années précédentes, mais cette fois, au moins, je me suis autorisé à les apprécier. C’est que, jusqu’ici, au nom de ce que représente cette période de fièvre mercantile, je refusais les sensations que me procuraient ces jeux de lumières et leurs couleurs. En vertu d’une lucidité glaciale et vaniteuse, je m’interdisais de retrouver un peu de l’émerveillement qui était le mien lorsque j’étais enfant. Quelle connerie de se mutiler ainsi ! Quelle plaie d’être à ce point dogmatique vis-à-vis de soi-même !
*
Faire preuve de lucidité : ok. Sonder les choses et ne pas se satisfaire des apparences : bien sûr. Mais le faire sans négliger son intériorité, sans la censurer, sans repousser l’équivoque au profit d’une conscience trop sûre d’elle et placée au-dessus de tout. Désolant de faire de sa raison la gardienne policière de ses émotions. En soi aussi, se méfier des instances supérieures.
*
Le portrait type du parfait progressiste : prôner la tolérance, manger bio, être pour le mariage pour tous, ne pas croire en Dieu, détester Zemmour.
*
Si je vous dis « j’ai compris votre douleur » et que je continue de vous appliquer les sévices qui sont à l’origine de cette douleur : je suis un menteur, un imbécile ou un pervers. Si je vous dis « j’ai compris votre message » et que je continue d’appliquer les programmes qui sont à l’origine de ce message : je suis un homme politique.
*
Une lectrice m’écrit pour me dire que mes textes, trop longs, lui parlent peu, qu’elle aimerait plus de concision, qu’elle s’y sent souvent perdue, qu’elle a du mal à voir où je veux en venir, qu’elle peine à me suivre dans la succession des thèmes qui y sont abordés, bref, que tout cela ne lui convient guère (point de vue oh combien respectable !), même si, m’écrit-elle, « politiquement nous sommes du même bord ». Elle semble par là me signifier qu’elle et moi sommes de gauche, ce qui pourrait compenser, du moins en partie, l’ennui qu’elle ressent à me lire et l’obscurité de mes textes. Mais est-elle si sûre de ce qu’elle avance ? Mes convictions politiques apparaissent-elles si nettement entre ces lignes incertaines et absconses ? S’il y a une chose dont je me fiche ici de témoigner, c’est bien de mon « bord » politique ! Qu’importe si vous et moi penchons du même côté, puisqu’il s’agit ici de nous rencontrer et non de piloter un side-car ? J’admets volontiers apprécier la plume d’auteurs estampillés de droite, comme Léon Bloy ou Bernanos, leur langue à vif, la tension de leurs textes, leur verve pamphlétaire née de leur détestation des valeurs établies, du conformisme, de la bien-pensance consensuelle et de la tiédeur des débats qui en découle. Ces lectures suspectes suffisent-elles à me faire changer de bord ? Remettent-elles en question mes tropismes de gauche ? D’ailleurs, de quelle gauche s’agit-il ? Celle du pacte de responsabilité ? Du maintient du cap ? Du gouvernement de combat ? Être de gauche, après tout pourquoi pas. Mais s’il me faut être de gauche, alors c’est d’une autre gauche, informelle et bien à moi. Parce que moi, ma gauche, c’est celle de mon pote Laurent, paysan, qui pratique une agriculture naturelle et dont la façon de travailler semble en adéquation totale avec la façon de penser ; celle de mon pote Nico, qui un jour a quitté son boulot et vendu sa voiture pour s’acheter un appareil photo et nous délivrer sa vision talentueuse et singulière du monde ; celle de Juliette, riche de son attention aux autres et des amitiés nombreuses qu’elle sait faire vivre et perdurer ; celle de Christelle, vibrante de sa faculté à mettre du jeu entre le monde et elle et toujours prête à lâcher la bride à son imaginaire ; celle de Virlo, dont la présence et la parole sont si pleines d’images et de poésie ; celle de Nicole, dont les difficultés de la vie n’ont en rien altéré la fraîcheur ; celle de Camille, à la finesse d’esprit si pétillante ; celle de Luc, dont la conversation vous rend plus riche de son amour de la littérature et de la langue ; celle de Max, à l’intelligence contagieuse, qui ose la pensée et le partage de son questionnement du sens ; celle de tous les autres, que je ne cite pas ici, mais qui par leur présence et leur façon d’être au monde me le rendent plus beau et plus vivable. La voilà ma gauche ! Une gauche sans parti, libre et sauvage. Une gauche « vécue », qui évolue et se construit d’elle-même. Une gauche faite de rencontres, d’amitié et de confiance, à côté de laquelle l’autre, l’officielle, l’institutionnelle, n’est rien.
*
Ce genre de gauche, chacun porte la sienne. Elle est unique et intime. Qu’on l’appelle gauche ou non a d’ailleurs peu d’importance. Ce qui importe, c’est qu’on s’y reconnaît par l’intensité des liens qui la composent, et non par son appartenance au clan. Ce qui compte, c’est la force de ses liens et la densité de ses échanges. Des communautés se forment dans le cœur de chacun, qui le plus souvent s’ignorent. Elles se croisent et se rencontrent, mais sans avoir conscience d’elles-mêmes. Pourtant elles sont là, fertiles, changeantes, vivantes, faites d’expériences sensibles et de présences au monde. C’est là qu’il se passe réellement quelque chose, sans qu’on puisse définir exactement quoi. Et c’est dans cet indéfinissable, dans cet impalpable, dans ce qui s’échange en dehors de toute organisation ou structure – tout cela qui n’est pas directement évaluable et observable – que réside leur plus grande force.
*
De Georges Picard, extrait de son Journal ironique d’une rivalité amoureuse : « Je pense parfois à tout ce qui se trame ici et ailleurs, aux innombrables histoires qui se nouent – d’amour, de haine, d’intérêt – et même aux combinaisons aléatoires de la vie. Cela doit former un complexe infini de relations, désirées ou subies, dans l’hyper-réseau du monde. Pourtant, je suis prêt à croire que chaque événement influence mystérieusement l’équilibre général comme entrent en résonance les échos des galaxies les plus éloignées. Si c’est le cas, chacun assume avec sa propre histoire un peu de la finalité globale : personne ne peut se prétendre entièrement détaché des autres. Drôle de pensée qui me rend attentif autant à moi-même qu’à ce qui m’entoure. »
*
États d’être et résonances dans l’écheveau des relations. Cela compte et cela pèse. Précieuses sont les traces ainsi laissées dans le sable. Il y a dans l’informel bien plus de potentialités qu’on croit.
Allez en découvrir plus dans l'Autrement dit, le blog de Cyril C. Sarot qui se présente ainsi :
« Je ne me considère pas écrivain. Ni poète ni penseur ni artiste. Ce serait futile et arrogant. Comme l’a écrit Van Gogh dans une lettre à son frère Théo : « Je ne suis pas un artiste, comme c’est grossier – même de le penser de soi-même. » Ce qui ne m’empêche pas d’avoir une activité de création, d’écrire et de le faire avec exigence. D’exprimer des éléments de pensée par l’écriture, versifiée ou non. Sans, je le répète, jamais me prendre pour un poète, un penseur ou un écrivain.
Donc ni penseur ni écrivain ni poète ni artiste. Ce qui ne m’empêche ni de penser ni d’écrire. Résolument et dans la conscience de mes limites. Lexicales, culturelles, intellectuelles.
Je fais avec mes pauvres moyens. Mais avec mes pauvres moyens, je fais. »
Ici : https://lautrementdit.wordpress.com/






 Le petit livre noir en couleurs de Dominique, de Pixel Vengeur
Le petit livre noir en couleurs de Dominique, de Pixel Vengeur
 Serge et Demi-Serge, de Geoffroy Monde
Serge et Demi-Serge, de Geoffroy Monde
 Talk Show, de Fabcaro
Talk Show, de Fabcaro sortie premier trimestre 2015
sortie premier trimestre 2015 Pixel Vengeur fait ses premières armes en bande dessinées dans les années 80 dans des journaux tels que Viper, le Petit Psikopat Illustré et Rigolo. Puis il devient graphiste en jeux vidéo et découvre l’ordinateur. Il recommence à apparaître en tant qu’illustrateur dans différents mensuels, puis par revenir définitivement en 2000 à la bande dessinée. Il travaille aujourd’hui pour Fluide Glacial, le Psikopat et Spirou.
Pixel Vengeur fait ses premières armes en bande dessinées dans les années 80 dans des journaux tels que Viper, le Petit Psikopat Illustré et Rigolo. Puis il devient graphiste en jeux vidéo et découvre l’ordinateur. Il recommence à apparaître en tant qu’illustrateur dans différents mensuels, puis par revenir définitivement en 2000 à la bande dessinée. Il travaille aujourd’hui pour Fluide Glacial, le Psikopat et Spirou. Geoffroy Monde est magique depuis 2004 et a souvent été élu meilleur espoir. Il raconte tout ça dans des albums publiés aux éditions Lapin et Warum, et sur son blog Saco : Pandemino. Des fois, il ment.
Geoffroy Monde est magique depuis 2004 et a souvent été élu meilleur espoir. Il raconte tout ça dans des albums publiés aux éditions Lapin et Warum, et sur son blog Saco : Pandemino. Des fois, il ment. Fabcaro poursuit depuis une dizaine d'années son exploration de la bande dessinée d'humour entre expérimentation, autobiographie et absurde, seul ou officiant au scénario pour d'autres, alternant les albums pour des éditions indépendantes avec notamment Le steak haché de Damoclès, L'album de l'année ou La clôture, et albums plus grand public, parmi lesquels Z comme Don Diego (avec Fabrice Erre) ou Amour, passion et CX diesel (avec James). Il a également collaboré à divers magazines ou journaux comme Tchô !, L'écho des savanes, Psikopat, ZOO, CQFD, Kramix ou Fluide Glacial pour lequel il travaille actuellement, ou des revues comme Jade et Alimentation générale. Il est aussi l'auteur d'un roman, Figurec, paru en 2006 aux éditions Gallimard.
Fabcaro poursuit depuis une dizaine d'années son exploration de la bande dessinée d'humour entre expérimentation, autobiographie et absurde, seul ou officiant au scénario pour d'autres, alternant les albums pour des éditions indépendantes avec notamment Le steak haché de Damoclès, L'album de l'année ou La clôture, et albums plus grand public, parmi lesquels Z comme Don Diego (avec Fabrice Erre) ou Amour, passion et CX diesel (avec James). Il a également collaboré à divers magazines ou journaux comme Tchô !, L'écho des savanes, Psikopat, ZOO, CQFD, Kramix ou Fluide Glacial pour lequel il travaille actuellement, ou des revues comme Jade et Alimentation générale. Il est aussi l'auteur d'un roman, Figurec, paru en 2006 aux éditions Gallimard.
















 Le 83e numéro du
Le 83e numéro du