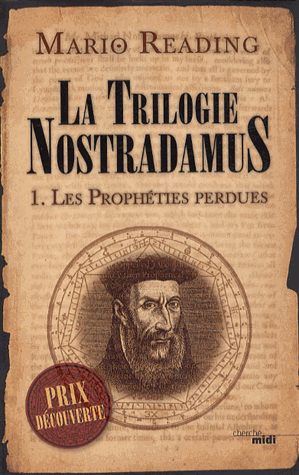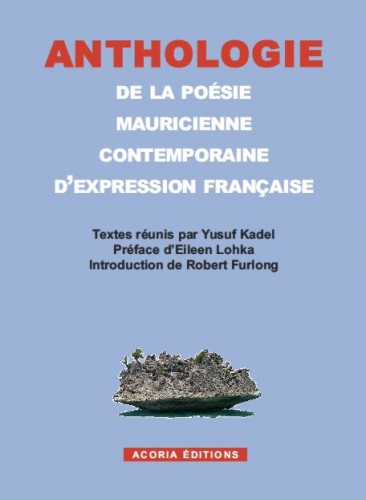Cette voie est nécessaire. De nombreux constats l’indiquent. D’abord, de fortes corrélations passées et récentes existent entre la pression écologique des humains et la croissance économique mondiale. Ensuite, d’autres résultats montrent que, indépendamment de l’écologie, la croissance n’apporte plus rien ou plus grand-chose dans les pays riches en termes de « développement humain », de bien vivre et de lien social [1].
Cette voie est, ou peut être, désirable. Le terme même de prospérité choisi par Tim Jackson correspond à cette conviction. Prosperare, en latin, c’est « rendre heureux ». C’est lié à l’espoir ou à la confiance dans l’avenir, sans connotation d’abondance matérielle.
Enfin cette voie est crédible, moyennant bien évidemment des réorientations profondes elles aussi crédibles. C’est ce que montrent les scénarios auxquels je faisais allusion. En passant, si une voie absolument nécessaire pour éviter le pire était inenvisageable, je ne sais pas ce qu’il faudrait en conclure sur notre avenir et celui de nos descendants…
Mais cette voie ne pourra pas être empruntée sans une forte réduction des inégalités, pas seulement les inégalités économiques. Je renvoie sur ce point à mon livre et, plus récemment, à ce papier d’Eloi Laurent, accessible en ligne, mais en langue anglaise : « Inequality as pollution, pollution as inequality » [2].
1. Quatre catégories pour penser autrement le « progrès » ou le bien vivre
Pour penser une « bonne société s’inscrivant dans la durée », mais aussi une bonne économie, il faudrait privilégier d’autres catégories, non économiques, relevant d’abord de la philosophie morale et politique et de disciplines autres que l’économie.
Je retiens quatre hypothèses, autour de quatre catégories non économiques : 1) prendre soin au-dessus de produire, 2) biens communs à préserver au-dessus de biens privés à accumuler, 3) qualités au-dessus de quantités, 4) sobriété matérielle plutôt que démesure. La question de la justice traverse ces quatre catégories, mais je ne l’évoquerai pas dans les limites de cet article.
Ces quatre catégories entretiennent de fortes relations et peuvent former l’ébauche d’un système ou cadre cognitif. Aucune des quatre ne supprime la catégorie « ancienne » à laquelle je l’oppose, mais chacune désigne un basculement des priorités, selon moi nécessaire pour penser et donc réussir la « transition ».
Pour résumer la façon dont les nouvelles catégories ont une priorité sur les anciennes sans les abolir, il faudrait selon mes hypothèses :
- mettre l’activité dite de production (économique ou non) au service du « prendre soin » ;
- conditionner la production et l’usage des biens privés à l’intégration de biens communs ;
- produire et consommer des quantités sous condition de qualités diverses, dont des qualités écologiques dites de soutenabilité ;
- conceptualiser la sobriété individuelle et collective comme exigence de recours mesuré à des ressources matérielles limitées, mais ne concernant pas des activités, plaisirs ou passions dans d’innombrables domaines autres que la consommation matérielle.
1.1. « Prendre soin » au-dessus de « produire »
Selon cette hypothèse, les économies et sociétés du futur seront non plus dominées par les catégories de production et de consommation croissantes de quantités, mais d’abord des économies et des sociétés du « prendre soin ». Je m’inspire très librement, en étendant sa portée, de la sociologie et de la philosophie du « care ». En voici cinq axes :
- Prendre soin des personnes, de leur santé, éducation, culture, bien-être, avec le souci non seulement d’aider ces personnes mais surtout de favoriser leur autonomie et leur activité propre, leurs « capabilités ». Prendre soin du travail aussi, de sa qualité et de son sens. Prendre soin de soi aussi…
- Prendre soin du lien social, à préserver et renforcer, de la solidarité de proximité à des solidarités plus globales, et de l’accès à des droits universels liés à des biens communs ;
- Prendre soin des choses et des objets, pour les faire durer, les utiliser, les concevoir et les produire à cet effet, les recycler lorsque cela s’y prête ;
- Prendre soin de la nature et des biens communs naturels, dans toutes les activités humaines, afin de rester dans les limites des écosystèmes et de transmettre aux générations futures des patrimoines naturels en bon état ;
- Prendre soin de la démocratie, vivante et permanente, bien au-delà de la démocratie à éclipse des élections, souvent décevante ou trompeuse. C’est peut-être le premier des biens communs, ou le plus transversal. Il faudrait lui associer le « prendre soin des savoirs », en tout cas de ceux qui correspondent, ou devraient correspondre, à des biens communs.
Depuis plus de deux siècles, les idées économiquement et politiquement dominantes ont affirmé le primat de la production, entendue comme production dans la sphère économique et monétaire (il a fallu attendre 1976 pour que la production non marchande des administrations publiques soit intégrée dans le PIB, ce qui est légitime et important, mais donne une idée des présupposés initiaux du grand projet des comptes nationaux, si indispensables soient-ils à l’analyse). La richesse des sociétés a alors été assimilée à sa richesse économique, par la suite comptabilisée dans le PIB. La croissance des « volumes » est devenue une finalité ultime et le critère central de progrès, ou dans le meilleur des cas sa condition impérative. Ce mode de pensée a conduit à ne pas voir ce que l’on perd en route, les dommages collatéraux de la croissance de la production, dommages sociaux, écologiques et humains. Ils sont en train de devenir massifs et centraux.
1.2. Biens communs à préserver au-dessus de biens privés à accumuler
Ce que l’on perd en chemin, dans les sociétés de croissance, ce sont souvent des patrimoines ou des biens communs dont certains sont essentiels pour inscrire les sociétés dans la durée, et dont aucun n’est comptabilisé dans le PIB.
Les biens communs désignent [3] des qualités d’ordre collectif jugées d’intérêt commun, accessibles à tous, dont la gestion est commune et passe par la coopération d’acteurs multiples. Ils sont donc trois fois « communs » : intérêt collectif, accessibilité commune, responsabilité commune.
Prenons un exemple, celui de la qualité de l’air en ville. Ce n’est pas un bien public au sens usuel d’une infrastructure publique prise en charge par les pouvoirs publics. Il existe un grand nombre de parties prenantes de la « production » et gestion de cette qualité. Les citoyens, ménages, associations, entreprises, organismes divers sont amenés à coopérer comme « co-concepteurs, coproducteurs et coresponsables, y compris comme fournisseurs de ressources financières et non financières, aux côtés des pouvoirs publics comme financeurs partiels, coordinateurs, incitateurs, éducateurs, législateurs, etc. Il s’agit d’un bien commun, ni privé, ni public.
Cette catégorie est essentielle pour penser une transition écologique, énergétique, climatique, parce que, au-delà de cet exemple, presque tous les grands enjeux écologiques constituent des qualités d’intérêt général dont il faut « prendre soin » en commun par la coopération d’acteurs multiples. C’est vrai aussi d’enjeux sociaux majeurs, dont la protection sociale, l’égalité entre les femmes et les hommes, etc.
Les biens communs (écologiques et sociaux) ne s’opposent pas systématiquement aux biens privés. L’objectif d’une transition écologique et sociale bien menée devrait être non seulement de prendre soin des biens communs en tant que tels, comme la qualité de l’eau, de l’air, de la biodiversité ou de la protection sociale, mais surtout d’enrichir la production des biens privés (et publics) en biens communs écologiques et sociaux via notamment des normes plus exigeantes (haute qualité sociale et environnementale).
Dans d’autres cas toutefois, la préservation et la gestion coopérative des biens communs vont s’avérer incompatibles avec leur gestion capitaliste. La « déprivatisation » de l’eau, de l’énergie, de la finance, entre autres, ou le refus de la privatisation de la protection sociale, sont des exemples de combats nécessaires. L’accent mis sur les biens communs va dans le sens non seulement de la réduction de la sphère capitaliste, celle dont les acteurs visent à (presque tout) privatiser, mais aussi dans le sens de la démarchandisation (et parfois de la gratuité) de biens associés à des droits universels existants ou à conquérir. Il faudrait ajouter à ces considérations un bien commun économique et social central : la monnaie, aujourd’hui non seulement privatisée, mais dont la gestion est dominée par la loi de la « valeur pour l’actionnaire ». Aucune prospérité sans croissance n’adviendra vraiment, en dépit d’expériences partielles ou locales concluantes, sans une socialisation de la monnaie et du système financier, pouvant passer par une articulation de monnaies locales et de monnaies communes à de larges espaces.
1.3. Qualités plutôt que quantités (une extension de la catégorie précédente)
Les constats statistiques de découplage, dans les pays riches, entre la croissance économique et de multiples variables associées à l’idée de bien vivre conduisent tous à cette idée : ont été oubliées en route d’innombrables qualités sacrifiées sur l’autel des quantités produites et consommées sous contrainte de gains de productivité. Qualité de vie, du travail, de l’emploi, des écosystèmes, du climat, des biens et des services, etc. Une partie de ces qualités sont des biens communs, d’autres relèvent notamment de la « qualité de service », services des prestataires ou services rendus par des biens, leur « valeur d’usage » ou mieux leur valeur dans l’usage.
La prospérité sans croissance est une transformation de nature qualitative. Les quantités (produites, consommées, de travail…) n’y prennent sens que sous des conditions ou normes de qualité. L’économie elle-même (section suivante) y est pensée comme une économie des qualités, des qualités dont on ne peut juger qu’à l’aune d’une économie comme science morale et politique.
1.4. Sobriété matérielle plutôt que démesure ou ébriété matérielles
Je me permets de renvoyer à ce texte : « La sobriété : une riche idée ! » [4]. Il y est montré que, loin d’être seulement une injonction individuelle pouvant parfois se révéler culpabilisante, la sobriété regroupe nombre de priorités écologiques collectives presque unanimement admises : l’économie « de fonctionnalité » et tous les usages partagés, l’économie « circulaire », le recyclage et la réparation, les circuits courts, la valorisation des activités gratuites, le combat contre le culte de la vitesse, etc.
2. Cette voie implique de « faire de l’économie » avec d’autres concepts et catégories, au-delà du PIB, de la croissance et des gains de productivité
Dans les raisonnements économiques usuels, ceux qui fondent les scénarios des politiques à venir en reproduisant ceux du passé, la croissance est supposée fournir les « marges de manœuvre » de toute l’action publique et des stratégies privées. Elle dépend largement des gains de productivité du travail, mais ces derniers suppriment du travail à quantités produites identiques. Pour ajouter du travail dans l’économie, il faut donc que la croissance soit plus importante que les gains de productivité.
Compte tenu de la révision précédemment proposée des grandes catégories permettant de penser autrement le « progrès », ces concepts économiques clés vont devoir eux aussi passer au second plan au bénéfices d’autres concepts. En tenant compte de travaux existants et des quatre grandes catégories que j’ai mises en avant, je propose de premiers points d’appui pour une telle révision.
Il faut selon moi réformer le cœur du raisonnement, à savoir le triptyque croissance, gains de productivité, volume de travail requis. Il me semble inadapté à une économie des qualités, du prendre soin, des biens communs et de la sobriété énergétique et matérielle. Voici deux arguments liés entre eux. Le premier concerne le culte des gains de productivité, le second la relation supposée entre la croissance et l’emploi. La possibilité de scénarios de prospérité sans croissance passe par ces deux critiques et par des propositions alternatives.
2.1. Le culte des gains de productivité et le rendement décroissant du concept
Il s’agit d’une croyance forte et ancienne, traversant presque tous les courants de pensée et courants politiques, à l’exception des familles diverses de la pensée écologique, et encore... car même André Gorz faisait des gains de productivité un des leviers d’une quête de l’autonomie et d’une prise de distance avec la société « travailliste ».
Selon cette croyance, les gains de productivité du travail sont libérateurs car ils permettent par définition de produire autant ou plus avec moins de travail. Ils libèrent les humains des « corvées productives » parce qu’il y a « substitution du capital au travail ». Ils autorisent donc la réduction du temps de travail, la progression du temps libre, l’élévation du « niveau de vie » et/ou l’affectation de richesses économiques en expansion à des besoins collectifs, à la protection sociale, et même à la réduction des inégalités via « le partage des gains de productivité ». Ils résument donc le « progrès des forces productives ».
L’illustration la plus éclatante serait la suivante : pour nourrir la population d’un pays, il fallait jusqu’au XIXe siècle que la grande majorité des individus travaille la terre, et la travaille durement. Aujourd’hui, dans les pays les plus « riches », 1 % à 2 % de la population active, soit moins de 0,5 % de la population totale, sont employés dans une agriculture devenue à 90 % industrielle et chimique, et suffisent en gros à répondre aux besoins alimentaires de toute la société, permettant même que 20 à 30 % de la nourriture achetée finisse dans les poubelles…
Pourtant, cet hymne puissant aux gains de productivité, ici agricoles, ailleurs industriels, s’accompagne de fausses notes devenues dissonances puis musique alternative. Ces gains s’accompagnent de pertes, et ces dernières deviennent massives. Pour une raison simple : pour produire plus de quantités avec autant de travail, ce qui est la définition des gains de productivité, il faut, sauf exceptions, plus de matériaux, d’eau, d’énergie, avec plus de pollutions et d’émissions. On pompe de plus en plus dans des biens communs disponibles en quantité limitée, dont les plus décisifs depuis les Trente Glorieuses ont été les énergies fossiles, pétrole en tête. Ce sont elles qui ont propulsé vers le haut les gains de productivité industriels et agricoles. Et qui ont de ce fait propulsé aussi vers le haut les émissions de gaz à effet de serre et quelques autres « dommages collatéraux » devenus des risques centraux.
Mais ce qui perturbe le plus les économistes, majoritairement indifférents aux enjeux écologiques, est le constat que les gains de productivité s’effondrent, décennie après décennie, depuis les « Trente Glorieuses » : 5 % par an en moyenne entre 1949 et 1973, 3 % entre 1973 et 1989, 2 % entre 1989 et 2009. Ils ont désormais retrouvé les niveaux du XIXe siècle, avant le pétrole et l’électricité, soit 1 % par an.
Or ce que, pour l’instant, ces économistes refusent d’admettre, c’est que le déclin des gains de productivité, tels qu’ils sont définis et mesurés, reflète essentiellement le déclin du concept, ses rendements intellectuels décroissants pour penser les transformations contemporaines des activités économiques et les grandes transformations à venir. Pourquoi le déclin du concept ? Plusieurs arguments interviennent, mais les deux plus importants sont les suivants.
D’abord, les économies contemporaines sont toutes caractérisées par le fait que les activités de service y occupent entre 75 % et 80 % de l’emploi. Or, les plus gros bataillons de cet emploi tertiaire sont constitués de services, publics, privés, ou associatifs où l’on ne peut pas, ou presque pas, réaliser de gains de productivité sans dégrader la qualité : éducation, santé, justice, services aux personnes âgées et à la petite enfance, services sociaux, recherche, etc. Mais c’est vrai aussi de services privés où la « relation de service » est déterminante et où la substitution du capital au travail a soit des perspectives limitées, soit des incidences négatives sur la qualité ou sur l’utilité sociale. On rejoint d’ailleurs ici l’une des dimensions du « prendre soin ».
Précisons encore, moyennant une brève incursion dans la technique : pour pouvoir définir et mesurer aussi bien la croissance « en volume » que les gains de productivité, il faut impérativement s’appuyer sur la notion d’unités produites et de prix unitaires, afin de construire des indices de prix, lesquels serviront à « déflater » les mesures en valeur monétaire courante. Or, depuis des décennies, les statisticiens rencontrent un problème insurmontable, à nouveau mentionné dans le « rapport Stiglitz » (2009) : personne ne sait définir, dans de très nombreux services qui ont connu une forte expansion, ce que sont les unités produites, donc les prix unitaires, donc les « volumes ».
Que sont les « unités produites » dans l’enseignement, la santé, la recherche, l’action sociale, les services aux personnes âgées, mais aussi les banques, les assurances, la protection sociale, le conseil, voire le commerce de détail ? On ne sait pas, et pourtant ces activités où « on ne sait pas » représentent désormais la majorité des activités et de la valeur ajoutée, donc du PIB. Comment définir des gains de productivité ou un taux de croissance en volume dans ces activités ? On ne sait pas plus. L’évaluation « à prix constants » perd son sens lorsqu’on ne sait pas répondre à la question : le prix constant de quoi ? Les comptes nationaux en volumes et les mesures des gains de productivité globaux ont été mis au point avec des références industrielles et agricoles dans une période particulière. Celles des activités de service qui résistent à la rationalisation industrielle, en dépit de tentatives pour y introduire des pratiques productivistes, résistent aussi à leur inscription dans cette conceptualisation d’origine industrielle. Les conventions retenues par les comptables nationaux confrontés à cette difficulté reviennent plus ou moins, faute de pouvoir disposer d’unités de produits séparables de leurs producteurs, à prendre des unités de prestations de services, soit très souvent… le temps de travail des prestataires (enseignants, aides à domicile, etc.). On met alors au numérateur du ratio de productivité presque la même chose qu’au dénominateur…
Le deuxième argument à l’appui du déclin du concept de productivité est écologique. Car ce qui est vrai de ces services et de leur qualité l’est aussi de la qualité écologique des produits et des processus, enjeu majeur de la période à venir. Les gains de productivité tels qu’on les mesure sont parfaitement indifférents aux « externalités environnementales ». Ils ne tiennent aucun compte par exemple des bilans carbone, des bilans de la consommation d’eau dans la production, de la déforestation liée à certaines productions ou des substances chimiques nocives embarquées dans d’innombrables produits de consommation courante, perturbateurs endocriniens, substances cancérogènes ou mutagènes, etc.
Au total, les gains de productivité passent, sauf exceptions, à côté des quatre exigences principales que sont la priorité au « prendre soin », l’attention aux biens communs, la qualité plutôt que la quantité, et la sobriété énergétique et matérielle. Ils ne sont plus émancipateurs.
Remarque : l’interprétation précédente d’un lien entre le déclin des gains de productivité et le déclin du concept lui-même fait l’objet de controverses parmi les économistes hétérodoxes, y compris ceux qui s’intéressent de près aux enjeux écologiques et qui partagent l’exigence d’une autre vision du « progrès ». Selon certains, on pourrait « sauver » le concept de gains de productivité, tout comme celui de croissance, moyennant des innovations méthodologiques et statistiques leur permettant de tenir compte des gains de qualité et de soutenabilité écologique. Je n’entrerai pas ici dans cette controverse, qui revêt des aspects très techniques. J’ai précisé mes convictions à plusieurs reprises sur mon blog [5]. Mais pour le dire de façon illustrée, il est selon moi illusoire et dangereux de vouloir faire entrer dans des prix fictifs ou corrigés toutes les externalités environnementales qui font qu’une fraise produite en Andalousie sur la base de la destruction de la qualité organique des sols, avec force pesticides et engrais azotés, une consommation d’eau considérable, des transports réfrigérés sur longue distance, et des conditions de travail indécentes, est différente (bien que moins chère sur les étals) d’une fraise de saison issue de l’agriculture biologique de proximité. Il s’agit d’une tentation de l’économisme prétendant pouvoir tout traduire en valeur monétaire.
2.2. La relation supposée entre la croissance et l’emploi
La question qui revient constamment dans les débats publics est celle de l’emploi dans un tel « modèle » ou dans la transition vers ce modèle. Créer des emplois sans croissance ? Les gens sont incrédules, mais ils le sont parce que presque tous les économistes et les responsables politiques affirment que c’est impossible. Ces économistes ont d’ailleurs raison s’agissant du passé : avec les gains de productivité des décennies passées, à une époque – celle des « Trente Glorieuses » de la « production de masse industrielle et agricole » – où la signification de ces gains était moins altérée qu’aujourd’hui, il était impossible d’ajouter des emplois sans croissance, sauf à réduire la durée du travail plus vite que les gains de productivité.
Le problème est que l’usage des raisonnements économiques du passé est incompatible avec les exigences et les urgences du présent et du futur. Le mieux pour prendre conscience de cette impasse est de partir d’un exemple, celui de la production agricole, que j’ai déjà emprunté car c’est le secteur qui a connu depuis 60 ans les gains de productivité les plus énormes, plus que l’industrie, tout en multipliant les dommages collatéraux sur l’environnement et sur la santé.
Supposons qu’on remplace progressivement l’agriculture industrielle par de l’agriculture biologique ou agro-écologie de proximité. À production identique en quantités, il faudrait en moyenne 30 à 40 % d’emplois en plus. Les comptes nationaux actuels nous diraient alors que la croissance de ce secteur « en volumes » est nulle (mêmes quantités produites) et que la productivité du travail baisse fortement. Pourtant, on aurait créé de nombreux emplois, il y aurait plus de valeur ajoutée agricole, et surtout la qualité et la durabilité de la production auront été bouleversées positivement.
Passer à une économie des qualités, de la soutenabilité, du prendre soin et des biens communs écologiques et sociaux sous condition de justice est très probablement bon pour l’emploi, croissance ou pas, mais mauvais pour les chiffres de productivité, parce que ces derniers ignorent ces catégories nouvelles.
La liste est longue des productions et des secteurs où une stratégie de montée en qualité et en durabilité restera invisible dans nos comptabilités. Les grands gisements d’emploi et de valeur ajoutée du futur résideront dans des transformations qualitatives « hors croissance », dans une économie dont le principe sera de « prendre soin » des personnes (des services de bien-être sans visée de productivité), des biens, de la nature et de la cohésion sociale. La prospérité sans croissance mais riche en emplois et en biens communs (et « pauvre en injustices ») repose sur cette réorientation, couplée avec une poursuite du mouvement historique de réduction de la durée du travail (RTT). Cette dernière exigence doit être aujourd’hui politiquement et moralement dissociée de toute référence à la croissance et à la productivité, d’abord parce qu’il y a cinq à six millions de chômeurs, et parce que ce résultat, qui ronge la société, est le fruit de décennies où l’on a mis en avant la croissance (reposant essentiellement sur des gains de productivité) comme principale solution, au lieu du partage équitable. Un remède qui rend de plus en plus malade devrait être abandonné.
Deux chiffres sur la RTT : la durée annuelle moyenne du travail des salariés était d’environ 1800 heures en 1970. Elle a régulièrement diminué jusqu’en 2002, et, depuis, elle stagne autour de 1400 heures, tous types de salariés confondus, y compris les petits boulots à temps très partiel. Si on en était resté à la durée de 1970, il y aurait aujourd’hui des millions de chômeurs en plus des cinq à six millions actuels (si l’on compte tous les chômeurs, et pas seulement ceux au sens du BIT).
Deuxième chiffre. Si l’on divise le volume total de travail en France par la population active, chômeurs BIT compris, on obtient environ 31,5 heures par semaine, et moins de 30 heures en tenant compte des chômeurs « non BIT ». En Allemagne, ce chiffre est de 29 heures. En d’autres termes, un « partage du travail équitable » entre tous ceux qui ou bien ont un emploi ou bien aspirent à en avoir, aboutirait à une semaine de 30 heures environ. L’idée d’un autre partage du travail, plus égalitaire, sans perte de salaire pour l’immense majorité, sur « toute la vie », avec comme mesure phare la semaine de 32 heures, n’est peut-être pas à la mode, mais il va bien falloir s’affranchir de la mode de la pensée unique travailliste qui fait exploser le chômage bien plus surement que la « panne de croissance », laquelle, probablement, va s’installer dans la durée, s’agissant de la croissance quantitative ou « en volume ».
Enfin, au delà de l’éthique du partage, une telle réduction serait favorable, moyennant des dispositifs innovants, à la participation des citoyens à la vie démocratique et militante, à la vie associative, à la « croissance » des innombrables richesses non marchandes et souvent non monétaires issues du bénévolat coopératif. Ce serait bon également pour réduire la pression écologique, car une corrélation significative existe entre cette dernière et la durée du travail. [6]
Bien entendu, dans le même temps, l’emploi devra diminuer progressivement (mais avec des conversions négociées, limitant les réductions d’emplois et préservant la sécurité professionnelle des salariés sur leur territoire) dans certains secteurs à forte pression écologique ou haut niveau d’émissions et de pollutions : énergies fossiles, transports routiers, industrie automobile, etc. Mais ce que montrent les meilleurs scénarios dont on dispose, c’est que ces pertes d’emplois seraient plus que compensées par les créations dans les secteurs porteurs de la transition.

 Courte vidéo satirique en langue espagnole, avec sous-titrage en français, qui retrace avec beaucoup d’à-propos, les fondements politiques de la faillite bancaire et immobilière espagnole. Document proposé pour CHAIRECOOP par Alejandro Muchada. « Màs que una casa ». Architecte et membre de la chaire.
Courte vidéo satirique en langue espagnole, avec sous-titrage en français, qui retrace avec beaucoup d’à-propos, les fondements politiques de la faillite bancaire et immobilière espagnole. Document proposé pour CHAIRECOOP par Alejandro Muchada. « Màs que una casa ». Architecte et membre de la chaire.

 Les fonds de pension et organismes bancaires désormais propriétaires de cet ensemble immobilier sont Blackstone et Goldman Sachs. En conséquence, les locataires en place ont perdu leur statut de locataire social et le patrimoine immobilier public financé par l’impôt, relève désormais du marché libre.
Les fonds de pension et organismes bancaires désormais propriétaires de cet ensemble immobilier sont Blackstone et Goldman Sachs. En conséquence, les locataires en place ont perdu leur statut de locataire social et le patrimoine immobilier public financé par l’impôt, relève désormais du marché libre.
 En réalité, il s’agit de remettre en perspective sur un temps long, ce processus de privatisation du logement social public en cours en Espagne. Cette démarche de marchandisation de biens publics n’est pas un phénomène isolé. Elle intervient à l’inverse, comme une lame de fond et ce, du nord au sud du continent européen. Portée par le courant de pensée néo-libéral, Margareth Thatcher initie le processus en Grande Bretagne dès le début des années, 1980 avec le « Right to Buy » (2 millions de logements sociaux publics vendus entre 1979 et 1999)[2]. Thatcher imprime ainsi sa vision du monde de la ” ownership society” (société de propriétaires).
En réalité, il s’agit de remettre en perspective sur un temps long, ce processus de privatisation du logement social public en cours en Espagne. Cette démarche de marchandisation de biens publics n’est pas un phénomène isolé. Elle intervient à l’inverse, comme une lame de fond et ce, du nord au sud du continent européen. Portée par le courant de pensée néo-libéral, Margareth Thatcher initie le processus en Grande Bretagne dès le début des années, 1980 avec le « Right to Buy » (2 millions de logements sociaux publics vendus entre 1979 et 1999)[2]. Thatcher imprime ainsi sa vision du monde de la ” ownership society” (société de propriétaires). En 2004, la municipalité social-démocrate de Berlin vend d’un coup 70.000 logements sociaux publics propriété de la société communale “GSW”, au fonds de pension américain CERBERUS, pour un montant de 2 milliards d’€. La ville de Berlin efface ainsi du même coup sa dette publique estimée à 1,6 milliards d’€…
En 2004, la municipalité social-démocrate de Berlin vend d’un coup 70.000 logements sociaux publics propriété de la société communale “GSW”, au fonds de pension américain CERBERUS, pour un montant de 2 milliards d’€. La ville de Berlin efface ainsi du même coup sa dette publique estimée à 1,6 milliards d’€…