Dans certains pays, s’exprimer sur scène est un défi. Les lieux dont ont besoin les musiciens et les comédiens pour rencontrer le public y sont fragilisés, voire inexistants, pour des raisons économiques ou de sécurité. En Syrie, le conflit armé et la présence de Daech – qui interdit toute pratique musicale – rendent pratiquement impossible la vie culturelle publique. La jeune chanteuse Waed Bouhassoun en témoigne. Elle réside en France et se rend régulièrement dans sa région, au sud de Damas. Les soirées autour de la musique et de la poésie, encore nombreuses, partout sur le territoire, avant 2012, y perdurent avec peine. La destruction de la vieille ville d’Alep empêche la tenue de concerts et de cérémonies musicales des confréries soufies. Les musiciens qui sont restés ne peuvent plus travailler.
Sous la menace d’attentats
Pourtant, la population syrienne continue à célébrer les rites de mariages et de funérailles. « Et quelques personnes courageuses arrivent à organiser des rencontres au milieu de l’après-midi, raconte Waed Bouhassoun, mais il y a beaucoup d’angoisse et d’inquiétude car circuler est devenu très dangereux. » Cette étoile montante de la musique arabe, venue en France avant le conflit pour étudier, poursuit désormais ses recherches en ethnomusicologie (à l’université Paris X-Nanterre) ainsi que ses activités de chanteuse et de joueuse de oud (le luth arabe). Waed Bouhassoun se produit dans des festivals européens et de pays arabes, notamment aux côtés du grand musicien Jordi Savall.
En République islamique d’Afghanistan, si la guerre se déroule principalement dans les montagnes, le terreau n’est pas non plus propice à la création, en particulier pour les arts du spectacle. Le théâtre afghan a certes connu un âge d’or dans les années 1970, mais il a été laminé par le règne des talibans (1993-2001), lesquels condamnent eux aussi toute forme d’art. Pour l’aider à renaître, de jeunes hommes et femmes ont fondé le Théâtre Aftaab en 2005. Ils ont réussi à travailler cinq années durant à Kaboul, avec le soutien du centre culturel français [1] et le parrainage du fameux Théâtre du Soleil, compagnie d’Ariane Mnouchkine. Ils affrontent de multiples pressions et intimidations, allant jusqu’à l’agression physique, de la part d’inconnus mais aussi de leur entourage. Nombre d’Afghans considèrent encore l’art dramatique comme un péché.
« S’exporter » pour vivre de son métier
Les treize membres de la compagnie, qui comprend deux femmes, venus se former en France, ont décidé de ne pas repartir, au moment de la vague d’attentats qui frappe Kaboul en 2010. « Nous avons choisi de construire une vie stable, ici, tout en retournant travailler là-bas, » explique Omid Rawendah, rencontré à la Cartoucherie de Vincennes dans les locaux du « Soleil ». « Nous nous sommes rebaptisés “Le Théâtre Aftaab en voyage”, car notre vocation reste de faire vivre une “maison de théâtre” à Kaboul et de transmettre ce que nous avons appris. » Le risque de subir une attaque terroriste ciblée les en a dissuadés. Un attentat-suicide a eu lieu dans la salle de spectacle de l’institut français, pendant une représentation, en décembre 2014. Hormis le danger, l’absence de financements reste un sérieux obstacle à leur retour.
Car l’argent est bien le nerf de l’art. Dans un pays comme la République du Congo (RDC), vivre de son métier est également une utopie pour un acteur : il n’y a tout simplement pas d’argent. À moins de tenter de passer par le réseau des instituts français fréquentés par l’élite, marche-pied pour « s’exporter » vers la France. Ce qui signifie aussi renoncer à jouer devant ses compatriotes. Une logique présente dans d’autres pays d’Afrique francophone. « L’art est inexistant, il y a une absence totale de soutien de la part de l’institution », affirme Dieudonné Niangouna, homme de théâtre congolais, qui nous a accordé une interview au Tarmac, lieu parisien qui programme régulièrement ses pièces. Lui ne s’est pas contenté de sa réussite personnelle en France, où il publie des textes [2], joue et met en scène des spectacles, y compris au prestigieux Festival d’Avignon (où il était artiste associé en 2013). « L’art, on ne le fait pas pour soi, mais pour les autres, déclare-t-il. Revenir au pays, c’est donner de l’énergie. Et pour croire à ce que l’on fait, on n’a pas besoin de moyens. L’important est d’abord d’y aller ! »
À cheval entre la France et la RDC, cet homme déterminé bataille ferme depuis douze ans pour que vive le festival « Mantsina sur scène ». Avec des bouts de ficelle, l’équipe du festival maintient à bout de bras un espace où le public peut venir entendre de « vraies paroles » dans un pays traumatisé par la guerre civile de 1997, et où le despote Denis Sassou-N’Guesso finance des artistes pour chanter ses louanges. Cette année, le festival met à l’honneur l’écrivain Sony Labou Tansi, grand nom du théâtre congolais à son apogée au début des années 1990.
« L’activité culturelle est la meilleure arme pour combattre le mouvement djihadiste,
Au Burkina Faso, où les premières élections démocratiques viennent de se tenir après vingt-sept années de corruption, de dictature et de néocolonialisme politique, le spectacle vivant, en dehors de la musique, est aussi un gagne-pain incertain. Les artistes n’ont d’autre choix que de travailler pour des ONG qui leur passent commande de spectacles « éducatifs », sur la prévention du sida, par exemple. Le collectif Acmur (Association arts, clowns, marionnettes et musique dans nos rues), dirigé par Boniface Kagambega, a conquis un nouveau lieu pour diffuser ses propres spectacles : la rue.
Leur festival annuel [3] propose aux habitants de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et de la campagne, tous peu accoutumés à ce type d’événement, de découvrir des marionnettistes, des danseurs, des acrobates, des comédiens, venus de toute l’Afrique de l’Ouest. Lui-même marionnettiste, Boniface Kagambega a suspendu sa création personnelle pour mettre sur pied cette manifestation qui repose en grande partie sur la solidarité de festivals et de compagnies françaises. C’est la coopération « Sud-Nord », précise-t-il en inversant, avec un brin de malice, l’expression consacrée.
« Notre ambition est la démocratisation et la décentralisation de l’art et de la culture, souligne le militant artistique. Démocratiser, cela veut dire s’adresser à tous mais aussi permettre une parole libre qui peut aborder des sujets sociaux, comme la parité ou l’excision. » En ce sens, oser produire la comédie satirique Démocratie, I love you, que l’on a vue dans plusieurs festivals français l’été dernier, est un acte courageux. Trois comédiens burkinabés, habillés en gugusses bonimenteurs, décrivent par le menu comment fabriquer un « roi » selon les règles de la corruption, de l’électoralisme et dans le mépris des citoyens – au passage, l’hypocrisie des institutions mondiales n’échappe pas au vitriol. Un vrai succès. « C’est un spectacle qui fait rire avec ce qui nous fait mal », ont confié des spectateurs burkinabés. L’engagement de l’ACMUR se concrétise également par sa participation au mouvement issu de la société civile, Le Balai citoyen, qui a contribué à évincer du pouvoir Blaise Compaoré, à neutraliser le coup d’État de septembre dernier, et à la bonne tenue des élections de novembre.
Poésie et patrimoine oral
Sans nécessairement dénoncer un régime politique, les créations de ces artistes portent en eux une nécessité vitale, une force de résistance. La voix habitée par l’émotion de Waed Bouhassoun fait vibrer les mots des mystiques et des poètes arabes et délivre avec douceur un message de tolérance. Dans sa bouche, la poésie ancienne devient « de ce jour », comme lors du concert d’ouverture du Festival de l’Imaginaire, en octobre dernier à Paris. « Je crois en la religion de l’amour, où que se dirigent ses caravanes », chante-t-elle faisant siens les vers d’Ibn Arabi, poète soufi du XIIIe siècle. Elle exprime sa souffrance de voir la ville de Damas meurtrie, en reprenant le « Fou (amoureux) de Layla », poème du VIIe siècle : « Dites-lui que je l’aime toujours / Aussi loin soit-elle, jamais je ne pourrai l’oublier / C’est elle qui m’a appris comment l’aimer ».
Par-delà sa langue, la musicienne nous touche, et nous fait apercevoir la richesse culturelle des traditions de Syrie, en particulier le patrimoine oral druze, comme les chants de mariage, de plus en plus délaissés au profit de cassettes de musique de variété arabe. « Pour combattre le mouvement djihadiste, l’activité culturelle est, pour moi, la meilleure arme, confie Waed Bouhassoun. L’art en général leur fait peur, parce que cela va ouvrir les mentalités des gens. »
Artistes, guerriers contre la léthargie,le laisser-aller, l’esprit en sommeil
Qu’il joue à Limoges ou à Brazzaville, Dieudonné Niangouna est traversé par une urgence palpable : dans son théâtre, la parole et le corps sont sous haute tension. « En tant qu’artistes, nous devons être des guerriers, s’écrie-t-il. La guerre, nous la menons contre la léthargie, le laisser-aller, l’esprit en sommeil, le fait de croire que tout se vaut. Nous pouvons arracher cela de la tête des gens. Grâce notamment à l’effet miroir que le théâtre produit pour les spectateurs. Et à la clairvoyance. C’est comme desserrer les étaux du projecteur, qui laisse passer plus de lumière. L’urgence est de repousser la mort de la vie. »
Lorsque la troupe afghane joue L’Avare, en langue dari, surtitré en français, à Kaboul mais aussi à Châteauroux ou à Oullins, ou sa création collective Ce jour-là, elle exprime les préoccupations d’une jeunesse qui a grandi sur un champ de bataille et qui aspire à s’ouvrir au monde. Dans La Ronde de nuit, les Afghans donnent la réplique à des comédiens français pour parler de ce que signifie migrer et s’intégrer en France. « Nous voulons montrer que le théâtre, ce n’est pas simplement s’amuser, souligne la jeune Wazhma Tota-Kil, du Théâtre Aftaab. On peut expliquer la réalité, le monde politique, faire comprendre un message. Le théâtre peut changer les idées de quelqu’un. Je l’ai vu, c’est pour cela que je continue. C’est cela qui me donne du courage. »
« Le monde, on le déplace centimètre par centimètre »
Car ces artistes résistants ou combattants enracinent leur admirable détermination dans la foi en leur art. Dieudonné Niangouna croit aux mots. Il cite l’écrivain haïtien Dany Laferrière : « Les mots sont “les plus beaux jouets du monde”. Ce sont des matériaux de réflexion. Ils sont plus savants, plus dangereux, plus subtils que les armes. » À la question de savoir si l’art peut réellement changer les choses, Dieudonné Niangouna répond : « Personne n’a de baguette magique. Le monde, on le déplace centimètre par centimètre. »
Ces deux festivals africains, qui font la part belle à la formation professionnelle « pour remédier au vide », ont déjà transformé le présent des artistes : ce sont des chaudrons où bouillonnent ensemble les énergies créatrices et où des rencontres peuvent se faire pour aider matériellement certains spectacles à voir le jour.
La dernière édition de Rendez-vous chez nous, en février 2015, fut une véritable réussite : le festival a touché 130 000 spectateurs ! L’édition 2016 se déroulera pour la première fois sous un gouvernement démocratiquement élu, celui de Roch Marc Christian Kaboré, élu le 29 novembre dernier. « Il nous faut aider les gens à comprendre qu’ils peuvent dire “nous ne sommes pas d’accord”, explique Boniface Kagambega. Et qu’ils résistent à ceux qui tenteront de les diviser sur des questions ethniques ou religieuses. Nous sommes plusieurs à redouter cela. » Les spectateurs pourront y découvrir un spectacle de cabaret qui interrogera : « que reste-t-il de l’intégrité ? »
Dieudonné Niangouna raconte une petite histoire édifiante. Alors que la guerre civile, durant il a failli laisser sa peau, vient de s’achever, il se rend au marché. Il est interpellé brutalement par une « mama » virulente qui lui demande urgemment de retourner faire du théâtre car elle veut le revoir sur scène, là maintenant, parce que la guerre vient de finir. « Elle a pu exprimer que, pour elle, le théâtre était devenu essentiel », résume-t-il. Preuve s’il en est que le public peut réclamer à cor et à cri cet art-là, substantiel, existentiel, plus encore que politique, et porteur d’une humanité vivante.
Naly Gérard
Photo : la comédie satirique burkinabée Démocratie I Love you.
Infos pratiques : des artistes à suivre
 Festival « Rendez-vous chez nous » : du 6 au 21 février 2016, à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, à Boromo, dans six villages de la commune rurale de Komsilga, et à l’orphelinat de Loumbila. Site : http://acmur-rdvcheznous.org.
Festival « Rendez-vous chez nous » : du 6 au 21 février 2016, à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, à Boromo, dans six villages de la commune rurale de Komsilga, et à l’orphelinat de Loumbila. Site : http://acmur-rdvcheznous.org.
 Association Acmur France :
Association Acmur France :
Machin la Hernie, texte de Sony Labou-Tansi, mise en scène de Jean-Paul Delore, joué par Dieudonné Niangouna, du 13 au 16 avril 2016, au Tarmac, Paris. Site : http://www.letarmac.fr.
À écouter
 L’Âme du luth, de Waed Bouhassoun, CD, Buda/Universal, 2014.
L’Âme du luth, de Waed Bouhassoun, CD, Buda/Universal, 2014.
 Orient-Occident II : Hommage à la Syrie, de Jordi Savall, ensemble Hespérion XXI, avec Waed Bouhassoun, CD, Alia Vox, 2013.
Orient-Occident II : Hommage à la Syrie, de Jordi Savall, ensemble Hespérion XXI, avec Waed Bouhassoun, CD, Alia Vox, 2013.
À voir
 Un Soleil à Kaboul, ou plutôt deux, film documentaire de Duccio Bellugi Vannuccini, Sergio Canto Sabido, Philippe Chevallier, 75 min, DVD, Bel-Air Média-Théâtre du Soleil, 2007.
Un Soleil à Kaboul, ou plutôt deux, film documentaire de Duccio Bellugi Vannuccini, Sergio Canto Sabido, Philippe Chevallier, 75 min, DVD, Bel-Air Média-Théâtre du Soleil, 2007.
À lire
 Acteur de l’écriture, de Dieudonné Niangouna, essai, éditions Solitaires intempestifs, 2013.
Acteur de l’écriture, de Dieudonné Niangouna, essai, éditions Solitaires intempestifs, 2013.







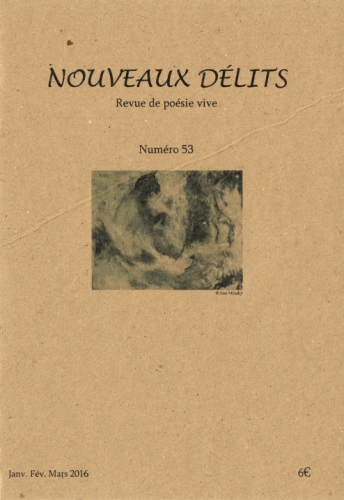






 Né à Kyoto en 1949, Haruki Murakami est un des auteurs japonais contemporains les plus lus au monde. Pressenti pour le prix Nobel depuis 2006, il est traduit en cinquante langues. Fils d’enseignants en littérature japonaise, Haruki Murakami passe son enfance dans une ville portuaire, Kobe, entouré de livres et de chats. Plus tard, il poursuit des études de théâtre et de cinéma à l’université de Waseda. Son imagination est très tôt séduite et façonnée par la littérature américaine, notamment les romans de Raymond Carver, de Raymond Chandler ou de Scott Fitzgerald. Dès 1974, il ouvre un petit bar de jazz, le « Peter Cat », à Tokyo, qu’il va tenir pendant sept ans avant de devenir écrivain. C’est en regardant un match de base-ball, au moment précis où le joueur américain Dave Hilton frappe la balle, qu’Haruki Murakami eut l’idée d’écrire son premier roman, Écoute le chant du vent (1979 – non traduit en Français) qui remporte un succès immédiat et se voit couronné du Prix Gunzo des Nouveaux Écrivains. Premier tome d’une trilogie, ce roman est suivi du Flipper de 1973 (1980) et de La Chasse au mouton sauvage (1982). Haruki Murakami devient dès lors l’un des écrivains japonais les plus populaires au monde. Après la publication de plusieurs romans à succès, Haruki Murakami s’installe à l’étranger. De 1986 à 1989, il vit en Grèce, à Rome et enfin aux États-Unis, où il enseigne la littérature japonaise dans plusieurs universités, dont celle de Princeton. Mais la grave crise économique et sociale que traverse le Japon incite l’écrivain à retourner sur ses terres natales dès 1995. Très marqué par le tremblement de terre de Kōbe, qui lui inspire par la suite le recueil de nouvelles Après le tremblement de terre, Haruki Murakami s’intéresse également à l’attaque terroriste au gaz sarin dans le métro de Tokyo, perpétrée par la secte Aum. Cette tragédie fera l’objet d’un grand livre d’enquête, Underground, dans lequel l’auteur donne la parole aux témoins et aux victimes de l’attaque. Le thème de l’attentat dans le métro figure également dans 1Q84. La plupart des romans d’Haruki Murakami sont traduits en France chez Belfond et repris aux éditions 10/18, parmi lesquels les célèbres Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil, Les Amants du Spoutnik, Kafka sur le rivage ou encore La Ballade de l'impossible. Haruki Murakami a reçu, tout au long de sa carrière, plusieurs distinctions littéraires prestigieuses, notamment le prix Yomiri Literary Prize, le prix Kafka 2006 et le prix Jérusalem de la liberté de l’individu dans la société. Après la trilogie 1Q84, qui a connu un immense succès planétaire, son nouveau roman L'Incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage, numéro un des ventes de livres en 2013 au Japon, paraît aux éditions Belfond à la rentrée 2014. En plus de son travail de romancier, Haruki Murakami est le traducteur en japonais de plusieurs écrivains anglo-saxons incontournables, dont Scott Fitzgerald, John Irving, J.D Salinger ou Raymond Carver. De ce dernier, Haruki Murakami affirme qu’il est le professeur le plus important de son existence, ainsi que son plus grand ami en littérature. Haruki Murakami est également journaliste et essayiste.
Né à Kyoto en 1949, Haruki Murakami est un des auteurs japonais contemporains les plus lus au monde. Pressenti pour le prix Nobel depuis 2006, il est traduit en cinquante langues. Fils d’enseignants en littérature japonaise, Haruki Murakami passe son enfance dans une ville portuaire, Kobe, entouré de livres et de chats. Plus tard, il poursuit des études de théâtre et de cinéma à l’université de Waseda. Son imagination est très tôt séduite et façonnée par la littérature américaine, notamment les romans de Raymond Carver, de Raymond Chandler ou de Scott Fitzgerald. Dès 1974, il ouvre un petit bar de jazz, le « Peter Cat », à Tokyo, qu’il va tenir pendant sept ans avant de devenir écrivain. C’est en regardant un match de base-ball, au moment précis où le joueur américain Dave Hilton frappe la balle, qu’Haruki Murakami eut l’idée d’écrire son premier roman, Écoute le chant du vent (1979 – non traduit en Français) qui remporte un succès immédiat et se voit couronné du Prix Gunzo des Nouveaux Écrivains. Premier tome d’une trilogie, ce roman est suivi du Flipper de 1973 (1980) et de La Chasse au mouton sauvage (1982). Haruki Murakami devient dès lors l’un des écrivains japonais les plus populaires au monde. Après la publication de plusieurs romans à succès, Haruki Murakami s’installe à l’étranger. De 1986 à 1989, il vit en Grèce, à Rome et enfin aux États-Unis, où il enseigne la littérature japonaise dans plusieurs universités, dont celle de Princeton. Mais la grave crise économique et sociale que traverse le Japon incite l’écrivain à retourner sur ses terres natales dès 1995. Très marqué par le tremblement de terre de Kōbe, qui lui inspire par la suite le recueil de nouvelles Après le tremblement de terre, Haruki Murakami s’intéresse également à l’attaque terroriste au gaz sarin dans le métro de Tokyo, perpétrée par la secte Aum. Cette tragédie fera l’objet d’un grand livre d’enquête, Underground, dans lequel l’auteur donne la parole aux témoins et aux victimes de l’attaque. Le thème de l’attentat dans le métro figure également dans 1Q84. La plupart des romans d’Haruki Murakami sont traduits en France chez Belfond et repris aux éditions 10/18, parmi lesquels les célèbres Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil, Les Amants du Spoutnik, Kafka sur le rivage ou encore La Ballade de l'impossible. Haruki Murakami a reçu, tout au long de sa carrière, plusieurs distinctions littéraires prestigieuses, notamment le prix Yomiri Literary Prize, le prix Kafka 2006 et le prix Jérusalem de la liberté de l’individu dans la société. Après la trilogie 1Q84, qui a connu un immense succès planétaire, son nouveau roman L'Incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage, numéro un des ventes de livres en 2013 au Japon, paraît aux éditions Belfond à la rentrée 2014. En plus de son travail de romancier, Haruki Murakami est le traducteur en japonais de plusieurs écrivains anglo-saxons incontournables, dont Scott Fitzgerald, John Irving, J.D Salinger ou Raymond Carver. De ce dernier, Haruki Murakami affirme qu’il est le professeur le plus important de son existence, ainsi que son plus grand ami en littérature. Haruki Murakami est également journaliste et essayiste.
