11/07/2013
Ouz suivi de Ore et de Ex de Gabriel Calderón
traduit de l’espagnol (Uruguay) par Françoise Thanas et Maryse Aubert, Actes Sud 2013
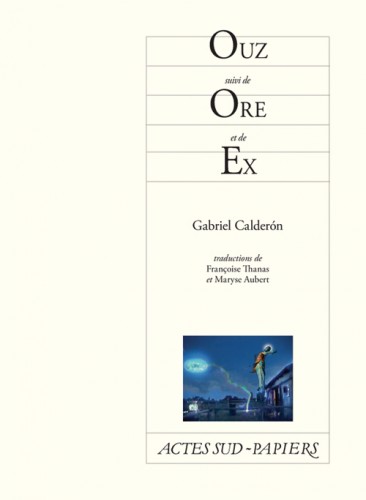
248 pages, 25 euros
Ouz et Ore et Ex, trois pièces d’un jeune auteur, dont les dénominateurs communs sont un humour féroce qui bascule dans le fantastique et l’absurde, caractéristique de beaucoup de bonnes écritures latino-américaines, et le poids de la famille, elle-même bousculée et violentée par le contexte politique, religieux et social. Ces pièces questionnent le fond d’humanité chez l’être humain, et aussi la quête d’amour et de vérité.
Trois pièces de théâtre qui ont pour toile de fond l’Uruguay. Petit pays dont on parle peu, qui comme ses voisins a subi dans les années 70 une dictature sanguinaire avec son lot de tortures, d’assassinats et de disparitions, et qui aujourd’hui est gouverné par José Mujica Cordano, surnommé Pepe Mujica, un étonnant président, ex-guérillero tupamaro. D’ailleurs, une de ses phrases a inspiré l’auteur pour l’écriture d’Ex, la dernière pièce.
La première, Ouz, est de loin la plus drôle et la plus déjantée. On ne s’y attend pas d’ailleurs au début, ce qui la rend encore plus drôle. La pièce démarre dans la cuisine de Grace, une respectable épouse d’un respectable époux, d’une respectable et pieuse famille catholique, vivant dans le tranquille et respectable village d’Ouz, où chacun va à l’église pour glorifier Dieu et où chacun respecte les lois du Tout-Puissant. Or, voilà que Dieu s’adresse personnellement à Grace, alors qu’elle est seule dans sa cuisine. Il s’adresse à elle comme n’importe qui le ferait, en lui parlant. Grace, ne pouvant le voir, a bien du mal à le croire, aussi sa foi est-elle mise à rude épreuve, et elle le sera encore plus quand Dieu va lui demander de lui prouver son amour, en tuant un de ses enfants.
Grace et son époux ont deux enfants, Tomàs, qui est beau, fort et fait son service militaire, et Dorotea, plus jeune, qui est autiste. Ce que Dieu lui demande là est absolument impensable, terrible, mais Grace a confiance en Dieu, plus que tout, et elle ne voudrait pas qu’il pense qu’elle n’est pas digne de sa confiance. Elle n’a pas le droit de parler à qui que ce soit de cette conversation avec Dieu, mais elle a besoin de confier son cruel dilemme à Jack son mari, quand il rentre ce soir-là. Lequel des deux enfants va-t-elle tuer ? Ce qui fait bien rire Jack, qui pas une seconde ne pense que sa femme est sérieuse, et quand il s’aperçoit qu’elle pense vraiment ce qu’elle dit, il prend peur et court chercher le curé pour un exorcisme. C’est ainsi qu’au fur et à mesure des tentatives avortées de Grace pour sacrifier un de ses enfants, et de ses mensonges de plus en plus éhontés, en même temps que le ton des dialogues va changer du tout au tout, entreront en scène d’autres personnages : Père Maykol, le curé, José le boucher et Catherine sa fille ; Fiona et Leona, deux sœurs voisines de Jack et Grace, et tout ce petit monde aux prises avec un imbroglio de plus en plus complexe et délirant, va révéler les dessous de ce village si tranquille et parfait, dans une spirale d’absurdités de plus en plus monumentales, où tous les tabous se verront balayés. C’est une pièce extrêmement subversive et hilarante, au rythme très dynamique qui se déverse en flot de dialogues où la vulgarité se fait libératrice, jusqu’au dénouement, qui lui aussi est des plus inattendus. Cette surenchère d’absurdités et de provocations donne à cette pièce la dimension d’une véritable et jouissive satyre sociale et religieuse.
La deuxième pièce, Ore, sous-titrée Peut-être la vie est-elle ridicule ?, paraît du coup plus fade, et surtout elle est plus difficile à suivre, car les personnages, suite à une arrivée d’extra-terrestres, changent de corps, si bien que chaque personne s’exprime dans le corps d’une autre. Le fond de la pièce est politique, et fait référence aux enlèvements durant la dictature et l’implication embrouillée des uns et des autres.
C’est aussi le cas d’Ex, sous-titrée Que crèvent les protagonistes ?, qui met en scène Ana et son fiancé Tadéo. Ana est jeune, elle n’a pas connu la dictature, mais elle voudrait connaître enfin la vérité sur les lourds secrets qui pèsent sur sa famille. Pourquoi certains ont disparu, pourquoi d’autres ne se parlent plus, mais la plupart sont déjà morts. Son fiancé, Tadéo, va, pour lui prouver son amour et grâce à une machine à remonter le temps qu’il a lui-même conçue, ramener du passé les uns après les autres, jusqu’à rassembler tout le monde, le temps d’un repas de Noël, Graciela, la mère d’Ana, Jorge, son père, et José, le frère de ce dernier, mort sous la torture, et Antonio, son grand-père et père de sa mère. Ana et Tadéo ont aussi invité Julia, l’autre grand-mère, mère de Jorge et José, la seule à être encore vivante. Mais rien ne se passera exactement comme l’avait espéré Ana, et le prix à payer pour connaître la vérité sera bien plus lourd qu’elle ne l’aurait imaginé. Remuer le passé et en ramener ses protagonistes ne sera pas sans conséquence. Cette pièce qui fait des va-et-vient entre temps présent et scènes du passé, met en lumière toute la complexité des situations de ces pays qui ont connu des dictatures, avec toute la souffrance provoquée qui perdure au présent, longtemps après, dans les non-dits, les crimes impunis, les familles désunies, les secrets qui rongent. Et cela peut-être, au moins tant que ne sont pas morts tous les protagonistes. C’est la question que se pose Gabriel Calderón dans son prologue.
« Il ne suffit pas qu’ils meurent, IL FAUT QUE CRÈVENT TOUS LES PROTAGONISTES ».
Cathy Garcia

Note parue sur : http://www.lacauselitteraire.fr/ouz-suivi-de-ore-et-de-ex...
14:29 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
09/07/2013
Guerriers amoureux de Jean-Louis Costes
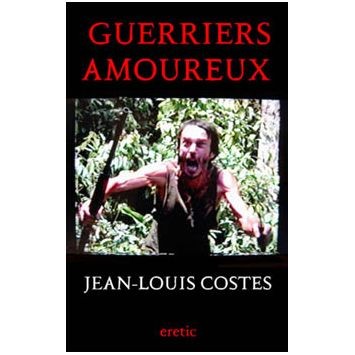
Edition Eretic, avril 2013, 286 pages, 17 €.
Dégueulasse, dégoûtant, obscène, scato, taré… et drôle, corrosif, rarement ennuyeux et bien écrit. Costes est un écrivain, n’en déplaise à ceux qui ne supportent pas qu’on puisse écrire caca dans un roman. Les qualificatifs péjoratifs ne manquent pas pour qualifier l’écriture de Costes, et chacun à un moment ou à un autre, comme dans un effet miroir, se verra confronté à ses limites. Ça en devient presque initiatique, certains laisseront tomber de suite, d’autres ne voudront même pas toucher le livre, d’autres iront plus loin, voire jusqu’au bout pour se sentir comme les deux antihéros de l’histoire : de vrais hommes, voire de vraies femmes. Ce qui est intéressant d’ailleurs, ce serait de savoir combien finalement vont jusqu’au bout en prenant des airs dégoûtés ? Costes se lit-il en cachette comme une revue porno ? Il me semble que c’est la même chose avec ses performances, il met le public face à un miroir, le plus extrême possible. Ainsi, d’autres iront jusqu’au bout peut-être parce qu’ils découvriront que ça les excite, ils en apprendront ainsi sur eux-mêmes et libre à eux ensuite d’en chercher le pourquoi, comment, papa, maman, etc. D’autres iront jusqu’au bout, même si par moment le roman leur tombe sur le moral comme un gourdin goudronné, sans doute parce qu’eux même sont autant dégoûtés que fascinés par l’humanité, au point de la chercher partout, et c’est un peu comme Dieu, elle se cache parfois là où on n’ira jamais la chercher. Pour Costes, c’est très certainement au fond d’un trou de balle. Plus clinique que pornographique, son roman plonge obsessionnellement dans les entrailles, au propre, c'est-à-dire crade, mais aussi paradoxalement au plus profond de l’âme humaine. C’est un constat pas très réjouissant d’ailleurs, Costes exagère mais jusqu’à quel point ? Ne mettrait-il pas plutôt le doigt et plus dans ce que l’on ne veut pas voir ? Ou juste à doses homéopathiques par le biais d’infos aseptisées ou au cinéma, pour le frisson. La crasse, la folie, la déchéance, la drogue, la violence et le sexe comme antidépresseur, on baise comme on hurle, pour se sentir vivant. Les épaves sont légions dans une société où règne mensonge, lâchetés, corruption et cupidité, et dire qu’on ne peut rire de tout, c’est bon pour celles et ceux qui n’ont pas encore goûté au grands fonds, ceux qui ont un arôme de chiasse, de poissons pourris et de fûts percés, où la vie ne vaut pas un clou et l’enfance se viole au petit-déjeuner. Nul n’ignore que l’humain, confronté à certaines situations et substances, peut devenir une créature bien plus cruelle et dégénérée que le plus féroce animal, mais c’est toujours l’autre, si possible le plus loin et le plus étranger possible. L’écriture de Costes pourrait jouer une sorte de rôle cathartique. En endossant toutes les perversions, toutes les saloperies humaines, le lecteur en ressort lavé, purifié, soulagé peut-être. Ouf, ce n’est pas lui ! Pour qui veut lire entre les lignes, au delà de la provocation, cette vulgarité est l’arbre qui cache la forêt. En rester là, ce serait passer à côté de la grande fragilité, l’évidente sensibilité et une lucidité écorchée vive, de l’auteur. Un roman pertinent, mais oui, qui dresse un constat sans pitié du monde actuel, cru, grinçant et souvent insoutenable, aucun puritain ni survivrait, mais le côté trash ne leurrera pas le lecteur déniaisé. Costes a un humour et un sens de l’autodérision qui sauvent de tout, c’est drôle et désespéré. Le paradoxe du titre, Guerriers amoureux en dit bien plus long qu’il n’y parait. En filigrane permanent, une quête d’amour, de paix, de beauté et de simplicité, toujours empêchée par un monde dingue qui part en couille, ravagé par le crack depuis la banlieue parisienne jusqu’au fin fond du désert ou de la jungle amazonienne. On a beau se voiler la face, serrer les fesses et se pincer le nez, le monde il est aussi comme ça, beaucoup même. C’est donc, littéralement, un roman d’aventures extrêmes, que jamais aucune marque sportive ne voudrait sponsoriser.
Cathy Garcia
 Jean-Louis Costes est né le 13 mai 1954 à Paris. Père militaire, mère catholique pratiquante, il a été éduqué par les pères des collèges catholiques. En 1968, il tombe amoureux d'une jeune fille de son lycée Anne Van Der Linden qui deviendra plus tard décoratrice et actrice de ses shows. Il quitte sa famille et vit tel un zonard, paumé et drogué. En 1972, il obtient son baccalauréat et débute des études d'architecture à l'école des beaux-arts de Paris. Il obtient le diplôme. En 1978, il voyage à travers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud (La Guyane deviendra son lieu de prédilection). Dans les années 80, il se réfugie dans la cave de sa grand-mère pour se consacrer uniquement à la musique. La cave désormais sera son milieu ambiant préféré, non par goût mais par nécessité. Il s’échappe aussi dans une cabane au milieu de la forêt guyanaise pour respirer. Artiste underground, subversif, amoral, transgressif, antihéros complètement déjanté. Sur scène et dans ses livres, aucune limite, il exploite tous les tabous, les thèmes les plus ambigus, scatologie en tête. On l’aime ou le plus souvent on le déteste, mais on ne peut rester indifférent. Ses réalisations, quel que soit le domaine via lequel il éructe, littéraire, performances live, films ou musique, toujours au degré maximum de la provocation aux yeux d’une certaine normalité en tout cas, sont toutes guidées par un sens aigu de l’autodérision, de l’absurde et de la bouffonnerie, avec beaucoup d’humour et en filigrane dans la surexcitation et l’explosion des sens, une quête de transcendance. Son cheval de Troie est la nullité. C’est en réalité une immense farce au sens mystique du terme, et cela peut évoquer le théâtre de l’absurde de Jodorowski ou celui de la cruauté d’Artaud. En 1986, il a publié chez Fayard, Grand-père, l’histoire d’un grand père arménien, cosaque, légionnaire, bagnard et collabo.
Jean-Louis Costes est né le 13 mai 1954 à Paris. Père militaire, mère catholique pratiquante, il a été éduqué par les pères des collèges catholiques. En 1968, il tombe amoureux d'une jeune fille de son lycée Anne Van Der Linden qui deviendra plus tard décoratrice et actrice de ses shows. Il quitte sa famille et vit tel un zonard, paumé et drogué. En 1972, il obtient son baccalauréat et débute des études d'architecture à l'école des beaux-arts de Paris. Il obtient le diplôme. En 1978, il voyage à travers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud (La Guyane deviendra son lieu de prédilection). Dans les années 80, il se réfugie dans la cave de sa grand-mère pour se consacrer uniquement à la musique. La cave désormais sera son milieu ambiant préféré, non par goût mais par nécessité. Il s’échappe aussi dans une cabane au milieu de la forêt guyanaise pour respirer. Artiste underground, subversif, amoral, transgressif, antihéros complètement déjanté. Sur scène et dans ses livres, aucune limite, il exploite tous les tabous, les thèmes les plus ambigus, scatologie en tête. On l’aime ou le plus souvent on le déteste, mais on ne peut rester indifférent. Ses réalisations, quel que soit le domaine via lequel il éructe, littéraire, performances live, films ou musique, toujours au degré maximum de la provocation aux yeux d’une certaine normalité en tout cas, sont toutes guidées par un sens aigu de l’autodérision, de l’absurde et de la bouffonnerie, avec beaucoup d’humour et en filigrane dans la surexcitation et l’explosion des sens, une quête de transcendance. Son cheval de Troie est la nullité. C’est en réalité une immense farce au sens mystique du terme, et cela peut évoquer le théâtre de l’absurde de Jodorowski ou celui de la cruauté d’Artaud. En 1986, il a publié chez Fayard, Grand-père, l’histoire d’un grand père arménien, cosaque, légionnaire, bagnard et collabo.
Pour en savoir plus : http://jeanlouiscostes.free.fr
Mais l’antre de la bête est ici : http://www.costes.org
12:32 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
08/07/2013
Le faucon errant de Jamil Ahmad
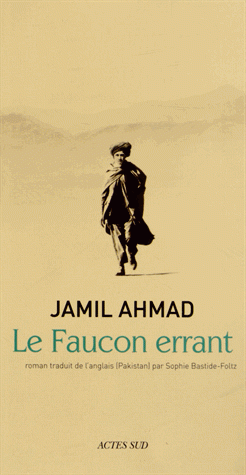
À l’âge de 5 ans, Tor Baz qui ne s’appelle pas encore ainsi, se retrouve abandonné en plein désert auprès d’un chameau mort. Ses parents qui s’aimaient d’un amour illégitime, ayant fui leurs tribus respectives avant même qu’il ne soit conçu, sont rattrapés et assassinés selon la dure loi tribale. Tor Baz sera alors recueilli par un vieux chef nomade, puis par un mollah mécréant, vagabond et rusé qui finira dément, et enfin par une famille Bhittani.
C’est cette famille qui lui donnera le nom de leur fils défunt, Tor Baz, Faucon Noir, qui deviendra le Faucon Errant que nous retrouverons tout au long du livre. Un livre que Jamil Ahmad a pu écrire en regroupant des notes prises durant plusieurs décennies dans ces zones tribales, où il exerçait comme haut fonctionnaire pakistanais. Une région où venaient se heurter cultures ancestrales, nomadisme et modernité, une région aux enjeux politiques, stratégiques et religieux extrêmement compliqués et où les innombrables tribus résistaient farouchement à tout pouvoir et ingérence étatique, sans parler des tentatives d’influences allemandes ou britanniques, qui plus tard seront soviétiques et américaines. Là réside le grand intérêt de ce livre, nous faire pénétrer au cœur de ces territoires bien éloignés de toute littérature, mal connus, peuplés d’hommes simples et rudes, exceptionnels aussi d’humanité tout autant que capables d’une grande cruauté. On y rencontrera des chefs tribaux, des mollahs miséreux, des hommes sages, humbles et honnêtes, d’autres fort corrompus, des femmes aussi soumises que robustes et courageuses. Des paysans, des villageois, des bandits, des soldats, des fonctionnaires, des kidnappeurs saisonniers, des vendeurs d’informations, des vendeurs de femmes, d’opium et de haschisch, de glace des glaciers, de champignons séchés ou de kebab, un montreur d’ours et un guide de haute-montagne qui retombera aussi bas qu’il était monté haut. Des morceaux de vie captés et entremêlés au cœur de paysages érodés et quelques vallées plus accueillantes. On entendra les vents des montagnes et du désert y chanter le nom de tout un tas de tribus telles que Siahpad, Baloutche, Brahui, Kharot, Pawindah, Bhittani, Pachtoune, Massoud, Wazir, Afridi, Mohmand, Gujjar… et nous verrons chacune lutter pour sa survie, sans que jamais toutefois ne soit oubliée la règle première et essentielle de l’hospitalité.
Cathy Garcia
 Né en 1933, haut fonctionnaire pakistanais aujourd’hui à la retraite, Jamil Ahmad exerça principalement dans la province frontalière du Baloutchistan. Il a également occupé un poste à l’ambassade pakistanaise à Kaboul avant et pendant l’invasion de l’Afghanistan par les Soviétiques. Il vit actuellement à Islamabad. Avec Le Faucon errant, son premier roman, il est devenu, à soixante-dix-huit ans, le « nouvel auteur phare » de la littérature pakistanaise. Ces expériences lui ont permis de décrire au plus juste la vie de ces régions interdites (aux frontières de l’Iran, du Pakistan et de l’Afghanistan) avant la montée des Talibans. Aujourd’hui les « zones tribales » sont le plus souvent décrites comme des régions reculées, nids de conspirateurs et cibles des attaques de drones.
Né en 1933, haut fonctionnaire pakistanais aujourd’hui à la retraite, Jamil Ahmad exerça principalement dans la province frontalière du Baloutchistan. Il a également occupé un poste à l’ambassade pakistanaise à Kaboul avant et pendant l’invasion de l’Afghanistan par les Soviétiques. Il vit actuellement à Islamabad. Avec Le Faucon errant, son premier roman, il est devenu, à soixante-dix-huit ans, le « nouvel auteur phare » de la littérature pakistanaise. Ces expériences lui ont permis de décrire au plus juste la vie de ces régions interdites (aux frontières de l’Iran, du Pakistan et de l’Afghanistan) avant la montée des Talibans. Aujourd’hui les « zones tribales » sont le plus souvent décrites comme des régions reculées, nids de conspirateurs et cibles des attaques de drones.
Photo (c)Fauzia Minallah
Note parue sur : http://www.lacauselitteraire.fr/le-faucon-errant-jamil-ah...
22:17 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
05/07/2013
Massalia Blues de Minna Sif
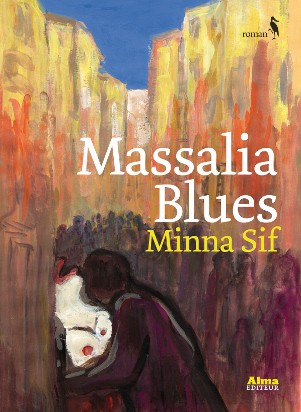
Être aimé ne sert à rien.
Pour ne pas être seul,
Il faut être capable d’aimer
Dino Buzatti
Minna Sif nous plonge au cœur d’une sorte de cour des miracles, pègre et misère s’y côtoient, pour le pire et exceptionnellement pour le meilleur. C’est Marseille la belle, ses quartiers, son vieux port, ses vendeurs à la sauvette, ses marchands de sommeil, ses parias et ses prostituées, et dans cette cour grouillante de la ville basse, un roi découronné pousse son Caddie. Clochard et clandestin, fier et roublard, Brahim refuse d’aller chercher des papiers à la préfecture. Et cela, malgré les offres d’aide insistantes de la narratrice, écrivain public du côté de la Poste Colbert, pour tout un monde sans voix, parfois même sans droits. Enfant déjà, elle était la voix de ses parents, venus eux aussi de douars marocains aux noms imprononçables.
« Cet emploi d’écrivain public était pour moi un pont ténu entre une population venue de l’autre bord de la méditerranée et cet autre monde bien ordonné qui ne voulait d’eux que du bout des lèvres, du bout de ce tutoiement dont on les gratifiait encore trop souvent ».
Brahim, vieux fou, est aussi un conteur hors pair. Lui, dont la vie comme tant d’autres a fait le grand écart au-dessus de la Méditerranée, ne transporte pas qu’un affreux cabot déplumé et tout un tas de vieilles saloperies au fond de son Caddie, mais aussi des pelletées d’histoires incroyables, dont les héroïnes sont des femmes, que dis-je, des furies, des ogresses débordantes de chair et de vie. Fadéla la dégourdie, Zina la morte, Leïla la putain aux dents d’or, Haffida la dévoreuse, Fatem la poétesse, la blonde Antoinette et d’autres encore. Mères, grand-mères, sœurs, épouses, maîtresses… Tout un univers féminin aussi jouissif qu’étouffant, en butte à la brute lâcheté des hommes.
Hardie, sacrément fleurie et explosive, l’écriture de Minna Sif déborde comme une opulente poitrine du corsage étroit de la bienséance. Elle ne craint pas de tremper sa plume dans les sucs et les fiels, l’amour et la haine étant bien souvent trop emmêlés pour pouvoir les distinguer. Les cris, la rage, les larmes, le sperme et les vers qui rongent les plaies. L’humanité dans toutes ses splendeurs et ses déchéances, excessive et délirante comme l’amour de ces mères du sud pour leur progéniture, à Marseille, aussi bien que dans les douars marocains.
On se perd dans la narration un peu brouillonne, forcément, à l’image de ce bouillon de cultures, d’où jaillissent cependant des envolées de génie. Il y a du fellinien, du rabelaisien… Nul n’y est à une fourberie ou une contradiction près, nous ne sommes pas chez ceux qui pètent dans la soie le petit doigt levé. Ici, c’est avec les poings et le verbe haut que la vie se conjugue. C’est à peine exagéré, comme la vie de Brahim, c’est un vécu du feu de dieu, à moins que ce ne soit celui d’un djoun, et c’est donc aussi forcément marseillais.
Un lexique à la fin permet de s’y retrouver dans les emprunts à la langue arabe et on apprend ainsi qu’Harraguas signifie littéralement « brûleurs de frontière » et désigne les jeunes émigrants qui rejoignent l’Europe clandestinement au péril de leur vie, et que les Hittistes, « teneurs de murs », sont de jeunes diplômés chômeurs qui passent la journée adossés à un mur. Massalia Blues à nous en faire rougir les tympans. Ça se lit avec le sourire, le souffle court et une certaine stupéfaction. Tant de gouaille sous la plume d’une jeune fille, ça ne s’invente pas, ça se vit et se transmet comme un bouton de fièvre. Âmes délicates s’abstenir, mais ce serait dommage.
Cathy Garcia
 Minna est née en Corse, dans une famille originaire du Sud marocain. Elle vit à Marseille où elle anime des ateliers d’écriture dans les quartiers Nord. Son premier roman, Méchamment berbère (Ramsay, 1997), a été réédité chez J’ai Lu, dans la collection Nouvelle génération. Elle a également écrit des nouvelles publiées dans des revues (Gulliver, La Pensée de Midi…) et des ouvrages collectifs : Scandale (Chihab, 2010) et Une enfance Corse (Bleu autour/ Colonna 2010). Auteure associée au Théâtre de la Mer, dans le cadre de Marseille Capitale européenne de la Culture 2013, elle a participé au projet international « Foot(ing) Marseille » en animant de nombreux ateliers d’écriture à destination des jeunes et des adultes.
Minna est née en Corse, dans une famille originaire du Sud marocain. Elle vit à Marseille où elle anime des ateliers d’écriture dans les quartiers Nord. Son premier roman, Méchamment berbère (Ramsay, 1997), a été réédité chez J’ai Lu, dans la collection Nouvelle génération. Elle a également écrit des nouvelles publiées dans des revues (Gulliver, La Pensée de Midi…) et des ouvrages collectifs : Scandale (Chihab, 2010) et Une enfance Corse (Bleu autour/ Colonna 2010). Auteure associée au Théâtre de la Mer, dans le cadre de Marseille Capitale européenne de la Culture 2013, elle a participé au projet international « Foot(ing) Marseille » en animant de nombreux ateliers d’écriture à destination des jeunes et des adultes.
Note parue sur : http://www.lacauselitteraire.fr/massilia-blues-minna-sif
21:37 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
27/05/2013
Etre adulte en amour de David Richo

traduit de l’anglais (USA) par Clémence Ma
Petite bibliothèque Payot 2013
382 pages, 9,65 €
Il existe une infinité d’ouvrages sur le sujet, mais celui-ci est plutôt exceptionnel. Centré sur une approche à la fois psychologique et spirituelle, il offre des outils très concrets pour ceux qui souhaitent les mettre en application, mais il propose surtout un grand voyage holistique introspectif, très fouillé, pointu et cependant à la portée de tout le monde. Cela en fait un livre remarquable, lumineux, où l’amour est à la fois la voie, la destination et le moyen de transport. Un ouvrage qui peut être d’un grand secours à tous les couples qui cherchent à se comprendre, à avancer ensemble, à affronter et dépasser les conflits, les problématiques inhérentes à leur relation, mais c’est aussi un manuel pratique de guérison et de sagesse pour tous, car il ouvre des perspectives d’équilibre et de force personnelle et d’amour inconditionnel applicable partout et pour toutes les situations, qu’elles soient amoureuses, familiales mais aussi sociales et professionnelles.
Il y est question d’attention, d’acceptation, d’appréciation, d’affection et d’autorisation, une base sur laquelle peut se construire ou se réparer chacun d’entre nous, qui s’appuie aussi sur des références poétiques et la pratique de la connaissance de soi des philosophies bouddhiste et zen, entre autres. On apprend ainsi à distinguer un égo sain et fonctionnel, d’un ego névrotique qui nous coupe de toutes possibilités de recevoir et de donner de l’amour. Un livre construit comme un voyage héroïque plein d’aventures et d’étapes, un voyage que chacun se doit d’accomplir, à son rythme et selon ses propres particularités, celles qui font de lui un être entier et unique, pour accéder à l’autonomie et la pleine conscience et être capable d’entretenir des relations saines avec lui-même et donc avec les autres. Ainsi le terme « adulte » prend toute sa dimension, en ouvrant sur de vastes horizons vers lesquels nous pouvons nous diriger, confiants, libérés de notre passé, des croyances et des blessures que chacun d’entre nous porte en lui, souvent sans même en avoir conscience, qui nous contrôlent et peuvent nous empêcher d’accéder à la joie de vivre pleinement l’amour. Rares et précieux sont les ouvrages qui montrent le chemin, avec autant de clarté et de pertinence.
A lire aussi du même auteur : Être adulte : les clés, qui donne une bonne introduction au livre proposé ci-dessus.
Cathy Garcia
 David Richo, psychothérapeute, enseigne au célèbre Institut Esalen en Californie. Il est l’auteur également de Pouvoir des coïncidences et des Cinq choses qu’on ne peut pas changer dans la vie.
David Richo, psychothérapeute, enseigne au célèbre Institut Esalen en Californie. Il est l’auteur également de Pouvoir des coïncidences et des Cinq choses qu’on ne peut pas changer dans la vie.
Note parue sur http://www.lacauselitteraire.fr/etre-adulte-en-amour-davi...
21:26 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
11/05/2013
La Guerre secrète de Guénane
Apogée, octobre 2011, 123 pages, 15 €
Elle s’appelle Lucie, elle est jeune, belle et pleine de vie. Il s’appelle Émilien, il est jeune, beau et il joue merveilleusement bien de la mandoline. Ils sont tous deux orphelins, fous amoureux et veulent se marier. Seulement voilà, Émilien est malade.
« Elle le savait atteint par le bacille honteux. Ses proches la mettaient en garde, avec plus ou moins de franchise ou d’élégance, mais tous lui faisaient le même grief : on n’épouse pas quelqu’un qui va mourir ; un mariage, c’est d’abord de l’espoir ».
Mais l’amour rend immortel et rien ne pouvait détourner les tourtereaux de leur rêve d’union.
« Veux-tu toujours t’envoler avec moi, même si l’arrêt est brutal ?
(…)
Oui, Émilien, avec toi j’irai même en enfer ».
Aussi, passés leurs vingt-et-un ans, ils s’épousèrent envers et contre toutes les langues perfides. Un an passera, durant lequel le bonheur des jeunes mariés commence déjà à perdre de l’éclat. Le bacille s’est fait discret mais Émilien compense sa maladie par des excès de bon vivant, et une rechute l’oblige à partir en sanatorium. Avec la distance, les lettres se remplissent de mots d’amour, mais Lucie commence à sentir le poids de cette fatalité qui menace et peu à peu en elle, commence à se livrer une guerre des sentiments, une guerre secrète. En même temps, en Espagne, gronde la menace d’une autre guerre, une guerre qui se répand très vite d’un pays à l’autre avec la montée en puissance d’« un petit nerveux avec la moustache de Charlot, atteint d’une faim sans fond appelée annexion ». Très vite, la France elle aussi, est en guerre, mais pour l’instant cela ne semble que des mots. Émilien après avoir dû reporter plusieurs fois son retour, finit par rentrer du sanatorium. Il ne pouvait partir au combat, son état en avait fait un réformé définitif.
« Émilien revient, reposé, tendre, toujours plus habile, émouvant à la mandoline, mais toujours aussi contagieux et Lucie, d’un trait rageur, raya le mot guérison dans le dictionnaire ».
Vient la débâcle, « la guerre n’était plus “bidon”, elle devenait oppressante ». Lucie et Émilien vivent à Lorient, un port militaire, et tandis que Lucie se débat avec sa guerre civile intérieure, son horreur grandissante de la maladie mêlée de sentiments de jalousie après la découverte d’une photo dans le portefeuille d’Émilien, arrive le moment où « deux jours plus tard, les Allemands pénétraient dans la ville. Ce fut un tel fracas de moteurs et de chenilles que les vitres et les nerfs tremblèrent pendant des heures. Désormais, les drapeaux nazis flottaient partout, rouges avec des croix noires, araignées du chagrin ».
Désormais, il faudra faire avec ! « Longtemps cette phrase pour les Bretons sous-entendit : avec les femmes et le mauvais temps. Depuis la guerre, le champ des calamités tendait vers l’infini ».
L’auteur nous fait vivre ce Lorient occupé comme si nous y étions. En plus de sa véracité historique, l’écriture a le don de nous faire vivre de l’intérieur cette période terrible, et l’histoire de Lucie n’est pas juste une fiction, l’auteur y glisse une grande part de vérité aussi, parce qu’il est nécessaire d’affronter le passé, pour libérer le présent, et que la recherche de la vérité n’obscurcit pas forcément l’horizon. Dans le chaos des bombardements, de la peur, des restrictions, des arrestations, Émilien et Lucie vont chacun tracer comme ils peuvent leur chemin. Survivre. Émilien participant à la résistance malgré ou peut-être à cause de son état, Émilien qui fume encore et donc l’état ne cesse d’empirer. Émilien qui sera arrêté et jeté au cachot, puis relâché parce que même pas bon à être gardé prisonnier, et Lucie qui continue à travailler comme accompagnatrice de bus, qui rend service comme elle peut, ramenant des vivres de la campagne. Lucie qui un jour par hasard, à Pontivy, « s’apprêtait à entrer dans l’Hôtel des Voyageurs pour y prendre une menthe avant le retour, lorsqu’un homme en sortit, chapeauté, ganté, grand, beau comme au cinéma. Leurs regards s’effleurèrent, ils s’offrirent un sourire, elle en fut chamboulée ».
Cet homme, ce Monsieur Gentil auquel elle ne pourra cesser de penser, s’appelle Alex, elle le saura parce qu’elle le reverra, et il souhaitera rencontrer Émilien et ils deviendront amis, puis elle et lui, deviendront amants, mais à la grande déception de Lucie, c’est avec Émilien qu’il aura une véritable complicité. Émilien qui ne fera aucune remarque quand le ventre de Lucie commencera à s’arrondir, et d’ailleurs elle mettra du temps à admettre qu’en temps de guerre, un ventre qui s’arrondit, ce n’est pas par excès de gourmandise. Et elle vivra comme une ultime trahison le départ des deux hommes pour une virée en Gironde, alors qu’elle doit rester seule et enceinte. « Elle vécut ce départ comme un abandon. À qui en voulait-elle le plus ? À ce mari, habité par la vie, guettée par la mort, qui riait de tout, même de son ventre qui bientôt lui lécherait le menton ? À cet homme beau “comme rêve d’amour”, passager énigmatique, tentateur chaleureux s’encombrant d’un sac d’os et de bacilles ? À la vie dont elle n’avait jamais trouvé le sens ? Le verdict de sa guerre civile intérieure refusa de trop accabler le condamné ; mais monsieur Gentil devint “une sorte de démon qui a embobiné Émilien” ».
Ainsi viendra au monde une petite fille et Lucie refusera tout ce qui vient d’Alex, il devient le centre de sa rage, de son chagrin, tandis qu’Émilien meurt peu à peu, tandis qu’au dehors la guerre continue. « Lucie se fichait bien des salauds de miliciens, de la France combattante, de l’armée secrète et des FTP. Sa lutte à domicile lui suffisait. La mort, elle l’avait à sa porte, tapie jusqu’à l’heure dite, écrite quelque part ».
La Guerre secrète est une tranche de vie, arrachée à l’oubli, au déni aussi qui habitera Lucie, longtemps, très longtemps, même si cela n’est pas raconté dans le livre. Une histoire, comme il en existe tant et tant, mais chacune en réalité est unique, bouleversante et devient un vrai roman quand elle est racontée avec autant d’amour et de talent.
Cathy Garcia
 La ville de Lorient ayant été détruite par les Alliés en 1943, Guénane est née au cœur de la Bretagne. Après des études de Lettres à Rennes où elle a enseigné, elle a longtemps vécu en Amérique du Sud. En 1968, elle envoya son premier manuscrit, Résurgences, à l’éditeur René Rougerie. En 2014 devrait paraître son quatorzième recueil, Un Rendez-vous avec la dune. Elle a publié aussi 12 livrets chez La Porte, dont Venise ruse en 2012, des livres d’artiste et une dizaine de récits et romans dont le dernier, Dans la gorge du diable, chez Apogée en 2013. www.guenane.fr
La ville de Lorient ayant été détruite par les Alliés en 1943, Guénane est née au cœur de la Bretagne. Après des études de Lettres à Rennes où elle a enseigné, elle a longtemps vécu en Amérique du Sud. En 1968, elle envoya son premier manuscrit, Résurgences, à l’éditeur René Rougerie. En 2014 devrait paraître son quatorzième recueil, Un Rendez-vous avec la dune. Elle a publié aussi 12 livrets chez La Porte, dont Venise ruse en 2012, des livres d’artiste et une dizaine de récits et romans dont le dernier, Dans la gorge du diable, chez Apogée en 2013. www.guenane.fr
Note parue sur : http://www.lacauselitteraire.fr/
16:25 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
03/05/2013
Le gardien invisible de Dolores Redondo

Voici le premier roman d’une trilogie policière qui se déroule au Pays Basque espagnol. Des adolescentes sont retrouvées dans la vallée de Baztán, étranglées, les vêtements déchirés de part et d’autre de leur corps, maquillage effacé et un txatxingorri déposé sur leur pubis rasé. Les txatxingorris sont des gâteaux typiques de la région. De plus, des poils d’origine animale sont retrouvés sur chacune d’elles. L’enquête est confiée à l’inspectrice Amaia Salazar, originaire d’Elizondo, le chef-lieu de la vallée, qui n’y était jamais revenue depuis qu’elle l’avait quitté. Amaia Salazar est une femme fine et intelligente, dotée d’une ferme volonté, formée au FBI, elle est spécialisée dans la traque de tueurs en série. C’est donc confiante dans ses capacités qu’elle va se lancer, plus ou moins bien secondée de ses co-équipiers, dans une course contre la montre pour identifier et arrêter le tueur, mais ce retour sur les lieux de son enfance, où elle a encore de la famille, est loin d’être anodin. Surtout qu’une de ses deux sœurs, Flora, prend visiblement plaisir à réactiver ce passé.
« Oublier est un acte involontaire. Plus on essaie de laisser quelque chose derrière soi, plus cette chose vous poursuit ».
Et ce retour va la déstabiliser bien plus qu’elle ne le pensait. Tout s’enchevêtre au fur et à mesure, le passé, le présent, l’enquête et sa propre et douloureuse histoire, ce qui lui rend les choses de plus en plus difficiles. Elle va devoir faire face à ses propres démons, affronter ce qu’elle fuit depuis des années et admettre des blessures profondes. C’est un défi qu’elle relèvera, soutenu par la présence et l’amour de son mari, un peintre américain, et d’une tante qui sait beaucoup de choses à propos de l’âme humaine. Ils lui seront d’un grand secours quand ses propres facultés mentales sembleront sur le point de basculer.
Peut-être que dans la solution à l’énigme posée par ces meurtres se cache aussi la résolution de ce passé qui la hante.
Aux passions et folies humaines se mêleront mystère, tradition et folklore, tels que le basajaun, cet être mythique qui semble rôder sur les lieux du crime, la déesse Mari, les lamies, mi-femmes mi-serpents, les fées et les belagiles, ces sorcières obscures… Un polar dense et captivant qui prend source dans l’atmosphère particulière du pays de Navarre, entre montagnes, forêt profonde et rivières, et qui serpente aisément entre modernité et croyances populaires, pour le plus grand plaisir du lecteur.
Cathy Garcia
 Dolores Redondo est née en 1969 à San Sebastian. Après un roman historique, Los privilegios del angel (2009), elle signe avec Le Gardien invisible son premier roman policier qui inaugure « la trilogie du Batzan ».
Dolores Redondo est née en 1969 à San Sebastian. Après un roman historique, Los privilegios del angel (2009), elle signe avec Le Gardien invisible son premier roman policier qui inaugure « la trilogie du Batzan ».
Note parue sur : http://cathygarcia.hautetfort.com/archive/2013/05/03/le-g...
14:49 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
18/04/2013
La femme en vol d'Ile Eniger

Collection main de femme, éditions Parole 2012.
250 pages, 12 €
La femme en vol, c’est l’histoire d’une femme et son intimité amoureuse, familiale, racontée à la troisième personne du singulier. Une histoire qui se révèle par petites touches, comme une peinture. Et justement, cette femme, c’est Fane et Fane aime Jean, Jean qui aime Fane. Mais voilà, Jean aime aussi la solitude et la peinture, et Fane va peu à peu apprendre le prix de cet amour qui est à la hauteur de ses exigences. Aimer Jean, c’est l’accepter tout entier, parce-que la solitude et la peinture l’emporteront sur son amour de femme, exigeant, exclusif, immense. Ce que Jean et Fane partagent et ne cesseront de partager, le ciment ou plutôt les ailes de leur amour, c’est une soif éperdue d’authenticité et de liberté.
« Bien sûr qu’elle avait eu envie de baisser les bras, de rentrer dans ces rangs bien droits, bien rassurants, bien sagement préparés pour toi des que tu montre ta tête. Bien sûr que la facilité avait été tentante, la banalité attestée est tellement plus confortable que le contre-courant ! On t’aime quand tu commences à ressembler à tout le monde ! Tu oublies qui tu es, pour quoi tu es, et ceux qui pensent à ta place se font un plaisir d’organiser tes limites. On te coule dans le moule sans qu’un poil ne dépasse, tu es reconnu ! »
Fane, sa liberté, elle la trouvera dans l’écriture, mais elle est femme et donc capable d’aimer plusieurs choses en même temps, se donner à toutes avec la même force, le même bonheur. Les hommes ne savent pas aimer comme les femmes. Ils aiment autrement, certains ne savent pas du tout aimer, mais Jean lui, il aime Fane et de cet amour est née une Belle Cerise, qui grandira en même temps que ses parents dans un mas retapé de l’arrière-pays niçois. Ce nid d’amour que Fane quittera un jour parce qu’elle doit le faire, parce qu’elle est une femme en vol.
Ce livre est bon comme un pain qui sort du four, beau comme un jardin sauvage, doux comme la fourrure d’un chat et puissant comme le mistral. C’est un roman d’amour qui va au-delà de l’amour, dans ce qui le sublime et le transcende. Ainsi l’amour ne peut mourir, seuls les masques et les oripeaux brûlent, mais quelque chose demeure, le noyau même de l’amour, qui est fait de poésie pure, mystique parfois, une quête éperdue de beauté, d’intensité. Fane n’est pas une femme de compromis, elle s’affirme dans ce qu’elle est, ce qu’elle pense, envers et contre toute attente sociale, elle est libre et seul un amour comme celui de Jean peut la rendre plus libre encore.
« – Tu comprends, à choisir un code je n’en vois qu’un : l’amour. Je me fiche que cela paraisse désuet, ou décrété impossible par une tonne de crétins. Il y a une perfection quelque part, je la cherche. Je ne vis pas à contre-courant j’essaie d’aller dans mon courant. »
Ce qui peut sembler aux yeux d’autrui comme une dépendance, l’impossibilité de tourner une page, est en fait une plongée dans la source même de l’amour. Un amour inconditionnel où le don devient une immense richesse, et que peut-on donner de plus grand que l’acceptation de la liberté de l’autre. C’est véritablement l’envol au–dessus des contingences, celle qui nous sont imposées par les règles sociales, mais aussi par nous-mêmes. La femme en vol est un bonbon qui fond sous la langue, un bonbon à la menthe poivrée, rafraichissant, vivifiant. On se régale à le lire, il contient tout un tas de trésors. La simplicité y devient un art de vivre et on touche à l’absolu, quelque chose qui ne se dit pas, mais qui s’éprouve, qui met tous les sens en éveil. C’est de la haute-voltige et heureux soient celles et ceux qui en saisiront toute la profondeur.
Cathy Garcia
 Ile Eniger est née en 1947. Poète et romancière, elle vit dans un petit village de l’arrière-pays niçois. Son œuvre, importante, répond à l’urgence d’écrire, impérative et vitale comme celle de la respiration. Une ile à aborder : http://insula.over-blog.net
Ile Eniger est née en 1947. Poète et romancière, elle vit dans un petit village de l’arrière-pays niçois. Son œuvre, importante, répond à l’urgence d’écrire, impérative et vitale comme celle de la respiration. Une ile à aborder : http://insula.over-blog.net
Bibliographie :
Empreintes (épuisé) Éditions Corporandy
Regards vers ailleurs (épuisé) Éditions Alternatives et Culture
Éditions Cosmophonies
La parole gelée
Les terres rouges
Une pile de livres sous un réverbère
Du feu dans les herbes
Celle qui passe
Éditions Chemins de Plume
Du côté de l’envers (Illustrations Émile Bellet)
Il n’y aura pas d’hiver sans tango, mon amour
Le bleu des ronces
Bleu miel
Terres de vendanges
Et ce fut le jardin - (Photos Dominique Cuneo)
Poivre bleu
Un violon sur la mer
Boomerang
Le raisin des ours (à paraître juin 2013 aux Éditions Chemins de Plume)
Éditions Collodion
L’Inconfiance – (Dessin Claire Cuenot)
Un coquelicot dans le poulailler
Éditions Le Libre Feuille
Le désir ou l’italique du jour – (Encres Michel Boucaut)
Une ortie blanche - (Gravures Michel Boucaut) – Prix du Livre d'Artiste Salon d'Automne Paris 2012
D'une île, l'autre – (Correspondances avec le chanteur auteur-compositeur Dominique Ottavi) Éditions Amapola
En préparation : Recueil de textes poétiques à 2 voix avec l'écrivain québécois Jean-Marc La Frenière – Parution au Canada en 2014
18:30 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (1)
13/04/2013
Superman est arabe de Joumana Haddad
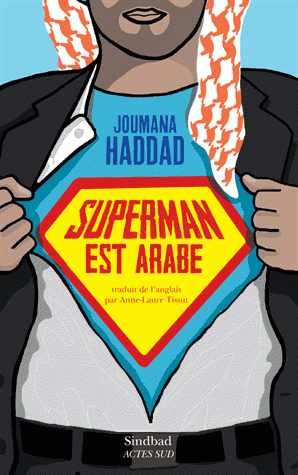
traduit de l’anglais par Anne-Laure Tissut, Sindbad/Actes Sud, février 2013. 232 pages, 20 €.
Joumana Haddad, dans la continuité de J’ai tué Shérazade, nous donne à lire un pamphlet aussi réfléchi que passionné, bouillonnant, à la fois très personnel dans la forme : truffée de citations qui soulignent les propos, elle alterne faits, pensées, coups de gueule, récit, poésie, témoignages - et d’une nécessité universelle vitale dans le fond. Ce livre sous-titré « De Dieu, du mariage, des machos et autres désastreuses inventions » est une attaque en règle contre le système patriarcal qui sévit dans le monde arabe mais pas seulement, loin de là. Un système qui s’enracine ici dans les trois religions monothéistes, avec tout ce qui en dérive : machisme, discrimination, violence, assassinat, privation de liberté et qui, si les femmes en sont les victimes directes, n’épargne pas non plus les hommes, qui se doivent d’adopter certains comportements, qui ne font que camoufler en vérité, un profond malaise, des peurs et un sentiment d’insécurité non affrontés de face et qui surtout les empêchent d’accéder à la totalité de leur être et donc à leur propre liberté.
« (…) il m’apparut un jour comme une évidence que ce monde, et en particulier les femmes, n’avait que faire d’hommes d’acier. Ce qu’il leur fallait c’était des hommes véritables. (…) Des hommes qui ne se croient pas invincibles, qui n’ont pas peur de dévoiler leur côté vulnérable, qui ne cachent pas, que ce soit à vous ou à eux-mêmes, leur véritable personnalité. Qui n’hésitent pas à demander de l’aide quand ils en ont besoin. Qui sont fiers que vous les souteniez comme ils sont fiers de vous soutenir. Des hommes qui ne s’identifient pas à la taille de leurs pénis ou à l’abondance de leur pilosité. Des hommes qui ne se signifient pas par leur performance sexuelle ou par leurs comptes en banque. Des hommes qui vous écoutent vraiment, au lieu de vous venir en aide avec condescendance. Des hommes véritables, qui ne se sentent pas humiliés ou castrés parce que, de temps à autre, ils peinent à obtenir une érection. De vrais hommes qui discutent avec vous de ce qui est mieux pour tous deux au lieu de dire, sur un ton arrogant : « Laisse-moi m’en occuper ! ». (…) des hommes qui partagent avec vous leurs problèmes et leurs préoccupations, au lieu de s’obstiner à tenter de tout résoudre tout seuls. Des hommes qui, en un mot, non pas honte de vous demander la direction à suivre, au lieu de prétendre tout savoir, souvent au risque de se perdre. »
D’où le titre « Superman est arabe ».
« (…) le vrai problème, c’est que ceux qui adhèrent à cette idée de Superman sont convaincus d’en être l’illustration. Et leurs actes sont en conformité avec cette conviction. Et c’est là que tout commence à dérailler. C’est là que les leaders se révèlent être des despotes, les patrons des esclavagistes, les croyants des terroristes et les copains des tyrans. Leur formule favorite c’est : « Je sais mieux que toi ce dont tu as besoin ».
Mais la perpétuation d’un système patriarcal dépassé n’est pas seulement de la responsabilité des hommes.
(…) Mais, s’il nous faut supporter l’existence de Superman, il n’est pas le seul à blâmer. N’oublions pas que ce sont des femmes qui on pourvu à son éducation. Des mères ignorantes, des petites amies superficielles, des filles complaisantes, des sœurs qui se posent en victime, des épouses passives, et ainsi de suite. »
C’est pourquoi il s’agit d’un combat qui doit impliquer les hommes autant que les femmes, car c’est toute l’humanité qui doit évoluer, et non pas hommes contre femme ou vice et versa, mais bien les deux ensemble pour le profit de tous. C’est ce que Joumana Haddad appelle le féminisme de la troisième vague et qui est la suite des premières vagues, nécessaires mais elles aussi aujourd’hui, dépassées. Il s’agit de sortir de la logique de guerre des sexes, pour entrer dans un partenariat évolué, libre et libérateur, où chacune et chacun se retrouve en tant qu’individu, avec ses particularités propres et toute sa dignité, dans des relations de réciprocité clairement choisies.
Joumana Haddad nous parle de l’amour, du sexe, de la fidélité, de l’image que la femme est censée donner à la société, qu’elle ait entièrement disparu sous une burqa ou soit entièrement nue sur du papier glacé, elle nous parle du mariage, de la vieillesse, de religion et de politique. Elle s’implique dans tout ce qu’elle défend avec une sincérité décapante, crue dirons certains qui ne s’habituent toujours pas à ce que les femmes puissent l’être, et elle conserve un sens de l’humour salvateur, car ce combat est loin d’être facile.
« J’ai toujours farouchement évité de jauger ma valeur dans le regard des autres parce que c’est cela, le véritable adultère : c’est se trahir soi-même. »
Sa position de Libanaise, issue d’une famille catholique, la place au centre même de l’hydre monothéiste tricéphale. D’ailleurs au sujet des femmes, le catholicisme et le judaïsme n’ont rien à envier aux intégrismes islamiques. Il faut donc du courage et de la verve, et elle ne manque ni de l’un, ni de l’autre, d’autant plus que malgré un grand succès à l’étranger, elle a choisit de rester vivre au Liban pour distiller sa parole de l’intérieur. Elle nous offre avec chaleur et générosité, une ode, provocante si besoin, à la vie et à la liberté, où la poésie, plus qu’un art de vivre, est l’art d’être vivant.
Joumana Haddad s’exprime avec force pour celles, mais aussi ceux, qui ne le peuvent pas, et si chacune et chacun, avec sa sensibilité propre, ne se retrouvera pas forcément dans tous ses propos, il va de soi que ce livre est un bon coup de pied dans une fourmilière non seulement poussiéreuse, mais aussi extrêmement active et toxique pour l’humanité.
« C’est la guerre des sexes, me direz-vous. Ne serait-ce pas plutôt le moment de déclarer le match nul et de nous remettre en question ? »
Cathy Garcia
 Joumana Haddad est née le 6 décembre 1970. Elle dirige les pages culturelles du quotidien An-Nahar, ainsi que le magazine Jasad (Corps), qu’elle a fondé en 2009. Journaliste et traductrice polyglotte, elle a interviewé de grands écrivains comme Umberto Eco, Wole Soyinka, Paul Auster, José Saramago et Mario Vargas Llosa. Poétesse, elle a publié cinq recueils, dont Le Retour de Lilith (Babel n° 1079), pour lesquels elle a reçu divers prix, notamment le prix de la fondation Metropolis bleu pour la littérature arabe (Montréal, 2010).
Joumana Haddad est née le 6 décembre 1970. Elle dirige les pages culturelles du quotidien An-Nahar, ainsi que le magazine Jasad (Corps), qu’elle a fondé en 2009. Journaliste et traductrice polyglotte, elle a interviewé de grands écrivains comme Umberto Eco, Wole Soyinka, Paul Auster, José Saramago et Mario Vargas Llosa. Poétesse, elle a publié cinq recueils, dont Le Retour de Lilith (Babel n° 1079), pour lesquels elle a reçu divers prix, notamment le prix de la fondation Metropolis bleu pour la littérature arabe (Montréal, 2010).
Publications en arabe
Invitation à un dîner secret, poésie, Éditions An Nahar, 1998
Deux mains vouées à l’abîme, poésie, Éditions An Nahar, 2000
Je n’ai pas assez péché, poésie, Éditions Kaf Noun, 2003
Le Retour de Lilith, poésie, Éditions An Nahar, 2004
La Panthère cachée à la naissance des épaules, poésie, Éditions Al Ikhtilaf, 2006
En compagnie des voleurs de feu, entretiens avec des écrivains internationaux, Éditions An Nahar, 2006
La mort viendra et elle aura tes yeux, 150 poètes suicidés dans le monde, anthologie poétique, Éditions An Nahar, 2007
Mauvaises Habitudes, poésie, Éditions ministère de la culture égyptienne, 2007
Miroirs des passantes dans les songes, poésie, Éditions An Nahar, 2008
Géologie du Moi, poésie, Arab Scientific Publishers, 2011
Publications et traductions en français
Le temps d'un rêve, original en français, Poésie, 1995
Le Retour de Lilith, traduit par Antoine Jockey, Paris, Éditions L’Inventaire, 2007/ Nouvelle édition 2011 chez Actes Sud, Paris
Miroirs des passantes dans le songe, traduit par Antoine Jockey, Paris, Éditions Al Dante, 2010
J'ai tué Shéhérazade. Confessions d’une femme arabe en colère, traduit par Anne-Laure Tissut, Arles, Actes Sud, 2010
Les amants ne devraient porter que des mocassins, original en français, littérature érotique, 2010, Éditions Humus
Superman est arabe, traduit par Anne-Laure Tissut, Arles, Actes Sud, 2013
21:51 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
07/04/2013
Tous les hommes de ce village sont des menteurs de Megan K. Stack
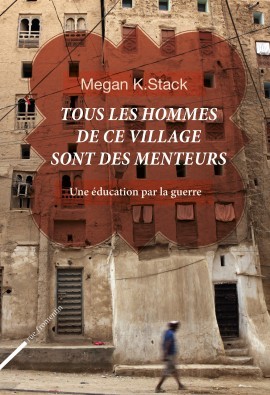
traduit de l'anglais (américain) par Martial Lavacourt.
Éditions rue Fromentin, janvier 2013. 412 pages, 20 €
Ce livre dont le titre évocateur fait référence à une parabole, « S’il dit la vérité, alors il ment. S’il ment, alors il dit la vérité », est un livre dont il est difficile de parler tellement il remue en nous nombre de questionnements et d’émotions. On s’y enfonce, au fur et à mesure de la lecture, avec une sensation de poids grandissante, sans doute de la même façon que l’auteur a vécu toutes ces expériences, ces rencontres, en tant que reporter de guerre, comme on dit. Et il s’agit bien de ça, effectivement, mais comment rapporter ainsi des évènements aussi brutaux sans s’y retrouver totalement impliqué, chamboulé, transformé pour toujours ? C’est impossible, et pourtant il y a une nécessité de rapporter l’irracontable, de raconter pour celles et ceux qui n’ont pas ou plus de voix, voire de vie. Tout commence après le 11 septembre 2011, la jeune journaliste, âgée alors de 25 ans, est envoyée par le L.A. Times en Afghanistan, alors qu’elle n’a jamais, jusque là, couvert de conflit. De conflit, c'est-à-dire LA guerre, toujours la même finalement, quels que soient les partis, les pays, les groupes, les confessions impliquées, quels que soient les prétextes invoqués. Il n’y qu’UNE guerre, insupportable de violence, d’arbitraire, de mensonges, d’enfances massacrées, de lieux dévastés, de drames qui entrainent d’autres drames. Un enfer, LA guerre, qui commence bien avant et finit bien après – si jamais elle finit- qu’elle ne prenne son nom. Des balles, des bombes, des blessés mutilés à vie, des cadavres, du meurtre et du sang, la peur, la faim, la destruction, la folie, la suppression quasi totale de tout rêve… et comment un semblant de vie, de normalité peut se frayer un chemin à travers les décombres. Cette première expérience en Afghanistan, sera comme définitive pour Megan K. Stack, jamais plus elle ne pourra retourner en arrière. Il lui sera impossible de rester aux États-Unis, alors comme elle ne peut oublier, elle va accepter toutes les missions, aller de l’avant, parcourir toute cette « région du monde » comme on désigne souvent le Moyen-Orient. Elle va chercher les clés, accumuler les témoignages avec une espèce d’avidité insatiable, que la peur ne fera qu’attiser. Elle portera son métier de journaliste en bouclier, jusqu’à s’oublier elle-même totalement, comme si cela pouvait peut-être apporter une réponse à ce qui n’a aucun sens et ne peut en avoir. C’est comme ça qu’après l’Afghanistan, il y aura Israël et la Palestine, puis l’Irak, la Lybie, la Jordanie, l’Arabie Saoudite, le Yémen, le Liban, l’Égypte, l’Irak encore et de nouveau le Liban en 2006, sous les bombes israéliennes… C’est un témoignage passionnant, unique, très personnel, celui d’une journaliste et femme de surcroit, dans un monde déjà difficile d’accès en tant que telle, et elle est allée au plus près des gens, au cœur des conflits comme on dit dans le jargon, si seulement une guerre pouvait avoir un cœur. Une quête, que son statut d’américaine a rendu sans doute encore plus essentielle, elle va au-delà des apparences, des discours officiels, des vérités établies, des partis pris ou à prendre et elle y va avec son professionnalisme, mais aussi et peut-être surtout, avec amour. Ce n’est pas un roman qui se lit avec plaisir, même si la qualité d’écriture de Megan K. Stack, bien rendu par son traducteur, donne à ce récit la puissance d’une véritable œuvre littéraire, mais outre qu’on apprend beaucoup en le lisant sur des situations extrêmement complexes, on se doit de lire se livre parce que, faisant partie de la communauté humaine, chaque bombe qui tombe quelque part sur cette planète nous concerne, qu’on le veuille ou non, parce que nul ne peut ignorer la souffrance de l’autre, qui a plus de choses en commun avec lui que de différences, à savoir : le désir d’une vie paisible et heureuse, la possibilité de rêver et d’offrir un avenir à ses enfants. C’est pour cela que certain(e)s font des métiers qui au péril de leur vie, leur permettent d’aller chercher la parole, les images et de les transmettre afin qu’elles circulent, et que l’horreur ne puisse être indéfiniment camouflée, étouffée sous le vacarme de spots publicitaires et autres diversions, là où la guerre ne frappe pas, là où on n’imagine même pas qu’elle puisse exister pour de vrai. Et quand la guerre frappe, c’est toujours aveuglément, il n’y a pas et il ne peut y avoir de guerre juste et il ne peut y avoir non plus de retour en arrière. « Ce fut la première chose que j’ai appris de la guerre. Vous vous souvenez ? Vous pouvez survivre et ne pas survivre, les deux à la fois. »
Cathy Garcia
 Megan K. Stack est grand reporter pour le L.A. Times. Tous les hommes de ce village sont des menteurs, son premier livre, a été finaliste du Prix Pulitzer. Elle est aujourd’hui correspondante du L.A. Times en Chine.
Megan K. Stack est grand reporter pour le L.A. Times. Tous les hommes de ce village sont des menteurs, son premier livre, a été finaliste du Prix Pulitzer. Elle est aujourd’hui correspondante du L.A. Times en Chine.
15:18 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
15/03/2013
Les possédés de la pleine lune de Jean-Claude Fignolé
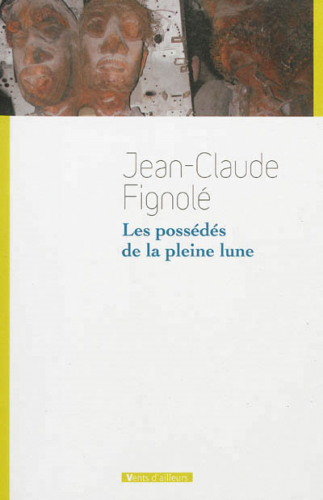
Vents d'Ailleurs, octobre 2012 (première édition en 1987 chez Seuil),
221 p. 19 €
Si l’on est de celles et ceux qui veulent tout comprendre et immédiatement, on prend le risque en lisant ce livre, d’un mal macaque, une gueule de bois, dans la langue haïtienne, car tout y est inextricablement emmêlé. Passé, présent, la nuit et le jour, la mort et l’amour, mythe et réalité, les histoires et les destinées, le rire et les larmes, espoir, désespoir, rêve et cauchemar. Tout est vivant, tout cherche à s’exprimer, même les morts. Tout a une âme, le ciel, la terre, l’eau, les animaux, tout est personnifié, même les objets, les maisons, tout est magie et même le malheur, omniprésent, est une force vitale dans ce village des Abricotiers, qui ne peut que se relever toujours et encore, entre deux désastres, qui ne manquent pas de le ravager.
Ouragans, sécheresses, inondations, deuils innombrables et la monstrueuse bête à sept têtes qui dévore régulièrement dans ce pays d’Haïti, chaque nouvelle pousse de liberté et de démocratie. Peu à peu, quelques personnages se dégagent du magma de cette langue incroyablement dense et riche, avec laquelle l’auteur nous dépeint ce petit village, coincé entre mornes et océan.
Il y a d’abord Agénor et sa femme Saintmilia, couple pivot du roman.
« Agénor avait vécu retiré avec sa femme aux limites du cimetière, cultivant dans la solitude de sa chaumière un goût de la singularité qui avait ouvert la porte à tous les fantasmes. Il dormait le jour, péchait la nuit, rentrait à l’aube, sa tête et son panier pullulant de poissons aussi gros que l’église. Les hommes du village le disaient bizarre. Certains insinuaient même qu’il était fou. Ils l’avaient jugé différent pour mieux opposer à cette différence une attitude collective dans laquelle entraient sans aucun doute la crainte, l’envie, la jalousie sinon la haine ».
Et puis, il y a Louiortesse, le rival, défiguré par Agénor, qui reviendra plus tard aux Abricotiers et cette mystérieuse savale borgne, un immense poisson des eaux mêlées qu’Agénor, éborgné lui aussi depuis la fameuse nuit où il avait faillit la pêcher, n’aura de cesse de traquer pour assouvir une folle soif de vengeance. Et puis encore la belle Violetta, la fille de Diéjuste, qui elle aussi s’en va au bord de l’étang de Pombucha, les nuits de pleine lune, et qui donnera naissance à Rosita, fille de l’eau et de la terre. Et tous les autres encore qui prennent place dans le tableau. Un tableau qui ne cessera de se modifier, où régulièrement un seau de pluie ou de clairin viendra tout barbouiller. C’est comme si l’auteur lui-même était possédé tour à tour, mais souvent en même temps, par chacun des habitants des Abricotiers, quand ce n’est pas par le vent ou un fantôme, le soleil ou la lune.
La mémoire collective elle-même s’empare de sa plume et cette plume se fait pressoir, dans lequel passe le village des Abricotiers avec toute son histoire et ce roman en est le jus concentré, de ce village particulier, mais aussi de tout ce fabuleux pays qu’est Haïti, avec sa beauté, sa magie, ses folies, sa douleur. Un jus épais, à la fois amer et sucré, miroir où vient se mirer le monde et dans lequel on se perd, on s’égare et se noie avec délectation.
C’est un livre qui ne se lit pas avec la tête, mais avec le ventre, avec la peau, avec le souffle. Un grand livre, dont la trame est une spirale, un roman d’une beauté féroce, plein d’humanité, avec un humour et une poésie inimitables, intimement liés à cette terre haïtienne. Envoûtant, il fond sous la langue, il enivre comme plusieurs maries jeannes de clairin, alors plongez-y, baignez-vous dedans, buvez jusqu’à plus soif, mais ne cherchez pas à tout comprendre de suite, cela vaut mieux, vous prendriez le risque d’un mal macaque.
Cathy Garcia
 Jean-Claude Fignolé est un écrivain haïtien né le 24 mai 1941 à Jérémie (Haïti). Il est l’un des fondateurs du mouvement littéraire appelé spiralisme en collaboration avec Frankétienne et René Philoctète. Dans les années 1980, Jean-Claude Fignolé apporte un support essentiel aux habitants du petit village des Abricots dans la Grand’Anse, dont il est originaire. Père de trois enfants (Jean-Claude O. Fignolé, Christina Fignolé et Klavdja Annabel Fignolé), Jean-Claude Fignolé est aujourd’hui maire de la commune des Abricots depuis 2007. Il assiste les habitants dans un travail de développement de toute nécessité (reboisement, éducation, santé, constructions routières, agriculture) afin de freiner l’exode rural prépondérant en Haïti. Épargné par le séisme du 12 janvier 2010, le village des Abricots a dû accueillir plusieurs milliers de rescapés qui ont fui la capitale. Jean-Claude Fignolé a dû abandonner sa plume pour se consacrer entièrement à cette cause.
Jean-Claude Fignolé est un écrivain haïtien né le 24 mai 1941 à Jérémie (Haïti). Il est l’un des fondateurs du mouvement littéraire appelé spiralisme en collaboration avec Frankétienne et René Philoctète. Dans les années 1980, Jean-Claude Fignolé apporte un support essentiel aux habitants du petit village des Abricots dans la Grand’Anse, dont il est originaire. Père de trois enfants (Jean-Claude O. Fignolé, Christina Fignolé et Klavdja Annabel Fignolé), Jean-Claude Fignolé est aujourd’hui maire de la commune des Abricots depuis 2007. Il assiste les habitants dans un travail de développement de toute nécessité (reboisement, éducation, santé, constructions routières, agriculture) afin de freiner l’exode rural prépondérant en Haïti. Épargné par le séisme du 12 janvier 2010, le village des Abricots a dû accueillir plusieurs milliers de rescapés qui ont fui la capitale. Jean-Claude Fignolé a dû abandonner sa plume pour se consacrer entièrement à cette cause.
Bibliographie :
Etzer Vilaire, ce méconnu, Port-au-Prince, Imprimerie Centrale, 1970.
Pour une poésie de l’authentique et du solidaire « ces îles qui marchent » de René Philoctète, Port-au-Prince, éd. Fardin, 1971.
Gouverneurs de la rosée : hypothèses de travail dans une perspective spiraliste, Port-au-Prince, éd. Fardin, 1974.
Vœu de voyage et intention romanesque, Port-au-Prince, Fardin, 1978.
Les Possédés de la pleine lune, Paris, Seuil, 1987.
Aube tranquille, Paris, Seuil, 1990.
Hofuku, Port-au-Prince, éd. Mémoire, 1993.
La dernière goutte d’homme, Montréal, Regain/CIDIHCA, 1999.
Moi, Toussaint Louverture… avec la plume complice de l’auteur, Montréal, Plume & Encre, 2004.
Faux Bourdons, in Paradis Brisé : nouvelles des Caraïbes, Paris, Hoëbeke, coll. Étonnants voyageurs, 2004, p. 87-131.
Le voleur de vent, in Nouvelles d’Haïti (collectif), Paris, Magellan & Cie, 2007, p. 37-52.
Une heure avant l’éternité, extrait de Une journée haïtienne, textes réunis par Thomas C. Spear, Montréal, Mémoire d’encrier / Paris, Présence africaine, 2007, p. 179-184.
Une heure pour l’éternité, Paris, éd. Sabine Wespieser, 2008.
Note parue sur La Cause Littéraire
19:50 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
08/03/2013
Nouvelles calédoniennes
Note parue sur http://www.lacauselitteraire.fr/nouvelles-caledoniennes

Vents d’ailleurs 2012
128 pages, 14,20 €
Sept auteurs, sept nouvelles, comme les sept notes de musique pour la richesse d’une mélodie, sept couleurs pour peindre l’arc-en-ciel d’une terre, celle de Nouvelle-Calédonie, terre de contraste, de métissage comme de conflits, terre d’ancêtres pour les uns, d’enracinement ou de passage pour d’autres. Sept nouvelles aussi différentes que les origines de leurs auteurs, et pourtant une terre, une seule, qui devient le lien, le creuset où se mélangent culture, rêves et parcours de chacun.
Sept nouvelles où souvenirs et fiction s’entremêlent pour tisser comme un manou, ce morceau d’étoffe à la fois utile et symbolique dans la coutume Kanak. Les Kanaks qui, ne l’oublions pas, sont le premier peuple de cette terre et on retrouvera leur souffle dans la majeure partie des nouvelles du livre, même si les auteurs sont d’origines diverses : kanak pour Waej Génin-Juni et Denis Pourawa, métisse pour Noëlla Poemate, néo-calédoniens de naissance comme Frédéric Ohlen et descendant de familles migrantes installées là depuis le XIXe siècle comme Nicolas Kurtovitch, mais aussi Française de Belfort comme Claudine Jacques, ayant pris racine là-bas à l’adolescence ou encore Bretonne partie vivre là-bas en 1989, comme Anne Bihan.
Toutes et tous ont en commun l’amour de l’écriture et d’une terre, avec un attrait et un respect certains pour sa culture première. On croisera dans ces nouvelles maints personnages et quelques destins tragiques, comme celui de la jeune Maeva dans Hula de Waej Génin-Juni, ou de René Lebel, atteint d’une terrible et infamante maladie dans Condamné à perpétuité de Claudine Jacques, ou encore celui de l’ami d’enfance disparu sous un éboulement dans L’allée couverte de graviers blanc de Nicolas Kurtovitch. On y lira des odeurs, des paysages, la végétation luxuriante, des questionnements à la croisée des cultures, entre tradition et modernité. Dans L’horloge végét@le, on entrera dans la tête aux circonvolutions plus qu’originales de Denis Pourawa qui, grâce à son horloge intérieure, a trouvé comment s’évader avec intelligence du temple unique des dépouilleurs de conscience. Frédéric Ohlen lui, dans Zénon ou les hirondelles, prenant en quelque sorte le contre-pied de la thématique Nouvelles calédoniennes, raconte une histoire qui se déroule en France pendant la dernière guerre et nous y fait rencontrer Yasmina, une jeune algérienne. Les hirondelles, beau symbole des mouvements migratoires qui insupportent les esprits étroits. Il y sera question de déracinement et de comment les destins de chacun se croisent pour le meilleur comme pour le pire.
Être ou ne pas être de là où l’on est, elle est là la question. Appartenir à un lieu c’est sans doute important, plus important encore est sans doute d’appartenir à soi-même, d’avoir l’esprit libre et une pensée vaste et ouverte à toutes sortes de pensées différentes. C’est peut-être ça que l’on peut, ou que l’on doit retenir, de ce petit voyage en Nouvelle-Calédonie.
Cathy Garcia
Vents d’ailleurs est une maison fondée en 1999 par Jutta Hepke et Gilles Colleu. Nous éditons des livres venus des cultures d’ailleurs, proches ou lointaines, convaincus que la connaissance des cultures du monde aide à bâtir une société plus solidaire et plus intelligente. Le catalogue de Vents d’ailleurs construit des passerelles vers ces imaginaires, propose des livres pour enrichir les êtres humains dans leur recherche d’humanité. La littérature est ainsi très présente dans le catalogue, mais également les albums jeunesse, l’art et les sciences humaines. Le plaisir de la découverte, la curiosité permanente, un non-conformisme littéraire revendiqué permettent à Vents d’ailleurs d’éditer des ouvrages qui reflètent les mille plaisirs de la vie, la diversité des idées du monde, les imaginaires les plus singuliers. Nous sommes membre de l’Alliance des éditeurs indépendants pour participer à la construction de réseaux à travers le monde, pour défendre une certaine idée de l’édition de création, pour défendre le livre et la lecture comme ouverture sur le monde et non comme un produit consommable, interchangeable et jetable comme un autre. Nous sommes un éditeur indépendant de création, nous défendons la bibliodiversité car l’offre pléthorique de livres n’équivaut pas à la diversité et la pluralité des idées. Vents d’ailleurs est également membre de l'association Éditeurs sans frontières et de l'association Jedi Paca. Vents d'ailleurs est signataire de la Déclaration des éditeurs indépendants du monde latin signée par 70 éditeurs venus de 23 pays, réunis à en novembre 2005 à l’occasion de la rencontre Les éditeurs indépendants du monde latin et la bibliodiversité, organisée par l’Union latine, l’Alliance des éditeurs indépendants, et le Centre régional pour la promotion du livre en Amérique latine et dans la Caraïbe (CERLALC) dans le cadre de la Foire internationale du Livre de Guadalajara au Mexique.
13:53 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
23/02/2013
Pensées étranglées d’E.M. Cioran

Gallimard, coll. Folio « sagesses »
janvier 2013. 88 pages. 2 €.
Ces textes sont extraits du Mauvais démiurge (Gallimard, collection NRF Essais, 1969). Plongeons-y sans rien savoir de Cioran ou tout du moins en oubliant ce que l’on sait, afin d’entrer directement dans l’essence de ce qui est écrit.
Toutes les voies peuvent mener à la sagesse, y compris celles du désespoir et du pessimisme les plus noirs, bien qu’on ne puisse imaginer qu’elles aient été délibérément choisies. Cioran en tout cas, y est naturellement enclin, et on lui doit outre une intelligente réflexion poussée parfois jusqu’à son extrême, des éclairs de génie qu’il traduit en phrases lapidaires, d’une force percutante et d’un humour ironique sans doute salvateur.
« Dieu est le deuil de l’ironie. Il suffit pourtant qu’elle se ressaisisse, qu’elle reprenne le dessus, pour que nos relations avec lui se brouillent et s’interrompent. »
La frontière entre les deux étant mince, son ironie flirte souvent avec le cynisme, mais Cioran est doté d’un sens aigu de la critique dont il ne s’exclut pas et d’un besoin sans doute intense de sincérité avec lui-même.
« Rien ne donne meilleure conscience que de s’endormir avec la vue claire d’un de ses défauts, qu’on n’osait pas s’avouer jusqu’alors, qu’on ignorait même. »
Dans de ce petit condensé de ses pensées « étranglées », il s’appuie sur les croyances gnostiques pour développer l’idée que l’humanité a besoin d’un démiurge, et que même s’il n’existe pas, il faut de toutes façons l’inventer et le réinventer encore.
« Il est difficile, il est impossible de croire que le dieu bon, le « Père » est trempé dans le scandale de la création. Tout fait penser qu’il n’y prit aucune part, qu’elle relève d’un dieu sans scrupules, d’un dieu taré. ».
« Le mauvais dieu est le dieu le plus utile qui fut jamais. Ne l’aurions-nous pas sous la main, où s’écoulerait notre bile ? N’importe quelle forme de haine se dirige en dernier ressort contre lui. »
Dans ce qu’il appelle sa lucidité chronique, Cioran ne peut éviter de voir derrière toute chose son ombre négative. Ce qui peut conduire à la sagesse comme à la folie.
« Mais c’est dans la volupté que nous comprenons à quel point le plaisir est illusoire. Par elle, il atteint son sommet, son maximum d’intensité, et c’est là, au comble de sa réussite, qu’il s’ouvre soudain à son irréalité, qu’il s’effondre dans son propre néant. La volupté est le désastre du plaisir. »
Un questionnement et un constat que l’on retrouve chez les Taoïstes, les Bouddhistes, et auquel ces philosophies ont su apporter quelques réponses, mais pour Cioran, cette vanité des choses et des sentiments, est un tel accablement que peu lui importe que ce soit un cycle, un mouvement qui au final s’équilibre dans un recommencement perpétuel, pour lui c’est un enfer, un néant.
Pour Cioran l’homme est le point noir de la création.
Autant être sur cette Terre, en tête à tête avec elle, tel un ermite contemplatif, passe encore, « L’horreur d’apercevoir un homme là où on pouvait contempler un cheval » mais vivre au milieu de ses semblables le plonge dans des abimes de dégoût. « Or, comme l’expérience nous l’enseigne, il n’existe pas d’être plus odieux que le voisin. » C’est pourquoi les croyances gnostiques au contraire du Christianisme semblent pouvoir apporter un semblant d’éclairage à cet atroce sentiment de répugnance : la Création n’est pas bonne. Cioran cependant ne prêtera pas foi au gnosticisme, pas plus qu’à n’importe quelle autre croyance.
Cioran est habité de véritables interrogations métaphysiques qui le conduisent à un vif mais vain débat intérieur. On sent chez lui une aspiration spirituelle qui l’encombre, mais il sait que « Les athées, qui manient si volontiers l’invective, prouvent bien qu’ils visent quelqu’un. Ils devraient être moins orgueilleux ; leur émancipation n’est pas aussi complète qu’ils le pensent : ils se font de Dieu exactement la même idée que les croyants. » Mais, cela ne répond pas à sa problématique personnelle. « L’enfer c’est la prière inconcevable » et « Nos prières refoulées éclatent en sarcasmes. »
« Il est aisé de passer de l’incroyance à la croyance, ou inversement. Mais à quoi se convertir, et quoi abjurer, au milieu d’une lucidité chronique ? Dépourvue de substance, elle n’offre aucun contenu qu’on puisse renier ; elle est vide, et on ne renie pas le vide : la lucidité est l’équivalent négatif de l’extase. »
Et cette dernière phrase résume peut-être la structure même de toute l’œuvre de Cioran. Elle pourrait en être aussi son issue. Car si on lit « négatif », on lit aussi « équivalent ». Et le vide peut devenir une forme de plénitude.
Et il l’écrit lui-même : « Nous ne fument heureux qu’aux époques où, avides d’effacement, nous acceptions notre néant avec enthousiasme. ».
C’est presque à un travail d’alchimiste auquel s’est livré Cioran, mais un alchimiste rongé et souvent aveuglé par la colère et l’amertume, qui tourne en rond dans l’œuvre au noir. Insomniaque lui-même, il s’interroge sur le lien qu’il peut y avoir entre insomnie et cruauté, la cruauté qui lui semble être une condition première chez l’homme. « L’impossibilité de dormir est-elle cause ou conséquence de la cruauté ? » Et il évoque Hitler et Caligula…
Chez Cioran, le désenchantement est trop puissant. « D’où vient que, dans la vie comme dans la littérature, la révolte, même pure, a quelque chose de faux, alors que la résignation, fut-elle issue de la veulerie, donne toujours l’impression de vrai » ? ». Un désenchantement, qualifié de nihilisme, qui freine chez lui le flux vital, l’élan premier, annihile semble t-il sa capacité d’agir « On vous demande des actes, des preuves, des œuvres, et tout ce que vous pouvez produire, ce sont des pleurs transformés. »
Des pleurs transformés, ce pourrait être une définition de l’écriture et de toute création artistique en général. Ce barrage existentiel, « l’esprit défoncé par la lucidité », l’oblige en quelque sorte à plonger en lui-même, à chercher des chemins plus en profondeur. « J’ai refoulé tous mes enthousiasmes ; mais ils existent, ils constituent mes réserves, mon fonds inexploité, mon avenir, peut-être. »
Souvent, dans une sorte d’aveu, il reviendra sur les peurs qui le manipulent de l’intérieur : « L’anxieux construit ses terreurs, puis s’y installe : c’est un pantouflard du vertige. », mais il sait aussi que « Sur le plan spirituel, toute douleur est une chance ; sur le plan spirituel seulement » précise t-il.
II semble pourtant que Cioran quoiqu’il en dise conservait en lui les graines d’un libre émerveillement qui lui font noter, par exemple, ce mot d’un mendiant : « Quand on prie à côté d’une fleur, elle pousse plus vite ». Des graines, qu’il s’est bien gardé de mettre en terre cependant, du moins en tant que personnage littéraire.
Cathy Garcia
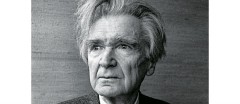 E.M. Cioran, né le 8 avril 1911 à Rășinari en Roumanie, mort le 20 juin 1995 à Paris, est un philosophe et écrivain roumain, d'expression roumaine initialement, puis française à partir de 1949 (Précis de décomposition). À 22 ans, il publie Sur les cimes du désespoir, son premier ouvrage, avec lequel il s'inscrit, malgré son jeune âge, au panthéon des grands écrivains roumains. Après deux années de formation à Berlin, il rentre en Roumanie, où il devient professeur de philosophie au lycée de Brașov pendant l'année scolaire 1936-1937. Il assiste, en compagnie de Mircea Eliade, à l'ascension du mouvement fasciste et antisémite de la Garde de fer, combattu par les armes et effectifs de la police du régime parlementaire. Une ambiance de guerre civile s'installe alors dans le pays, nationalisme xénophobe ultra-chrétien d'un côté (la Garde de fer elle-même s'affichant comme chrétienne), laïcité démocrate de l'autre. Les premiers font appel aux anciennes traditions roumaines, aux valeurs de la paysannerie longtemps opprimée par les Empires étrangers voisins ; les seconds s'inspireront plutôt des valeurs de l'Occident. En 1936, Cioran publie La Transfiguration de la Roumanie où il développe une pensée influencée par les thèses de la Garde de fer (qui, à ce moment, n'a encore assassiné personne et cultive une aura de martyre patriotique, car la police tire sans sommation sur ses rassemblements), mais il fera clairement part aussi, suite à ses études à Berlin, d’une grande admiration pour Hitler, il approuvera notamment et ouvertement la nuit des longs couteaux, et foncera tête baissé dans un extrémisme véritablement délirant qu’il regrettera plus tard. Contrairement à d’autres, il ne cherchera pas à le cacher, mais au contraire en fera la base d’une position farouchement anti-utopiste dont il ne se débarrassera plus. Marta Petreu dans son essai « Un passé infâme : E.M. Cioran et la montée du fascisme en Roumanie », reconnaît que Cioran a pu être motivé par des raisons égoïstes pour se distancier de son œuvre des années 1930. Pourtant, dans sa vieillesse, pense-t-elle, il « avait substantiellement reconsidéré ses anciennes idées et en était venu à les détester profondément ». Dans une lettre de 1979, il décrivit Transfiguration comme inacceptable. En 1937, la publication de son troisième ouvrage, Des larmes et des saints, avait fait scandale dans son pays. Il est interdit de séjour en Roumanie à partir de 1946, pendant le régime communiste. Bien qu'ayant vécu la majeure partie de sa vie en France, il n'a jamais demandé la nationalité française. À Paris, Cioran vécut d'abord à l'hôtel Marignan dans le 5e arrondissement de Paris. C'est dans le Quartier Latin et celui de la Sorbonne qu'il résidera jusqu'à sa mort. Dans ses écrits, il relatera ses fréquentes déambulations nocturnes dans les rues de Paris et les longues nuits de solitude et d'insomnies passées dans de minuscules chambres d'hôtel. Puis plus tard, ce sera celles de ses chambres de bonne, où il se réfugiera pendant de longues années. Il reste pauvre, décidé à « ne plus jamais travailler autrement que la plume à la main ». Ces menus détails sur son vécu quotidien parsèment son œuvre et son discours mais Cioran ne s’apitoiera nullement sur cet aspect de sa condition. Il le décrit simplement comme une sorte de cheminement ou de combat qui l'accompagnent autant dans ses écrits que dans son existence ou comme, en quelque sorte, un « état d'esprit qui le maintient constamment en vie ». Dans la solitude, le dénuement matériel et ce retrait des divertissements modernes, s'établit alors une démarche philosophique et spirituelle comparable à l'ascétisme proposé par le Bouddhisme. Ainsi Cioran raconta, qu'étudiant en Allemagne, il prit ses distances avec la fureur nazie en se réfugiant dans « l'étude du bouddhisme » (Entretien à Tübingen), les Cyniques ou Diogène de Sinope. Cioran refusa tous les prix littéraires (Sainte-Beuve, Combat, Nimier, Morand, etc.) à l'exception du prix Rivarol en 1949, acceptation qu'il justifia par un besoin financier. En 1973, Cioran publie son œuvre la plus marquante : De l'inconvénient d'être né. En 1987, il publie son ultime ouvrage, Aveux et anathèmes, avant de mourir, huit années plus tard, en 1995 de la maladie d'Alzheimer, sans jamais avoir mis à exécution son projet de suicide.
E.M. Cioran, né le 8 avril 1911 à Rășinari en Roumanie, mort le 20 juin 1995 à Paris, est un philosophe et écrivain roumain, d'expression roumaine initialement, puis française à partir de 1949 (Précis de décomposition). À 22 ans, il publie Sur les cimes du désespoir, son premier ouvrage, avec lequel il s'inscrit, malgré son jeune âge, au panthéon des grands écrivains roumains. Après deux années de formation à Berlin, il rentre en Roumanie, où il devient professeur de philosophie au lycée de Brașov pendant l'année scolaire 1936-1937. Il assiste, en compagnie de Mircea Eliade, à l'ascension du mouvement fasciste et antisémite de la Garde de fer, combattu par les armes et effectifs de la police du régime parlementaire. Une ambiance de guerre civile s'installe alors dans le pays, nationalisme xénophobe ultra-chrétien d'un côté (la Garde de fer elle-même s'affichant comme chrétienne), laïcité démocrate de l'autre. Les premiers font appel aux anciennes traditions roumaines, aux valeurs de la paysannerie longtemps opprimée par les Empires étrangers voisins ; les seconds s'inspireront plutôt des valeurs de l'Occident. En 1936, Cioran publie La Transfiguration de la Roumanie où il développe une pensée influencée par les thèses de la Garde de fer (qui, à ce moment, n'a encore assassiné personne et cultive une aura de martyre patriotique, car la police tire sans sommation sur ses rassemblements), mais il fera clairement part aussi, suite à ses études à Berlin, d’une grande admiration pour Hitler, il approuvera notamment et ouvertement la nuit des longs couteaux, et foncera tête baissé dans un extrémisme véritablement délirant qu’il regrettera plus tard. Contrairement à d’autres, il ne cherchera pas à le cacher, mais au contraire en fera la base d’une position farouchement anti-utopiste dont il ne se débarrassera plus. Marta Petreu dans son essai « Un passé infâme : E.M. Cioran et la montée du fascisme en Roumanie », reconnaît que Cioran a pu être motivé par des raisons égoïstes pour se distancier de son œuvre des années 1930. Pourtant, dans sa vieillesse, pense-t-elle, il « avait substantiellement reconsidéré ses anciennes idées et en était venu à les détester profondément ». Dans une lettre de 1979, il décrivit Transfiguration comme inacceptable. En 1937, la publication de son troisième ouvrage, Des larmes et des saints, avait fait scandale dans son pays. Il est interdit de séjour en Roumanie à partir de 1946, pendant le régime communiste. Bien qu'ayant vécu la majeure partie de sa vie en France, il n'a jamais demandé la nationalité française. À Paris, Cioran vécut d'abord à l'hôtel Marignan dans le 5e arrondissement de Paris. C'est dans le Quartier Latin et celui de la Sorbonne qu'il résidera jusqu'à sa mort. Dans ses écrits, il relatera ses fréquentes déambulations nocturnes dans les rues de Paris et les longues nuits de solitude et d'insomnies passées dans de minuscules chambres d'hôtel. Puis plus tard, ce sera celles de ses chambres de bonne, où il se réfugiera pendant de longues années. Il reste pauvre, décidé à « ne plus jamais travailler autrement que la plume à la main ». Ces menus détails sur son vécu quotidien parsèment son œuvre et son discours mais Cioran ne s’apitoiera nullement sur cet aspect de sa condition. Il le décrit simplement comme une sorte de cheminement ou de combat qui l'accompagnent autant dans ses écrits que dans son existence ou comme, en quelque sorte, un « état d'esprit qui le maintient constamment en vie ». Dans la solitude, le dénuement matériel et ce retrait des divertissements modernes, s'établit alors une démarche philosophique et spirituelle comparable à l'ascétisme proposé par le Bouddhisme. Ainsi Cioran raconta, qu'étudiant en Allemagne, il prit ses distances avec la fureur nazie en se réfugiant dans « l'étude du bouddhisme » (Entretien à Tübingen), les Cyniques ou Diogène de Sinope. Cioran refusa tous les prix littéraires (Sainte-Beuve, Combat, Nimier, Morand, etc.) à l'exception du prix Rivarol en 1949, acceptation qu'il justifia par un besoin financier. En 1973, Cioran publie son œuvre la plus marquante : De l'inconvénient d'être né. En 1987, il publie son ultime ouvrage, Aveux et anathèmes, avant de mourir, huit années plus tard, en 1995 de la maladie d'Alzheimer, sans jamais avoir mis à exécution son projet de suicide.
Bibliographie :
Les six premiers titres parurent initialement en roumain :
Sur les cimes du désespoir (1934)
Le Livre des leurres (1936)
Transfiguration de la Roumanie (1936), traduit du roumain par Alain Paruit (Éditions de L’Herne 2009), 343 p.
Des larmes et des saints (1937)
Le Crépuscule des pensées (1940)
Bréviaire des vaincus (1944)
Précis de décomposition (1949)
Syllogismes de l'amertume (1952)
La Tentation d'exister (1956)
Histoire et Utopie (1960)
La Chute dans le temps (1964)
Le Mauvais Démiurge (1969)
Valéry face à ses idoles (1970), 78 p.
De l'inconvénient d'être né (1973), 243 p.
Essai sur la pensée réactionnaire. À propos de Joseph de Maistre (1977), Fata Morgana (d'abord publié comme préface d'un recueil de textes de Joseph de Maistre en 1957 aux éditions du Rocher), 78 p.
Écartèlement (1979), 178 p.
Ébauches de vertige (1979), 126 p.
Face aux instants (L'Ire des vents, 1985), 28 p.
Exercices d'admiration (Gallimard-Arcades 1986), 224 p.
Aveux et Anathèmes (Gallimard-Arcades 1987), 154 p.
L'Ami lointain : Paris, Bucarest (Criterion, 1991), 76 p.
Entretiens (Gallimard-Arcades 1995), 319 p.
Œuvres (Gallimard-Quarto 1995), 1818 p.
Cahiers, 1957-1972 (Gallimard 1997), 998 p.
Cahier de Talamanca (Mercure de France 2000), 57 p.
Solitude et destin (Gallimard-Arcades 2004), 434 p.
Exercices négatifs : En marge du précis de décomposition (Gallimard 2005), 227 p.
De la France, traduit du roumain par Alain Paruit (Éditions de L’Herne 2009), 94 p.
Bréviaire des vaincus II, traduit du roumain par Gina Puicǎ et Vincent Piednoir (Éditions de L’Herne 2011), 116 p.
Lettres à Armel Guerne,1961-1978, préfacé et annoté par Vincent Piednoir (Éditions de L’Herne 2011), 386 p.
Œuvres (Gallimard-Bibliothèque de la Pléiade 2011), 1658 p.
15:36 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
14/02/2013
Une quête infinie, Mary Johnson
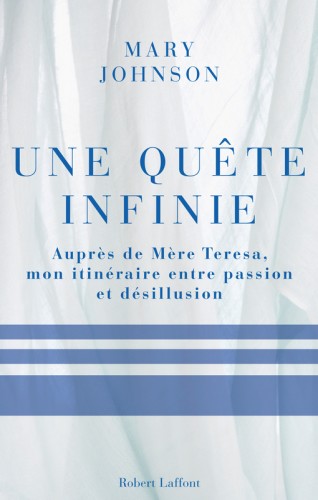
Robert Laffont, parution le 18 février 2013
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marianne Reiner.
480 pages, 22 €
Sous-titré « Auprès de Mère Teresa, mon itinéraire entre passion et désillusion », Une quête infinie est un captivant témoignage. Mary Johnson y raconte avec une impressionnante franchise, son parcours de nonne catholique. Cela commence un jour de 1975, où elle tombe sur une photo de Mère Teresa à la une du Time. Subjuguée par le personnage, elle prend alors, du haut de ses 17 ans, une importante décision vers laquelle convergeaient alors tout son être et ses plus profondes aspirations. Elle ne pouvait imaginer plus belle vie que celle qui se consacre entièrement à apporter soutien et compassion aux plus démunis de ce monde. Aucun membre de sa famille ne put la décourager d’arrêter ainsi ses études, pour se retrouver dix-huit mois plus tard dans un couvent du sud du Bronx, face à Mère Teresa, qui lui dit en accrochant un crucifix sur sa chemise « Reçois le symbole de ton époux crucifié. Porte sa lumière et son amour dans les demeures des pauvres partout où tu te rendras ». La voici donc novice chez les Missionnaires de la Charité. Mary Johnson y donnera vingt ans de sa vie. C’est donc un récit exceptionnel, vu de l’intérieur d’une de ces congrégations religieuses, qui souvent s’entourent d’ombre et de secrets pour mener à bien leur mission et accomplir leur vocation. Mary Johnson est alors une jeune fille un peu mal dans sa peau, qui n’intéressait pas les garçons, mais elle est intelligente, enthousiaste et dotée d’une foi qu’elle veut croire à toute épreuve. Mais la réalité est bien différente des rêves, et dès le premier jour nous pénétrons avec elle dans un monde clos, austère, difficile, exigeant et souvent injuste. Son enthousiasme et son idéal d’amour et de don total, se heurtent à des règles extrêmement rigides, paraissant parfois même moyenâgeuses, un monde où l’obéissance aveugle et sans condition est considérée comme la voie unique vers la sainteté. Mary Johnson dès le départ se retrouve confrontée au doute, à l’humiliation, à la remise en question de faits et gestes qui pourtant ne lui paraissent pas contradictoires avec la vie d’une Missionnaire de la Charité. Elle se sent pourtant prête à tous les sacrifices, elle veut travailler à devenir meilleure, pourvu qu’elle puisse se dévouer entièrement à sa mission, mais son esprit d’initiative, son intelligence et son sens de la justice, vont devenir alors ses pires ennemis. Ainsi devra t’elle, dès les premiers jours, accepter sans répliquer d’être traitée d’égoïste, de désobéissante, d’impudique, de paresseuse et de vaniteuse, tout cela pour avoir pris des douches et non utilisé un seau, alors qu’elle ne savait même pas qu’elle était censée le faire.
« Lorsqu’une sœur était corrigée, avait expliqué sœur Carmeline, même si l’accusation était injuste, elle devait demeurer silencieuse, comme Jésus devant Pilate. Je savais que ce n’était pas tout à fait exact – Jésus était resté silencieux devant Hérode mais pas devant Pilate. J’avais levé la main pour signaler cette erreur, mais je l’avais immédiatement abaissée : comme elle l’avait expliqué, mourir à soi-même et à la fierté était plus important que d’avoir raison, j’allais donc rester silencieuse, comme Jésus devant Pilate. »
Mary Johnson devient Sœur Donata, « celle qui se donne librement », car pour se donner à Jésus, il faut tout perdre, jusqu’à son propre nom. Et page après page, elle nous offre le récit de cette expérience unique, elle s’y livre intégralement, jusque dans les détails les plus intimes et les interdits qu’elle a enfreint, des amitiés particulières avec d’autres sœurs, allant jusqu’au plaisir charnel, et un amour profond et partagé avec un prêtre. Elle ne cache rien, non par goût de l’exhibition ou par provocation, mais dans un souci constant de vérité, de sincérité. Un besoin sans doute exacerbé par toutes ses années vécues dans un milieu où le secret et le silence étaient de mise, même quand il aurait été préférable de parler. On la suit ainsi de mission en mission, d’abord aux États-Unis, puis en Italie, à Rome. A sa plus grande déception, elle ne sera jamais envoyée plus loin, ses qualités et ses compétences, une fois de plus, se retournant contre elle, si bien qu’on lui confie toujours des taches qui ne lui permettent pas se consacrer véritablement à ce qui l’avait poussée, au départ, à rejoindre les Missionnaires de la Charité. On la voit se débattre avec des questionnements, des contradictions, des désirs, des obsessions et ce combat incessant entre ce qui lui semble naturel, voire même voulu par un Dieu d’amour, et le dogme, la honte, la culpabilité. Un combat qui durera vingt ans, avant que le besoin d’être soi, d’être dans l’amour véritable et non simplement dans une obéissance aveugle qui donne à la souffrance des odeurs de sainteté, ne devienne plus fort que tout. Cette obéissance aveugle à laquelle elle ne peut plus croire, ayant vu quel terreau elle était pour bon nombre d’injustices, en donnant raison aux plus intégristes, aux plus arrivistes, aux manigances de certain(e)s qui sous couvert de règles et d’intégrité théologiques se livrent aux plus viles manies humaines : manipulations, mensonges, cruauté, humiliations, pour assouvir leur soif de pouvoir, ce qui rappelle les plus sombres périodes inquisitrices. Un monde finalement bien éloigné de l’idéal Chrétien. C’est pourquoi Mary Johnson, au bout de vingt ans, prendra la courageuse et très difficile décision de quitter la congrégation pour ne plus jamais y retourner. Ce récit témoigne justement de comment une personne habitée d’une véritable vocation de don aux autres, d’un véritable esprit de compassion, un esprit christique dans le sens le plus profond, le plus libre du terme, se verra barrer la route dans ses aspiration les plus saines et les plus utiles et en arrivera au point d’y perdre toute joie et la santé.
Nous ne sommes là que pour aimer et être aimés répétait Mère Teresa et pourtant elle ne supportait pas d’être embrassée et si une sœur Missionnaire de la Charité ne pouvait prendre, ne serait-ce que la main d’une autre sœur dans la sienne, pour la réconforter sur un moment difficile, « Nous ne devions pas nous serrer la main, encore moins nous tapoter le bras ou nous toucher l’épaule et jamais, bien-sûr, nous étreindre », il leur était demandé par contre de pratiquer « la discipline » : « Mais tout en me fouettant les cuisses et en serrant les chaînes autour de mon bras et de ma taille, je découvris que je ne croyais plus que Dieu prenait du plaisir dans ma douleur. »
Sœur Donata se donnera à fond, elle fera taire ses réticences, fera tout son possible pour devenir une sœur accomplie telle que le conçoit Mère Teresa, qui voulait en faire de véritables saintes. Elle sera d’ailleurs appréciée de la plupart de ses compagnes, mais cela deviendra de plus en plus difficile, de plus en plus impossible d’aller à ce point contre elle-même d’une part, mais surtout contre ses convictions religieuses les plus profondes. « En attendant, je priai. Je savais à nouveau que Dieu résidait dans mon cœur, bien plus certainement qu’Il ne se trouvait dans les Règles. ». Elle en arrivera à maudire le jour où Dieu avait placé sous ses yeux, sur la couverture du magazine Time, le visage de cette femme ridée qui parlait de l’amour des pauvres.
« Et je ne me sentais plus à ma place. J’ai vu la Congrégation devenir de plus en plus étroite d’esprit. Ce n’était pas ce pour quoi je m’étais engagée. Je voulais apporter ma contribution, mais la congrégation ne semblait pas intéressée par ce que j’avais à offrir. »
Aussi, quand Sœur Donata prit la décision irrévocable de quitter la Congrégation, de redevenir Mary Johnson, et qu’elle se retrouva face à Mère Teresa, elle savait à quel point celle-ci ne pourrait pas comprendre.
« Savait-elle à quel point je détestais l’idée de la décevoir ?
« Ma Sœur, écoutez Mère Teresa. Parlez-lui. Pourquoi voulez-vous partir ? »
Tout me revient en mémoire. L’étouffement, les désillusions, la frustration, la soif de plus.
J’aurais voulu dire : Mère Teresa, mon Dieu n’est pas comme le vôtre. Votre Dieu vous demande de vous nier vous-même. Il compte chaque sacrifice et récompensera chaque acte de déni de soi. Votre Dieu est Jésus crucifié. Mon Dieu est celui de la résurrection – le Dieu qui dit : « Assez avec la souffrance. Guérissons le monde. »
Votre Dieu est un Dieu jaloux, qui dit : Tant que vous ne serez jamais trop proche d’un autre humain, je serai toujours proche de vous. » Mon Dieu dit : « Je vous offre des amis, je vous offre des amants. Je suis présent dans les gens que je vous donne. »
Ma Mère, j’aimerais que vous compreniez. Mais je ne peux pas prendre le risque que vous ne compreniez pas. Je ne veux plus de votre Dieu.
Sœur Donata quitta les Missionnaires de la Charité en 1997, trois mois avant le décès de Mère Teresa. Ce livre qui sort 10 ans après la béatification de celle qui reçut le prix Nobel de la Paix en 1979 et consacra sa vie aux plus pauvres d’entre les pauvres, apporte un autre éclairage sur le personnage de cette femme hors du commun. Un dévouement aussi total peut camoufler de grandes souffrances. Dans ce livre, Mary Johnson redonne à Mère Teresa sa dimension humaine, avec tout ce que cela implique d’imperfection.
« Mère Teresa en était ainsi arrivée à croire que ses sentiments de « torture et de douleur » faisaient plaisir à Dieu. Au cours des années, elle avait encouragée ses filles spirituelles à devenir des « victimes de l’amour divin ». Souvent elle disait aux malades : « la souffrance est le baiser de Jésus ».
Ses questions n’avaient finalement débouché que sur une détermination dogmatique à croire. Elle évitait les doutes en insistant, de manière intransigeante, sur les enseignements de l’Église, y compris ceux portant sur le contrôle des naissances, la place des femmes, sans tenir compte de la souffrance ou de l’injustice que ces enseignements perpétuaient.
Tant de choses dépendent des histoires que nous nous racontons et des questions que nous nous posons ou que nous ne voulons pas nous poser. »
Ce qui n’empêche que Mary Johnson éprouve un profond respect et un réel amour pour cette femme et à la fin de ce livre qu’elle dédie « à toutes ses sœurs où qu’elles soient », elle remercie les Missionnaires de la Charité « pour avoir enrichi et compliqué ma vie de manière inestimable et pour avoir été mes sœurs et mes frères ».
Nul besoin d’être catholique, ou justement de ne pas l’être, pour lire ce livre. Passionnant, il se lit comme un roman, et son plus grand mérite, est sans doute de montrer que la bonté et les aspirations spirituelles demeurent en chacune et chacun de nous, et que si la religion peut ou devrait être une des voies pour les réaliser, la primauté des règles sur l’intelligence du cœur, les raideurs et archaïsmes dogmatiques, l’aveuglement et les excès qu’ils entrainent, peuvent devenir au contraire, et ceci quelle que soit la religion, de graves entraves. Alors, s’en libérer, devient un véritable acte de foi, libre et responsable.
Cathy Garcia
 Mary Johnson est née en 1958 au Texas dans une famille catholique. Lorsqu'elle quitte les Missionnaires de la charité en 1997, elle obtient une licence en littérature et un master en beaux-arts et art de la rédaction. Conférencière très respectée, elle enseigne à présent à l'Université et a créé une fondation, Une chambre à soi, qui a pour vocation d'aider et soutenir les femmes écrivains. Son livre, Une quête infinie, est traduit dans de nombreux pays.
Mary Johnson est née en 1958 au Texas dans une famille catholique. Lorsqu'elle quitte les Missionnaires de la charité en 1997, elle obtient une licence en littérature et un master en beaux-arts et art de la rédaction. Conférencière très respectée, elle enseigne à présent à l'Université et a créé une fondation, Une chambre à soi, qui a pour vocation d'aider et soutenir les femmes écrivains. Son livre, Une quête infinie, est traduit dans de nombreux pays.
14:24 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
05/02/2013
La nuit du loup de Javier Tomeo
Janvier 2013, traduit de l’espagnol par Denise Laroutis, 150 p. 15 €
Voici une bien drôle d’histoire, serait-on tenté de dire. Dans une ambiance inquiétante qui frôle le fantastique, Javier Tomeo nous fait assister tout au long de La nuit du loup à une longue et étrange discussion. Cela se passe une nuit de 30 novembre, une date qui n’est pas anodine, cependant le sujet n’est pas là. Le sujet, ce sont deux hommes partis faire un petit tour après le repas, et qui tous deux, à une cinquante de mètres de distance l’un de l’autre, se foulent malencontreusement la cheville. Les voilà donc immobilisés là, dans la lande déserte. Tout proches, et cependant hors de vue, à cause d’un virage qui sépare Macarío, le premier, réfugié sous un abribus, d’Ismael, le deuxième, assis plus loin au bord de la route. Macarío vit à cinq cents mètres à peine de là, c’est un retraité solitaire, poète lyrique et un peu bizarre. Ismael, qui s’est foulé la cheville quelque temps après Macarío, est un assureur qui devait passer une nuit à l’hôtel du village, après avoir vendu quelques assurances-vie à des villageois faciles à convaincre. Un homme qui ne fait rien de plus que son métier, en somme, un citadin, marié, dont la seule bizarrerie serait d’aimer les films de vampires et de loups-garous, ce qui ne peut que nourrir l’imagination un peu plus qu’il ne le faudrait dans une telle situation.
« Il ne parle pas en l’air, il se juge assez entendu en la matière. Il n’a pas eu besoin d’aller voir sur Internet pour savoir tout ce qu’il sait sur les loups-garous. Au cours des quinze dernières années, il a vu tous les films de Dracula et de loups-garous qui sont passés au cinéma de son quartier et à la télévision, et il est capable de faire la différence entre les loups qui naissent loups et ces hommes atteints de mélancolie qui finissent par se transformer en lycanthropes ».
Macarío lui, est doté d’une grande érudition du genre « googlelienne », qu’il a acquise en passant des heures et des heures, jour après jour, sur internet. Il a mémorisé toutes sortes de choses, de chiffres, de détails, à propos de tout et n’importe quoi, ce qui n’est peut-être pas très utile en soi, mais se révèlera bien pratique pour alimenter une conversation, presque tout au long d’une nuit. Presque, parce que l’humain est ainsi fait – mettons ça sur le compte de la lune, pleine cette nuit-là – qu’il demeure au fond de lui un fond d’agressivité, de cruauté, de folie, qu’il est parfois difficile de contenir et dissimuler trop longtemps sous le vernis mondain. Seuls témoins de cette conversation à bâtons rompus qui, pour contrer la peur et les ténèbres qui siègent à l’intérieur même de chacun, galope et dérape en toutes directions, parfois jusqu’à l’absurde, un corbeau, un hibou et mêmes deux grillons, qui croassent, ululent et chantent, comme pour approuver ou désapprouver ces échanges, durant lesquels la lune, jouant avec les nuages, jouera aussi un rôle de révélateur et d’amplificateur.
C’est presque une fable que nous offre ici Javier Tomeo, non dénuée d’humour, tantôt léger, tantôt grinçant, où l’on apprend plein de choses, des choses qui ne servent à rien, comme savoir que la girafe n’a que sept vertèbres, ou pouvoir réciter dans l’ordre alphabétique les cinq pays du monde dont le nom commence par la lettre k, ou encore raconter la vie des saints du calendrier, mais qui pourraient se révéler bien utiles, s’il nous fallait ainsi parler toute une nuit à un inconnu sans le voir.
Cathy Garcia
 Javier Tomeo Estallo est un écrivain et dramaturge né le 9 septembre 1932 dans l’Aragon. Il a passé une licence de Droit et de Criminologie à l’Université de Barcelone. En 1963, il a publié, avec Juan María Estadella, La brujería y la superstición en Cataluña (La sorcellerie et la superstition en Catalogne). En 1967, il écrit son premier roman. Il a obtenu en 1971 le premio de novela corta Ciudad de Barbastro, pour El Unicornio. Dans les années 70 sont apparus d’autres titres comme El castillo de la carta cifrada. Dans les années 80, il écrit Diálogo en re mayor, Amado monstruo ; dans la décennie suivante ont été publiés de nombreux livres, comme El gallitigre (1990), El crimen del cine Oriente (1995), Los misterios de la ópera (1997), Napoleón VII (1999) ou Cuentos perversos (2002), La mirada de la muñeca hinchable (2003), Los nuevos inquisidores (2004), El cantante de boleros (2005), Doce cuentos de Andersen contados por dos viejos verdes (2005), entre autres. Quelques unes de ses œuvres ont été portées sur les scènes avec un accueil favorable de la critique, et surtout en France. Amado monstruo (Monstre Aimé) a été donné au Théâtre National de la Colline de Paris en 1989 avec un grand succès. Il a reçu le Premio Aragón a las letras en 1994 et la médaille d’or de la municipalité de Saragosse. Il rédige aussi des articles pour différents médias, comme ABC.
Javier Tomeo Estallo est un écrivain et dramaturge né le 9 septembre 1932 dans l’Aragon. Il a passé une licence de Droit et de Criminologie à l’Université de Barcelone. En 1963, il a publié, avec Juan María Estadella, La brujería y la superstición en Cataluña (La sorcellerie et la superstition en Catalogne). En 1967, il écrit son premier roman. Il a obtenu en 1971 le premio de novela corta Ciudad de Barbastro, pour El Unicornio. Dans les années 70 sont apparus d’autres titres comme El castillo de la carta cifrada. Dans les années 80, il écrit Diálogo en re mayor, Amado monstruo ; dans la décennie suivante ont été publiés de nombreux livres, comme El gallitigre (1990), El crimen del cine Oriente (1995), Los misterios de la ópera (1997), Napoleón VII (1999) ou Cuentos perversos (2002), La mirada de la muñeca hinchable (2003), Los nuevos inquisidores (2004), El cantante de boleros (2005), Doce cuentos de Andersen contados por dos viejos verdes (2005), entre autres. Quelques unes de ses œuvres ont été portées sur les scènes avec un accueil favorable de la critique, et surtout en France. Amado monstruo (Monstre Aimé) a été donné au Théâtre National de la Colline de Paris en 1989 avec un grand succès. Il a reçu le Premio Aragón a las letras en 1994 et la médaille d’or de la municipalité de Saragosse. Il rédige aussi des articles pour différents médias, comme ABC.
14:57 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
05/11/2012
L’autre vie de Valérie Straub, de Stéphane Padovani
Note parue sur : http://www.lacauselitteraire.fr/l-autre-vie-de-valerie-straub-stephane-padovani.html

Valérie Straub « n’aspire plus qu’à la tranquillité des pierres ». Elle a passé plusieurs dizaines d’années en prison pour des idées mises en application de la manière la plus violente. Elle a tué pour ces idées-là, pour un idéal de justice, pour un monde meilleur, elle était jeune, rebelle, déterminée. « Ce combat, il t’a fallu quand même le mener jusqu’au bout, jusqu’à la mélancolie, jusqu’à une certaine forme de folie, au fond d’une prison ». Et quand elle en sort, c’est pour entrer dans un monde qu’elle ne reconnaît plus.
« Les gens t’ont oubliée. Ne reste vaguement que le bruit superficiel de tes éclats, d’armes ou de voix, dans un espace social replié comme un linge dans une armoire de réfectoire ».
Une ancienne compagne de cellule, Isa, va l’accueillir et l’aider à faire ses premiers pas, et la femme de son petit frère qu’elle avait à peine connu et qui est décédé, vient lui confier un journal qu’il n’a écrit, tout au long de ses années, que pour elle. Un journal plein d’amour mais aussi de questionnements, face au vide, que cette sœur inaccessible et constamment en révolte avait laissé suite à son arrestation. Valérie ne sait pas trop ce qu’être libre pourra bien vouloir signifier dans une société qui a poursuivi son cours vers quelque chose qu’elle et ses compagnons d’armes avaient combattu de toute leur âme.
« Pourquoi t’es-tu battue ? Le monde que tu souhaitais n’est pas advenu, n’aura jamais été que dans les interstices d’espoir, des alliances clandestines traquées par la violence d’État. C’était un monde déjà perdu au moment même où tu l’entrevoyais ».
Mais elle aspire cependant à la paix, à un peu de bonheur si jamais cela était encore possible, le chat écorché accepterait bien quelques caresses. Elle a beaucoup lu, étudié, médité lors de ses années d’incarcération. Elle a tué et elle a payé. Mais peut-on vraiment payer sa dette de mort ? Le cercle de la violence est un cercle infernal et chaque acte n’en finit jamais de porter à conséquence. Les peuples de la vendetta connaissent bien ça. Une agression en pleine rue va le lui rappeler alors qu’elle est sur le point de commencer à travailler avec son amie Isa, dans une pépinière. Elle se sent bien là-bas, chez ces espagnols, chez Pablo, sa sœur Clara et ses trois enfants. Elle s’y sent bien au point de ne plus les quitter, et très vite entre Pablo et Valérie, quelque chose de beau et de bon commence à lui faire oublier toutes ces années passées à l’ombre.
« Mon histoire est là à présent, sous les mains de Pablo et dans les miennes, dans les intervalles qu’il me reste à parcourir. Et je me dis que je n’aurais pas trop d’une troisième vie pour me rejoindre ».
Mais peut-on vraiment payer sa dette de mort ? Valérie Straub aspire à la paix mais elle n’est pas le genre de femme à se dégonfler devant son destin.
Un destin que vous découvrirez en lisant ce livre, court mais intense. Une écriture fluide et envoûtante pour un clin d’œil courageux à ces idéalistes, les gauchistes comme on dit, extrémistes certes, mais on sait bien que l’ennemi qu’ils combattent ne l’est pas moins, et qui ont choisi un jour ou l’autre la manière la plus directe, la plus brutale, et la plus vaine aussi, pour tenter de changer le monde.
Vraiment un très beau texte, fort et poignant, que l’on pourrait peut-être résumer ainsi : courage, dignité et désespoir.
Soulignons au passage aussi l’éditeur, Quidam, qui encore une fois, publie un texte de grande qualité, dans un ouvrage bien réalisé, pour un prix dérisoire.
Cathy Garcia
 Stéphane Padovani est né en 1966 à Courbevoie et a vécu en région parisienne jusqu’en 1999, dans différentes banlieues, où il a commencé à enseigner. 1995 : premières publications en revues. Il a obtenu la bourse « découverte » du CNL et animé quelque temps un atelier d’écriture en maison d’arrêt. Il vit et enseigne désormais en Bretagne. Il est aussi l’auteur de L’Homme de bois (2002) et Chiens de guerre (2004), tous deux chez Bérénice. Aux éditions Quidam, il a publié en 2007 La Veilleuse, où il poursuit, sur un fil toujours tendu, des itinéraires intimes pris dans la marche du monde.
Stéphane Padovani est né en 1966 à Courbevoie et a vécu en région parisienne jusqu’en 1999, dans différentes banlieues, où il a commencé à enseigner. 1995 : premières publications en revues. Il a obtenu la bourse « découverte » du CNL et animé quelque temps un atelier d’écriture en maison d’arrêt. Il vit et enseigne désormais en Bretagne. Il est aussi l’auteur de L’Homme de bois (2002) et Chiens de guerre (2004), tous deux chez Bérénice. Aux éditions Quidam, il a publié en 2007 La Veilleuse, où il poursuit, sur un fil toujours tendu, des itinéraires intimes pris dans la marche du monde.
20:01 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
26/10/2012
Le Meilleur des Jours, Yassaman Montazami
Note parue sur : http://www.lacauselitteraire.fr/le-meilleur-des-jours-yas...

144 p. 15 € Edition Sabine Wespieser août 2012
Ce livre, le premier de Yassaman Montazami, est un émouvant hommage au père, une manière de conjurer la perte et de faire vivre encore cette forte figure familiale au travers de l’écriture. Un père original, épris de justice, généreux et impertinent, doté d’un grand talent pour les pitreries, qui fut surnommé à sa naissance, en 1940, plusieurs semaines avant terme, Behrouz – en persan « le meilleur des jours ». Un enfant miraculé, premier né d’une famille aisée de Téhéran, et qui survécut grâce aux soins d’une mère, qui n’eut de cesse ensuite toute sa vie de veiller obsessionnellement à ce qu’il ne manque de rien. Behrouz est mort d’un cancer à Paris en 2006, et sa fille a alors pris le crayon pour l’immortaliser et nous plonger ainsi dans l’histoire de sa famille, avec un pied en France, l’autre en Iran.
Son père est envoyé faire des études à Paris vers la fin des années 60, il a d’ailleurs été éduqué en français, comme bon nombre d’enfants de la bourgeoisie téhéranaise de l’époque. Il se trouve alors « pris dans une ivresse sans limite devant la vastitude des connaissances qu’il pouvait acquérir à Paris » et comme ses parents lui assurent leur soutien pécuniaire, après avoir épousé Zahra, dans un élan romantique lors d’un retour à Téhéran, il restera un éternel étudiant.
Il vit à Paris avec Zahra quelques années, puis lorsque celle-ci tombe enceinte, il la renvoie en Iran et part à Londres pour se lancer dans un projet de thèse faramineuse : « La détermination de l’histoire par la superstructure dans l’œuvre de Karl Marx », dont il rédigera des milliers de pages, mais qui ne seront que le dixième du travail titanesque qu’il s’était donné et dont il n’arrivera jamais à bout.
Yassaman Montazami vient au monde en 1971, à Téhéran. Sa mère et elle rejoignent Behrouz en France en 1974. C’est de là-bas que Behrouz participe à sa manière aux évènements révolutionnaires de 1979.
« Mon père pour qui la laïcité était une des conditions indispensables à l’avènement de la démocratie, avait du reste toujours marqué une forte défiance à l’idée que des religieux s’emparent du pouvoir ».
Leur appartement parisien devient alors un refuge pour des Iraniens en exil, venant des milieux les plus divers, tous fuyant la tenaille de la République Islamique et laissant derrière eux leur rêve d’un Iran enfin libre et juste : poètes, révolutionnaires, en jeans à pattes d’éléphant, gilets en peau de mouton, sandales ou sabots de cuir, « on trouvait là des communistes prosoviétiques, des léninistes, des trotskistes, des maoïstes, des bordiguistes, des albanistes » et même une femme de la haute bourgeoisie monarchiste, épouse en fuite d’un colonel emprisonné.
« A force d’entendre toutes ces histoires, il m’était apparu qu’un vrai iranien était nécessairement un fugitif. (…) Cela ne me dispensait pas pour autant de tenir mon père pour un authentique héros. Ses publications et ses prises de positions politiques lui interdisaient en effet de remettre les pieds en Iran, où elles l’auraient tout droit conduit en prison. La prescience que tout le monde lui reconnaissait au sein de la diaspora iranienne m’emplissait également de fierté : après être retourné à Téhéran dans l’euphorie qui avait suivi la fuite du shah, en février 1979, il avait été l’un des premiers à reprendre l’avion pour l’Europe, dès l’été, pressentant l’hécatombe qui allait décimer les militants gauchistes malgré leur soutien aux islamistes, auxquels les unissait une même détestation de l’impérialisme et de la bourgeoisie ».
Yassaman Montazami nous offre avec ce premier livre l’opportunité de retraverser tout un pan de l’histoire iranienne à travers quelques destins qui y sont liés, et de découvrir ainsi une autre facette de l’Iran, celle notamment d’intellectuels et d’artistes militants qui espéraient là-bas comme ailleurs l’avènement d’un monde meilleur, plus libre et plus équitable. Behrouz, marxiste idéaliste, bon vivant et facétieux, n’a de cesse d’inventer des farces et faire de la vie un éternel terrain de jeu, mais il va cependant petit à petit perdre une certaine insouciance et joie de vivre. Suite à la mort de son propre père en 1988, puis au double échec de son couple et d’une thèse jamais achevée, il retourne en 1997 en Iran, alors qu’on vient d’y élire le président réformateur Mohammad Khatami. Il y retrouve un amour et y cherche ses anciens compagnons. Ceux qui ne sont pas morts ou en exil, ont été brisés par la prison, les tortures, les humiliations.
« L’Histoire s’était refermée sur eux comme un étau ».
Avec une écriture à la fois fluide et dense, au travers de son regard de petite fille, puis de l’adulte, sur un père adulé, Yassaman Montazami va et vient dans le temps, au gré de souvenirs tendres et cocasses, et nous offre un témoignage drôle, vivifiant et porteur d’espoir, car l’énergie qui animait Behrouz n’a pas disparu avec lui, les hommes s’en vont, les idées évoluent mais l’essentiel demeure, l’espoir d’un monde libre et meilleur.
Cathy Garcia

Yassaman Montazami, qui vit en France depuis 1974, est née à Téhéran en 1971. Docteur en psychologie, elle a travaillé de nombreuses années auprès de réfugiés politiques et a enseigné à l’université Paris VII. Elle exerce actuellement en milieu hospitalier. Le Meilleur des jours est son premier roman.
16:25 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
22/10/2012
Fée d’hiver, André Bucher
Note parue sur : http://www.lacauselitteraire.fr/fee-d-hiver-andre-bucher....

Le Mot et le Reste décembre 2011, 160 pages, 16 €
Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore le talent d’André Bucher, voici une bien belle façon de le découvrir. Dans Fée d’hiver, on sent le souffle d’un Jim Harrison, dont André Bucher est grand lecteur, mais l’écriture de cet écrivain poète paysan est unique. Et justement, elle sent le vécu, le territoire arpenté, la solitude affrontée. Fée d’hiver est un roman à la fois âpre et magnifique, austère et puissamment physique, comme les lieux dans lesquels il prend place dans ce sud de la Drôme, à la limite des Hautes-Alpes. Des lieux sauvages, entourés de montagnes, désertés par les hommes partis rejoindre les villes, où la vie, croit-on, offre plus de facilités.
Le roman démarre sur un prologue, un article paru dans le journal le Dauphiné Libéré, daté du 31 août 1948. Un fait divers « Drame de jalousie dans le sud de la Drôme », qui fait écho au titre du livre, Fée d’hiver. Cette fée d’hiver qui vient comme pour rompre une malédiction, une sorte de réparation d’accrocs dans les mailles du destin.
La première partie du roman est un journal intime à deux voix, s’étalant entre 1965 et 1988. Une façon de présenter les lieux, le contexte, les personnages. Daniel et Richard sont deux frères, l’un géant et l’autre court sur pattes, l’un parle peu, l’autre ne parle plus du tout. Ce sont les deux enfants laissés orphelins par le drame familial évoqué dans l’article du journal. Placés en famille d’accueil par la DDASS, ils ont grandi et retournent maintenant vivre dans la ferme familiale aux Rabasses, pas très loin du village de Laborel. Une ferme délabrée, que Richard, l’aîné, va peu à peu transformer en casse. Daniel lui, muet depuis le drame, s’occupe d’un troupeau de brebis. Deux marginaux en quelque sorte, repliés sur eux-mêmes, que les gens alentour prennent pour des attardés.
Et puis, il y a les Monnier, qui ont une scierie. Le père était l’amant de la mère de Richard et Daniel, responsable en quelque sorte de leur malheur, mais il est mort lui aussi, emporté par un cancer peu de temps après. Restent les deux fils, dont l’aîné dirige maintenant la scierie, et le cousin Louis, le nabot que les frères Monnier aimaient tant tyranniser, étant enfant. Depuis toujours enclins à la morve et à la méchanceté, la vie n’avait pas aidé à les changer ces deux-là. Heureusement il y a Alice, la jeune sœur. Alice est différente et elle n’a pas peur de passer du temps avec Daniel, pendant qu’il fait pâturer ses brebis. Elle passe le voir, cherche à communiquer avec lui. Daniel l’aime beaucoup bien qu’elle soit bien plus jeune que lui, seulement les années passent vite. Alice travaille comme secrétaire à la scierie de ses frères, elle part à midi ravitailler les bûcherons. Un jour, elle a déjà plus de trente ans, elle finit par dire oui au cousin Louis. Daniel décide qu’il ne parlera vraiment plus jamais et arrête son journal. Nous sommes en 1988.
Le roman enchaîne alors sur l’histoire de Vladimir entre 1995 et 1998. Vladimir est serbo-croate et bûcheron. En 1995, avant le cessez-le-feu entre les Serbes et les Bosniaques, sa sœur et ses parents périssent dans la destruction de leur village. Vladimir, c’est son métier qui l’a sauvé, il était dans la montagne en train de bûcheronner quand c’est arrivé. Quand il est revenu, il n’y avait plus rien, juste larmes, cendres et décombres. Il a donc fui, son pays, ses souvenirs, sa douleur. De pays en pays, une vie rude et solitaire, d’exilé, de sans-papiers, avec pour seul bagage, seul lien avec son passé, une anthologie bilingue de poésie des Balkans. Il exerce son métier partout où il peut, et de pays en pays, finit ainsi par arriver en France. Dans le parc du Lubéron, il travaille comme surveillant d’incendies avec Alain, un étudiant qui prépare une thèse sur l’éclatement de la péninsule des Balkans, et parle donc un peu la langue de Vladimir. Ainsi, tout en guettant les feux, débroussaillant, éclaircissant les bois, il aide ce dernier à perfectionner son français. Le Lubéron hors saison touristique est totalement dépeuplé au grand étonnement de Vladimir.
« – Et encore, tu n’as rien vu. Ici ça va, on est dans le Lubéron. Passe seulement de l’autre côté du plateau d’Albion, en redescendant jusqu’à l’extrême pointe Sud de la Drôme, à la limite des Hautes-Alpes, tu verras… c’est bien pire. Là-bas même les corbeaux sont inscrits sur les listes électorales. Par contre en tant que bûcheron, tu devrais pouvoir trouver. Plus personne ne veut faire ce boulot ».
C’est comme ça, qu’en mars 1998, quelques mois après la fin de leur contrat, Vladimir se retrouve face à Alice devant la scierie des Monnier.
« – Bonjour Madame. Je m’appelle Vladimir, je suis bûcheron et je cherche du travail ».
Entre temps, Alice, avait donc vécu sa vie de femme mariée. Mariée moins par amour que par peur de rester seule, et aussi sous la pression de ses frères, histoire que la scierie reste en famille. Le petit Louis était devenu un homme, toujours aussi faible, mais plus sournois, et puis il s’était mis à boire, à boire et à frapper. Alice était loin, bien loin de ses rêves. Après huit années de mariage, la coupe était pleine, et elle avait quitté le domicile conjugal, pour aller vivre dans un gîte d’une amie d’enfance, pas très loin des frères Lacour, Richard et Daniel. Ça faisait longtemps qu’elle ne les voyait plus, elle s’en voulait. Les choses allaient changer.
Vladimir donc, est embauché par la scierie. Non déclaré, il loge dans une caravane vétuste sans aucune commodité, mais il a l’habitude, et se contente de ce qu’il a, jusqu’au jour où les frères Lacour viennent lui témoigner quelques signes d’amitié et finissent par lui proposer d’aménager sur leurs terres, dans une cabane à remettre en état, au fond du Val Triste, à quelques kilomètres de leur ferme.
« Une tanière toute en rondins de pins mal équarris, adossée à la forêt et donnant sur une clairière avec une vaste prairie où serpentait un ruisseau qui prenait sa source en haut du vallon. L’eau y était fraîche même en été et elle avait un léger goût de rouille ».
Vladimir ne se doute pas qu’il va préparer là un nid d’amour pour une fée d’hiver.
André Bucher a l’art de décrire la nature, les sentiments qu’elle provoque et ses propres sentiments à elle, en tant qu’entité vivante à part entière, d’une façon totalement originale, des images non attendues qui donnent beaucoup de fraîcheur à son écriture, outre que l’histoire elle-même est captivante, toute pleine de rebondissements, de profondeur, d’humanité, et de rage aussi. Vraiment, ce roman est un torrent de montagne à glisser à votre chevet, il serait dommage de s’en priver.
Cathy Garcia
André Bucher, col de Perty, janvier 2012 © B. P.
André Bucher, écrivain, paysan, bûcheron, André Bucher est né en 1946 à Mulhouse, Haut-Rhin. Après avoir exercé mille métiers (docker, berger, ouvrier agricole…), il s’installe à Montfroc en 1975, vallée du Jabron, dans la Drôme, où il vit toujours. Il est un des pionniers de l’agriculture bio en France. Écrivain des grands espaces, lecteur de Jim Harrison, Rick Bass, Richard Ford…, des écrivains amérindiens tels James Welch, Louise Erdich, Sherman Alexie, David Treuer…, son écriture puise sa scansion, sa rythmique dans le blues, la poésie, le jazz et le rock’n’roll. La nature n’est pas un décor mais un personnage de ses histoires. Fée d’hiver est son sixième roman.
Bibliographie :
Histoire de la neige assoupie, Une hirondelle qui pleure tout le temps, (nouvelles), Chiendents n°17, Cahier d’arts et de littératures, André Bucher, Une géographie intime.
Fée d’hiver, roman, éditions le mot et le reste, 2012
La Cascade aux miroirs, roman, Denoël, 2009
Le Pays de Haute Provence, carnet de voyage, vu de l’intérieur, récit, en collaboration avec un photographe, Pascal Valentin, pour l’office de tourisme du Pays de Haute Provence, 2007
Déneiger le ciel, roman, Sabine Wespieser, 2007
Le Matricule des Anges n°80, Clairé par une âpre beauté…
Pays à vendre, roman, Sabine Wespieser, 2005
Le Cabaret des oiseaux, roman, Sabine Wespieser, 2004, France-Loisirs, 2005, traduction en langue espagnole El Funambulista, 2007, traduction en chinois, 2008
Le Pays qui vient de loin, roman, Sabine Wespieser, 2003
Le Juste Retour des choses, Saint-Germain-des-Prés, Miroir oblique, 1974
Le Retour au disloqué, Publication par l’auteur, 1973
La Lueur du phare II, Éditions de la Grisière / Éditions Saint-Germain-des-Prés, Balises, 1971
La Fin de la nuit suivi de Voyages, J. Grassin, 1970
13:48 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
14/09/2012
Blood Hollow de William Kent Krueger
Note parue sur : http://www.lacauselitteraire.fr/blood-hollow-william-kent...

Parution le 13 septembre 2012 trad. anglais (USA) Sophie Aslanides, 480 p. 20 €
Edition: Le Cherche-Midi
Troisième volet de ce qui semble être une trilogie, après Aurora, Minnesota et Les neiges de la mort, les amateurs d’enquête policière ne pourront qu’adorer Blood Hollow, mais même ceux qui ne sont pas particulièrement attirés par le genre, auront du mal à ne pas se laisser happer par ce roman dense, riche et captivant. L’événement qui a secoué la petite et tranquille ville d’Aurora dans le Minnesota, va prendre rapidement l’allure d’un séisme. L’enquête est minutieusement menée par Corcoran « Cork » O’Connor, conjointement avec sa femme. Cork est un ex-flic de Chicago et l’ex-shérif de la petite ville. Mi-Irlandais, mi-Anishinaabeg, c’est un personnage très attachant, épris de vérité et de justice, reconverti un peu malgré lui dans la vente d’hamburgers, au bord du lac d’Iron Lake. Une sorte de retraite suite à un conflit dramatique. Sa femme Jo est l’avocate qui va prendre en charge la défense du présumé coupable. Coupable de meurtre, celui de la jeune Charlotte Kane, fille d’une des familles les plus riches de la ville. Le suspect est un ex-petit ami, Solemn Winter Moon, un Ojibwe vivant sur la réserve, déjà connu des services de la police pour diverses infractions et son impulsivité notoire. Cork et Jo O’Connor le connaissent bien et sont tous deux quasi persuadés de son innocence, malgré les preuves qui l’accablent.
L’enquête démarre de façon assez classique pour ne cesser de rebondir, basculant parfois dans le roman fantastique noir, et au fur et à mesure de plus en plus dans ce qu’on pourrait appeler un polar spirituel. Car ce qui transparaît dans ce roman dont l’intrigue est maîtrisée à la perfection par l’auteur, c’est un questionnement spirituel. Un questionnement sur la foi, le manque de foi, la perte de foi, les excès de la foi quand elle tourne au fanatisme délirant et assassin et plus largement à la quête du sens de la vie, où la spiritualité d’une forme ou d’une autre, quelles que soient nos croyances, peut s’avérer essentielle pour savoir qui nous sommes.
« Chaque être humain, lui semblait-il, était un assemblage d’impulsions conflictuelles enserrées dans un seul corps, essayant tant bien que mal de trouver la paix ».
Le problème de l’identité est un autre sujet largement prédominant dans ce livre. Nombre de personnages s’avèreront être bien différents de ce qu’ils ont l’air d’être, et par là, il est question aussi des problématiques de préjugés et d’intolérance.
« Il aimait Aurora et comprenait pourquoi c’était le genre d’endroit où venaient les gens qui voulaient échapper à des problèmes – au monde, à une grande ville, à un passé trouble. Mais il n’existait pas d’endroit assez éloigné qui permettait d’échapper à ce qu’on était. Même si les gens gardaient des secrets pour les autres, ils devaient malgré tout vivre avec eux-mêmes. C’était exactement ce que Cordelia Diller lui avait dit sur cette colline dans l’Iowa. Pour recommencer à zéro, le meilleur point de départ, c’était de regarder la vérité en face ».
Dans tout ce micmac, un personnage deviendra central bien qu’il n’apparaisse qu’à deux ou trois reprises. C’est Henry Meloux, un grand-père Ojibwe, qui vit avec son chien dans une cabane à l’écart des hommes, au sein de cette nature grandiose et sauvage du Minnesota. Détenteur d’une spiritualité ancestrale solidement reliée à la Terre, le vieil Ojibwe sera un guide précieux pour montrer la voie de la paix et de la sagesse.
« Chaque fois que Cork entrait dans la forêt profonde, il savait qu’il pénétrait dans un endroit sacré. C’était proche de ce qu’il ressentait, lorsque, enfant, il entrait dans l’église. (…) Il y avait ici un esprit si grand qu’il rendait le cœur de l’homme tout petit. Le sang anishinaabeg qui coulait dans ses veines était peut-être la raison pour laquelle il ressentait cela, mais il ne le croyait pas. Il pensait que tout homme ou toute femme qui venait ici sans méchanceté ressentirait la même chose ».
Blood Hollow est un roman passionnant, facile à lire, ce qui n’exclut pas la profondeur. L’auteur a l’art des petits détails anodins qui donnent à son écriture un ton extrêmement vivant et si réaliste, "qu’on s’y croirait", comme disent les enfants. Le genre de livre qu’on a vraiment du mal à poser, une fois qu’on l’a commencé.
Cathy Garcia
 William Kent Krueger est né le 16 novembre 1950 dans le Wyoming (États-Unis). Père de deux enfants, il habite à Tangletown. Après avoir fréquenté l’université de Stanford, dont il est renvoyé pour ses positions radicales sur la guerre du Vietnam, il travaille dans la construction, s’essaye au journalisme puis se consacre à l’écriture. Il publie plusieurs nouvelles, puis à 40 ans son premier roman, Iron Lake. Il reçoit trois prix, dont deux du premier roman, le Barry Award et le Anthony Award. Surnommé le Michael Connelly du Midwest, il a écrit une dizaine d’ouvrages, dont beaucoup pas traduits en français, qui ont tous remporté un véritable succès et ont reçu de nombreuses distinctions.William Kent Krueger est né le 16 novembre 1950 dans le Wyoming (États-Unis). Père de deux enfants, il habite à Tangletown. Après avoir fréquenté l’université de Stanford, dont il est renvoyé pour ses positions radicales sur la guerre du Vietnam, il travaille dans la construction, s’essaye au journalisme puis se consacre à l’écriture. Il publie plusieurs nouvelles, puis à 40 ans son premier roman, Iron Lake. Il reçoit trois prix, dont deux du premier roman, le Barry Award et le Anthony Award. Surnommé le Michael Connelly du Midwest, il a écrit une dizaine d’ouvrages, dont beaucoup pas traduits en français, qui ont tous remporté un véritable succès et ont reçu de nombreuses distinctions.
William Kent Krueger est né le 16 novembre 1950 dans le Wyoming (États-Unis). Père de deux enfants, il habite à Tangletown. Après avoir fréquenté l’université de Stanford, dont il est renvoyé pour ses positions radicales sur la guerre du Vietnam, il travaille dans la construction, s’essaye au journalisme puis se consacre à l’écriture. Il publie plusieurs nouvelles, puis à 40 ans son premier roman, Iron Lake. Il reçoit trois prix, dont deux du premier roman, le Barry Award et le Anthony Award. Surnommé le Michael Connelly du Midwest, il a écrit une dizaine d’ouvrages, dont beaucoup pas traduits en français, qui ont tous remporté un véritable succès et ont reçu de nombreuses distinctions.William Kent Krueger est né le 16 novembre 1950 dans le Wyoming (États-Unis). Père de deux enfants, il habite à Tangletown. Après avoir fréquenté l’université de Stanford, dont il est renvoyé pour ses positions radicales sur la guerre du Vietnam, il travaille dans la construction, s’essaye au journalisme puis se consacre à l’écriture. Il publie plusieurs nouvelles, puis à 40 ans son premier roman, Iron Lake. Il reçoit trois prix, dont deux du premier roman, le Barry Award et le Anthony Award. Surnommé le Michael Connelly du Midwest, il a écrit une dizaine d’ouvrages, dont beaucoup pas traduits en français, qui ont tous remporté un véritable succès et ont reçu de nombreuses distinctions.
13:49 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
25/07/2012
Gîtes de Julio Cortazar

trad. de l’esp. par Laure Bataillon,
Gallimard, Collection L’imaginaire, Mai 2012,
280 p. 9,50 €
Ce qu’il y a de fascinant dans les nouvelles de Cortázar, très représentatives de la riche littérature fantastique latino-américaine, c’est qu’elles partent quasi toujours du quotidien, de situations des plus banales, et puis, comme si la réalité commune n’était protégée que par un voile extrêmement ténu, soudain par une brèche, une faille, une déchirure, elle est envahie ou insidieusement pénétrée par d’autres réalités bien plus sombres et menaçantes, où évoluent des créatures dangereuses, effrayantes, ou pire encore. Elles montrent à quel point notre normalité, finalement, tient à peu de chose et qu’un rien peut nous faire basculer dans la folie, attiser nos pulsions les plus obscures, les plus animales, comme la statuette qui rend fou et sanguinaire dans L’idole des Cyclades et Les ménades, où un chef d’orchestre paye cher et probablement en chair, son moment de gloire, quand le concert classique se transforme en orgie carnassière, sous la conduite d’une femme vêtue de rouge. Le talent de Cortázar n’est plus à démontrer, et bien que les nouvelles de Gîtes, dont certaines figurent également dans d’autres recueils, commencent à dater – première parution chez Gallimard en 1968 – elles n’ont pas pris une ride. Elles se lisent avec toujours autant d’intérêt, de frissons et de plaisir.
Une des plus notables, c’est sans doute N’accusez personne. Un homme enfile un pull, situation que nous avons tous connue, ça serre un peu, on se débat, on cherche la sortie, lui n’en ressortira pas vivant. Cette nouvelle, très simple en apparence est d’une efficacité redoutable. Dans le registre légèrement surréaliste, il y a encore Céphalée, où un couple d’éleveurs subit les symptômes de tous les terrains homéopathiques, sur fond d’élevage de bêtes étranges, fragiles et apparemment répugnantes, les mancuspies.
Il y a cet homme dans Lettre à une amie en voyage qui vomit des petits lapins. Dans Maison occupée, un frère et une sœur vivent seuls dans une vaste demeure familiale, mais peu à peu sont obligés de se retrancher dans un espace de plus en plus restreint, jusqu’à devoir quitter la maison. Le talent de Cortázar est l’art de rendre palpables les tensions, sans besoin d’expliquer quoi que ce soit, souvent les situations virent à l’absurde, mais un absurde si noir qu’il est difficile d’en rire. Parfois, les nouvelles ressemblent à des souvenirs d’enfance, elles ont cette ambiance un peu douce et délavée, des anciens albums photos, et soudain transparait, sans crier gare, la cruauté.
Pas mal de nouvelles se construisent aussi autour des rêves, des prémonitions, comme Récit sur un fond d’eau, Dîner d’amis ; de la perméabilité des frontières entre la vie et la mort, comme cet enfant qui pleure derrière La porte condamnée d’une chambre d’hôtel, scène qui pourrait tout à fait figurer dans un film fantastique japonais, et puis dans Le fleuve, une nouvelle particulièrement cynique autour du couple, ainsi que dans Autobus, où les deux mondes s’interpénètrent le temps d’un parcours en autobus, au plus grand effroi de deux des passagers qui n’ont pas de bouquet de fleurs et ne descendent pas au cimetière. Cette nouvelle d’ailleurs fait penser à une autre excellente nouvelle qui se déroule dans un tramway, Les vautours, de l’auteur bolivien Oscar Cerruto dans Cercle de pénombre.
Pour les aficionados de ce genre de littérature, on ne saurait trop conseiller entre autre l’anthologie Histoires étranges et fantastiques d’Amérique latine parue chez Métailié en 1997, où l’on peut retrouver deux nouvelles de Cortázar,N’accusez personne et Apocalypse du Solentiname. Un auteur à découvrir également, uruguayen, si ce n’est déjà fait : Horacio Quiroga, avec notamment ses Contes d’Amour, de folie et de mort.
Cathy Garcia
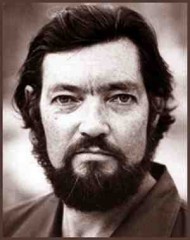 Julio Florencio Cortázar Descotte, né le 26 août 1914 à Ixelles (Belgique) est un écrivain argentin, auteur de romans et de nouvelles, établi en France en 1951 et naturalisé français en 1981. À sa naissance en 1914, son père travaille à la délégation commerciale de la mission diplomatique argentine à Bruxelles. La famille, issue d’un pays neutre dans le conflit qui commence, peut rejoindre l’Espagne en passant par la Suisse, et passe 18 mois à Barcelone. En 1918, la famille retourne en Argentine. Julio Cortázar passe le reste de son enfance à Buenos Aires, dans le quartier périphérique de Banfield, en compagnie de sa mère et de sa sœur unique, d’un an sa cadette. Le père abandonne la famille. L’enfant, fréquemment malade, lit des livres choisis par sa mère, dont les romans de Jules Verne. Après des études de lettres et philosophie, restées inachevées, à l’université de Buenos Aires, il enseigne dans différents établissements secondaires de province. En 1932, grâce à la lecture d’Opium de Jean Cocteau, il découvre le surréalisme. En 1938, il publie un recueil de poésies, renié plus tard, sous le pseudonyme de Julio Denis. En 1944, il devient professeur de littérature française à l’Université nationale de Cuyo, dans la province de Mendoza. En 1951, opposé au gouvernement de Perón, il émigre en France, où il vivra jusqu’à sa mort. Il travaille alors pour l’UNESCO en tant que traducteur. Il traduit en espagnol Defoe, Yourcenar, Poe. Alfred Jarry et Lautréamont sont d’autres influences décisives. Il s’intéresse ensuite aux droits de l’homme et à la gauche politique en Amérique latine, déclarant son soutien à la Révolution cubaine (tempéré par la suite : tout en maintenant son appui, il soutient le poète Heberto Padilla) et aux sandinistes du Nicaragua. Il participe aussi au tribunal Russell. La nature souvent contrainte de ses romans, comme Livre de Manuel, modelo para armar ou Marelle, conduit l’Oulipo à lui proposer de devenir membre du groupe. Écrivain engagé, il refuse, l’Oulipo étant un groupe sans démarche politique affirmée. Ses trois épouses successives sont Aurora Bernárdez, Ugné Karvelis (qui a traduit de l’espagnol quelques-uns de ses inédits) et l’écrivain Carol Dunlop. Naturalisé français par François Mitterrand en 1981 en même temps que Milan Kundera, il meurt le 12 février 1984 à Paris. Sa tombe au cimetière du Montparnasse est un lieu de culte pour des jeunes lecteurs, qui y déposent des dessins représentant un jeu de marelle, parfois un verre de vin. L’œuvre de Julio Cortázar se caractérise entre autres par l’expérimentation formelle, la grande proportion de nouvelles et la récurrence du fantastique et du surréalisme. Si son œuvre a souvent été comparée à celle de son compatriote Jorge Luis Borges, elle s’en distingue toutefois par une approche plus ludique et moins érudite de la littérature. Avec Rayuela (1963), Cortázar a par ailleurs écrit l’un des romans les plus commentés de la langue espagnole. Une grande partie de son œuvre a été traduite en français par Laure Guille-Bataillon, souvent en collaboration étroite avec l’auteur.
Julio Florencio Cortázar Descotte, né le 26 août 1914 à Ixelles (Belgique) est un écrivain argentin, auteur de romans et de nouvelles, établi en France en 1951 et naturalisé français en 1981. À sa naissance en 1914, son père travaille à la délégation commerciale de la mission diplomatique argentine à Bruxelles. La famille, issue d’un pays neutre dans le conflit qui commence, peut rejoindre l’Espagne en passant par la Suisse, et passe 18 mois à Barcelone. En 1918, la famille retourne en Argentine. Julio Cortázar passe le reste de son enfance à Buenos Aires, dans le quartier périphérique de Banfield, en compagnie de sa mère et de sa sœur unique, d’un an sa cadette. Le père abandonne la famille. L’enfant, fréquemment malade, lit des livres choisis par sa mère, dont les romans de Jules Verne. Après des études de lettres et philosophie, restées inachevées, à l’université de Buenos Aires, il enseigne dans différents établissements secondaires de province. En 1932, grâce à la lecture d’Opium de Jean Cocteau, il découvre le surréalisme. En 1938, il publie un recueil de poésies, renié plus tard, sous le pseudonyme de Julio Denis. En 1944, il devient professeur de littérature française à l’Université nationale de Cuyo, dans la province de Mendoza. En 1951, opposé au gouvernement de Perón, il émigre en France, où il vivra jusqu’à sa mort. Il travaille alors pour l’UNESCO en tant que traducteur. Il traduit en espagnol Defoe, Yourcenar, Poe. Alfred Jarry et Lautréamont sont d’autres influences décisives. Il s’intéresse ensuite aux droits de l’homme et à la gauche politique en Amérique latine, déclarant son soutien à la Révolution cubaine (tempéré par la suite : tout en maintenant son appui, il soutient le poète Heberto Padilla) et aux sandinistes du Nicaragua. Il participe aussi au tribunal Russell. La nature souvent contrainte de ses romans, comme Livre de Manuel, modelo para armar ou Marelle, conduit l’Oulipo à lui proposer de devenir membre du groupe. Écrivain engagé, il refuse, l’Oulipo étant un groupe sans démarche politique affirmée. Ses trois épouses successives sont Aurora Bernárdez, Ugné Karvelis (qui a traduit de l’espagnol quelques-uns de ses inédits) et l’écrivain Carol Dunlop. Naturalisé français par François Mitterrand en 1981 en même temps que Milan Kundera, il meurt le 12 février 1984 à Paris. Sa tombe au cimetière du Montparnasse est un lieu de culte pour des jeunes lecteurs, qui y déposent des dessins représentant un jeu de marelle, parfois un verre de vin. L’œuvre de Julio Cortázar se caractérise entre autres par l’expérimentation formelle, la grande proportion de nouvelles et la récurrence du fantastique et du surréalisme. Si son œuvre a souvent été comparée à celle de son compatriote Jorge Luis Borges, elle s’en distingue toutefois par une approche plus ludique et moins érudite de la littérature. Avec Rayuela (1963), Cortázar a par ailleurs écrit l’un des romans les plus commentés de la langue espagnole. Une grande partie de son œuvre a été traduite en français par Laure Guille-Bataillon, souvent en collaboration étroite avec l’auteur.
NOTE PARUE SUR : http://www.lacauselitteraire.fr/gites-julio-cortazar.html
14:11 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)





