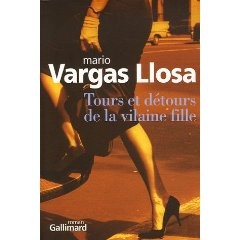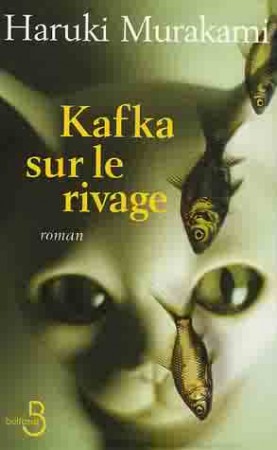25/06/2012
Voyages sur Chesterfield de Philippe Coussin-Grudzinski
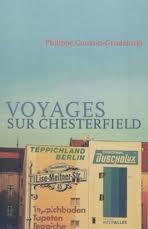
Editions Intervalles, 2012, 128 p. 15 €
Ce court récit, s’étalant sur une seule nuit de 0h07 à 7h00 du matin d’un mois de février pluvieux dans un appartement parisien, fait sans concession le portrait socio-zoologique de notre société contemporaine. Un portrait cynique mais réaliste d’un monde grotesque et un autoportrait d’une jubilatoire sincérité. Dans ce qui pourrait être comme des pages d’un journal intime, Philippe, jeune surdiplômé au chômage, expose comment il préfère se vautrer dans l’ennui le plus total, ponctué de petites rapines de produits de luxe, que de se plier aux hypocrisies, au fiel et à la poussée de dents, dont il faut faire preuve pour tracer sa route de paillettes dans le monde. « Pour remplacer mes pulls en cachemire à moindre frais, je retire habilement l’étiquette antivol dans les cabines d’essayage et je mise sur mon physique de fils de bonne famille pour déjouer la vigilance des hommes en noir à l’entrée des magasins ». Un monde top high-tech, celui des grands groupes de média, des « maîtres du monde », qu’il a connu alors qu’il était, il n’y a pas si longtemps, ce jeune con sous-employé lors de stages café/photocopies légèrement amélioré mais sans intérêt. Parcours obligatoire de tous les jeunes loups bien équipés pour espérer grimper rapidement l’échelle du paradis social, mais pour cela mieux vaut ne pas avoir trop soif d’Idéal.
Welcome dans un monde creux, superficiel et superfétatoire, puissamment épris de tape à l’œil, de réussite bling bling et cependant dépourvu de toute grandeur. L’auteur décrypte les personnages, les rouages et les backstages carton-pâte de ce parfait symbole de la société moderne, où le look, le cv et la bêtise ont ceci en commun que ça doit briller pleins feux, qu’importent les moyens, qu’importe le mensonge, qu’il est d’ailleurs de bon ton d’angliciser un peu. Ce qui est in un jour, top tendance le lendemain, est has been le jour suivant. Alors le narrateur reste chômeur, dort le jour et passe ses nuits sur facebook, où à travers des dialogues tantôt drôles, tantôt consternants, se brosse un portrait de l’ennui poussé à l’extrême. De tout ça, un être un tant soit peu sensible et idéaliste, ne peut que chercher à s’évader. L’amour, la drogue, la musique… Tout ce qui peut donner encore de véritables émotions. Pour Philippe, ce sont les souvenirs, d’enfance, de voyages, les fantasmes, et puis l’amour de Raphaël, l’intensité du plaisir, des transes sur la musique électronique des nuits de Berlin-Est, la grandeur de l’opéra, l’herbe bio d’Auvergne. C’est donc bien à un voyage sur Chesterfield, le fameux canapé cuir fait main, qu’il nous convie dans ce texte. Un texte facile à lire, qui au départ peut agacer, voire rebuter. On peut se poser la question de son intérêt, surtout si on trouve qu’on perd déjà soi-même trop de temps sur facebook, mais outre le fait qu’en transformant en quelque sorte le lecteur en voyeur, ce qui questionne aussi, c’est quelque chose de très essentiel qui filtre de ce récit : qu’en est-il de la beauté, du cœur, de l’intelligence, de la relation à l’autre, de tout qui donne valeur à l’humanité dans notre société de consommation ultra-artificielle, où il est si facile de se laisse hypnotiser, voire lobotomiser par tout et surtout rien, et passer sa vie à brasser du vide ? Il y a donc un espoir pour que les jeunes générations de diplômés échappent au grand cauchemar éveillé du monde des apparences et exigent que leur vie ait le véritable goût du vivant.
Cathy Garcia

Philippe Coussin-Grudzinski est né en 1986. Après avoir collaboré aux Inrocks, il est devenu community manager pour la télévision. Son blog Humeurs sur Chesterfield connaît un succès fulgurant : Voyages sur Chesterfield est son premier roman.
15:59 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
23/06/2012
La Fissure
Un webdocu d’Annabelle Lourenço et Cyprien Nozières sur le Japon de l’après-Fukushima
Article de Cathy Garcia paru dans le journal Le Lot en Action n°56

Un homme pêche près d’une maison renversée, presqu’ïle d’Oshika (Annabelle Lourenço)
Annabelle Lourenço est photographe et Cyprien Nozières* réalisateur-animateur. Ils sont partis tous les deux au Japon, dans un esprit de totale indépendance et par conséquent peu de moyens, pour récolter des témoignages et des photos de l’après Fukushima, neuf mois, chiffre on ne peut plus symbolique, après la tragique catastrophe du 11 mars. Accueillis à Tokyo par le frère de Cyprien et son épouse japonaise, ils sont restés au Japon trois semaines, pour rencontrer les gens et les lieux : la préfecture de Miyagi à la pointe de la presque île d’Oshika, lieu plus proche de l’épicentre du séisme, Fukushima dont nul aujourd’hui n’ignore, hélas, le nom, et Tokyo donc, la capitale, où l’inquiétude va grandissante.
« Nous avons réfléchi à un projet commun qui considérerait le problème dans son ensemble. Nous ne voulions pas nous contenter d’aborder uniquement la situation des victimes du tsunami, ni nous concentrer exclusivement sur le problème des radiations. »
Ainsi est né Fissure, un webdoc que vous pouvez voir ici sur le site d’Annabelle Lourenço : http://annabellelourenco.com/lafissure/
Le fil conducteur de ce très sensible webdoc, c’est l’eau, des gouttes d’eau qui semblent suinter de l’écran, chacun y verra ce qu’il veut, des larmes, des fuites d’eau contaminée et l’eau nous accompagne aussi parfois en fond sonore. Le webdoc se regarde, se lit et s’écoute. Après une présentation et un rappel des faits, il fait apparaître la carte du Japon où sont indiqués les trois lieux cités plus haut. Une grosse tache sombre s’étale sur la région en partant de Fukushima, la catastrophe après la catastrophe : la centrale, les réacteurs, les radiations. A l’internaute de cliquer ensuite sur la ville de son choix. Commençons par la préfecture de Miyagi. La vidéo présente Ishinomaki, à 90 km de la centrale, la ville a été dévastée par le séisme et le tsunami, 163 000 habitants, 6000 morts et disparus. Une photographie de Tadashi Okubo a immortalisée à jamais une jeune habitante au milieu des décombres, cette inconnue est alors devenue en quelque sorte, et bien malgré elle, l’icône du séisme japonais. Mais ici les images de la ville dévastée sont d’Annabelle Lourenço, la ville, une maison, une fenêtre, des portraits de disparus, des bruits de couverts, on est à table, la voix d’un pêcheur d’un petit village tout proche raconte. Comme tout le monde là-bas, il a perdu des parents, des amis : « Les gens devrait se réjouir d’être en vie. C’est si précieux la vie. ». Retour sur la ville fantôme, les travaux de reconstruction en cours… De ces traces de vie interrompue si brutalement, on ne peut qu’imaginer… Les photos d’Annabelle Lourenço sont très belles et le choix des sujets interpelle. Une espèce de grand silo renversé, rouge vif avec une publicité pour de la viande cuisinée, comme une immense boite de conserve absurde, renversée au milieu des ruines et gravats, des magazines ouverts sur des photos abîmées de jeunes filles nues, allongées, assises, souriantes, aguichantes… Éros contre Thanatos. La voix du pêcheur continue de parler : remercier, être courageux, positif, aller de l’avant, « Si on marche en se retournant, on tourne le dos à la lumière ».
Les photos disparaissent au profit d’une petite animation très simple mais efficace, pour raconter les secousses, puis le tsunami, la GROSSE goutte d’eau qui a tout balayé.
Puis des photos de la famille qui reçoit, le pêcheur, son épouse, les parents octogénaires, et l’homme raconte, la vie, maintenant, les problèmes de logement, de reconstruction, l’espoir. Ici point n’est question de radiations, on n’en est pas encore là, trop de choses à faire pour se remettre en selle et il y a déjà tant de morts à garder en mémoire, grâce aux photos que chaque famille a pu récupérer. Un travail de centaines de bénévoles venus d’un peu partout dans le Japon, le webdoc n’en parle pas car il reste centré sur ce témoignage en particulier, qui en dit tout aussi long mais c’est un détail qui me parait suffisamment important pour le mentionner. Et nous quittons la préfecture de Miyagi sur des photos de la grand-mère qui s’est déguisée, un chapeau, des lunettes rigolotes, un nez de clown, et qui chante, qui danse. Quelle belle leçon nous donne cette octogénaire qui a tout perdu mais peut être pas l’essentiel. Elle a eu cette chance, une partie de sa famille est vivante et il faut vivre, et vivre c’est se réjouir !
Pas de sensationnel morbide, d’apitoiement mais une volonté dans ce webdoc de rendre simplement hommage au courage et à la dignité des survivants, à leur capacité à continuer à vivre malgré tout.
Retour à la carte, un clic sur Fukushima. Fukushima, neuf mois après, des gens plus que légitimement inquiets et un gouvernement qui minimise, qui dissimule. Apparait Wataru Imata, un jeune homme originaire de Tokyo, membre du groupe Projet 47, un projet visant à fournir des outils de mesure aux habitants de Fukushima afin qu’ils puissent décider par eux-mêmes s’ils doivent évacuer ou pas. Projet 47 s’est associé avec le Réseau citoyen pour sauver les enfants de Fukushima pour créer le CRMS (Citizen’s Radioactivity Monitoring Station), un centre de mesure pour les contrôles citoyens, indépendant de TEPCO et des autorités japonaises.
Là encore des animations très simples, ludiques, faciles à comprendre pour les enfants, illustrent le propos. La politique de la préfecture de Fukushima pour les déjeuners des écoles, était de « produire local et manger local », quelle belle initiative, on en rêve tous, si seulement il n’y avait pas eu…. la catastrophe après la catastrophe. Le spectre peu appétissant du nucléaire. On peut apprendre ainsi que début mai 2011, soit moins de deux mois après le tsunami et ses terribles conséquences, si on allait dans un supermarché à Fukushima, tout ce qu’on y trouvait était des produits de Fukushima. C’est la CRIIRAD en déplacement sur place qui a fournit au CRMS les instruments nécessaires pour les mesures. Il faut savoir que la ville de Fukushima n’est pas dans le périmètre d’évacuation, donc si les gens voulaient partir, c’était selon leurs propres moyens, aucune aide à attendre de la part de TEPCO. Aujourd’hui on parle de décontamination, mais qu’en est-il vraiment ? On change les chiffres, on rehausse la limite de radiations annuelle de 1 micro sievert, elle est passé soudain à 20 mSv/ an, ceci pour les radiations externes, mais qu’en est-il de l’ingestion d’alimentation contaminée ? Le choix de partir ou de rester est difficile. Les radiations, les habitants ne peuvent pas les voir, ni les sentir, seulement les imaginer et se faire leur propre opinion, sachant que le temps joue contre eux. Wataru Imata est sur place depuis fin avril 2011, il sait que c’est son choix, il peut rester encore ou partir. En toute conscience et nous ne pouvons que saluer son courage.
Retour à Tokyo, situé à 250 km de la centrale, c’est l’angoisse, l’inquiétude, le doute. Le manque d’informations, c’est ce qui ressort de tous les témoignages, et nous savons bien ou devrions savoir que là-bas comme ici, la transparence en matière de nucléaire est une fiction, à fortiori en cas de catastrophe. Tchernobyl nous avait donné une bonne leçon à ce sujet, mais apparemment elle n’a pas servi à grand-chose. Les parents pensent à leurs enfants, et se regroupent en associations actives pour échanger des informations et se faire entendre des autorités. Sumiko Sasa et son mari, ont une fillette de 3 ans et Sumiko est très impliquée dans l’ « Association pour la défense des enfants du quartier de Kita contre les radiations ». Ce sont de simples citoyens, comme on dit, et surtout des mères de famille, qui font ce qu’ils peuvent pour prévenir autant que possible les risques, pour en informer les autres, pour faire pression sur les conseils municipaux. Ils s’encouragent, se soutiennent et sont de plus en plus nombreux. Les enfants ont des problèmes avérés de santé : thyroïde, saignement de nez, sang dans les urines… Sans doute qu’une véritable conscience anti-nucléaire est en train de grandir au Japon, un pays où les habitants n’avaient pourtant pas été habitués à prendre position contre l’autorité quelle qu’elle soit, mais ce qui ressort de ce webdoc c’est qu’il s’agit surtout de mères de famille, les maris se sentent apparemment moins concernés, ce qui créé des conflits dans les couples. Les hommes sont donc plus conditionnés que les femmes, histoire d’éducation, pour accepter l’inacceptable ? Ce n’est pas le cas de tous en tous cas, je pense entre autre à Laurent Mabesoone*, un français qui vit à Nagano, même distance de la centrale que Tokyo, depuis 19 ans, marié à une japonaise, père d’une fillette de 3 ans, et qui a choisi de rester là-bas. Il publie régulièrement des "chroniques anti-nucléaires" sur le site Netoyens* et participe activement au mouvement anti-nucléaire du Ruban Jaune (Yellow ribbon against nuclear power) au Japon. Ces regroupements de citoyens, comme les mères de famille du quartier de Kita, vont peut-être réussir à se faire entendre à force de persévérance mais tout de même, on ne peut s’empêcher de penser que ce monde marche sur la tête. Heureusement qu’il y a des personnes courageuses et suffisamment concernés par les autres, même à l’autre bout du monde, pour prendre des initiatives et réaliser des projets tel que ce webdoc. Je pense notamment au réalisateur Alain de Halleux et les Récits de Fukushima, visibles ici http://fukushima.arte.tv/#!/4883.
Nous ne devons pas oublier, car l’horreur de Fukushima n’est pas derrière nous, elle est en cours.
Cathy Garcia
*Voir les vidéos de Cyprien Nozières :http://vimeo.com/cypriennozieres/videos
*Le site Netoyens : http://www.netoyens.info/index.php/
* On peut lire des haïkus japonais écrits après Fukushima dans les deux derniers numéros de la revue Nouveaux Délits : des extraits d’Après Fukushima, haïkus du Cercle Seegan, présenté par Seegan (Laurent) Mabesoone dans le n°41 et Fukushima Renaissance de Taro Aizu dans le n°42 http://larevuenouveauxdelits.hautetfort.com/
Écouter une entrevue avec Laurent Mabesoone : http://www.youtube.com/watch?v=trgdE5KQeSw
Quelques liens pour savoir ce qui se passe aujourd’hui à Fukushima :
http://www.scoop.it/t/fukushima-informations/
http://fukushima.over-blog.fr/
http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
On peut aussi écouter le slam du groupe japonais Frying Dutchman qui, les 10 et 11 Mars 2012, ont organisé une grande parade anti-nucléaire "humanERROR" du nom de leur album et morceau éponyme sorti en Aout 2011 : http://www.dailymotion.com/video/xoccwe_frying-dutchman-humanerror_music
14:48 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE, NUCLEAIRE | Lien permanent | Commentaires (0)
18/06/2012
Ici comme ailleurs de Lee Seung-U
Note parue sur : http://www.lacauselitteraire.fr/ici-comme-ailleurs-lee-se...
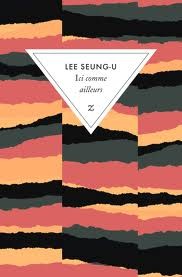
Zulma 2012 - Traduit du coréen par Choi Mikyung et Jean-Noël Juttet – 220 pages – 21 €
Kafkaïen est le premier qualificatif qui vient à l’esprit en lisant ce roman, pour l’univers dans lequel il se déroule et l’absurdité qui émane du parcours du personnage principal. Yu est muté par sa boite, le Gangsan Complex Resort, à Sori, une ville perdue entre un lac et des montagnes à l’Ouest du pays. « Lorsque, dans son guide, il a lu que « la petite ville de Sori, du fait de sa topologie particulière avait servi de lieu de bannissement », son cœur s’est de nouveau mis à balancer ».
L’histoire démarre sur ses mots qui donnent d’emblée le ton :
« Le vent a des hurlements de bête féroce. Au moment de quitter sa voiture, Yu a l’impression qu’un molosse enragé se jette sur lui. Il a un mouvement de recul. Le long des rues, papiers sales et sacs plastique tourbillonnent sous la bourrasque. Quelques véhicules cahotent sur la chaussée éventrée en soulevant des nuages de poussière ocre. Les rares passants, silencieux, font la gueule. »
Ici comme ailleurs est un roman hybride, indéfinissable. Il tient du polar, du roman noir, psychologique, métaphysique, à la limite du fantastique, et on pense à des films de cet extrêmement riche cinéma sud-coréen, en particulier ceux de Kim Ki-Duk, qui de même échappent à toute définition.
Lee Seung-U raconte le parcours d’un homme qui arrive dans une ville inconnue en pensant y travailler et qui y perdra tout ce avec quoi il est venu : sa femme, avant même d’arriver, car elle ne le suivra pas mais retournera dans une autre ville s’occuper d’un ancien amant, son portefeuille, l’accès à son compte, sa voiture, la raison pour laquelle il est là et ainsi de suite, comme si le réel se dissolvait derrière lui à chacun de ses pas. Sori, cette ville grise, froide, venteuse, inhospitalière et même dangereuse est un piège, mais à vrai dire, cet homme là n’avait-il pas déjà tout perdu avant même d’y arriver ? En refermant les dernières pages du livre, où la nature dans une apothéose grandiose, met un point final à tout questionnement, toute corruption, à toute l’absurdité de la condition humaine qui est exprimée ici, c’est la question que l’on se pose. Ce roman est un véritable condensé critique du monde d’aujourd’hui, une allégorie inversée, et finalement c’est un roman initiatique. On se détruit ici-bas et le seul espoir, le seul moyen que les hommes ont trouvé pour ne pas sombrer totalement dans la folie, c’est de quitter ce monde avant que la mort ne les prenne, découvrir par la dépossession, la paix éternelle. La grotte où un vieux fou dénommé Noé construit des maisons de pierre, est le seul lieu par lequel on peut s’échapper, le double enfermement devient matrice. Les vivants sont morts et les morts sont éternellement vivants. Les hommes libres sont piégés par une ville entièrement corrompue dans laquelle ils s’enlisent, ceux qui ont tenté de résister sont enfermés dans une grotte et découvrent dans l’enfermement, la liberté du détachement suprême. Subtile hybridation là aussi entre la pensée occidentale et orientale.
Ce roman austère, minéral, désespérant parfois, offre de par sa lecture elle-même, une étonnante expérience. Parfois, on voudrait poser le livre, le laisser tomber, mais il est impossible d’en sortir avant la fin car on la cherche, comme on cherche une goulée d’air. Par moment on s’ennuie, on se sent morne et même quand la fin arrive, on reste hébété, comme choqué, voire insatisfait. La magie de Lee Seung-U, c’est de provoquer ainsi une réflexion, où soudain on accède à la compréhension de l’ensemble et on ne peut que saluer le génie de l’auteur. Ce n’est pas une lecture facile, une lecture de détente, si au départ nous pouvons être captivés comme on l’est par un polar, vers la fin, on s’enlise comme le protagoniste, on se sent gris. L’auteur nous fait traverser les états d’âme, les sensations de ce qu’il raconte, si bien que nous ne faisons plus qu’un avec ce que nous lisons. Avec le recul, c’est fascinant.
Cathy Garcia
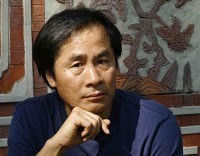 Lee Seung-U est né en 1959 à Jangheung, au sud-est de la péninsule, et a passé son adolescence à Séoul. Suite à une expérience religieuse, il entreprend des études de théologie ("Je ne me sentais pas heureux, je me suis lancé dans cette voie pour fuir ce malheur et cette pression"), bientôt interrompues ("J'ai réalisé que l'on ne pouvait aborder la théologie d'un point de vue mystique ou à la manière d'un refuge."). Le goût retrouvé de l'écriture se concrétise en 1990 par la parution d'un premier roman (Portrait d'Erisichton) qui lui vaut le Prix du jeune espoir littéraire de son pays. Majeure et unique dans la littérature contemporaine, sa voix est celle de l’intranquilité.
Lee Seung-U est né en 1959 à Jangheung, au sud-est de la péninsule, et a passé son adolescence à Séoul. Suite à une expérience religieuse, il entreprend des études de théologie ("Je ne me sentais pas heureux, je me suis lancé dans cette voie pour fuir ce malheur et cette pression"), bientôt interrompues ("J'ai réalisé que l'on ne pouvait aborder la théologie d'un point de vue mystique ou à la manière d'un refuge."). Le goût retrouvé de l'écriture se concrétise en 1990 par la parution d'un premier roman (Portrait d'Erisichton) qui lui vaut le Prix du jeune espoir littéraire de son pays. Majeure et unique dans la littérature contemporaine, sa voix est celle de l’intranquilité.
Du même auteur :
L’envers de la vie, Zulma, 2000
La vie rêvée des plantes, Zulma, 2007
14:11 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
10/06/2012
Sept façons de tuer un chat de Matias Nespolo

trad. de l’espagnol (Argentine) par Denise Laroutis, 2012, 254 p. 22,30 €
Edition: Thierry Magnier
Cette histoire est un premier roman plutôt réussi. Un récit nerveux, sec, dense et noir, qui laisse peu de place à la respiration, très vivant aussi grâce aux très nombreux dialogues dans lequel le traducteur retranscrit le style et le ton du lunfardo, l’argot de Buenos Aires. Le Gringo celui qui raconte et Chueco, le Tordu, son copain d’infortune, sont deux adolescents, mais l’âge ici a peu d’importance, on vit vite et on meurt tôt dans ce bidonville en périphérie de la capitale argentine. L’existence est un rouleau compresseur, misère, violence, corruption en guise de sainte trinité, et toute tentative pour sauter hors du bocal est vouée à l’échec. Pas d’espoir pour ceux et celles qui sont nés du mauvais côté, parents perdus très vite, la petite rapine de survie quand elle ne conduit pas au trou, mène en chute libre dans la guerre des dealers. Chueco le Tordu n’y échappera pas. L’amitié ici est fragile, à la merci de n’importe quelle trahison et l’amour n’y a pas sa place. Même sur le point de passer son bac, la jeune Délia dont Le Gringo est amoureux, n’échappera pas au droit de cuissage de Jetita, un chef de gang. Le trottoir et les coups sont la destination souvent finale des filles et femmes de ces quartiers. Drogues, alcool sont les seules et illusoires portes de sortie de cet enfer et Mamina, une vieille, pauvre mais courageuse femme, tente de redonner un peu de dignité à ces gamins de la rue en les recueillant et les élevant comme elle peut.
« Il y a des choses de Mamina que je ne comprends pas. Le travail inutile par exemple. Mais aussi les attitudes, les façons de réagir… plus je la connais, moins je la comprends. A l’heure qu’il est elle lave le trottoir à grandes eaux. Comme elle le fait un jour sur deux, religieusement. Qu’il pleuve, qu’il tonne ou qu’il grêle, elle lave sa portion de ciment jusqu’à ce qu’elle soit impeccable ».
Mamina sait bien que peu d’entre ses protégés ne la décevront pas. Le Gringo aimerait bien en faire partie mais comment échapper à la fatalité qui vous poursuit et vous mord au talon pire qu’un chien enragé ? C’est dans un livre qu’il cherche une réponse, un livre que Le Gringo a acheté dans une librairie avec le gain d’un larcin qui coûtera très cher.
« Je ne sais pas ce que je fous, là. Je n’ai jamais lu un livre de ma vie et maintenant j’en achète un. Le comble : c’est donné et je voulais seulement dépenser mon fric ».
Un livre qui l’accompagnera comme quelque chose que l’on poursuit et qu’on n’atteindra jamais : la baleine blanche de Moby Dick.
« Qu’est-ce que je fais ? J’ouvre le livre comme pour y chercher un conseil, en me demandant ce qu’il va me raconter, l’Ismaël, et il me sert une des ses salades… »
En parallèle de cette vie de misère où on en est réduit à bouffer du chat, se prépare en ville une grande manifestation contre le pouvoir en place, ce qui met l’accent sur le décalage entre ceux qui se veulent révolutionnaires, les étudiants, les travailleurs et ces laissés pour compte des bidonvilles qui dès leur plus jeune âge, s’ils l’atteignent, vivent et survivent la peur et la faim au ventre, le doigt sur la gâchette et le nez dans la merde, à des lieues de toute normalité où discours et idéaux auraient encore un sens. Cependant, il arrive un moment où les combats se rejoignent.
« (…) juste au moment où le mégaphone des flics nous ordonne de nous disperser. De dégager la route « gentiment » avant le départ de l’opération, dit le flic. Je connais cette voix. Elle ressemble beaucoup à celle que j’ai entendue l’autre nuit dans le talkie-walkie de Jetita. C’est le commissaire Zanetti, ce fils de la grande pute. Et son « gentiment » me rappelle ce que m’a dit Chueco il y a quelques jours. Cette réflexion qu’il a faite, qu’il y a sept façons de tuer un chat, mais, qu’à l’heure de la baston, il n’y a que deux façons qui vaillent, la gentille ou la dégueulasse. (…) C’est maintenant que le bal commence vraiment. Tout ce qu’il y a de gentiment… »
Cathy Garcia
 Matías Néspolo, dont c’est le premier roman, est né à Buenos Aires en 1975. Il a étudié la littérature, a écrit des poèmes et des nouvelles. Il est aujourd’hui journaliste culturel pour El Mundo et vit à Barcelone.
Matías Néspolo, dont c’est le premier roman, est né à Buenos Aires en 1975. Il a étudié la littérature, a écrit des poèmes et des nouvelles. Il est aujourd’hui journaliste culturel pour El Mundo et vit à Barcelone.
21:16 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
24/05/2012
Dernières nouvelles du sud, Luis Sepulveda et Daniel Mordzinski
Note parue sur : http://www.lacauselitteraire.fr/dernieres-nouvelles-du-su...

Avril 2012, 160 pages, 19 €
Edition: Métailié
1996. Le romancier Luis Sepúlveda et son ami photographe, Daniel Mordzinski, partent pour une longue virée sans but précis, ni contrainte de temps, au fin fond du continent américain, au-dessous du 42ème parallèle.
« Nous avancions lentement sur une route de graviers car, selon la devise des Patagons, se hâter est le plus sûr moyen de ne pas arriver et seuls les fuyards sont pressés ».
Ils nous livrent ici le concentré, l’essence même de ce qu’est le voyage : la rencontre avec l’autre. Et puis un constat, terrible, le constat d’une disparition. Patagonie, Terre de Feu, des noms qui pourtant évoquent encore tout un univers de mythes, d’aventures et de rêves, tout ça disparaît, comme ont disparu les tout premiers habitants, « Les autres ethnies ont succombé aux règles d’un progrès dont nul n’est capable de définir les fruits », premières victimes d’un engrenage qui broie toujours plus vite, aussi féroce qu’aveugle, un monde emporté dans la grande gueule d’un capitalisme toujours plus vorace. Ainsi de carnet de voyage, le livre devient une sorte d’« inventaire des pertes », et les superbes photos en noir et blanc de Mordzinski appuient sur cet aspect de monde dont il ne resterait que des ombres, un monde à l’abandon, échoué comme une baleine sur les rives d’une mondialisation dévorante et inhumaine.
« (…) le mot voyageur semble déplacé, peut-être subversif. Nous ne sommes plus des personnes ou des citoyens mais les clients d’un lupanar transparent surveillé par des caméras vidéo ».
C’est donc bien plus qu’un journal de voyage qui nous est donné à lire ici, mais un véritable témoignage critique et engagé.
« Pour définir la capacité des armes on parle de pouvoir de destruction. Pour définir la capacité de destruction de certains hommes il faut parler du pouvoir d’achat ».
Et l’auteur n’hésite pas à citer des noms :
« Les Benetton prétendaient apporter le progrès dans la région. Ils y ont apporté les clôtures en fil de fer barbelé, empêché la transhumance des gauchos et des rares espèces sauvages encore existantes, imposé des bornes absurdes dans une région où le ciel et la terre sont les seules limites ».
S’y rajoutent d’autres noms comme celui de Ted Turner, Sylvester Stallone…
Comme le dit Sepúlveda dans sa préface « A sa naissance, ce livre était la chronique d’un voyage effectué par deux amis mais le temps, la violence des bouleversements économiques et la voracité des vainqueurs en ont fait un recueil de nouvelles posthumes, le roman d’une région disparue ».
Des visages en émergent, des visages immortalisés par Mordzinski, qui à eux seuls racontent déjà une histoire, une histoire humaine, simple, émouvante. Des visages qui disparaissent aussi. C’est un livre dont on ne sort pas indemne. Le talent de Sepúlveda a fait de chacune de ces histoires un conte, un roman, mais la réalité, comme on dit, dépasse et de loin la fiction. Comme l’histoire d’El Tano, qui cherchait un violon au milieu de la pampa :
« – Ce violon, quand l’avez-vous perdu, l’ami ?
– Qui vous a dit ça ? Je ne peux pas l’avoir perdu puisque je ne l’ai pas encore trouvé, déclare-t-il dans une nouvelle démonstration de logique écrasante ».
Ou encore la magnifique et très bouleversante histoire de doña Delia :
« Je viens tout juste d’avoir quatre-vingt quinze ans, lui a-t-elle répondu avec une moue coquette.
– Depuis quand ?
– Maintenant, c’est aujourd’hui mon anniversaire ».
Donã Delia, la dame aux miracles :
« – Comment avez-vous fait ? a demandé mon socio.
– Quoi donc ? s’est étonnée la vieille dame.
– La fleur, ai-je ajouté en montrant le rameau qui avait fleuri entre ses mains.
– Je ne sais pas. C’est un don, paraît-il. Tout ce que je touche vit, a-t-elle répondu timidement ».
On croise donc bien des visages, des personnages qu’on pourrait dire pittoresques tel El Duende, le mystérieux lutin d’El Bolsón, mais néanmoins bien réels, des personnes ayant vécu hier et faisant figure maintenant de légendes locales, tel Martin Sheffield, dit le Shérif, compère de Butch Cassidy et puis des gens bien vivants d’aujourd’hui, pas tous fréquentables d’ailleurs, mais des gens encore et tout simplement humains, il y en a, tels les hommes du rails du Patagonia Express.
« Ce fut un voyage joyeux, très joyeux, car ce fut Le dernier Voyage du Patagonia Express ».
Il est donc question de déclin dans ce livre, oui, mais aussi et surtout de dignité, et on se prend encore à espérer qu’il ne soit pas trop tard.
« On a la nostalgie de ce qu’on vous arrache, non de choses imaginaires ».
En ce monde dit moderne qui se resserre de plus en plus, jusqu’à nous étouffer, heureusement « Lire ou écrire, c’est une façon de prendre la fuite, la plus pure et la plus légitime des évasions. On en ressort plus forts, régénérés et peut-être meilleurs. Au fond et malgré tant de théories littéraires, nous autres écrivains nous sommes comme ces personnages du cinéma muet qui mettaient une lime dans un gâteau pour permettre au prisonnier de scier les barreaux de sa cellule. Nous favorisons des fugues temporaires ».
Cathy Garcia
22:00 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
08/05/2012
The doors, 23 nouvelles aux portes du noir, ouvrage dirigé par Jean-Noël Levavasseur
Note parue sur http://www.lacauselitteraire.fr/the-doors-23-nouvelles-au...

Dessins de Riff Reb’s, 2012, 256 p. 17 €
23 auteurs de polar français, marqués par l’esprit du rock, proposent chacun une nouvelle inédite ayant pour fil conducteur le groupe mythique des Doors et le plus mythique encore, roi lézard, Jim Morrison. Ces 23 nouvelles sont classées dans un ordre chronologique fictif, s’étalant entre le 8 juillet 1965 et l’année 2005. On peut regretter le manque d’originalité de certaines, et donc une qualité inégale du recueil, mais l’ensemble se laisse lire facilement et a le mérite d’offrir un portrait rapide d’une époque et ce qu’il en reste.
Le côté sombre de l’Amérique des années 60, c’est d’abord le Viêt-Nam, thème abordé dans la première nouvelle, We’ll be home for Christmas de Pierre Mikaïloff, l’évocation de toute une jeunesse sacrifiée, à travers une correspondance entre un jeune Morrison, étudiant en cinéma, et un de ses amis qui lui envoie des poèmes depuis le front. Des poèmes qui portent des titres tels que Light my fire, Love me two times, The End…
Il y a Charles Manson, qui apparaît dans la deuxième nouvelle, The ballad of Sarah J. de Thierry Crifo. On pense à Sarah Jane Moore qui en 1975 tentera d’assassiner le président Ford et à la chanson de Dylan.
Trafalgar d’Olivier Mau, est un texte bref qui parle des déboires d’un looser alcoolo avec sa copine alors qu’il est sur le point de produire le groupe de son copain Jim. L’alcool semble le rendre visionnaire quant à l’avenir des Doors.
Marc Villard fait le va et vient dans D’esprit à esprit, entre Paris et l’Amérique de 1966 : Morrison provoque son premier et fameux scandale au Whiskey A Go-Go et une adolescente cherche dans Paris un disque des Doors pour son père en train de mourir à l’hôpital.
La nouvelle suivante, La perception des portes, est un récit plutôt. Michel Leydier prend pour fil conducteur le thème des portes et raconte ses premiers émois adolescents à Casablanca sur l’air de Love her madly, quelques anecdotes de sa vie dans le show-biz rock’n roll en lien avec les Doors et des retrouvailles 40 ans plus tard, lors d’un mariage à Casablanca, histoire de refermer la boucle des portes. Puis Sylvie Rouch enchaîne avec une histoire de lycéens, Coltrane, Simpson, Lorette et moi, qui nous replonge dans l’ambiance des années 60 en France, avec un clin d’œil au Che en final.
Bel interlude psychédélique avec Attention, mon petit Jim, de Bruno Sourdin, un poème plus qu’une nouvelle, incantatoire, électrique et envoûtant, dans le style chamanique de Morrison, avec en refrain l’entêtant Mr Mojo Risin’ (le mojo étant un sortilège d’amour vaudou). Un superbe hommage en forme de trip, à l’album L.A. Woman.
Puis, nous replongeons brutalement dans la réalité noire noire, avec une nouvelle de Marion Chemin, Under the bridge, un texte bref et puissant, qui remue en profondeur, et où Morrison devient prétexte à rouvrir une porte bien sombre de l’histoire française : le massacre du 17 octobre 1961.
Bunch of slaves de Max Obione évoque sans grande conviction le Caen de mai 68, exprimant ainsi le début de la désillusion. Matthias Moreau nous balance une mordante Parade molle de Coconut Grove dont la chute est aussi celle de Morrison.
Autre parade, Douce parade funèbre de Jean-Noël Levavasseur, nous ramène non sans humour en France profonde, où il est question de sérial killer lors d’une conversation téléphonique à l’Hôtel Maurisomme.
Avec Le plus grand poète vivant depuis Rimbaud, Denis Flageul nous embarque pour une virée de bar en bar dans la nuit rennaise et rend hommage à Kérouac.
La rizière rouge de Michel Embareck revient sur la thématique du Viêt-Nam et de nouveau à travers une correspondance, une impression de déjà lu. Outdoors d’Hugues Fléchard est une nouvelle plus confuse que déjantée qui nous fait pénétrer dans un centre pénitentiaire de Floride. Jean-Bernard Pouy crache, avec Merci d’être venus si nombreux, un extrait de ce qui semble être un long poème sur la condition de poète de Morrison et du poète en général dans la grande bétaillère du monde, constat plutôt amer. « C’est un emmerdeur, un bonnet d’âne, un radiateur ou un pinacle, un démiurge à la con ».
Bellevue Hospital Center de Jan Thirion raconte un Morrison fin de parcours, en visite dans un hôpital pour enfants où un gardien déguisé en orang outang pourrait être Kérouac. On pense au Bellevue Psychiatric Hospital de New York qui a vu passer pas mal de têtes plus ou moins connues de cette époque de grande défonce, notamment Burroughs. Dans Les portes du pardon de Luc Baranger, on retrouve Morrison dans la peau d’un beauf de 69 ans, à Clermont-Ferrand, où il a passé sa vie après l’avoir échangée avec un certain Charlie Behrman, son sosie, rencontré dans une boîte de Saint-Germain des Prés en avril 71.
Dans Le couteau des mots de Pierre Hanot, le ton est à l’humour, noir bien sûr. Un poète de catégorie raté y relate sa courte carrière de petite frappe, ratée aussi, et sa brève rencontre dans un bar avec un Morrison pathétique. Dans Un ou deux francs, une ou deux vies, Jean-Luc Manet explore lui aussi le thème de l’échange d’identité, sauf que là il s’agit plutôt d’un vol, avec le portrait au vitriol d’un ex-prof soixante-huitard à la dérive pour qui l’irresponsabilité devient crédo. Mission d’intérim de Serguei Dounovetz, nous présente the End, la mort, sous les traits d’une infirmière transsexuelle du bois de Boulogne. C’est ma prière (American prayer) de Bruno Schnebert nous fait basculer dans la génération qui redécouvre les Doors, et nous entraîne sur la tombe de Morrison by night, histoire de voir que la poésie du mot FUCK a survécu. Stéphane le Carré avec son Misogyne Morrison, ne fait pas dans la dentelle, encore une histoire de sosie, un portrait bien cynique de la société actuelle lobotomisée, avide de sexe et de divertissements bas de gamme. La dernière nouvelle nous rend le sourire, à travers la soirée bien galère du protagoniste, auquel on peut s’identifier sans mal. Le malheur des autres, on le sait bien, est également plutôt divertissant, surtout quand il est raconté avec humour, et puis là au moins il n’y a pas mort d’homme.
En fin d’ouvrage, une chronologie rapide de la vie de Morrison par Jean-Noël Levavasseur, suivie de la présentation des auteurs : Luc Baranger * Marion Chemin * Thierry Crifo * Serguei Dounovetz * Michel Embareck * Denis Flageul * Hugues Fléchard * Pierre Hanot * Stéphane Le Carre * Jean-Noël Levavasseur * Michel Leydier * Jean-Luc Manet * Olivier Mau * Pierre Mikaïloff * Mathias Moreau * Max Obione * Jean-Bernard Pouy * Sylvie Rouch * Bruno Schnebert * Caroline Sers * Bruno Sourdin * Jan Thirion * Marc Villard
Cathy Garcia
11:52 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
23/04/2012
Le vent d’Anatolie - Zyrànna Zatèli
Note parue sur : http://www.lacauselitteraire.fr/le-vent-d-anatolie-zyrann...

Quidam éditeur (collection Poche) 2012 - Traduit du grec par Michel Volkovitch - 56 pages - 5 €
Sympathiques petits livres pour un prix plus qu’abordable, la collection Poche de Quidam séduit d’emblée. Un beau chat bleu en couverture de celui-ci. Le Vent d’Anatolie est une nouvelle de Zyrànna Zatèli, tirée du recueil Gracieuse dans ce désert.
C’est un texte qui se lit d’un trait, d’une grande beauté, troublant, qui raconte dans une langue simple, très fortement empreinte de poésie, une étrange histoire d’amitié. Celle d’une jeune fille et d’une vieille tuberculeuse un peu folle. Mais est-elle réellement folle ou plutôt désespérément seule ? Isolée par la communauté qui craint sa maladie, mais la nourrit quand même par acquis, sans doute, de bonne conscience, elle meurt à petit feu dans sa maison, comme une pestiférée, brassant souvenirs et délires.
Un jour, la jeune fille qui est la narratrice de l’histoire, est chargée d’apporter à manger à Anatolie, c’est le nom de la vieille malade. La nouvelle débute ainsi par le trajet qui mène à sa maison, un bref portrait de quelques personnages de ce coin perdu au nord de la Grèce : Naoum le bijoutier qui met des pompons aux oreilles des chats et qui vend aussi bien des bijoux que des fusils de chasse, le souvenir d’une jeune fille morte à 17 ans dans un sanatorium, un boucher cynique, pétomane, coureur de jeunes jupons et ainsi, on arrive chez Anatolie.
« Je suis là » dit-elle sèchement, levant haut le menton. Puis elle tourna la tête et ajouta l’air songeur : « Gracieuse dans le désert… ».
L’auteur a une façon de traduire le regard de la jeune fille sur Anatolie qui donne le ton de tout ce qui suivra, on est un peu chez la sorcière du conte de fée. La maladie, la différence, la solitude donnent à Anatolie une sorte d’aura magique, à la fois inquiétante et fascinante.
« ses mollets luisaient comme la gélatine »
« Sa démarche et son corps lui-même avaient quelque chose d’oblique, une ondulation incessante et fascinante en forme de huit… huit… huit… ».
« Deux très grandes chaussures, presque autant que celles des clowns, vertes comme des poivrons et munies d’attaches rouges en corne ».
Peu à peu, se tisse un lien entre Anatolie et cet enfant qui vient la nourrir, qui brave les interdits en demeurant auprès d’elle et qui, dès la première fois, va jusqu’à partager la nourriture à la même cuillère.
« C’est Anatolie, on s’en doute, qui eut cette idée imprévue de manger ensemble, issue d’un désir pas vraiment clair et généreux mais plutôt cruel : celui de partager avec quelqu’un, avec moi, le poids de sa solitude, de cette maladie qui la torturait ».
Parfois Anatolie souffre trop, délire ou se laisse aller à une certaine méchanceté, malice plutôt.
« Tu veux donc voir une photo rouge ? demanda-t-elle quand la terrible toux se calma. Tiens ! Et elle déplia le mouchoir, plein de sang… Voilà mes rubis ! Tu en as, toi, des comme ça ? »
D’autres fois elle raconte, son passé, son père, sa mère, sa sœur et son frère cadets. Bien qu’elle ne le montre pas, elle s’attache à sa visiteuse, celle qui ose rester avec elle et les deux finalement ont une certaine bizarrerie en commun.
Un jour Anatolie parle du vent, ce vent qui devient parfois un homme et qui vient la chercher, la harcèle, mais elle lui résiste, alors il repart.
Elle l’appelait le vent (…) il avait toujours le dos tourné ; elle voyait seulement son omoplate gauche, nue, son cou, une partie de sa tête, puis rien que le torse – il devait être assis au bord du lit, à sa droite –, tandis que l’autre côté se perdait dans les ténèbres.
(…)
Comme il doit se sentir seul de n’être désiré par personne… C’est pour ça qu’il vient vers moi comme un sauvage. Comme un mendiant.
C’est que malgré tout elle est solide Anatolie, elle en a vu dans sa vie, cependant, vient le jour où elle arrête de manger. La jeune fille continue de lui rendre visite, de rester avec elle.
Je précise que je n’ai jamais cru un seul instant que j’étais l’amie d’Anatolie par héroïsme. C’était ce charme surnaturel qui m’enveloppait quand je traversais sa cour, en arrivant ou en repartant (…). C’était cette image de la brume dorée, le premier matin, qui ne m’avait pas quittée depuis (…). C’était ses paroles, qui lorsqu’elles ne débordaient pas de méchanceté, étaient attirantes comme la nuit.
Elle sera là jusqu’à la fin, jusqu’à ce que :
« J’ai sommeil, dit-elle ».
(…)
Je me levai enfin pour partir. Le vent avait laissé la porte ouverte.
Et on referme le livre, non sans une certaine émotion, ébloui par cette histoire si simple, mais que l’auteur, grâce à un véritable talent de conteuse, réussit à rendre absolument envoûtante.
Cathy Garcia

Zyrànna Zatèli est née en 1951 à Sohos, près de Thessalonique et vit à Athènes. Elle a reçu le Grand prix national du roman en 1994 et 2002. Du même auteur : Le Crépuscule des loups, le Seuil 2001 ; La Fiancée de l’an passé, Le Passeur 2003 - Publie-net 2009 ; La Mort en habits de fête, Le Seuil 2007.
15:33 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
10/04/2012
J'ai lu Mémoires du Serpent de Michel Host
Note parue sur : http://www.lacauselitteraire.fr/memoires-du-serpent.html

Hemann éditeur, 2010, 170 pages, 22 €
Dans ces Mémoires du Serpent, on y entre et on y plonge même, avec un plaisir quasi enfantin, et il s’agit bien de cela, d’une fable fantaisiste et ludique, mais néanmoins pleine de fond et de sens. Ces Mémoires du Serpent ne sont rien de moins que la véritable histoire de la Genèse, narrée par celui qui en fut le maître d’œuvre, connu sous le nom de Satan et bien d’autres noms encore plus ou moins désobligeants, et à côté de laquelle la version de la Bible fait figure de mauvaise et lugubre plaisanterie.
« Pourquoi ne m’ont-ils pas reconnu, moi leur créateur, si visible, à leurs pieds parmi les herbes, dans les trous de la terre, ou sous leurs yeux dans les branches des arbres ? Mon nom est Heywa. Je suis l’envers et l’endroit, je suis la vie riante et belle, la vie sombre et laide, je suis le commencement et la fin, le serpent coloré qui aime à dérouler ses anneaux dans les ténèbres et dans la lumière ».
Edmund Orpington, professeur anglais fraîchement retraité, décide d’acquérir pour ses vieux jours un vieux château des Highlands, hanté comme il se doit (mais ceci est une autre histoire), le château de Deathstrike. Outre la population locale des plus accueillantes, il y fait la connaissance de la jeune et charmante Miss Ophélia Mac Callahan, qui deviendra sa nouvelle gouvernante. C’est elle qui conduira le professeur, lors d’une de leurs excursions, dans un souterrain oublié où ils découvriront, après quelques fouilles guidées par un mystérieux reptile, ces mémoires transcrites à cet endroit même par le moine Paphnuce, au XIe siècle. Miss Mac Callahan deviendra alors aussi une assistante à la traduction de ces textes rédigés en latin, non pas en anglais, mais en français, langue bien plus à-propos selon le professeur.
« Porter des santés à l’Écosse, à ses collines venteuses, à ses averses rafraichissantes, à ses brouillards impénétrables, à ses habitants valeureux… fit monter la chaleur ambiante de plusieurs degrés Celsius ».
Michel Host avec ce livre s’est fait plaisir et nous prenons tout autant le nôtre, bons vins, bonne chère, soutiennent nos deux traducteurs, et de là à passer aux plaisirs de chair, nous patienterons encore quelques chapitres… Un minimum pour aller au fond du sujet, si gentiment et joyeusement subversif (certains voudront peut-être dresser le bûcher ?).
Nous noterons qu’en cela, nos deux protagonistes et avec eux au moins une bonne partie de la population locale, voire de l’Écosse toute entière, sont les dignes créatures de leur créateur qui, après avoir inventé l’espace et mis le temps en marche, créa sa première œuvre incontournable : le premier bar du monde.
« je vis clairement que “cela était bon”, et cela l’était bel et bien : il fallait que nous nous désaltérions mes aides et moi, la tâche de créateur n’étant pas si simple et la chaleur paradisiaque s’avérant accablante ».
Un roman plein d’humour et de bonnes manières y compris envers les animaux.
On connaît Michel Host pour son amour de la langue et de la culture hispanique, aussi est-il surprenant de voir ce livre prendre place en Angleterre, mais il a eu donc vite fait de déménager en Écosse, et l’Écosse on le sait, n’est pas l’Angleterre. Il faut souligner que l’auteur règle subtilement ses comptes avec certaines manières anglo-saxonnes, avec la présentation de deux démons infréquentables pour leurs pairs, Time is money et My taylor is rich, qui, bannis pour tentative de corruption du couple originel pas même encore réveillé, s’en iront construire la City avant de se répandre plus tard Outre-Atlantique.
« Et dès qu’il leur prit la fantaisie de faire des enfants, j’envoyai ceux-ci plus loin encore, au-delà du grand océan, en un autre lieu qu’ils allaient nommer Wall Street, au bord du fleuve Hudson… Je l’avoue, mon ami, tout cela, qui fut plutôt mal inspiré, mis en œuvre de manière approximative, finira un jour selon le pire des scénarios. Inflation ! Récession ! Chômage ! Rhumatismes chez les banquiers ! Crise mondiale… ! Que sais-je encore ! »
Et nous nous régalons donc d’apprendre enfin la vérité sur l’histoire de nos commencements, mais petite critique, cependant, était-ce l’abondance de plus en plus rabelaisienne de mets et boissons ? Il semblerait que sur la fin, la traduction des Mémoires du Serpent soit un peu vite expédiée, afin sans doute de passer à la fête et au baptême, doux sacrilège, de deux chatons, personnages non négligeables de ce roman, devenus grands. De véritables bacchanales donc, qui devaient clore en beauté ce roman des plus pertinemment facétieux et si délicieusement épicurien.
Cathy Garcia
 Michel Host né en 1942, en Belgique, de parents français, vit actuellement entre Paris et un village de Bourgogne. A enseigné avec un immense plaisir la langue et la littérature espagnoles, successivement à des lycéens, des étudiants et des agrégatifs. A toujours écrit et aussi traduit de l’espagnol et du portugais. A publié des poèmes : Déterrages / Villes (Dumerchez, 1997) ; Graines de pages (Eboris, Genève, 1999) ; Alentours (L’Escampette, 2001), Poème d’Hiroshima (Rhubarbe, 2006). Figuration de l’Amante (Poèmes, Ed. de l’Atlantique, 2010).Des romans chez Grasset : L’Ombre, le fleuve, l’été (1983, prix Robert Walser), Valet de nuit (1986, prix Goncourt)… chez Fayard : Converso ou la fuite au Mexique (2002), Zone blanche (2004)… Des nouvelles : Les Cercles d’or (Grasset, 1989), Heureux mortels (Grand prix S.G.D.L. de la nouvelle, Fayard, 2003)… etc. L’Amazone boréale (nouvelles, Ed. Luc Pire, Bruxelles, 2008). A traduit de Luis de Góngora : Les Sonnets (Dumerchez, 2002), la Fable de Polyphème et Galatée (L’Escampette, 2006), d’Aristophane, Lysistrata, (Ed. Mille & Une Nuits, 2009),3O Poèmes d’amour de la tradition Mozarabe d’al-Andalus (Ed.de l’Escampette, 2010), de Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre (Ed. de l’Atlantique -Collection Hermès 2011).« La poésie m’est langue fondamentale, surgissement et violence, parfois traduisibles dans la langue maternelle. Son haut voltage n’est tolérable que par intermittence. Selon ma pratique, elle peut informer le roman, voire la nouvelle. » Direction d’ateliers d’écriture durant plusieurs années en milieux scolaires difficiles, professionnels et étudiants, au Blanc-Mesnil, à Bobigny, Nanterre, Cherbourg, Paris, et aujourd’hui à Muret. « Je suis né à la littérature et à la langue française dans l’exploration des poètes et penseurs de la Renaissance (Marot, du Bellay, Ronsard, Montaigne, Rabelais…). De là m’est venu naturellement un profond intérêt pour les classiques grecs, latins, allemands, espagnols et portugais notamment. Mes philosophes de prédilection : Socrate, Jésus, Jeremy Bentham, tous témoins d’une « morale naturelle » de fond : « Ne fais à autrui ce que tu ne voudrais qu’il te fasse, aime-le, ne porte pas atteinte à sa vie. » Mes devises : « Faisons provision de rire pour l’éternité. » (Marquise de Sévigné) – « Le combat est mon repos. » (Don Quichotte). Ces quelques lignes proposent un portrait subjectivement positif : je laisse de côté des défauts bien ordinaires, entre autres un art certain de déplaire, source de plaisirs et de déplaisirs selon les circonstances. Je ne puis me passer de silence et de musique, de l’amour et de la conversation des femmes et des enfants ; de la confiance des animaux familiers ou non ; de l’amitié dans les travaux partagés ; d’un jardin où respirer, voir les arbres, les nuages, la beauté du monde, oublier les faux maîtres à penser, penser avec ma tête après avoir lu de vrais maîtres.»
Michel Host né en 1942, en Belgique, de parents français, vit actuellement entre Paris et un village de Bourgogne. A enseigné avec un immense plaisir la langue et la littérature espagnoles, successivement à des lycéens, des étudiants et des agrégatifs. A toujours écrit et aussi traduit de l’espagnol et du portugais. A publié des poèmes : Déterrages / Villes (Dumerchez, 1997) ; Graines de pages (Eboris, Genève, 1999) ; Alentours (L’Escampette, 2001), Poème d’Hiroshima (Rhubarbe, 2006). Figuration de l’Amante (Poèmes, Ed. de l’Atlantique, 2010).Des romans chez Grasset : L’Ombre, le fleuve, l’été (1983, prix Robert Walser), Valet de nuit (1986, prix Goncourt)… chez Fayard : Converso ou la fuite au Mexique (2002), Zone blanche (2004)… Des nouvelles : Les Cercles d’or (Grasset, 1989), Heureux mortels (Grand prix S.G.D.L. de la nouvelle, Fayard, 2003)… etc. L’Amazone boréale (nouvelles, Ed. Luc Pire, Bruxelles, 2008). A traduit de Luis de Góngora : Les Sonnets (Dumerchez, 2002), la Fable de Polyphème et Galatée (L’Escampette, 2006), d’Aristophane, Lysistrata, (Ed. Mille & Une Nuits, 2009),3O Poèmes d’amour de la tradition Mozarabe d’al-Andalus (Ed.de l’Escampette, 2010), de Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre (Ed. de l’Atlantique -Collection Hermès 2011).« La poésie m’est langue fondamentale, surgissement et violence, parfois traduisibles dans la langue maternelle. Son haut voltage n’est tolérable que par intermittence. Selon ma pratique, elle peut informer le roman, voire la nouvelle. » Direction d’ateliers d’écriture durant plusieurs années en milieux scolaires difficiles, professionnels et étudiants, au Blanc-Mesnil, à Bobigny, Nanterre, Cherbourg, Paris, et aujourd’hui à Muret. « Je suis né à la littérature et à la langue française dans l’exploration des poètes et penseurs de la Renaissance (Marot, du Bellay, Ronsard, Montaigne, Rabelais…). De là m’est venu naturellement un profond intérêt pour les classiques grecs, latins, allemands, espagnols et portugais notamment. Mes philosophes de prédilection : Socrate, Jésus, Jeremy Bentham, tous témoins d’une « morale naturelle » de fond : « Ne fais à autrui ce que tu ne voudrais qu’il te fasse, aime-le, ne porte pas atteinte à sa vie. » Mes devises : « Faisons provision de rire pour l’éternité. » (Marquise de Sévigné) – « Le combat est mon repos. » (Don Quichotte). Ces quelques lignes proposent un portrait subjectivement positif : je laisse de côté des défauts bien ordinaires, entre autres un art certain de déplaire, source de plaisirs et de déplaisirs selon les circonstances. Je ne puis me passer de silence et de musique, de l’amour et de la conversation des femmes et des enfants ; de la confiance des animaux familiers ou non ; de l’amitié dans les travaux partagés ; d’un jardin où respirer, voir les arbres, les nuages, la beauté du monde, oublier les faux maîtres à penser, penser avec ma tête après avoir lu de vrais maîtres.»
15:01 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
21/11/2011
Mémoires d’un rat Andrzej Zaniewski
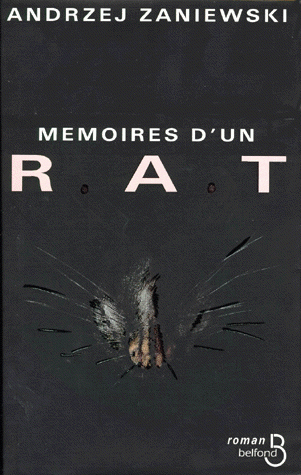
(Szczur – Varsovie septembre-novembre 1979 inédit – Belfond 1994)
Intitulé Szczur (Rat) en polonais, il a été écrit à Varsovie en septembre-novembre 1979 et refusé par tous les éditeurs. Jugé « pessimiste, outrancier, amoral et pornographique », le roman fut finalement traduit en tchèque et édité pour la première fois en 1990. Sa publication en allemand lui a donné ses lettres de noblesse, traduit ensuite en seize langues, il devient un best-seller. Mémoires d’un rat est un roman aussi passionnant que brutal. Il se dévore. Un livre où nous devenons rat, et traversons à ras de terre l’Histoire des hommes, rat de terre et de mer aussi, car le rat poussé par la faim est un voyageur. La vie d’un rat de sa naissance à sa mort, racontée par lui-même. Un rat qui pour contrer les peurs et la fragilité de sa prime jeunesse devient peu à peu un monstre, un rat dominant. Et peu à peu se fait jour cette troublante ressemblance entre lui et nous, nous et lui. Nous humains, lui rat, nous rats humains. Le rat est une créature intelligente, opportuniste, qui vit en clans familiaux, sans pitié pour tous ceux qui ne sont pas de la famille. Ce qui n’empêche pas le rat de manger un jour sa mère ou ses enfants. Ce livre, par ailleurs très documenté, nous parle de notre propre répugnante condition quand nous nous laissons aller à nos instincts les plus primaires. "Tu comprendras tout ce qui t'unis à cet animal apparemment si éloigné de toi". Seulement voilà, un rat est un rat, nous, nous n’avons pas cette excuse…
Andrzej Zaniewski est né en 1940. Sa mère, épouse d’un homme issu d'une bonne famille bourgeoise, devra cacher pendant des années son identité à moitié juive, mais aussi son métier de danseuse. Son père, membre de l'armée clandestine, trahi par ses compagnons, sera interné et fusillé à Auschwitz. D’août 1944 jusqu’à la fin de l'insurrection, en octobre, Andrzej Zaniewski enfant et sa mère se cachent dans les caves à Varsovie. C'est là qu’il entend, pour la première fois de sa vie, des rats derrière le mur. Il vivra toutes les horreurs de cette période, sera témoin d’exécutions. Les habitants des caves survivent grâce à une chèvre, cachée avec eux, qui, à la grande stupeur de l’enfant, sera tuée lorsque devenue trop faible pour donner du lait. Tuée et mangée. Après la guerre, sa mère et lui s'installent à Gdansk dans le quartier du nouveau port, peuplé de trafiquants, de prostituées et de rats. Pour André, l'horreur continue, il voit des pères abuser de leurs propres filles. Il grandit dans un monde brutal et sordide. Sa mère tombe malade, la schizophrénie. Pour fuir tout ça, il étudie l'histoire de l'art et s’adonne la poésie, mais sans succès, puis fait une tentative de suicide suite à un chagrin d’amour. Andrzej Zaniewski entrera au parti communiste, et sera membre de l'association des écrivains polonais, contrôlée par le parti. Il n’a jamais été apprécié en Pologne.
17:50 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
10/11/2011
J'ai lu Zoli de Colum Mc Cann
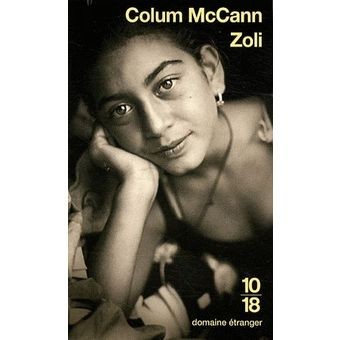
(Irlande 2006 - Belfond 2007)
1930 - Zoli Novotna avait six ans, mais elle n’était heureusement pas là quand sa famille se retrouve bloquée sur les glaces par la Hlinka, qui allume ensuite des feux sur la berge. Elle n’était heureusement pas là quand sa mère, son frère, ses deux sœurs et toute la famille, roulottes, chevaux, quand tout part englouti sous les eaux. «Lorsqu'il a commencé à faire moins froid dans l'après-midi, les roulottes, bien obligé, se sont déplacées vers le milieu du lac. Mais la glace a fini par craquer, les roues se sont enfoncées et tout a coulé en même temps, les harpes et les chevaux». La Hlinka c’est la haine. La milice fasciste de Slovaquie. La petite Zoli et son grand-père fuient sur les routes, fuient la Hlinka, fuient la haine et la mort, avec pour leitmotiv cette phrase qui reviendra tout au long du livre et qui pourrait finalement presque tout résumer : « Avance mon cheval et chie ». Chie au nez de la haine, chie au nez de ceux qui voudraient enfermer, sangler, anéantir ton peuple libre et nomade. « Grand-Père disait que nous étions faits pour le ciel, pas pour les plafonds. » Mais, grand-père aime la connaissance et il va briser un tabou énorme, que lui-même a brisé plus ou moins en cachette, il va apprendre à sa petite fille à lire et à écrire. Alors, la petite fille va écrire par exemple la liste des choses à faire pour survivre : «Lave ta robe dans une eau qui court. (…) Rappelle-toi le temps qu'il fait au son de la roue. Change de nom. Perds tes chaussures. (...) Garde-toi de la Hlinka, les massacres ont toujours lieu la nuit». Très vite, la petite Zoli prendra goût à l’écriture et en plus des chants que tous connaissent, elle en invente d’autres et en écrit les paroles. Zoli Novotna se découvre poétesse et dans la Tchécoslovaquie communiste de l’après-guerre, qui souhaite intégrer les Rom à sa nouvelle et égalitaire vision du monde, elle deviendra une égérie du régime. Soutenue par un poète déjà glorifié et complètement exalté par cette « découverte », elle fréquente également l’ami ,de ce dernier, Stephen Swann, un jeune anglais trop romantique, que la jeune veuve rendra fou d’un amour impossible. Elle bravera pourtant là encore l’interdit ancestral, mais y renoncera très vite. « Avant de repartir chez les siens, elle cousait des pages sous la doublure de son manteau, dans les poches de ses robes. (…) Elle se promenait avec ses chants d'amour collés aux hanches, et j'ai appris par cœur des poèmes entiers pour les lui réciter à voix basse lorsqu'on prenait le risque d'un moment entre nous. Elle conservait dans diverses autres poches des ouvrages de Krasko, Lorca, Whitman, Seifert, et même un Tatarka récent. Quand elle posait son manteau à l'imprimerie, elle faisait tout de suite plus mince ». Portée par ce succès qu’elle ne comprend pas vraiment, Zoli sera produite en public, sera adulée, hissée au sommet d’un monde auquel elle n’appartient pas et ne pourra jamais appartenir, et croyant un instant qu’elle pourrait aider ainsi son peuple, elle sera trahie par Swann l’éconduit et en paiera la déconvenue au prix fort. Même si son peuple, secoué par les évènements de la guerre, « Il y a des choses qu'on peut voir et entendre - encore aujourd'hui, longtemps après : les fosses qu'on creusait, la terre qui tremblait, les oiseaux qui ne volent plus au-dessus de Belsen, ce qui est arrivé à nos frères de Tchéquie, sœurs de Pologne, cousins de Hongrie, quand nous autres Slovaques avons survécu, bien qu'ils nous aient frappés, torturés, jetés en prison. Ils nous ont volé notre musique, nous ont bouclés en camp de travail », même si les siens donc tolèrent pour un temps cette transgression, vient le moment où l’intransigeance des règles revient la prendre de plein fouet. Zoli qui a livré aux gadže, avec sa poésie enregistrée et publiée, l’âme de son peuple, est bannie, devenant selon la coutume, pour tous et à tout jamais, une paria. Alors que les siens sont immobilisés de force dans des tours d’immeubles, Zoli, pour leur épargner la honte, et particulièrement à celles et ceux qui lui sont chers comme Conka, son amie d’enfance, entame une errance sans retour dans l’Europe. Une longue et rude errance d’une femme exceptionnellement digne et courageuse, qui supportera sans broncher et sans jamais perdre son goût inné pour la liberté, toutes les souffrances, les privations, jusqu’à ce qu’un amour paisible croise son chemin, un gadže différents des autres. « J’ai demandé à Enrico pourquoi il n’avait pas demandé si j’étais gitane. Il m’a demandé pourquoi je n’avais pas demandé s’il ne l’était pas. C’est peut-être la plus belle réponse qu’on m’ait jamais faite. » Alors Zoli peut se reposer un temps, « tout cela pour dire čhonorroeja, que l’envie d’aller plus loin venait de s’évanouir. Selon un vieux proverbe rom, la rivière n’est jamais où elle commence, jamais où elle finit, mais il me semblait être arrivée au bout de quelque chose. » mais cet amour lui aussi, lui sera brutalement enlevé, en lui laissant une fille. Une fille que Zoli à la fin du livre, ira rejoindre pour quelques jours à Paris, nous sommes en 2003, un bond dans le temps et les temps s’emmêlent, mais Zoli n’a pas changé. « Avance mon cheval et chie. »
Cathy Garcia
Colum McCann, écrivain né à Dublin en 1965 et vivant aujourd’hui à New York, est l'auteur de très beaux romans (le Chant du coyote, Les Saisons de la nuit, Danseur) et de deux recueils de nouvelles, La Rivière de l’exil et Ailleurs en ce pays. Zoli a pris racine à partir d'une photo de la poétesse tzigane polonaise Papusza, sur laquelle Colum McCann est tombé, en lisant Enterrez-moi debout !, L'Odyssée des Tziganes, d'Isabel Fonseca (livre que je vous recommande aussi fortement). Obsédé par cette image, il n'a pas pu faire autrement que de se plonger dans le monde des Tziganes d'Europe centrale et d’écrire ce très beau roman, «à mi-chemin de la fiction et de la non-fiction». Zoli n'est pas Papusza, mais elle lui ressemble.
17:55 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
12/07/2010
J'ai lu Les deux fins d’Orimita Karabegović de Janine Matillon
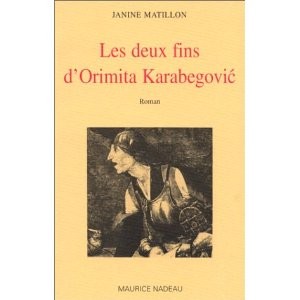
(Maurice Nadeau 1996)
Alors qu’on exhume, quinze ans après, des corps de musulmans bosniaques d’un charnier près de Srebrenica, et que plus de 700 victimes identifiées provenant d’une centaine de fosses communes ont été enterrées hier, le 11 juillet au centre mémorial de Potocari, à l'occasion du quinzième « anniversaire » du massacre de Srebrenica, j’avais déjà depuis quelques jours entamé ce livre de Janine Matillon, sachant que ce n’est pas exactement ce qu’on appelle dans les magazines féminins et autres, un roman d’été… Troublante coïncidence en tout cas, car je ne m’attendais pas à ce qu’on reparle tout à coup dans les médias de ces atroces massacres si vite tombés dans l’oubli, sans parler de la lamentable passivité pour ne pas dire complicité, des autres pays d’Europe et d’ailleurs.
Dans Les deux fins d’Orimita Karabegović, paru à peine un an après la fin de cette guerre, Janine Matillon nous plonge directement dans le ventre de la bête. Son héroïne Orimita, est une jeune étudiante bosniaque et musulmane, qui parle plusieurs langues et qui préparait à l’université de Zagreb une thèse sur Mallarmé et la logique négative, espérant devenir professeur de littérature française. Le premier jour où la guerre a frappé, elle assistait à un mariage à Vukovar, et le plafond de la salle s’écroule sur la table de noces et sur les convives. Pendant quelques mois, elle survit avec les survivants dans une cave avant de se retrouver emportée dans les flots de réfugiés. Elle finit par se faire arrêter et elle est embarquée brutalement avec beaucoup d’autres femmes, dont certaines meurent en route, dans d’immenses poulaillers transformés en camp. Mais Orimita, et onze autres jeunes femmes de sa condition, sont ensuite choisies pour subir un sort privilégié. Mises à part dans un autre bâtiment, une ancienne école, elles sont nourries et bien traitées, sous l’égide d’un professeur attentionné, qui leur administre journellement des cours, c'est-à-dire un lavage de cerveau idéologique. Ces douze jeunes femmes apprennent très vite qu’elles sont destinées à être purifiées, non pas par la déportation et la mort, mais par l’ensemencement quotidien de valeureuse et orthodoxe sève serbe, jusqu’à ce qu’elles en portent le fruit, ce qui leur offrira l’incroyable chance d’être accueillies au sein du seul et grand peuple légitime, du peule astral des Balkans et d’être lavée à jamais de leurs souillures d’origine.
Ce roman nous embarque donc dans le pire, avec pourtant une force poétique incroyable. C’est un roman viscéral, l’héroïne toujours au bord de basculer dans la folie, certaines de ses compagnes y sombreront totalement, et disparaitront de nuit, le fameux camion de minuit, et seront remplacées par d’autres comme si de rien n’était, car l’horreur est là, d’autant plus atroce qu’elle est pour un temps étouffée, déguisée, camouflée, mais Orimita hantée par Mallarmé y puise sa force, se protège par des couches de glace, de neige, combat le feu des obus, des massacres, de la violence et du sang, par le froid intense, la nudité de paysages à jamais glacés, tout son être se congele de l'intérieur. La poésie la sauve pour un temps mais la rage monte, insidieusement, la rage envers les épurateurs mais aussi, et peut-être encore plus fortement, pour le pays tant aimé, le pays de littérature, la France, dont elle ne peut croire la trahison, l’abandon, la langue de bois des technocrates « laissons le temps au temps » dit le président de France, pendant que le temps avance à coup d’obus, de chars et de tanks, dans ses grosses bottes de crapules saoules, et les têtes tombent sur les omoplates, et les membres se mélangent, détachés de leurs corps, et massacres, viols, pillages, incendies, se succèdent à la barbe de l’ONU et toute l’inexprimable horreur de cette démence qu’on appelle la guerre, et il faut laisser le temps au temps, pendant que tous les ministres, présidents, diplomates, militaires de France, d’’Europe et d’ailleurs ont « le sentiment d’avoir établi une bonne base pour la solution négociée », et d’ailleurs vient le temps où les réfugiés doivent rentrer chez eux, chez eux c'est-à-dire chez les conquérants, qui les renvoient sur les terrains truffés de mines, mais si les réfugiés rentrent chez eux, directive de l’Europe, il n’y a plus de réfugiés, effacés les réfugiés, disparus et enterrés les massacrés, les membres, les têtes, les corps, oubliés les massacres… Et chez Orimita, la rage monte insidieusement, une rage folle et froide, et quand elle se retrouve avec un groupe armé bosniaque, les siens donc, c’est un autre Islam qui monte, le sang appelle le sang, et un Moudjahidine lui impose un foulard sur la tête sous pene de l'égorger, et même ceux qui se sentaient plutôt athée sentent monter en eux la rage d’être autre, différent, et donc de l’être jusqu’au bout, intégralement, la haine appelle la haine et tout vole en éclat…Et chacun voit sa vision de plus en plus obstruée, étroite, l’autre est l’ennemi, l’autre est le tueur et doit être tué, "la Croatie aux Croates" lui lanceront les nouveaux ocupants de son appartement, et il devient impossible de retourner à la normalité, impossible ne serait-ce que de la supporter, quand on est allé aussi loin en enfer, même la littérature et la poésie n’y survivent pas. Deux fins seulement sont possible pour Orimita Karabegović, mourir ou tuer.
Janine Matillon, épouse de l’écrivain ex-yougoslave Stanko Lasic, a enseigné et vécu 15 ans à Zagreb, enseigne le croate, le bosniaque et le serbe à l'école des langues orientales à Paris.
Cathy Garcia, le 12 juillet 2010
12:01 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
09/05/2010
J'ai lu beaucoup de littérature LATINO-AMERICAINE et CARAÏBE
Voici une liste non exhaustive, pour découvrir toute la richesse et l’inventivité de cette littérature que j’adore, je vous présente donc ici seulement les livres que j’ai lu moi-même, y compris ceux que j’ai moins ou pas aimé, en espérant que cela vous donne envie de faire vos propres découvertes :
ANTHOLOGIES
14 écrivains d’Amérique centrale (Centre National du Livre 1997)
Histoires étranges et fantastiques d’Amérique latine (Métailié 1997)
ARGENTINE
Fleurs volées dans les Jardins de Quilmes Jorge Asis (Argentine 1988 –Renaudot et cie 1990)
Une certaine mûlatresse Miguel Angel Asturias (Mulata de tal –1963- Argentine – Albin Michel 1965)
Les armes secrètes (nelles) Julio Cortazar (Las armas secretas 1959 Folio 1973)
Cronopes et fameux Julio Cortazar (Historias de cronopios y de famas 1962 Argentine – Gallimard 1977)
Gîtes (nelles) Julio Cortazar (1968- Gallimard 1963)
BOLIVIE
Le cercle de pénombre (Cerclo de penumbras – Bolivie 1958) Oscar Cerruto (Ed. Patiño -Suisse - 1987)
BRÉSIL
Contes de Noël brésiliens (Albin Michel 1997)
Des nouvelles du Brésil 1945-1999 (Métailié 1998)
L’enfant cacao Jorge Amado (Cacau 1933 - Messidor 1986)
Suor Jorge Amado (1934 - Folio 93)
Mar morto Jorge Amado (1936 – Folio 1982)
Capitaine des sables Jorge Amado (Capitães de areia 1937 – Gallimard 1996)
Les chemins de la faim Jorge Amado ((Seara Vermelha, 1946 – Gallimard 1994)
La boutique aux miracles Jorge Amado (Tenda dos milagres 1971 – Stock 1976)
La bataille du petit Trianon Jorge Amado (Farda, fardão, camisola de dormir, 1979 – Stock 1991)
Tocaia Grande Jorge Amado (Tocaia Grande : a face obscura 1984 – Stock 1985)
L’alchimiste Paulo Coelho (Ed. A. Carriere 1994)
Sur les bords de la Piedra… Paulo Coelho (Brésil 1987 –A. Carriere 1996)
La cinquième montagne Paulo Coelho (Carrière 1998)
La nuit obscure et moi Lygia Fagundes Telles (Brésil - Rivages 1998)
La structure de la bulle de savon Lygia Fagundes Telles (Brésil 1977-84 –Serpent à plumes 1998)
Diadorim Joao Guimarães Rosa (Grande sertáo : veredas 1984 Albin Michel 1991)
Toutaméia –Troisièmes histoires- João Guimarães Rosa (Brésil 1985 – Seuil 1998)
Contes sarcastiques (Fragments érotiques) Hilda Hilst (Brésil - Serpent à plumes 1999)
O matador Patricia Melo (Albin Michel 1996)
Enfer Patricia Melo (Inferno 2000 – Actes Sud 2001)
Utopie sauvage (Souvenirs de l’innocence perdue –une fable-) Darcy Ribeiro (Brésil 1982 –Gallimard 1990)
Capitaine de la mer océane J. Sarney (Brésil - Hachette 1997)
Le carnaval des animaux Moacyr Scliar (Brésil 1976 –Serpent à plumes 1998)
CHILI
La maison des esprits Isabel Allende (Chili 1982 – Fayard 1984)
Les contes d’Eva Luna Isabelle Allende (Chili 1989 –Fayard 1991)
Cap Horn Francisco Coloane (Cabo de Hornos Chili 1941 –Seuil 1996)
Le sillage de la baleine Francisco Coloane (Chili El camino de la Ballena 1962 Phébus 1998)
Tierra del fuego (nelles) Francisco Coloane (Chili 1963 –Phoebus 1994)
El guanaco Francisco Coloane (El guanaco blanco 1981 Chili – Phoebus 1995)
Le passant du bout du monde Francisco Coloanne (Los Pasos del hombre 2000 Phébus 2000
Né pour naître Pablo Neruda (Chili 1978 –Gallimard 1986)
Mains sur la nuque Angel Parra (chilien, exilé en France, Manos en la nuca 2005 – Métailié 2007)
La reine Isabel chantait des chansons d’amour Hernán Rivera Letelier (La Reina Isabel cantaba rancheras 1994 Chili - Métailié 1997)
Le vieux qui lisait des romans d’amour Luis Sepulveda (Métailié 1992)
Un nom de torero Luis Sepulveda (Seuil 1996)
Journal d’un tueur sentimental (nelles) Luis Sepulveda (Métailié 1998)
Le café Azul profundo Roberto Ampuerto (chilien, exilé à Cuba Cita en el Azul Profundo 2001 – ed 10/18 2005)
COLOMBIE
J’ai légué mon âme au diable Germán Castro Caycedo (Colombie 1982 – Seuil 1986) ***
La Mala Hora G. Garcia Marquez (Colombie 1962 –Grasset 1986) ****
Cent ans de solitude Gabriel Garcia Marquez (1967 – Colombie Seuil 1995)
L’automne du patriarche Gabriel Garcia Marquez (Colombie 1975 –Grasset et Fasquelle 1976) ***
Douze contes vagabonds Gabriel Garcia Marquez (Colombie 1992)
De l’amour et autres démons G. Garcia Marquez (Colombie 1994 –Grasset 1995) ***
Le feu secret Fernando Vallejo (Colombie 1986 –Belfond 1998)
CUBA :
Adiós a mamá Reinaldo Arenas (Cuba 1974-82 – recueil paru à titre posthume, l’auteur, vivant aux USA depuis 1980 après avoir fui le régime castriste, atteint du sida, il s’est donné la mort en 1990, Serpent à plumes 1993)
Mon ange Guillermo Rosales (Cubain, né à la Havane en 46, mort à Miami en 93 - publié en 1987 à Barcelone « Boarding home » – Actes Sud 2002)
Trafiquants de beauté Zoé Valdés (Traficantes de belleza, Cuba 1998 – Actes Sud 2001)
Cher premier amour Zoë Valdes (Querido primer novio Cuba 99 - Actes Sud 2000)
Le pied de mon père Zoé Valdés (El pie de mi padre, 2000 – Gallimard 2000)
GUATEMALA
Le miroir de Lida Sal Miguel Angel Asturias (Albin Michel 1967)
Pierres enchantées Rodrigo Rey Rosa (Guatemala 2001 – Gallimard 2005)
HAÏTI :
Yeto ou le Palmier des Neiges Gérald Bloncourt (Henri Deschamps 1991, Haïti)
La douce récolte des larmes Edwige Danticat (The farming of bones, New York 1998, Haïti, Grasset 1999)
Vie et mort d’un apprenti-sorcier M. Veloz Maggiolo (Haïti - Ed. du Griot 1993)
MEXIQUE
La nouvelle contemporaine au Mexique (Atelier du Gué 1995)
Terre de personne Eduardo Antonio Parra (Mexique 1999/2001 – Ed. Boreal (Québec) 2003)
Les prières du corps Eloy Urroz (1994 Mexique - Mille et une nuits 2001
Jour de colère Jorge Volpi (Dias de ira 1994 Mexique – Mille et une nuits 2001)
PARAGUAY
La petite fille que j’ai perdu au cirque Raquel Saguier (Paraguay 1987 – Ed. du Griot 1992)
PÉROU
La passion selon San Pedro Balbuena Alfredo Bryce Echenique (Tantas veces Pedro Pérou 1977 – Flammarion 1980)
Roulements de tambours pour Rancas Manuel Scorza (Pérou 1970 –Métailié 1998)
La guerre de la fin du monde Mario Vargas Llosa (Pérou 1981 – Gallimard 1983)
L’homme qui parle Mario Vargas Llosa (Pérou 1987 –Folio 1989)
Eloge de la marâtre M. Vargas Llosa (Pérou 1988 –Gallimard 1990)
La fête au Bouc Mario Vargas Llosa (Pérou La fiesta del Chivo 2000 Gallimard 2002)
Tour et détours de la vilaine fille Mario Vargas Llosa (Travesuras de la niña mala Pérou 2006, Gallimard 2006)
URUGUAY
Contes de folie, d’amour et de mort Horacio Quiroga – écrivain uruguayen (1917 Buenos Aires – Métailié 2000)
15:24 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (4)
09/12/2009
J'ai lu L‘énergie secrète de l’univers de Maxence Layet

Savez-vous que les océans tournent sur eux-mêmes tels d'énormes tourbillons ? Que les points d'acupuncture se mesurent avec un simple voltmètre ? Que l'on peut entendre les échos des grincements de la Terre ? Que le corps humain rayonne de fréquences radio ? qu'un peu de lumière rouge peut soigner une entorse ?... Mon avis : bien fait, clair et précis, voilà un livre à lire pour tout ceux qui s'intéressent un tant soi peu à ce que nous sommes et à cet univers dans lequel nous évoluons. Cela fait bien longtemps que cela me passionne, et ce livre a le mérite de regrouper en un seul d'innombrables pistes à creuser. Je vous donnerai par la suite d'autres ouvrages qui m'ont accompagnée depuis de nombreuses années dans une recherche à mes yeux essentielle. Une quête de sens, bien-sûr, où science et spiritualité ne sont pas opposées, bien au contraire. Aux questions que l'humanité se posent, il y a des réponses déjà très anciennes mais qui ont été négligées ou tout simplement ridiculisées au nom d'une recherche moderne toute puissante et soi-disant détentrice du seul savoir valable, scientifique et occidental. Or, avec la physique quantique cette science là s'est vu propulsée quelques milliers d'années en arrière, dans des textes et des traditions que l'on pensait, en occident en tout cas, définitivement dépassées, textes védiques, taoïstes pour ne citer que ceux-là, pratiques spirituelles, arts martiaux, médecine holistique, méditation, électromagnétisme... Aujourd'hui nous vivons une période de jonction des savoirs, et tous les savants et chercheurs qui ont été diabolisés, rejetés, méprisés, bannis (et parfois même assassinés) par la science dite officielle vont faire parler d'eux, tout comme la poésie... Si, si tout est lié, je ne saurai pas vous l'expliquer mais je peux en toute certitude vous dire que je sais... et c'est pourquoi vous allez retrouver bientôt sur ce blog toute une série de propositions de lectures qui vous aideront à vous faire votre propre opinion, qui vous aideront à y voir plus clair et vous donneront peut-être envie d'aller encore plus loin. Il y a urgence, car d'un autre côté ces savoirs intéressent tous ceux qui ont un intérêt quelconque à contrôler leurs semblables. Il est temps d'ouvrir grands vos sens et se sortir vos antennes. Nous sommes bien plus que des mammifères consommateurs et corvéables à merci. Eteignez les télés, et lisez, expérimentez, lisez et expérimentez encore. |
||||
14:49 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
02/11/2009
J'ai lu Tour et détours de la vilaine fille de Mario Vargas Llosa
Présentation de l'éditeur
Biographie de l'auteur
Mon avis : j’ai aimé la vilaine fille et son bon garçon, j’ai aimé traverser le temps, les continents, les secousses d’un pli d’Histoire avec eux. J’ai aimé être la liseuse-voyeuse de cet amour impossible qui pose ses cruels jalons sur l’existence de ces deux exilés. Le désir et la mort dansent ensemble tout au long de ce roman qui s’immisce chez le lecteur comme un invité non attendu et auquel on s’attache, un inconnu qui nous semble étrangement familier. Cet amour fou du bon garçon pour la vilaine, la très vilaine fille, envers et contre tout bon sens ne peut nous laisser indifférent, de même l’entêtement désespérée de cette dernière à poursuivre sa propre perte. L’amour c’est sûr n’a rien à voir avec la raison, ni avec la décence et parfois même pas avec l’amour et Vargas Llosa en donne ici, une preuve éclatante.
Je vous conseille au passage un de mes livres préférés de cet auteur, la délirante et extraordinaire épopée de La guerre de la fin du monde (Gallimard 1983) :

Quatrième de couverture
J'ai lu et recommande aussi du même auteur
L’homme qui parle
Eloge de la marâtre
La fête au Bouc
et vous encourage à découvrir la richesse extraordinaire et haute en couleurs de la littérature latino-américaine, avec des auteurs comme Jorge Amado, Gabriel Garcia Marquez, Pablo Neruda, bien-sûr mais aussi Horacio Quiroga, Julio Cortazar, Francisco Coloane, João Guimarães Rosa, Oscar Cerruto, Miguel Angel Asturias, Manuel Scorza, Luis Sepulveda, J. Sarney, Lygia Fagundes Telles, Germán Castro Caycedo, Hernán Rivera Letelier, Eduardo Antonio Parra, Patricia Melo, Isabelle Allende...
14:52 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
05/02/2008
J'ai lu la Supplication de Svetlana Alexievitch
Tchernobyl, chroniques du monde après l’apocalypse (Tchernobylskaïa molitva, Russie, 1997 – JC Lattes 1998)
Il faut lire ce livre, ces paroles de l'Après... Il le faut parce que dans un pays qui prêche, prône et vend à qui mieux mieux le nucléaire, il faut savoir, savoir la folie, la monstrueuse folie d'une telle technologie. Tchernobyl la ville des roses, Tchernobyl "réalité noire", Tchernobyl oubliée, les enfants de Biélorussie, cobayes d'un dantesque laboratoire à ciel ouvert, Tchernobyl, le grand mensonge, Tchernobyl miroir où l'on peut lire l'avenir... Parfois en lisant la Supplication, la conscience veut s'échapper, s'imaginer dans un roman d'anticipation, fiction démente... Mais il s'agit bien de réalité, une réalité pour des milliards d'années... Tchernobyl... Il faudrait lire la Supplication en buvant des litres de vodka pour tenter de croire encore en des lendemains meilleurs... C.G.
*

Extrait :
Monologue à deux voix pour un homme et une femme
Nina Konstantinovna et Nikolaï Prokhorovitch Jarkov. Il enseigne le travail manuel et elle, la littérature.
Elle : " J'entends si souvent parler de la mort que je ne vais plus aux enterrements. Avez-vous entendu des conversations d'enfants sur la mort ? En sixième, ils se demandent si cela fait peur ou non. Il n'y a pas si longtemps, à leur âge, ils voulaient savoir comment naissent les bébés. Maintenant, ils s'inquiètent de savoir ce qui se passerait après une guerre atomique. Ils n'aiment plus les oeuvres classiques : je leur récite du Pouchkine et ils me regardent avec des yeux froids, détachés... Un autre monde les entoure... Ils lisent de la science-fiction. Cela les entraîne, dans un monde différent, où l'homme se détache de la terre, manipule le temps... Ils ne peuvent pas avoir peur de la mort de la même manière que les adultes... Que moi, par exemple. Elle les excite comme quelque chose de fantastique.
Je réfléchis à cela. La mort tout autour oblige à penser beaucoup. J'enseigne la littérature russe à des enfants qui ne ressemblent pas à ceux qui fréquentaient ma classe, il y a dix ans. Ils vont continuellement à des enterrements... On enterre aussi des maisons et des arbres... Lorsqu'on les met en rang, s'ils restent debout quinze ou vingt minutes, ils s'évanouissent, saignent du nez. On ne peut ni les étonner ni les rendre heureux. Ils sont toujours somnolents, fatigués. Ils sont pâles, et même gris. Ils ne jouent pas, ne s'amusent pas. Et s'ils se bagarrent ou brisent une vitre sans le faire exprès, les professeurs sont même contents. Ils ne les grondent pas parce que ces enfants ne sont pas comme les autres. Et ils grandissent si lentement. Si je leur demande de répéter quelque chose pendant le cours, ils n'en sont même pas capables. Parfois, je dis juste une phrase et leur demande de la répéter : impossible, ils ne la retiennent pas... Alors, je pense. Je pense beaucoup. Comme si je dessinais avec de l'eau sur une vitre : je suis seule à savoir ce que représente mon esquisse. Personne ne le devine, ne l'imagine.
Notre vie tourne autour... autour de Tchernobyl. Où était Untel à ce moment-là ? À quelle distance du réacteur vivait-il ? Qu'a-t-il vu ? Qui est mort ? Qui est parti ? Pour où ? Je me souviens que, dans les premiers mois après la catastrophe, les restaurants se sont de nouveau remplis. Les gens organisaient des soirées bruyantes... "On ne vit qu'une seule fois...", "Quitte à mourir, autant que ce soit en musique". Des soldats, des officiers sont venus. Mais Tchernobyl est désormais tout le temps avec nous... Une jeune femme enceinte est morte soudain, sans cause apparente. Le pathologiste n'a pas établi de diagnostic. Une petite fille de onze ans s'est pendue. Sans raison. Une petite fille... Et quoi qu'il arrive, les gens disent que c'est à cause de Tchernobyl. On nous dit : "Vous êtes malades parce que vous avez peur. À cause de la peur. De la phobie de la radiation." Mais pourquoi les petits enfants sont-ils malades ? Pourquoi meurent-ils ? Ils ne connaissent pas la peur. Ils ne comprennent pas encore.
Je me souviens de ces jours... J'avais la gorge irritée et me sentais lourde. "Vous vous faites des idées sur votre santé, m'a dit le médecin. Tout le monde se fait des idées à cause de Tchernobyl." Mais non, je me sentais réellement mal, avec des douleurs partout et les forces qui m'abandonnaient. Mon mari et moi étions gênés de nous l'avouer l'un à l'autre, mais nous commencions à perdre l'usage de nos jambes. Tout le monde autour de nous se plaignait, même nos amis, de ne plus avoir la force de marcher, d'avoir envie de s'allonger au milieu de la route. Les élèves étaient avachis sur les tables et perdaient connaissance pendant les cours. Tout le monde était devenu sombre. On ne rencontrait plus de gens souriants, de visages sympathiques. Les enfants restaient à l'école de huit heures du matin à neuf heures du soir. Il leur était strictement interdit de jouer dehors, de courir dans la rue. On leur avait distribué des vêtements : une jupe et un chemisier aux filles, un costume aux garçons, mais ils rentraient chez eux dans ces vêtements et l'on ne savait pas où ils traînaient avec. Normalement, les mères devaient laver ces vêtements chaque jour, de manière à ce que les enfants aillent tous les matins à l'école avec des habits propres. Mais on n'avait pas distribué de vêtements de rechange. De plus, les mères avaient leurs tâches domestiques. Elles devaient s'occuper des poules, des vaches, des cochons... Elles ne comprenaient pas pourquoi elles devaient se charger de ce surcroît de travail. Pour elles, des vêtements sales devaient porter des taches d'encre, de terre, de graisse et non des isotopes à courte période. Lorsque j'essayais d'expliquer la chose aux parents d'élèves, j'avais l'impression de leur parler en bantou. "Qu'est-ce que c'est que cette radiation ? On ne l'entend pas, on ne la voit pas... Mais moi, je n'ai pas assez d'argent pour finir le mois. Les trois derniers jours avant la paie, nous ne mangeons que des pommes de terre et du lait. Laissez tomber..." Et la mère faisait un geste las de la main. Or, justement, on a interdit de boire le lait et de manger les pommes de terre de la région. Les magasins étaient approvisionnés en conserves chinoises de viande et en sarrasin. Seulement, les villageois n'avaient pas assez d'argent pour se les payer. Les consignes étaient destinées à des individus cultivés. Elles supposaient une certaine éducation. Or cela manquait cruellement ! Le peuple pour qui les instructions étaient rédigées n'existe pas chez nous. Et il n'est pas si simple d'expliquer la différence entre un röntgen et un rem... De mon point de vue, je qualifierais ce comportement de fatalisme léger. Par exemple, la première année, il était interdit de consommer ce qui poussait dans les potagers. Et pourtant, non seulement les gens en ont mangé, mais ils en ont même fait des conserves. De plus, la récolte était extraordinaire ! Comment expliquer que l'on ne peut pas manger ces cornichons ou ces tomates... Cela veut dire quoi : on ne peut pas ? Leur goût est normal et ils ne donnent pas mal au ventre... Et personne ne "brille" dans l'obscurité... Pour changer leur plancher, nos voisins ont utilisé du bois local. Ils ont mesuré : la radiation était cent fois supérieure à la normale. Vous croyez qu'ils ont démonté ce parquet pour le jeter bien loin ? Pas du tout, ils ont vécu avec. Les gens se disent que tout cela va se calmer et finir par s'arranger tout seul. Au début, certaines personnes apportaient des produits alimentaires aux dosimétristes. Le niveau de radiation dépassait systématiquement la norme des dizaines de fois. Mais l'habitude a été vite perdue. "La radiation, on ne la voit pas, on ne l'entend pas. Ce sont des inventions des scientifiques !" Les choses ont repris leur cours : les labours, les semailles, la récolte... L'impensable s'est produit : les gens se sont mis à vivre comme avant. Renoncer aux concombres de son potager était plus grave que Tchernobyl. Pendant tout l'été, les enfants ont été forcés de rester à l'école. Les soldats l'ont lessivée à fond et ont enlevé une couche de terre autour d'elle. Mais, à la rentrée, on a envoyé ces écoliers récolter les betteraves, ainsi d'ailleurs que des étudiants et des élèves des écoles techniques. Ils étaient tous forcés d'y aller. Tchernobyl était moins grave que de laisser des légumes non récoltés dans les champs...
15:15 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (1)
23/07/2007
J'ai lu Kafka sur le rivage de Haruki Murakami
Kafka Tamura, est un adolescent de quinze ans, qui fuit Tokyo et son père qu'il déteste, avec à ses trousses une prophétie oedipienne. Kafka ne se souvient ni de sa mère, ni de sa soeur qui sont partis quand il avait quatre ans...
Mr Nakata, est un vieil et brave homme, simple d'esprit depuis un étrange accident dans son enfance, qui sait parler avec les chats. Il est parfois chargé de retrouver ceux qui se sont perdus. Sur la piste d'une chatte nommée Sésame, il se retrouve entraîné dans une macabre aventure qui le dépasse et qui le forcera à prendre la route, lui qui n'avait jamais quitté son quartier. Suivant un appel impérieux, le voilà parti dans une quête dont il ignore tout. Il semble lui-même être l'origine d'étranges évènements tels que des pluies de poissons ou de sangsues. Sur son chemin il trouve un compagnon en la personne de Mr Hoshino, jeune chauffeur routier qui va tout laisser tomber pour suivre Mr Nakata dans cette invraisemblable odyssée...
Ce que j'en pense :
Quand on se plonge dans Kafka sur le rivage il devient extrêmement difficile d’en sortir. Un peu comme de ces sommeils peuplés de rêves au petit matin. Entre road-movie fantastique et tragédie grecque au parfum de sushi, ce roman est tout simplement époustouflant. Onirique, lyrique, d’une étrange douceur, très humain. Un grand roman initiatique qui laisse le lecteur trouver par lui-même certaines des réponses. Entrecroisements de personnages au destin entremêlé, ce roman est aussi dense qu’une forêt, aussi riche qu’une bibliothèque et d’une simplicité déconcertante. La forêt, la bibliothèque : les deux pôles de l’histoire, le reste est dans la tête ou dans le ventre rythmé par la respiration lointaine et hypnotique de la mer. Kafka sur le rivage nous entraîne en ces lieux aux frontières fluctuantes entre vie et mort, rêve et réalité, dans notre propre labyrinthe intérieur, dans les tréfonds de l’âme humaine. Kafka sur le rivage…. Un stupéfiant chef d’œuvre.
13:25 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (1)
31/05/2007
J'ai lu Galsan Tschinag
Je voudrais vous inciter à découvrir un auteur pour lequel j’ai un grand coup de cœur. Il s’appelle Galsan Tschinag, il est né le 26 décembre 1944 dans une famille de chamans touvas de Mongolie. Il a passé sa jeunesse dans les steppes, puis est allé étudier à l’Université de Leipzig. Il est revenu dans son pays où il a commencé à publier en 1981. Sa langue d’origine, le touva, ne possède aucune tradition écrite, il écrit donc en Allemand. Une douzaine de titres, romans, récits et études le situent aujourd’hui parmi les tout premiers écrivains étrangers de langue allemande. Il vit actuellement à Oulan Bator et s’est fait l’ardent défenseur des coutumes de son peuple face aux dangers de la modernisation.
Lire Galsan Tschinag c’est comme franchir une porte qui vous transporte non seulement au cœur des steppes, à travers un paysage physique, rude, austère et grandiose, non seulement dans la chaude intimité du cercle de la yourte, mais aussi au plus profond du cœur de l’homme et à la frontière d’un savoir mythique entre tradition et modernité. C’est tout le devenir des cultures minoritaires dans le monde dit moderne qui est en jeu. Cette écriture simple et belle trace un chemin et ouvre des voies oubliées, où résonnent des chants anciens et puissants. Quand on commence à lire, on ne peut plus s'arrêter. Mais, ce sont des livres qui n'incitent pas au bavardage, ce sont même parfois des pages de silence, alors je vous invite à découvrir par vous-même :
Dojnaa, L’esprit des péninsules 2003
Dojnaa est la fille d’un lutteur de légende, une chasseuse hors pair, une femme humiliée par son mari qui la laisse seule avec ses enfants, une femme qui doit affronter les loups mais aussi les hommes. Un court roman dédié “à la femme nomade qui porte sur ses épaules le destin d’un monde en train de disparaître.”.
Sous la montagne blanche, Métailié 2004
Récit autobiographique. Après avoir suivi le « Chemin du savoir », celui d’une éducation moderne, «socialiste» à la mode soviétique des années 60 en fréquentant une école très éloignée géographiquement et culturellement de sa steppe natale, celle de ses ancêtres, où vivent les Touvas, le jeune Dshuruguwaa, qui se sent une vocation de chaman, est déchiré entre cette modernité qui prétend détruire les traditions millénaires de son peuple et qui considère sa foi dans le Père-Ciel et la Mère-terre comme arriérée et sa responsabilité à l’égard de la famille, du clan. Dans ce contexte, l’adolescent grandit, fait ses premières expériences sexuelles et vit la destinée tragique d’un grand amour.
A lire également :
Ciel bleu, une enfance dans le Haut Altaï
Vingt jours et un
Le monde gris
La fin du chant
La caravane
15:35 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (1)
29/05/2007
J'ai lu Matin brun de Franck Pavloff
"Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée d'un régime politique extrême : l'Etat brun.
Dans la vie, ils vont d'une façon bien ordinaire : entre bières et belote. Ni des héros, ni des purs salauds. Simplement pur éviter les ennuis, ils détournent les yeux.
Cheyne Editeur 43400 LE-CHAMBON-SUR-LIGNON
11:15 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
09/01/2007
J'ai lu Une saison de machettes de Jean Hatzfeld

Une saison de machettes
Jean Hartzfeld
Seuil 2003
Ancien reporter à Libération, Jean Hatzfeld a quitté le journalisme pour se pencher exclusivement sur le génocide rwandais. Après Dans le nu de la vie, dans lequel il rapportait les récits des rescapés tutsis, il sort un nouvel ouvrage consacré cette fois aux tueurs des marais, Une saison de machettes. Jean Hatzfeld y raconte ses entretiens avec les auteurs du massacre.
Ce que j’en pense :
On ne lit pas Une saison de machettes, on l’avale, comme on peut, difficilement.
On en prend un petit bout, puis on laisse reposer, afin que la nausée passe puis on reprend et comme ça peu à peu on arrive au bout de ces récits qui à vrai dire se passent de tout commentaires. On ne peut que saluer le courage de l’auteur qui a entrepris de recueillir ces témoignages et d’en faire ce document essentiel. Jean Hatzfeld avait déjà fait paraître en 2001 Dans le nu de la vie, Récits des marais rwandais, où il avait recueilli les témoignages des rescapés du génocide. Je n’ai pas lu ce livre, mais j’imagine qu’aussi insupportable qu’il soit, il demeure pourtant un témoignage de victimes, dont on ne peut que se sentir solidaires. Mais quand il s’agit de leurs tueurs, des tueurs qui sont leurs voisins, leurs collègues, leur co-équipiers de foot, leur instituteur, leurs époux… Des tueurs partis "couper", qui vous racontent ça comme des chasseurs du sud-ouest vous raconteraient une partie de chasse aux palombes, des tueurs qui quelque part ne font pas vraiment preuve de remords, qui ne saisissent ou ne veulent pas saisir l’horreur de leurs gestes, alors ces témoignages prennent une coloration complètement surréalistes, atrocement absurdes.
Et pourtant ces hommes là ont parlé, ont accepté de parler. Ils ont même, sauf un, posé pour une photo que l’on retrouve à la fin de l’ouvrage. Pourquoi ?
Et comment garder confiance en l’Homme lorsqu’on se trouve confronté à la folie bestiale d’un génocide ?
Ce sont les questions que posent ce livre, en tentant quelques comparaisons avec d’autres génocides et des ouvrages comme Des hommes ordinaires. Le 101e bataillon de réserve de la police allemande et la Solution finale en Pologne, publié en 1992 par le chercheur américain Christopher Browning, mais il n’y répond pas. Je crois bien qu’il est impossible d’y répondre.
Et en refermant Une saison de machettes, on ne peut s’empêcher de se demander lesquels d’entre nos voisins viendraient nous découper, nous éliminer ou nous vendre si tout à coup tout basculait…
Cathy Garcia
17:45 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
12/12/2006
J'ai lu Terre somnambule de Mia Couto
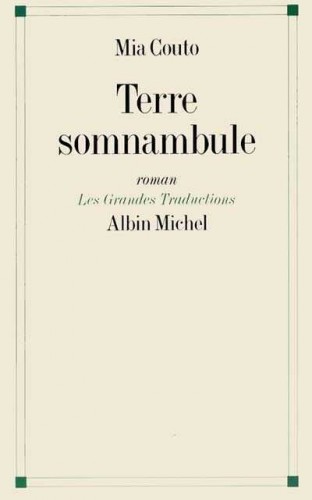
(Terra Sonâmbula, 1993), roman, traduit du portugais par Maryvonne Lapouge-Pettorelli. [Paris], Éditions Albin Michel, « Les Grandes traductions », 1994
Sur une route déserte, un vieil homme et un enfant marchent, épuisés. Alentour, un Mozambique déchiré entre troupes régulières et bandes armées. Devant eux, un car-brousse, ou ce qu'il en reste : tôles incendiées, corps pêle-mêle ; un asile, pourtant, où le vieillard et l'enfant vont faire halte et découvrir, miraculeusement intacts, les cahiers d'un certain Kindzu. Le récit de cet homme parti vers l'inconnu pour renouer avec l'esprit des sorciers et des guerriers sacrés leur livrera peu à peu la clé de leur destin.
Premier roman du jeune écrivain mozambicain António Emílio Leite Couto. Fils du poète Fernando Leite Couto (1924). Biologiste de formation. Militant du Frelimo (Front de libération du Mozambique). Collaborateur de nombreuses publications (África, Colóquio Letras, Hora de Poesia, etc.). Il a été directeur de l’Agence d’information du Mozambique, des revues Tempo et Domingo, et du journal Notícias de Maputo. Après un livre de poèmes (Raiz de Orvalho, 1983), deux recueils de nouvelles (Vozes Anoitecidas, 1986 ; Cada Homen É Uma Raça, 1990), et un volume de chroniques (Chronicando, 1991), il publie son premier roman en 1992 (Terres somnambules), qui a comme toile de fond la guerre civile dans son pays. Depuis, il a fait paraître de nombreux ouvrages (romans, nouvelles, contes) traduits un peu partout dans le monde. Il a également collaboré à plusieurs films. Prodigieux conteur, artisan d'une langue portugaise subvertie, métissée de parlers populaires, « mozambicanée».
Ce que j'en pense :
il est d'abord déroutant ce roman, deux histoires y avancent en filigrane. Un aller-retour incessant entre le présent des deux protagonistes, le vieil homme et l'enfant réfugiés dans un car-brousse incendié, au-milieu des morts, un no man's land sinistre cerné de violence, où passé et présent, réel et rêvé, s'entremêlent constamment et la lecture des cahiers trouvés là, dans lesquels aussi se mélangent l'histoire et le mythe, le vécu et le rêvé... Il n'est pas forcément nécessaire de connaître l'histoire du Mozambique même si cela aide à la compréhension du fond de ce roman. Par contre il est nécessaire de lire avec les tripes, plus qu'avec sa tête, de lire avec cet organe indéfinissable qui se met à vibrer dès qu'on le confronte à la dimension poétique. L'écriture de ce roman est belle, étrange et fascinante, et c'est bien de poésie qu'il s'agit ici. Une poésie qui puise dans l'imaginaire africain autant qu'à la beauté de la langue, ici donc celle de l'ancien colon, le Portugais, en les mêlant eux aussi pour en créer de nouvelles images, riches et surprenantes et qui donnent un style très particulier qui rappelle certains romans latino-américains. Une poésie où se diluent dans une sorte de fièvre, de lent cauchemar, le tragique des destins, la barbarie des guerres civiles comme les paysages qui en sont le décor. L'absurde violence, l'abysse des souffrances, là où l'homme se confond avec l'animal, n'en sont que plus palpables. Etrange, magnifique et bouleversant roman dont on ne sait pas exactement comment on y est entré, ni quand on en est sorti
15:40 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (1)