07/05/2021
Le rapport sexuel n’existe plus de Philippe De Jonckeere
 éditions Inculte, 3 février 2021 – décembre 2020. 300 pages, 18,90 €.
éditions Inculte, 3 février 2021 – décembre 2020. 300 pages, 18,90 €.
Qu’un homme puisse éjaculer à la vue d’une pantoufle ne nous surprend pas, ni non plus qu’il s’en serve pour ramener le conjoint à de meilleurs sentiments, mais personne assurément ne peut songer qu’une pantoufle puisse servir à apaiser la fringale, même extrême, d’un individu.
Jacques Lacan (1901-1981, psychanalyste français)
Entre autofiction et séance de psychanalyse étalée sur près de 300 pages, dans Le rapport sexuel n’existe plus, l’auteur est son propre personnage, endossant son propre nom et une partie en tout cas de sa vraie vie. Le fait que le récit prenne place en 2022 et s’achève en 2024 invente une distance temporelle avec ce qui semble pourtant être un véritable journal intime. Récit à visée thérapeutique pour guérir la douleur d’une déception amoureuse, dont l’auteur — cinquantenaire, se décrivant lui-même comme obèse et obsédé par l’arrivée de l’andropause qui vient alourdir le bilan d’une vie sexuelle de plus en plus fantasmatique — n’arrive pas à se défaire. Autoflagellation, autodérision, décorticage hyperlucide de son manque de lucidité, c’est grâce à son grand humour que l’auteur/personnage se rattrape toujours et parfois in extremis avant la chute dans le pathétique.
Philippe De Jonckeere, informaticien, personnage donc de l’auteur Philippe De Jonckeere, et c’est là que réside l’originalité parfois inconfortable de ce roman — où commence la fiction ? Où s’arrête-t-elle ? —, cherche à travers ce processus d’écriture à autopsier une relation affective que son imagination a rendu bien plus forte et réciproque qu’elle ne l’était en réalité, le but étant de parvenir à en faire le deuil, mais il y a aussi la possibilité que la personne en question, la cause de ses souffrances, lise le roman une fois publié, ce qui rend le deuil impossible puisque cela demeure une énième tentative, même masquée, de faire perdurer le lien. Donc le but du roman lui-même se mord la queue finalement.
Un roman comme une tentative de mise à jour :
« Internet c’est étonnant parfois. On dit souvent que c’est une mémoire, c’est tout le contraire, c’est une fiction dont les mises à jour gomment les données les plus anciennes, elles les écrasent, comme on dit en informatique. Car, comme vous savez, je suis informaticien. »
C’est très intéressant sur le plan du questionnement du pourquoi de l’écriture et du pourquoi nous faisons les choses dans la vie en général. L’intention affichée et l’intention sous-jacente. Tout lecteur peu disposé à réfléchir en profondeur sur ses propres fonctionnements psychologiques posera sans doute assez vite ce livre. Lecteur qui se retrouve happé dans ce processus très intime, témoin et même complice malgré lui d’une autoanalyse, où on retrouve notamment des narrations de rêves et des citations de Lacan, comme par exemple : « On finit toujours par devenir un personnage de sa propre histoire » ou « La vérité a la structure d’une fiction » et qui a inspiré le titre même de ce roman.
Une plongée dans la micro-réalité la plus intime du personnage de l’auteur donc, qui ainsi dévoile le moindre ressort de ses pensées, divaguant entre fantasme et réalité dans un roman qui lui-même sème le doute chez le lecteur quant à ce qu’il est en train de lire. Parfois, ce dernier peut se sentir de trop dans ce monologue intérieur, qui à force de détails des plus anodins et de ressassements, peut devenir même lassant et puis il est rattrapé, parce que c’est drôle aussi, impudiquement et férocement drôle, parce qu’il peut aussi se reconnaître – plus encore si le lecteur est un homme cinquantenaire en perte de confiance et tourmenté par les premiers signes de l’andropause. Sujet d’ailleurs rarement abordé en littérature ou dans la vraie vie même et qui est ici largement exposé. « Soixante-neuf fois le mot andropause. Vous pouvez vérifier. »
Dans « Le rapport sexuel n’existe plus », il est question de sexe bien-sûr, mais plus encore de solitude, de manque d’affection et d’élévation, de stimulation intellectuelle et sensorielle et il est beaucoup question de musique, de jazz en particulier, car celle autour de qui tourne tout le roman — en plus du nombril malmené, vieillissant et inquiet de son auteur — est une contrebassiste. Musique, cinéma, poésie, littérature et le sentiment d’impuissance face aux drames du monde forment aussi le canevas du récit bien plus que les problèmes d‘érection.
« Le rapport sexuel n’existe plus » est donc une sorte de journal de bord, journal hyper détaillé d’une obsession érotico-sentimentale, qui use et abuse du pouvoir thérapeutique de l’écriture pour se sonder en profondeur, se traquer dans les recoins, s’avouer ses plus inavouables faiblesses, disséquer ses pensées, comportements, fuites et addictions, et remonter ainsi peu à peu la pente de la dépression. Un lecteur ne connaissant pas du tout le travail de l’auteur et ses livres précédents ne saura pas si l’objet de ce roman est réellement ce qu’il prétend être, mais en comprenant la démarche de cet auteur qui, pensant ne pas savoir écrire, s’est obstiné à le faire — un réflexe de survie à sa propre histoire — on ne peut que saluer le courage de cette extrême mise à nu qui épargne en même temps le lecteur du fardeau excessif de pathos, grâce à cette distance que permet un sens aigu de l’humour et de l’absurde.
C’est bon de lire une voix d’homme osant aborder ses fragilités de mâle et en déconstruire les clichés, osant afficher ses peurs, sa sensibilité jusque dans ses accès les plus larmoyants, ses manques, ses obsessions et ses petites hontes intimes, qui ne craint pas de montrer des aspects peu glorieux de lui-même.
Cathy Garcia Canalès
 1951, Robert Frank prend une petite fille en photo dans les rues de Paris. Cette petite fille sera ma mère. Né le jour de la 1964ème commémoration du massacre des innocents. Entrée en 1986 à L’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs à Paris où je perds un peu de temps faute de recevoir l’enseignement que j’étais venu y chercher. Les professeurs de photographie sont des photographes stricto sensu, c’est dire. En 1988, deux ans d’études à The School of the Art Institute of Chicago, où je reçois notamment l’enseignement de Barbara Crane, Joyce Neimanas, Ken Josephson, Karen Savage et Bart Parker, je rattrape amplement le temps perdu aux Arts Décos. En 1990, je suis l’assistant de Robert Heineken, j’assiste à des miracles tous les jours. Fin 1991, retour en France, les choses vont mal. En 1993, à la suite d’un deuil, je commence à écrire, force est de constater que je ne sais pas écrire, mais je m’obstine, comme en toutes choses. 1995, Mai de la Photo à Reims, seule exposition d’envergure, l’exposition est censurée. Ça foire, comme en toutes choses. En 1995, je pars à Portsmouth en exil. Je fais les trois huit, travail alimentaire, sommeil, travail dans l’atelier ou travail alimentaire, travail dans l’atelier, sommeil, ou travail dans l’atelier, travail alimentaire, sommeil. En 1998, retour en France, je ne fais plus de photographie, presque plus, je continue d’essayer d’écrire, je fais des petits progrès. J’habite à la campagne. En 1999, j’achète un ordinateur personnel, j’apprends à m’en servir en apprenant à écrire, de même que j’apprends à écrire en apprenant à me servir de mon ordinateur. 1999 : Naissance de Madeleine Hannah De Jonckheere. En 2000, je construis un site Internet, le Désordre. C’est très long. Je me couche souvent très tard. Ça foire pas mal, mais je m’entête. En 2002, je reçois le prix multimédia de la Société des Gens de Lettres, ça ne foire pas tout le temps. En 2002, je tiens le journal de cette existence désordre, le bloc-notes du désordre, étonnant succès. En 2004, je reçois des lettres très encourageantes d’éditeurs mais qui ne proposent pas de projet d’édition. Ça foire encore un peu. Finalement, Adèle est née le 9 avril 2004, Nathan est enfin diagnostiqué autiste et mon père est opéré du cœur, les trois plus ou moins le même jour, c’est tout moi. Le journal de cette aventure est publié en 2008 par François Bon sur publie.net. En mai 2009, je participe à la grande rétrospective du Terrier au Nova de Bruxelles. Fin 2009, je travaille à l’iconographie et à la réalisation du numéro 109 de Manière de Voir (Monde diplomatique) : Internet, révolution culturelle. Depuis fin 2010, je travaille au spectacle Formes d’une Guerre avec l’écrivain François Bon et les musiciens Dominique Pifarély et Michele Rabbia. En 2012, Publication de Robert Frank, dans les lignes de sa main, Publie Papier. Philippe, film d’animation de trois minutes sur une musique d’Elémarsons. Un an de prises de vue, trois minutes d’animation. On ne rit pas. Invité envouté de Marie Richeux sur France Culture pour son émission Pas la peine de crier du 10 septembre 2012. En 2013, nouveau spectacle avec François Bon en lecteur de mon texte intitulé Contre et Dominique Pifarély, violon. Succès critique et salle (presque) pleine. Le rapport sexuel n’existe plus est son troisième roman publié aux éd. Inculte après Une fuite en Egypte (2017) et Raffut (2018). Les trois sont clairement autobiographiques.
1951, Robert Frank prend une petite fille en photo dans les rues de Paris. Cette petite fille sera ma mère. Né le jour de la 1964ème commémoration du massacre des innocents. Entrée en 1986 à L’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs à Paris où je perds un peu de temps faute de recevoir l’enseignement que j’étais venu y chercher. Les professeurs de photographie sont des photographes stricto sensu, c’est dire. En 1988, deux ans d’études à The School of the Art Institute of Chicago, où je reçois notamment l’enseignement de Barbara Crane, Joyce Neimanas, Ken Josephson, Karen Savage et Bart Parker, je rattrape amplement le temps perdu aux Arts Décos. En 1990, je suis l’assistant de Robert Heineken, j’assiste à des miracles tous les jours. Fin 1991, retour en France, les choses vont mal. En 1993, à la suite d’un deuil, je commence à écrire, force est de constater que je ne sais pas écrire, mais je m’obstine, comme en toutes choses. 1995, Mai de la Photo à Reims, seule exposition d’envergure, l’exposition est censurée. Ça foire, comme en toutes choses. En 1995, je pars à Portsmouth en exil. Je fais les trois huit, travail alimentaire, sommeil, travail dans l’atelier ou travail alimentaire, travail dans l’atelier, sommeil, ou travail dans l’atelier, travail alimentaire, sommeil. En 1998, retour en France, je ne fais plus de photographie, presque plus, je continue d’essayer d’écrire, je fais des petits progrès. J’habite à la campagne. En 1999, j’achète un ordinateur personnel, j’apprends à m’en servir en apprenant à écrire, de même que j’apprends à écrire en apprenant à me servir de mon ordinateur. 1999 : Naissance de Madeleine Hannah De Jonckheere. En 2000, je construis un site Internet, le Désordre. C’est très long. Je me couche souvent très tard. Ça foire pas mal, mais je m’entête. En 2002, je reçois le prix multimédia de la Société des Gens de Lettres, ça ne foire pas tout le temps. En 2002, je tiens le journal de cette existence désordre, le bloc-notes du désordre, étonnant succès. En 2004, je reçois des lettres très encourageantes d’éditeurs mais qui ne proposent pas de projet d’édition. Ça foire encore un peu. Finalement, Adèle est née le 9 avril 2004, Nathan est enfin diagnostiqué autiste et mon père est opéré du cœur, les trois plus ou moins le même jour, c’est tout moi. Le journal de cette aventure est publié en 2008 par François Bon sur publie.net. En mai 2009, je participe à la grande rétrospective du Terrier au Nova de Bruxelles. Fin 2009, je travaille à l’iconographie et à la réalisation du numéro 109 de Manière de Voir (Monde diplomatique) : Internet, révolution culturelle. Depuis fin 2010, je travaille au spectacle Formes d’une Guerre avec l’écrivain François Bon et les musiciens Dominique Pifarély et Michele Rabbia. En 2012, Publication de Robert Frank, dans les lignes de sa main, Publie Papier. Philippe, film d’animation de trois minutes sur une musique d’Elémarsons. Un an de prises de vue, trois minutes d’animation. On ne rit pas. Invité envouté de Marie Richeux sur France Culture pour son émission Pas la peine de crier du 10 septembre 2012. En 2013, nouveau spectacle avec François Bon en lecteur de mon texte intitulé Contre et Dominique Pifarély, violon. Succès critique et salle (presque) pleine. Le rapport sexuel n’existe plus est son troisième roman publié aux éd. Inculte après Une fuite en Egypte (2017) et Raffut (2018). Les trois sont clairement autobiographiques.
15:49 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
27/04/2021
Et pourquoi moi je dois parler comme toi ? écrits bruts (et non bruts) réunis par Anouk Grinberg
Le Passeur éd. 15 octobre 2020

256 pages, 20,90 €.
C’est en puisant, entre autres, dans la Collection de l’Art brut de Lausanne que la comédienne et artiste peintre Anouk Grinberg a pu rassembler tous ces écrits, dits bruts car écrits par des personnes internées et considérées comme démentes ou délirantes. Des écrits souvent dessinés aussi car un bon nombre d’entre eux font l’objet d’un graphisme très particulier et c’est pourquoi on trouvera aussi dans cet ouvrage des photos de ce qui forme une œuvre brute complète.
Anouk Grinberg a une histoire avec la folie, avec celle de sa mère dont elle a eu peur et même honte : « Je ne l’ai pas aimée, je n’ai pas réussi. J’étais de la famille humaine qui se détourne. ». Ce livre est sa façon de réparer : « Par un grand détour, ce sont ces hommes et ces femmes qui m’ont conduite vers cette mère, cette femme, et si j’ai négligé de son vivant toutes ses lettres affamées, je suis heureuse aujourd’hui d’être passeuse de textes jamais lus ». De cette mère, elle dit : « Ma mère était comme ça. Une petite femme fine, intelligente, mal adaptée à la vie bourgeoise. Elle aurait voulu peindre, et elle a été mère, épouse. (…) Elle n’a pas su dire non à la famille qui faisait une croix sur ses désirs, elle n’a pas su dire oui à la petite voix qui devait lui parler tout bas, et elle est descendue marche après marche dans le malheur, comme dans un refuge où on n’irait plus la chercher. On l’a mise dans des endroits pour fous, le désespoir a prospéré avec sa litanie de délires, alors qu’elle était une lumière sur la terre ». Alors, Anouk Grinberg dédie ce livre « à tous ces lumineux que le monde ne doit pas oublier. » Il ne s’agit pas de faire une anthologie d’écrits de fous mais de montrer plutôt la valeur littéraire de ces écrits, qui « ont inspiré les surréalistes et d’autres auteurs reconnus qui se sont fouillé les méninges pour atteindre leur liberté. »
On ne sera pas surpris donc, de trouver aussi dans ce livre des écrits dit non-bruts, des écrits de poètes, car qui d’autre qu’eux s’approche le plus de cette forme d’indécente liberté ? D’ailleurs deux d’entre eux — et on note par ailleurs ici la curieuse absence d’Artaud — comme Paul Éluard ou Tristan Tzara, ont trouvé refuge durant la guerre, l’un en 1943, l'autre en 1945, à l’hôpital psychiatrique de Saint-Alban-sur-Limagnole en Lozère où furent internés deux auteurs bruts figurant dans ce livre.
La préface a été rédigée par Jean-Pierre Siméon dans laquelle il nous dit : « Les fous, donc, prétendument les plus dénués d’entre nous (ou faudrait-il dire les plus dénudés ?), ont ce talent inouï, et que l’on ne dira qu’avec prudence involontaire, de s’affranchir absolument des lois de la langue et de nous révéler en conséquence dans la langue même cet absolument impossible de la langue dont rêvent les poètes, mais que leur raison sociale empêche généralement d’assumer jusqu’au bout. »
Et pourquoi moi je dois parler comme toi est donc « un livre sur la vie et la création, non sur la folie. » Si les fautes d’orthographe et la ponctuation n’ont pas été retouchées, certains passages ont cependant été volontairement coupés car trop incompréhensibles. Les auteurs de ces écrits bruts sont nés entre 1827 et 2005, mais plus spécifiquement au XIXe et XXe siècle. On trouvera une photo et une courte biographie pour chacun d’eux, mais une partie sont des textes anonymes, les auteurs n’ayant laissé aucune autre trace de leur passage sur terre.
« (…) dans nos sociétés riches et prétentieuses, ce trop-plein d’antennes est sévèrement puni. Les sans-fard inspirent la honte et le mépris, alors ils fanent ou enragent, et c’est le début de l’enfer. On les met dans des hôpitaux, on les force à manger des médicaments pour les remettre droit, on leur enlève la parole puisqu’ils parlent mal la langue de papa et maman, on leur enlève leurs droits, parfois leurs noms. » nous dit Anouk Grinberg dans son prologue.
Écrits compulsifs, écrits rageurs, écrits du désespoir et de la privation de liberté, mais aussi tentatives de communication, de tresser une passerelle entre des réalités qui s’entrechoquent. Des êtres humains « enfermés dans un faisceau de malentendus », comme si leur pensée, leur vision étaient erronées alors que, bien souvent, ils ont été surtout broyés par les conditions de leur existence quand ils n’ont pas été tout simplement et violemment mis à l’écart, parce qu’ils gênaient l’ordre et la raison établis ou bien considérés socialement comme définitivement idiots parce qu’incapables de contacter le monde extérieur comme ce fut le cas pour Babouillec, autiste sans paroles, diagnostiquée comme très déficitaire et qui n’a jamais appris à lire, écrire et parler et qui est auteur de plusieurs livres, grâce à sa mère qui l’a sortie des institutions spécialisées et a fini par trouver le moyen de communiquer avec elle, lui permettant ainsi de révéler et diffuser son génie littéraire et ses pensées dont l’acuité et la pertinence sont absolument jubilatoires.
La postface de Sarah Lombardi, directrice de la Collection de l’Art Brut de Lausanne donne un éclairage sur l’origine et l’histoire des écrits issus de cette collection dont certains ont déjà été publiés précédemment et mentionne les personnes, médecins ou autres, qui s’y sont intéressés, non pas d’un point de vue pathologique mais sur le plan du processus créatif.
Pulsion d’écrire, pulsion de vivre : de crier, défier et même rire et aimer dans le silence carcéral, que ce dernier soit imposé de l’intérieur ou de l’extérieur. Un bon nombre des textes publiés ici donnent envie justement de les lire à haute voix, ils ont quelque chose de théâtral, entre comédie et tragédie, le grand théâtre de la vie. Certains sont des pieds de nez au dogme de la normalité, d’autres sont peut-être bien trop en avance sur leur temps, d’autres encore font mal car ils sont paradoxalement des appels au bon sens de celui qui les lira… Beaucoup sont des blessures ouvertes qui débordent sur le papier et des flux de douleur qui frayent un chemin vers la lumière. La poésie est très souvent au rendez-vous.
« Veuillez dire à ce langage
Qu’il dise qu’il est là
C’est une prière
La vie ne peut pas vivre »
Constance Schwartzlin-Berberat (1845-1911)
Un ouvrage précieux qui, espérons-le, permettra de porter un autre regard sur ce que la société nomme trop facilement des folles et des fous.
« Alors que la vie elle-même est démente, qui de nous peut dire où se trouve la folie ? Trop de bon sens, n’est-ce pas aussi de la folie ? (…) Et la folie suprême n’est-elle pas de voir la vie telle qu’elle est et non telle qu’elle devrait être ? » avait écrit Cervantès.
Cathy Garcia Canalès
 Anouk Grinberg est née à Uccle (Belgique), le 20 mars 1963. Fille du dramaturge Michel Vinaver, elle fait ses premiers pas sur les planches dès l'âge de 12 ans dans Remagen mis en scène par Jacques Lasalle. Malgré quelques apparitions au cinéma à partir de 1976, la jeune fille se consacre avant tout au théâtre et commence parallèlement des études d'ethnologie. Après quelques rôles secondaires la comédienne rencontre Bertrand Blier qui la révèle au grand public et dont elle devient la muse. Ils tournent trois films ensemble avant de se séparer : Merci la vie (1991), Un, deux, trois, soleil (1993) et Mon homme (1995). Malgré deux beaux rôles dans Un héros très discret de Jacques Audiard (1995) et Disparus de Gilles Bourdos (1997), Anouk Grinberg espace ses apparitions au cinéma. Elle se consacre au théâtre mais également à la peinture et à l'écriture.
Anouk Grinberg est née à Uccle (Belgique), le 20 mars 1963. Fille du dramaturge Michel Vinaver, elle fait ses premiers pas sur les planches dès l'âge de 12 ans dans Remagen mis en scène par Jacques Lasalle. Malgré quelques apparitions au cinéma à partir de 1976, la jeune fille se consacre avant tout au théâtre et commence parallèlement des études d'ethnologie. Après quelques rôles secondaires la comédienne rencontre Bertrand Blier qui la révèle au grand public et dont elle devient la muse. Ils tournent trois films ensemble avant de se séparer : Merci la vie (1991), Un, deux, trois, soleil (1993) et Mon homme (1995). Malgré deux beaux rôles dans Un héros très discret de Jacques Audiard (1995) et Disparus de Gilles Bourdos (1997), Anouk Grinberg espace ses apparitions au cinéma. Elle se consacre au théâtre mais également à la peinture et à l'écriture.
10:09 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
Dérives des âmes et des continents de Shubhangi Swarup
traduit de l’anglais (Inde) par Céline Schwaller

éd. Métailié, 12 mars 2020. 368 pages, 22 €.
Au cœur des voix et des sensations se cache une prémonition de ce qui va se produire. Toute évolution est guidée par l’instinct primordial. Celui qui nous rend libres d’explorer les géographies incertaines du désir, pour finalement découvrir le bonheur de la mortalité. L’instinct nous conduit tous vers le lac primordial. Flottant telles de simples cellules isolées, attendant que la vie cesse.
Tectoniques des plaques et tectoniques des existences, Dérives des âmes et des continents est un bien étrange et déroutant roman, avec un soupçon de conte et de magie et une grande érudition scientifique : les sciences de la Terre. Il prend racine dans les îles d’Andaman encore habitées de quelques ethnies autochtones et où les Britanniques avaient construit le plus grand et sinistre bagne politique du monde au XIXe siècle. Des îles qui ont été frappées en 2004 par un tsunami des plus meurtriers suite à un des séismes les plus puissants jamais enregistrés. Un jeune couple de mariés s’installe sur une des îles — dans les années 50 on suppose — dans une ancienne demeure coloniale pleine de fantômes. Lui, Girija Prasad, est scientifique, il a étudié à l’Université d’Oxford, c’était le premier étudiant indien du Commonwealth ; elle, Chanda Devi, médaillée d’or en mathématiques et en sanskrit, est un peu sorcière. Leur histoire qui forme la première partie du roman est tellement belle, même si elle est triste, que l’on éprouve une vraie nostalgie lorsque l’auteur nous déloge de ces îles et nous propulse dans le temps et l’espace. Il devient alors plus difficile de s’ancrer car tout bouge, comme sur cette ligne de faille qui va de l’Océan indien à l’Himalaya. Lointain passé géologique, évolution des espèces, mémoire, présent, futur, contexte politique, drames et violence, résilience, tout se mêle et se bouscule et le lecteur part lui aussi à la dérive. Des liens entre quelques-uns des personnages offrent quelques repères mais le temps fait des boucles. La nature avec ses hoquets, ses sursauts, ses bouleversements, reste peut-être le seul fil conducteur : le descendant du couple originel du roman que l’on rencontre à la fin est un géologue qui travaille sur la probabilité qu’un nouveau sommet himalayen surgisse à l’intérieur des frontières indiennes, bien plus haut que l’Everest.
Mais avant cela nous rencontrons Mary, née Rose Mary en 1926 dans une colonie karen des îles Andaman. Elle entrera au service de Girija Prasad à la mort de son épouse, alors que leur fille est encore un bébé. Bien plus jeune, elle avait dû laisser son propre fils âgé de 8 mois, après avoir poignardé à mort, alors qu’elle était enceinte de 7 mois, son mari, un pêcheur birman devenu très violent après avoir sombré dans l’alcool. Les îles étaient passées de la domination japonaise, qui persécutaient les habitants d’origine birmane, à celle des dirigeants indiens qui y avaient amené « quelque chose qui prospérait depuis des siècles sur le continent et qui symbolisait la nouvelle république (…). La pauvreté. »
Le fils de Mary, élevé par ses grands-parents paternels, s’auto-nommera Platon. Étudiant révolutionnaire, arrêté et torturé au début des années 70, par la junte birmane, il rencontrera sa mère pour la première fois à sa sortie de prison, il a alors une vingtaine d’années. Pour retrouver son fils et tenter de le faire libérer, elle est venue travailler à Rangoon, comme domestique pour une famille indienne, aidée en cela par Thapa, un trafiquant désabusé et ami de Platon. Platon qui retournera encore à la clandestinité et à la guérilla dans la jungle himalayenne à la frontière indo-birmane pendant douze ans avant d’être à nouveau arrêté. Sa mère recommencera alors à se battre pour sa libération.
Thapa, lui, est népalais et il a perdu toute sa famille dans un glissement de terrain qui emporta une nuit tout son village avec entre autres sa femme et son fils de deux ans, alors que lui était parti vendre la production de leur ferme à la ville la plus proche, c’est-à-dire à trois jours de marche. En suivant Thapa, on se retrouvera dans le quartier de Thamel à Katmandou : « Gravats, échafaudages, fossés à moitié creusés et bâtiments à demi-construits, tous tassés dans les coins et recoins de cette ville marécageuse. » Sa jeune voisine toujours affamée est stripteaseuse dans un bar à touristes. Thamel, avec sa foule « de randonneurs, rabatteurs, mendiants, parieurs, accros au crack, prostituées trop jeunes et clients trop vieux. »
Dérive des âmes et des continents, parle de la vie et de la mort et même de l’entre-deux, chaque individu étant l’épicentre du séisme de sa propre existence. Les vies passent, la planète, elle, poursuit la sienne à l’échelle de son propre temps qui n’est pas celui des hommes. Ceux-ci sont comme des poussières balayées par le vent, emportées par les rivières et c’est dans une langue de toute beauté que Shubhangi Swarup nous égare et nous disperse dans ce premier et impressionnant roman, déboussolant et foisonnant.
Cathy Garcia Canalès
 Shubhangi Swarup est née en 1982 à Nashik, dans l'État du Marahashtra. Journaliste, réalisatrice, pédagogue, elle vit aujourd'hui à Bombay. Dérive des âmes et des continents est son premier roman. Elle a obtenu la bourse d'écriture créative Charles Pick à l'Université d'East Anglia (Norwich).
Shubhangi Swarup est née en 1982 à Nashik, dans l'État du Marahashtra. Journaliste, réalisatrice, pédagogue, elle vit aujourd'hui à Bombay. Dérive des âmes et des continents est son premier roman. Elle a obtenu la bourse d'écriture créative Charles Pick à l'Université d'East Anglia (Norwich).
10:08 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
16/03/2021
Le silence des carpes de Jérôme Bonnetto
éditions Inculte, 6 janvier 2021
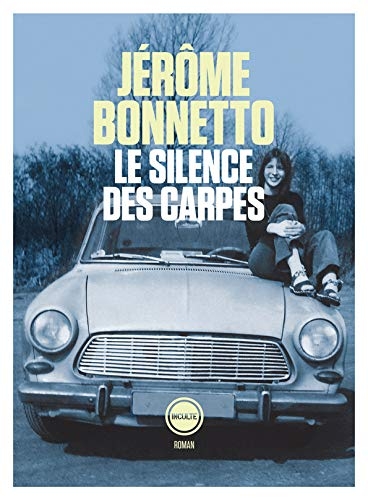
300 pages, 18,90 €.
Jérôme Bonnetto nous livre ici un remarquable roman, aussi drôle que fin et touchant. Remarquable sur le plan littéraire et savoureux pour le lecteur qu’il entraine avec virtuosité dans l’aventure de son narrateur : Paul Solveig, informaticien, qui pour échapper à la pente dépressive qui le guette, joue son destin au dé après avoir trouvé une photo qu’un pseudo plombier tchèque a laissé tomber dans sa cuisine. Apprenant par ce dernier, qu’il s’agit d’une photo de sa mère disparue pendant le régime communiste, Paul Solveig s’organise expressément pour partir sans date de retour vers une Moravie dont il ignore tout. Certes sous le prétexte de rechercher des traces de la mère et de son photographe, dont la touche artistique le trouble beaucoup, mais aussi et surtout pour fuir la réalité d’une séparation avec Pauline, qui est sur le point de le quitter après 10 ans de vie commune. Fuir avant même d’en avoir la certitude.
« La chose me tentait bien. Ma vie parisienne ressemblait à ces vieilles vestes tellement usées qu’on n’ose même pas les donner aux bonnes œuvres. Pauline me torturait, le boulot me vidait. L’horizon me manquait. Je ne pouvais rester sans réagir et regarder ma vie se déliter, mais la Moravie tout de même… Qu’allais-je faire là-bas ? »
On retrouve dans Le silence des carpes, l’art de l’auteur pour peindre avec douceur et finesse ses personnages. Déjà à l’œuvre dans La certitude des pierres, ce talent se confirme ici dans une pleine maturité tout comme cette capacité à immerger le lecteur dans un lieu original hors des sentiers trop battus : dans La certitude des pierres, un petit village perdu de montagne, dans Le silence des carpes, une petite ville au cœur de la Moravie au nom aussi improbable que Blednice, sans doute un détournement de la bien réelle Lednice.
Le silence des carpes est construit en deux parties qui se font écho : la première, bien plus courte, commence en prologue, elle ponctue l’ensemble comme un mystérieux ricochet. Les prénoms des protagonistes y évoquent un pays de l’Europe centrale. Il y est question d‘une pêche impossible, de carpes d’amour et d’un étang énigmatique, donc la magie va céder à l’inquiétant quand il apparait que certains qui s’en approchent de trop près disparaissent.
De même sous la surface plutôt légère et pleine d’humour du roman, portée par le récit du narrateur et sa capacité à l’autodérision féroce et hilarante, on devine peu à peu une profondeur bien plus sombre, en lien avec l’Histoire de l’ancien bloc communiste et son régime totalitaire.
Le lien entre les deux parties qui alternent se dévoile peu à peu, par petites touches très subtiles.
Le silence des carpes est, au-delà d’une enquête qui semble vouée à l’échec, de toute évidence un hommage au pays d’accueil de l’auteur qui vit à Prague ; une ode aux doux paysages de Moravie et à la culture artistique tchèque et en particulier son cinéma, via la cinéphile et insaisissable Míla qui va aider Paul Solveig dans ses recherches. On peut y voir très certainement un clin d’œil aussi à l’artiste sculpteur monumental Aleš Veselý décédé en 2015, avec Veselý, l’artiste, sculpteur lui aussi d’œuvres monumentales, qui reçoit Paul Solveig avec un profond et authentique sens de l’amitié et de l’hospitalité, lui ouvrant ainsi les portes d’un pays qui a lui-même quitté depuis longtemps.
Le silence des carpes est une belle œuvre humaine, d’une écriture vive et cocasse dont on ne peut que se délecter, mais empreinte cependant aussi de délicatesse, de poésie et d’une pointe de mystère. Ce deuxième roman est aussi la confirmation d’un talent qui se déploie, vivement le troisième !
Cathy Garcia Canalès
 Jérôme Bonnetto est né à Nice en 1977, il vit désormais à Prague où il enseigne le français. Après La certitude des pierres, Le silence des carpes est son deuxième roman publié chez inculte.
Jérôme Bonnetto est né à Nice en 1977, il vit désormais à Prague où il enseigne le français. Après La certitude des pierres, Le silence des carpes est son deuxième roman publié chez inculte.
Voir ma note sur La certitude des pierres :
http://delitdepoesie.hautetfort.com/archive/2020/02/17/la...
15:21 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
17/11/2020
Petits cimetières sous la lune de Mauricio Electorat
traduit de l’espagnol (Chili) par l’auteur lui-même.

Métailié, octobre 2020. 302 pages, 21 €.
Ce n’est pas tant l’intrigue qui nous attache à ce récit, bien qu’elle soit très intéressante, mais l’étonnante texture de son écriture, qui nous rend le narrateur très proche, très familier, et qui donne aussi à ces Petits cimetières sous la lune, un côté très cinématographique, sans pour autant tomber dans l’exercice de style.
Le titre du roman évoque le pamphlet de Bernanos, Grands cimetières sous la lune, et ce n’est pas un hasard. Le narrateur, Emilio Ortiz, a fui la pression familiale et son pays, le Chili, tout juste sorti de la dictature, pour aller étudier la linguistique à Paris, avec l’aide financière de sa jeune tante Amalia. Mais plus que de sa vie d’étudiant, à laquelle il sera peu assidu, c’est surtout de ses nuits de veilleur dans un petit hôtel du quartier Montparnasse qu'il est question, ses rencontres avec une faune nocturne, des amitiés entre exilés, des nuits alcoolisées. Il y a aussi Chloé, serveuse dans un dancing, le dancing de La Coupole, fréquenté par des couples mûrs qui semblent tout droit sortis des années '50 ; Chloé qui soudain s’évapore, après avoir entretenu avec Emilio une courte, étrange et sexuellement intense relation, Chloé dont la disparition devient pour lui une obsession alors qu’il ne connaît même pas son nom de famille. C’est elle qui vit dans un appartement près d’un cimetière de banlieue avec une autre fille, une Coréenne : « trois chambres, séjour, salle de bains, cuisine assez minuscule. Mais, en revanche, l’appartement a un parquet de lattes larges qui traversent les pièces d’un bout à l’autre. Un beau parquet à l’ancienne. Ceci dit, les chambres ne sont pas très spacieuses. Et, en plus, elles donnent sur un cimetière. ».
Emilio Ortiz va et vient, dans son récit, entre sa toute nouvelle vie parisienne qui bouscule tout ses repères et les souvenirs de son passé à Santiago avec sa famille et notamment la relation à son père ; les liens de ce dernier avec des membres haut placés de la dictature de Pinochet, un père dont il ne veut plus entendre parler mais dont il ne peut pas complètement se détacher. Il va lui falloir, alors que sa mère va très mal et que son père est rattrapé par la justice, retourner dans ce pays désormais abhorré. Le besoin de savoir la vérité, plus fort que tout, le poussera à enquêter sur le passé de ce père impossible à aimer, tout en essayant de retrouver à Paris, la Chloé évaporée.
Petit cimetières sous la lune est entre autre le récit d’amours impossibles. L’ombre de la douleur plane en permanence sur ce roman mais il y a un tel ciselage de l’écriture, une précision dans la narration, qui font que le texte se déguste véritablement comme un bon alcool fort et une sorte de distanciation désabusée, apporte de nombreuses touches d’humour très flegmatique, so british pour un Chilien. Un vrai régal sur le plan littéraire !
Le narrateur porte un regard désabusé sur la vie, les êtres ; c’est sur lui que repose le poids de son histoire et il en assume la charge seul. Quelque chose a cassé en lui, il y a longtemps déjà, quelque chose qui se cache dans le sous-sol d’un garage que son père détenait avec un associé.
La construction du récit elle-même est atypique : des chapitres plus ou moins longs, parfois d’un seul mot, des allers-retours dans le temps et entre la France et l’Amérique latine, en passant par un tour en Roumanie. Sa lecture nous plonge dans une sorte d’ivresse douce-amère, comme celle de la mère d’Emilio que son père a quitté pour une fille bien plus jeune que lui. Il y flotte une atmosphère, comme une odeur d’anesthésique qui contraste avec la précision de l’écriture. L’alcool, le déni, la fuite à l’étranger, tout le monde cherche à échapper à la douleur du réel, car il y a des réels trop sales pour être nettoyés et pour Emilio Ortiz, une filiation insupportable.
C’est aussi l’histoire de tout un pays qui se dessine en filigrane, pendant et après la dictature avec ses dessous crapuleux et criminels, la bassesse humaine. Petits cimetières sous la lune, un roman de l’exil, de l’attachement impossible et où la proximité entre morts et vivants est trop étroite.
Cathy Garcia Canalès
Mauricio Electorat est né à Santiago du Chili en 1960. Après deux années d’études de journalisme et de littérature à Santiago, il s’installe à Barcelone en 1981, où il obtient une maîtrise en philologie hispanique. Petit fils de français émigrés à Valparaíso au début du XXe siècle, il choisit Paris comme lieu de résidence définitif dès 1987. Il a publié deux recueils de poésie. Son premier roman, Le Paradis trois fois par jour (Série noire, Gallimard, 1997), ainsi que son recueil de nouvelles Nunca fui a Tijuana y otros cuentos (Cuarto Propio, 2000) ont reçu le Prix de Littérature de la Ville de Santiago et le Prix du Conseil National du Livre et de la Lecture, les récompenses littéraires annuelles les plus importantes au Chili. Sartre et la Citroneta, son deuxième roman, a obtenu en Espagne le prestigieux Prix Biblioteca Breve.
17:14 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
07/11/2020
La Mort et le Météore de Joca Reiners Terron
Zulma éd., 1er octobre 2020

190 pages, 17,50 €.
Nul homme n’est le roi de quoi que ce soit.
LES INDIENS MÉTROPOLITAINS
Un roman bien singulier que La Mort et le Météore, une dystopie amazonienne qui dresse un portrait acerbe d’une sinistre réalité brésilienne, d’ailleurs exacerbée encore depuis les dernières élections présidentielles, envers l’environnement et les derniers peuples autochtones, notamment les plus isolés, dits non contactés. C’est de ceux-là qu'il est question dans ce roman, qui se déroule dans un futur de plus en plus proche où il ne reste rien de la forêt amazonienne sinon quelques derniers hectares brûlant comme l’enfer et où le Chili a disparu sous le Pacifique.
La mission qui est confiée au narrateur par Boaventura, un vieux et énigmatique protecteur des derniers Indiens Kaajapukugi — alors qu’une fusée chinoise s’apprête à décoller pour une nouvelle tentative de mission habitée vers Mars — c’est d’accompagner les Kaajapukugi au Mexique, avec l’aide de l’association Survival International (qui existe vraiment) et de les aider à s’y installer. En effet, les cinquante ultimes membres de cette tribu isolée, confrontée à la destruction intégrale de l’écosystème essentiel à leur survie physique et spirituelle, ont demandé l’asile politique. Une première dans l’Histoire. Le Canada, qui avait accepté en premier, étant bien trop froid, c’est finalement le Mexique qui sera leur terre d’accueil et plus précisément un plateau du territoire mazatèque.
Tout ce que les Kaajapukugi connaissent et bien qu’ils soient parvenus à échapper pendant 400 ans à l’avancée de l’homme blanc, bien qu’ayant frôlé une première éradication au XIXe siècle, raconte Boaventura, a été détruit avec « leurs plantes médicinales sacrées, et même les poisons dans lesquels ils trempaient leurs flèches ou encore le timbó, cette légumineuse toxique qu’ils utilisaient pour la pêche. Les fleuves sont asséchés, les poissons sont morts. Tout a disparu, y compris les hannetons dont ils extrayaient du tinsdanhán. Avec l’érosion tout est parti, il ne reste plus que du sable. Et, suite à la disparition du tinsdanhán, c’est aussi leur monde supérieur qui a été emporté, leurs dieux, leurs fêtes et même les trois Ciels où ils auraient trouvé repos dans la nature, chassé joyeusement les hannetons et fait l’amour avec leurs femmes ».
Et justement, les cinquante derniers membres de la tribu, sont tous des hommes.
C’est donc une bien triste mission qui est confiée au narrateur, anthropologue intéressé par les langues mortes et jusque-là surtout un « rond de cuir coincé dans un bureau de la Commission nationale pour le développement des peuples indigènes, à mi-chemin entre le ventilateur et le classeur métallique, et à environ deux coudées de la petite table où le thermos de café exhalait ses derniers soupirs. ». Pas marié, sans enfant, il vient de perdre ses parents et se retrouve héritier seul et endeuillé d’une vieille maison dans le centre historique d’Oaxaca au Mexique, ville décor pour touristes où tous les temps se sont mélangés. Pour lui, c’est donc une mission des plus intéressantes, ne serait-ce que pour le sortir de sa morne vie et lui permettre d’approcher une langue quasi inconnue et de faire quelque chose de bien qui pourrait donner un peu de sens à sa vie. Et il compte sur Boaventura pour le guider dans cette mission, puisque ce sertanista (spécialiste de la forêt amazonienne) de la Funai, la bien réelle Fondation nationale de l’Indien au Brésil, a consacré sa vie à la défense des Kaajapukugi. Mais voilà que la mort subite de ce dernier sème le trouble et la mission prend une tournure des plus imprévues. Une vidéo envoyée par Boaventura à l’anthropologue, juste avant de mourir, pourrait être la clé du mystère kaajapukuji.
Il serait dommage de révéler plus de ce récit vraiment atypique, si ce n’est qu’il ne cache pas une critique sèche et sans concession d’un monde violent et vorace, vu sous l’angle des plus fragiles des humains, mais aussi les plus mystérieux, qui ont des connaissances que le monde moderne ignore et sous-estime grandement. Dans La Mort et le Météore, elles dépassent les lois du temps et de l’espace. Il est aussi une plongée dans les abîmes de l’être humain et la tentative d’y échapper. Joca Reiners Terron mêle, dans ce roman d’aventure terminale, fiction, fantastique et réalité, une très dure réalité qu’il connaît de par son engagement pour la forêt amazonienne.
C’est son premier roman traduit en français. Un auteur à suivre.
Cathy Garcia Canalès
 Joca Reiners Terron est né en 1968 dans le Matto Grosso. Il vit à São Paulo. Il a publié une dizaine d’œuvres narratives et trois recueils de poésie.
Joca Reiners Terron est né en 1968 dans le Matto Grosso. Il vit à São Paulo. Il a publié une dizaine d’œuvres narratives et trois recueils de poésie.
14:50 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
Fragments erratiques de Xavier Combres
 The BookEdition 2020
The BookEdition 2020
194 pages, 10 €
« Celui qui méprise les petites bêtes ignore combien il est minuscule ! »
Quand il s’est présenté à un de mes ateliers d’aide à l’écriture, je ne me doutais pas que je venais de rencontrer un écrivain déjà confirmé, même si lui-même l’ignorait peut-être encore, aussi c’est avec enthousiasme que je publiais de lui dans ma revue, des extraits d’un carnet de voyage dans lequel il relatait ses pérégrinations en pays kanak. Déjà je me régalais de le lire, aussi la sortie de son livre — et tant mieux si j’ai pu l’encourager — fut donc une très bonne nouvelle. Je viens juste de le terminer et je suis éblouie, vraiment, ce que j’avais perçu s’y révèle pleinement et se pose en confirmation : Xavier Combres est — entre autre talents dont il ne manque pas, il n’y a qu’à suivre la piste de Deadman river https://deadmanriver.bandcamp.com/releases — un écrivain talentueux !
Sur « les chemins d’un esprit-monde ouvert, vers plus d’espace et de liberté », il a voyagé, avide de connaître, découvrir, rencontrer, mais aussi d’éprouver avec un maximum d’intensité cette ivresse du voyageur solitaire, notamment face aux éléments d’une nature propice à cette exaltation, qui enseigne mieux que quiconque l’art de la contemplation et ce retour aux sources si essentiel à tout être humain, même si beaucoup l’ignorent encore. Et qui dit retour aux sources, dit retour à la source intérieure, la connexion avec l’être-soi et l’écrivain voyageur est aussi poète, pas pour la posture, mais parce que son approche du monde est également sauvage et poétique. Abreuvé de poésie chinoise, c’est un peu en apprenti taoïste qu’il voyage et ses poèmes polis comme des galets, témoignent de son avancée. En érudit aussi, toujours curieux, qui ne se prend pas au sérieux et n’assomme pas le lecteur avec ses connaissances. Il les partage seulement et il y réussit à merveille : tout devient intéressant, passionnant, du plus petit insecte à l’Histoire des civilisations, de la géologie aux mythes et traditions de l’humanité, en passant par des anecdotes pleines d’humour et d’autodérision avec toujours cette ouverture d’esprit qui va grandissant au fur et à mesure de l’ouverture des horizons.
Aventurier de la sagesse, un vrai voyageur contrairement à bon nombre de touristes, revient riche de souvenirs et pauvre en orgueil et c’est le plus souvent loin des sentiers battus et du sensationnel que les vraies rencontres peuvent avoir lieu.
Ces Fragments erratiques derrière les récits de voyages parlent de quête intérieure : se connaître en se dépossédant de tout ce qu’on croit être, repousser ses limites. Sur son chemin, Xavier Combres va trouver des merveilles et sa soif de connaissances et de découvertes n’en sera jamais étanchée, mais il va aussi ramener un mal inconnu, un mal réel dans ses répercussions physiques et psychiques mais dont nul médecin et autres praticiens n’ont su à ce jour déceler l’origine. Un mal inexpliqué qui amplifie donc un malaise déjà conséquent et qui handicape sévèrement le libre voyageur. Aussi de l’enthousiasme kayafou des premiers récits, qui nous emmènent de Nouvelle-Calédonie à la Guyane, la Chine, la Thaïlande, la Malaisie, en passant par des échappées sauvages en France et un poème cueilli en Angleterre, ces fragments erratiques s’achèvent pour l’instant en Algarve, où le voyage se mêle à l’épreuve. De l’épreuve nait l’obligation de découvrir peut-être des contrées intérieures plus profondément enfouies, que le mouvement extérieur perpétuel peut éviter d’aller sonder, des contrées où l’auteur saura trouver la force tout autant que le détachement nécessaires pour continuer le voyage, quelle que soit sa forme, et personnellement j’ai très hâte de te lire encore Xavier !
La pierre marche si lentement
Pas même le vieux pin
Ne l’a entendue
S’éloigner du rivage
Cathy Garcia Canalès
Xavier Combres est né en 1979 à Toulouse, sur la rive gauche de la Garonne. Après des études d’ingénieur, il prend son sac-à-dos et son stylo pour voyager et écrire pendant une dizaine d’années. Depuis 2015, il s’est installé à Cahors, au creux du Lot.
Pour commander le livre : https://www.thebookedition.com/fr/fragments-erratiques-p-377922.html

Xavier Combres - Deadman River
14:50 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
Marcher sur la diagonale du vide de Jean-Luc Muscat
 Le Mot et le reste, mai 2020. 122 pages, 13 €.
Le Mot et le reste, mai 2020. 122 pages, 13 €.
Après avoir écrit Voyage du côté de chez moi, sorti chez le même éditeur en février 2019, Jean-Luc Muscat récidive avec Marcher sur la diagonale du vide. Dans le premier, l’auteur partait à pied de chez lui, dans le second, il part de Vézelay pour revenir à pied jusqu’à chez lui, près de Figeac dans le Lot. Un trajet qui s’inscrit dans un rectangle que géographes et démographes appellent « diagonale du vide » et que l’auteur requalifie de diagonale de la déprise, « pour exprimer le déclin de la population et des services de proximité, eu égard aux habitants de ces régions qui ne vivent pas en état d’apesanteur ». Un trajet d’environ 660 km, que l’auteur va parcourir en 25 journées d’avril.
Il est difficile de transcrire la marche, car l’acte d’écrire se fait à l’arrêt, au moment des pauses ; si la marche est inspiration, alors l’écriture en serait l’expiration, une expiration qui laisse des traces. Ainsi Marcher sur la diagonale du vide, en invitant le lecteur à marcher avec l’auteur, le déplace en une succession de tableaux mêlée d’impressions, de réflexions, d’anecdotes. La mémoire a déjà commencé à travailler le matériau — paysages, rencontres, sensations — capté par les sens lors de la marche, mais Jean-Louis Muscat sait le rendre suffisamment vivant pour que le lecteur se sente marcher lui aussi et qu’il ait l’impression de découvrir au même moment que l’auteur, ce que le chemin déroule de beauté, d’obstacles, de surprises agréables et de déconvenues et l’acte physique même de la marche.
La marche nous fait renouer avec nous-mêmes et avec nos origines : de mémoire d’homme, nous avons toujours marché. En ramenant les choses à l’essentiel et en prise directe avec le réel, la marche amène à développer une forme de sagesse, pour peu que le marcheur ne soit pas juste intéressé par la performance. Prendre le temps de voir, de sentir les lieux traversés, d’être réellement présent avec cette lenteur obligée, comparativement à tout autre mode de transport, peut ouvrir l’esprit tout autant que tous les autres sens. Le marcheur est confronté physiquement à lui-même et aux éléments : ici souvent la pluie, le vent et même le gel, le froid, et l’effort que la marche demande oblige à lâcher prise sur toute préoccupation autre que celle de l’instant présent.
Jean-Louis Muscat n’est pas un poète, mais il est sensible à la poésie ou au manque de poésie des lieux. On comprend très vite que la sensation de décrépitude qui pèse sur les milieux encore habités de cette « diagonale du vide » et la laideur et l’ennui des zones périphériques des quelques villes traversées, lui donne hâte de retrouver les champs, les prés, les bois, les milieux plus sauvages où les rencontres se font plus animales, végétales et où la solitude devient légèreté et jouissance. Jean-Louis Muscat adore les arbres et il en connait un bout à leur propos, sa formation originelle étant celle de forestier, aussi la façon dont on les traite le touche très directement. Et la façon dont on traite un arbre, une forêt, est très représentative de la façon dont on traite la nature en général et l’humain en particulier qui, même s’il l’a oublié, en fait partie intégrante. Il n’y a de séparation que dans un mythe de modernité qui ne cesse de prouver ses limites et ses effets délétères.
De sa marche, Jean-Luc Muscat tire en plus d’un plaisir purement personnel, des réflexions qui dépassent la seule aventure du marcheur : des réflexions écologiques, politiques même, car il ne peut en être autrement, il passe et témoigne de ce qu’il voit, et il n’est pas idiot, c’est une personne consciente et très concrète, on le sent à sa façon d’écrire. S’il ne croit donc pas aux contes à dormir debout, il peut cependant avoir la sensation que des fées le voient passer en des lieux — de moins en moins nombreux — qu’elles habiteraient encore. La nature sait appeler l’enfant en nous, raviver l’émerveillement, l’indispensable respiration de l’âme.
« Rêver en marchant, voilà l’affaire, se laisser aborder par les esprits du chemin, tutoyer les fées, vagabonder, caresser les formes. La poésie opère, les conditions sont réunies, profitons-en, il faut en faire bonne réserve, s’en remplir les bajoues pour que les jours de disette soient supportables. »
L’auteur trouve sens dans la marche, y trouve un bon rythme pour l’existence, un rythme qu’il lui sera difficile de quitter. C’est une forme d’addiction pour lui, mais qui n’a de conséquences que bénéfiques. Réminiscences d’un lointain passé où nous étions tous chasseurs-cueilleurs nomades ? Ici la cueillette se fait dans les épiceries quand l’auteur en trouve, parfois un repas dans un restaurant ou chez l’habitant et pas toujours meilleurs que la boite de sardines, à déguster seul sur un banc ou en tête à tête avec un horizon grand ouvert. Jean-Luc Muscat a le regard lucide, parfois acerbe, notamment pour ses contemporains qu’il épingle parfois, mais il sait se moquer aussi de lui-même. Pleinement humain, il assume ses contradictions et ne cherche pas à jouer le beau rôle.
Marcher c’est traverser des lieux et se laisser traverser par eux. Marcher c’est découvrir et se découvrir, y compris au sens littéral du terme : ôter couche après couche ce qui ne nous appartient pas et ne nous est en réalité d’aucune utilité. On ne peut s’encombrer de rien qui ne soit indispensable. Marcher, c’est être dans une simplicité volontaire sans même y penser, cela va de soi. C’est se souvenir d’un temps où tout était fait et pensé à taille humaine. Marcher, c’est être tout entier dans l’instant présent, mais c’est aussi réfléchir au sens littéral même et rêver, rêver, respirer, un rêve en mouvement. Jean-Louis Muscat a une sensibilité qui l’attire fortement vers la nature, les arbres, on l’a vu, mais aussi vers les églises et les lieux sur lesquels le temps ne semble pas avoir de prise. Il aime les rencontres généreuses, surtout avec de vieilles dames sympathiques et s’il marche parfois en compagnie, il apprécie cependant la vraie et pleine solitude du marcheur, en assume l’égoïsme s’il en est, savoure cette interpénétration intime et personnelle avec le monde qui l’entoure.
En lisant Marcher sur la diagonale du vide, j’ai aimé partager cette expérience de marche de Vézelay à Figeac, marcher dans l’écriture d’un autre, non seulement parce que la destination finale est un pays que je connais bien et où je vis depuis bientôt vingt ans, mais parce que marcher et écrire sont deux activités qui me sont, à moi aussi, essentielles et que c’est exactement ce que je voudrais faire : ce genre de livres là et cela m’en a donné une envie encore plus forte. Je peux parfaitement comprendre cette addiction, comprendre combien il peut être malaisé de retourner à un mode de vie plus statique, plus encombré. Le corps aime marcher et l’esprit aime cette découverte lente et profonde des choses, des gens et des lieux.
Ce livre qui nait du mouvement, a tissé ensemble la marche et le message que cette marche a infusé dans le marcheur, un message important à transmettre : éloge de la lenteur, éloge de la simplicité, éloge du naturel, éloge du vivant et d’un tissu social vivant, alors que dans ces régions traversées, il s’est tellement délité qu’il n’est plus que haillons. Des lambeaux se soulèvent cependant, s’agitent encore au souffle provoqué par le déplacement du marcheur et dévoilent quelques couleurs, quelques sourires, quelques gestes d’hospitalité, de générosité, comme des braises encore vives d’un autre temps, mais aussi exposent leur aigreur, leur colère, la fermeture des êtres comme réponse à celles des lieux.
Marcher oui, marcher pour rester humain, c’est peut-être la clé, n’en déplaise à la vitesse exponentielle de nos sociétés lancées à toute allure vers un désert du sens, des sens et au final d’essence... Ce qui nous obligera peut-être au final à marcher de nouveau, toutes et tous !
Cathy Garcia Canalès
 Jean-Luc Muscat, né en 1954, a appris le métier de forestier. Il a quitté l’Office National des Forêts très tôt parce qu’il ne parvenait pas à se résigner à l’idée qu’il lui fallait éliminer les arbres tordus. Dès lors, il a exercé toute une kyrielle de métiers dont ceux d’auteur de guides touristiques, de formateur consultant et d’éducateur technique. Aujourd’hui, il se consacre à la marche en solitaire au long cours, et à l’écriture, une passion de toujours, dans une cabane perchée dans un pin sylvestre.
Jean-Luc Muscat, né en 1954, a appris le métier de forestier. Il a quitté l’Office National des Forêts très tôt parce qu’il ne parvenait pas à se résigner à l’idée qu’il lui fallait éliminer les arbres tordus. Dès lors, il a exercé toute une kyrielle de métiers dont ceux d’auteur de guides touristiques, de formateur consultant et d’éducateur technique. Aujourd’hui, il se consacre à la marche en solitaire au long cours, et à l’écriture, une passion de toujours, dans une cabane perchée dans un pin sylvestre.
14:49 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
Le Chemin des âmes de Joseph Boyden
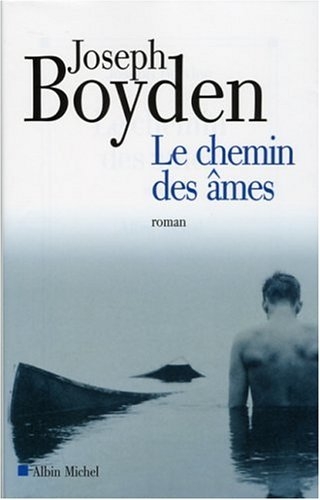
(titre original : Three-day road, 2004), Albin Michel 2006. 475 pages.
Je viens de terminer ce livre inoubliable, dont la fin m’a fait pleurer. Un hymne tordu de douleur, mais puissant, à la vie arrachée aux champs de mort. Un chant de mort aussi et un chant de guérison. J'y ai appris encore des choses sur cette première guerre mondiale et notamment sur les soldats amérindiens qui y ont pris part. Ici, ce sont deux amis d‘enfance de la nation Cree. En cherchant un peu plus sur le sujet suite à cette lecture inspirée de faits bien réels, j'ai appris, sans surprise hélas, la façon dont ces recrues (comme les autres minorités) ont été traitées, avant, pendant, après... Mais entre les hommes jetés dans cette grande boucherie, les soldats de base rampant, pataugeant et crevant dans la même soupe de boue et de sang, il n'y avait plus beaucoup de différences. Les deux jeunes Cree vont se distinguer sur le terrain par leurs qualités de chasseurs mais ils en paieront le prix fort : quelque chose les sépare et cette séparation va peu à peu se transformer en gouffre. L’un, abandonné par sa mère qui avait sombré dans l’alcoolisme, avait été sauvé du pensionnat tenu par de rudes religieuses, missionnées pour bouter le païen hors de ces corps de sauvageons, par sa tante, une des rares Cree à perpétuer la vie d’avant à l’écart de la ville et des wemistikochiw et qui l’a pris avec elle au fond des bois, pour lui enseigner tous les savoirs et traditions de son peuple, celles du monde visible mais aussi du monde invisible, elle qui était une des dernières chasseuse de wendigos. L’autre, orphelin, a passé trop d’années dans ce pensionnat, avant que la tante de son ami d’enfance, ne vienne lui aussi le chercher. Le Chemin des âmes force une réflexion sur l'humain dans l’enfer de la guerre, le meurtre autorisé, les limites (y en a t-il ?), mais aussi sur les conséquences de la colonisation et de l’acculturation, leur violence et heureusement il y a cette sagesse ancestrale, qui malgré tout, palpite encore, resurgit quand on la croit disparue à jamais sous la pression de la culture qui se voulait et se veut encore dominante et qui a envoyé des milliers d’hommes colonisés finir en morceaux de viande faisandée au fond d’une tranchée, dans des pays qui leur étaient totalement étrangers. Un livre qui m’a vraiment bouleversée.
Joseph Boyden, né en 1966, est canadien avec des racines amérindiennes, écossaises, irlandaises. Le chemin des âmes est son premier roman. D’autres ont paru depuis, le dernier : Dans le grand cercle du monde, 2015.
En savoir plus sur l'auteur :
https://www.etonnants-voyageurs.com/spip.php?article2344
14:48 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
17/04/2020
Pensées pour Luis Sepúlveda

Un auteur qui m'est très cher s'est envolé, bon voyage Monsieur Sepúlveda, votre plume et votre belle âme va nous manquer !
Vous trouverez sur ce blog cinq notes de lectures, dont trois pour la jeunesse, consacrées à cet écrivain
14:44 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE, CG - NOTES DE LECTURES JEUNESSE, RÉSONANCES | Lien permanent | Commentaires (0)
07/03/2020
El Ninõ de Hollywood de Óscar & Juan José Martínez
traduit de l’Espagnol (Salvador) par René Solis
Métailié, février 2020
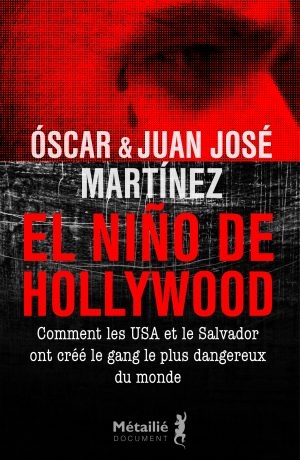
332 pages, 22 €
« Je voudrais pouvoir revenir en arrière, et pas aller avec la Mara…
Aux mioches, moi je leur dis, ne le faites pas, disait El Niño. »
Miguel Ángel Tobar, celui qui fut d’abord El Payaso, Le Clown, puis El Niño de Hollywood, du nom de la branche de la Mara Salvatrucha 13 à laquelle il appartenait, les Hollywood Locos, dont il fut l’un des plus redoutables sicario, avant de devenir un misérable témoin protégé de l’État salvadorien, après avoir dénoncé un bon nombre de mareros, dont son pandillero, son chef, Chepe Furia. Chepe Furia, de son vrai nom José Antonio Terán, avait été dans les années 70, un policier de l’ultra brutale police d’État, la Garde Nationale de sinistre mémoire où il était alors connu sous le nom d’El Veneno, le Poison, ce n’est que bien plus tard qu’il reviendra au Salvador, sous le nom de Chepe Furia, membre de la Mara Salvatrucha 13.
José Antonio Terán avait fui le pays, sa guerre intestine et ses propres exactions. Dans les années 70, il y avait eu une fuite en masse des Salvadoriens vers le sud de la Californie, puis ces derniers — dont bon nombre avaient rejoint les gangs — furent expulsés sous le gouvernement de Reagan. Des centaines de membres de la Mara Salvatrucha 13 (la MS-13), qui en 1992 était le gang le plus puissant de Californie et du Barrio 18 qui lui s’était rallié au système des gangs sureños, principalement d’origine mexicaine, comme l’indique le chiffre 18, contrairement à la MS-13. Les deux gangs étaient ennemis et se disputaient des territoires. Les Salvadoriens n’ayant connu que l’ultra-violence dans leur propre pays, dressés tout jeunes à tuer, n’avaient respecté aucune règle des autres gangs des ghettos californiens à leur arrivée. Sales, adeptes des drogues et de l’alcool, tous vêtus de noir avec les cheveux longs, jeunes fans absolus et très perturbés de heavy metal aux pratiques macabres, la MS-13 s’était vite fait une réputation avant de s’organiser en gang plus conforme niveau look à l’image des autres gangs californiens, mais avec toujours une longueur d’avance sur leur capacité de violence pure.
Une fois de retour au Salvador, les deux gangs ennemis se sont donc reformés. La MS-13, avec ses différentes branches, a alors conforté et prouvé sa réputation de gang du XXIe siècle le plus violent au monde, aussi bien vis-à-vis de l’extérieur qu’à l’intérieur même de celui-ci. C’est le seul a être sur la liste noire du département du Trésor des États-Unis, ses membres qualifiés d’animaux par Trump, « ce président ignorant (….) et non d’animaux humains créés par d’autres humains ».
El Niño de Hollywood n’a jamais mis les pieds aux États-Unis, encore moins à Hollywood, mais il fait partie de ses enfants perdus, issus de familles totalement éclatées, dans un pays ravagé par des décennies de guerre et qui n’ont déjà connu que la violence et la misère.
Ainsi, en un peu plus de trois cents pages, parfois très dures, le lecteur pourra comprendre ce qui a bien pu faire de ce tout petit pays d’Amérique centrale, le pays le plus meurtrier du monde avec un taux d’homicides absolument dément. Il faut pour cela remonter au XIXe siècle, à l’époque où des propriétaires terriens faisaient fortune avec l’indigo et avaient pour cela relégué les populations indiennes sur les terres non exploitables à flanc de montagnes. Quand la découverte inopinée, à Londres, du premier colorant de synthèse, bleu donc, fait chuter brutalement la demande et le cours de l’indigo, l’élite des propriétaires terriens à l’initiative du président alors en place, Gerardo Barrios, va se reconvertir très vite dans le café et pour cela elle a besoin des terres en pente qu’elle avait laissées aux Indiens, mais aussi de leurs mains pour récolter. Le traitement qui est infligé alors à cette main d’œuvre, déjà humiliée par le régime colonial espagnol, est tel que cette population dont la colère et la frustration a atteint un point de non retour, n’ayant rien de plus à perdre, commence à se rebeller au début des années 30, ce qui entraînera aussitôt une répression féroce, la Matanza : en 1932, « au moins quinze mille personnes, des hommes jeunes dans leur majorité, ont été assassinées dans la région occidentale du Salvador en quelques mois (…) et une bien plus grande quantité encore a été exécutée durant le reste de l’année. Aucun de ces morts n’a été enregistré dans les registres d’homicides. »
Roque Dalton, poète salvadorien membre de l’organisation insurgée Armée révolutionnaire du peuple dans les années 1970, qui sera assassiné sur ordre des dirigeants de cette même organisation pour insoumission, écrivit à ce sujet :
« Nous sommes tous nés à demi morts en 1932
Nous survivons à demi vivants
Et chacun de nous porte une dette de trente mille morts bien entiers
Dont les intérêts ne cessent de gonfler
Et qui aujourd’hui suffit pour enduire de mort ceux qui continuent
À naître
À demi morts
À demi vivants
Nous sommes tous nés à demi morts en 1932
Être Salvadorien c’est être à demi mort
Ce qui bout
C’est la moitié de la vie qu’on nous a laissée… »
Mais comme souvent l’injustice et l’atrocité furent rentables : « Les riches sont devenus très riches dans les décennies qui ont suivi 1932. Les pauvres, eux, ne pouvaient être plus pauvres. »
Mais ces pauvres soutenus par les idéaux marxistes s’organisent dans les années 70, le pays entre alors dans l’une des dictatures les plus sadiques d’Amérique centrale, composée de militaires putschistes d’extrême-droite avec comme d’habitude la participation de la CIA, le but étant comme toujours de protéger les possessions et privilèges de la classe dominante. La guérilla est forte et brutale elle aussi, nourrie de plus d’un siècle d’injustices sans réparation. Dans un pays composé alors « à plus de 60 % par des enfants, le résultat était prévisible. Des milliers de mineurs de moins de 15 ans ont été recrutés des deux côtés. (…) Le Salvador, un pays vingt fois plus petit que la Californie, s’est lancé avec ses armées adolescentes dans l’abîme dont il devait ressortir en 1992 avec pour bilan plus de soixante-quinze mille morts et une immense quantité de personnes déplacées.»
Voilà le terreau de tant de morts déjà décomposés, dans lequel les gangs made in USA viendront semer leurs graines assassines.
Qui dit guerre, dit ennemi, la nécessité d’avoir un ennemi à combattre, « l’envie irrépressible de détester quelqu’un sans motif idéologique a été fondamentale dans la construction du Salvador ». La minorité possédante demeurant, quoiqu’il arrive, intouchable, on entre donc dans la logique des clans, où la raison de vivre est la mort de l’autre. Quand les membres des gangs comme Chepe Furia et bien d’autres, dont certains étaient partis trop jeunes pour connaître leur pays, sont expulsés de Californie vers la fin des années 90, une certaine aura les entoure aux yeux de la jeunesse qui a grandi dans la misère au Salvador dans un environnement très rural.
« Les États-Unis vomissaient.
Sans comprendre ce qu’ils faisaient.
La migration est un cercle.
Des recruteurs pour tout le Salvador.
Des recruteurs d’enfants perdus pour tout le Salvador.
Des chefs de clans pour tout le Salvador.
Un pays en reconstruction.
Un pays en ruines.
Un pays qui n’avait pas le temps pour les enfants perdus.
La guerre expulsée des rues de Californie aux rues du Salvador.
Une guerre s’achevait. Une autre commençait. »
Il fut très facile pour Chepe Furia, auréolé de son parcours de « combattant » et fort de son expérience d’ex-policier de la Garde Nationale, de manipuler ces « enfants de personne », les enfants de la guerre. « Enfants de familles dysfonctionnelles fabriquées avec des restes d’autres familles », leur seule consigne : survivre. « Beaucoup d’entre eux faisaient face aux déceptions de la vie de la même façon que leurs pères, à grandes rasades d’alcool de canne, le guaro. ». Illettrés, misérables, déjà confrontés à la violence, ils étaient d’autant plus manipulables qu’ils étaient mus par un désir de valorisation, de reconnaissance et notamment de la part d’un père souvent inexistant ou minable comme celui d’El Niño, alcoolique lui-même victime de son propre tragique destin, qui vendait sa fille de 15 ans à son contremaître.
C’est le 24 décembre 1994 exactement, que Miguel Ángel Tobas, celui qui deviendra El Niño de Hollywood, né en 1981 dans une plantation de café, a pour la première fois, tenté de tuer un homme : le contremaître qui violait sa sœur. Une première tentative ratée à coups de gourdin et de pierres, « grosses comme les pierres qu’un enfant de 11 ans mal nourri peut soulever », l’enfant déçu de lui-même avait toutefois emporté un révolver .38, qu’il avait trouvé à la ceinture de cet homme.
Cette reconnaissance, les enfants de personne achetés par quelques bouteilles d’alcool par Chepe Furia, l’obtiendront ou croiront l’obtenir au prix du sang.
« Le secret, c’est que leur rêve n’est pas de devenir riche, mais d’être quelqu’un. Quelqu’un de différent de ce qu’ils étaient, (…) le rebut. »
Ils devront prouver leur allégeance totale à la Hollywood Locos Salvatrucha en assassinant violemment d’autres gamins absolument semblables à eux, dans une guerre contre cet ennemi déclaré, ceux de l’autre gang, avec bon nombre de victimes collatérales, mais aussi une guerre à l’intérieur même du gang contre les tièdes, les faibles et les traîtres, qui seront cruellement éliminés. Ainsi El Payaso, s’auto-nommera El Niño de Hollywood, — il a autour de 16 ans — par un meurtre particulièrement atroce car il ne s’agit pas seulement de tuer, mais aussi d’écrire avec le corps des victimes, celui-ci devenant un support pour transmettre un message qui doit faire horreur.
« Difficile d’arrêter une horde de chevaux emballés. Surtout si personne ne cherche à les arrêter. Surtout si quelqu’un les suit en les excitant. La haine qui s’est mise à rouler au Salvador a trouvé une interminable pente descendante. Elle roule toute seule. La première impulsion a suffi. La mort a donné du sens à toutes ces vies. »
Et à celle d’El Niño de Hollywood, devenu sicaire reconnu comme l’un des plus redoutables et le plus sanguinaire du gang des Hollywood Locos de la MS-13, dont il deviendra cependant lui aussi un traître et ne connaîtra plus jamais le repos, pas même après sa mort.
La boucle est bouclée, l’ultra-violence au Salvador est le mode de vie psychopathe de toute une partie de la jeunesse la plus pauvre. Les gangs, « une mafia, oui, mais toujours une mafia de pauvres. ».
« Tuer, haïr celui qui, sans te connaître, te tue, te hait », avec toute une mythologie, une mystique presque du meurtre, avec la Bête qui réclame sa part de sang. « Notre Bête à nous, elle est noire, c’est un cheval noir qui a le pouvoir, d’après l’Apocalypse, d’enlever la paix sur la terre. C’est une Bête de couleur noire avec une épée pointue. »
« Chepe Furia était intelligent pour créer des symboles, pour revêtir de transcendance ce qui n’était qu’un bain de sang contre des jeunes gens ».
On ne lit pas ce type de livre pour se divertir, à moins d’être soi-même un gros malade, non, on le lit pour comprendre comment cette violence est possible, comment des enfants de 10, 12 ans peuvent commettre des crimes aussi abominables, et devenir vers 16, 18 ans des tueurs déjà professionnels et à moitié, si ce n’est complètement, fous. On lit pour comprendre quel est le mécanisme à l’œuvre, pour comprendre comment tout cela a pu commencer et comme trop souvent, on trouvera à l’origine une élite possédante qui opprime, exploite et accule des populations à des situations d’injustice et de misère extrêmes et dans une spirale infernale, des décennies plus tard, toute une partie de la jeunesse d’un pays se retrouve pourrie jusqu’aux os, tellement qu’il n’est plus possible de distinguer les victimes des bourreaux.
Si les deux frères, auteurs de cet ouvrage magistral dans lequel la réalité pulvérise la fiction et qui ont réalisé là un travail de journalisme d’investigation courageux et réussi, s’intéressent de si près à El Niño de Hollywood qu’ils ont interviewé pendant des centaines d’heures, c’est bien parce que comme il le lui ont dit : « malheureusement, nous croyons que ton histoire est plus importante que ta vie… ».
On lit pour entrevoir l’humain derrière le monstre, pour nous rassurer nous-mêmes sans doute et il se trouve que l’humain est bien là, pris dans cette logique implacable qui le dépasse. Une multitude de fils de vies microscopiques qui se trouvent piégés ensemble dans la même trame, la toile souillée d’un sang qui n’en finit plus de couler.
« Au fil des mois et des années nous avons pu nous rendre compte que la vie de cet homme était conditionnée par des processus globaux, par des histoires à l’échelle mondiale dont il ignorait tout. Nous avons découvert que le pouvoir de décision, ce qu’on peut appeler la possibilité d’agir, a toujours était limité, toujours étroitement lié à des mécanismes lointains conçus par de hauts fonctionnaires aux États-Unis et au Salvador durant tout le XXe siècle. »
Personne ne voudrait être Miguel Ángel Tobar. « À présent il n’est plus que terre et racine. De l’engrais pour ce coin pourri du monde », laissant derrière lui, une très, trop jeune maman d’à peine 18 ans et leurs deux petites filles. Quelle histoire, quelle légende cette dernière leur racontera-t-elle à propos de leur père ?
Cathy Garcia
 Oscar MARTÍNEZ est un journaliste d'investigation et écrivain salvadorien qui travaille pour elfaro.net, journal en ligne spécialisé sur les sujets de violence, migration et crime organisé. Il a remporté de nombreux prix tout au long de sa carrière, notamment le prix Fernando Benítez de journalisme, le Prix des droits de l'homme et le Prix international de la liberté de presse.
Oscar MARTÍNEZ est un journaliste d'investigation et écrivain salvadorien qui travaille pour elfaro.net, journal en ligne spécialisé sur les sujets de violence, migration et crime organisé. Il a remporté de nombreux prix tout au long de sa carrière, notamment le prix Fernando Benítez de journalisme, le Prix des droits de l'homme et le Prix international de la liberté de presse.
 Juan José MARTÍNEZ est un anthropologue né au Salvador en 1986. Il étudie les gangs et la violence depuis 2008 et a collaboré avec diverses institutions telles que l'Unicef, Action on Armed Violence et l'American University.
Juan José MARTÍNEZ est un anthropologue né au Salvador en 1986. Il étudie les gangs et la violence depuis 2008 et a collaboré avec diverses institutions telles que l'Unicef, Action on Armed Violence et l'American University.
18:52 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
17/02/2020
La certitude des pierres de Jérôme Bonnetto
éditions Inculte, 8 janvier 2020

192 pages, 16.90€.
Ségurian est un village isolé et perché dans la montagne, dont le saint patron est St Barthélémy, fêté comme il se doit tous les 24 août, avec la sortie du saint en procession et la traditionnelle préparation et dégustation bien arrosée de la soupe au pistou. Tout un symbole si on pense au massacre du même nom et nul doute que l’auteur ne l’a pas choisi par hasard.
Ségurian est un village de chasseurs et les chasseurs forment un clan avec un chef qui est aussi le chef, de père en fils, d’une entreprise familiale de construction qui a bâti une bonne partie du village : ce sont les Anfonsso. Joseph Anfonsso est donc un chef : chef de famille, chef d’entreprise, chef des chasseurs. Et plus tard, il passera la main à son propre fils Emmanuel. Tout est bien qui tourne bien, immuablement, dans ce village refermé sur lui-même.
« L’amour de Joseph pour la chasse n’était pas feint. Première carabine à six ans, la première grive à sept sous le fier regard du père, la main tendre qui décoiffe l’enfant. L’amour de la chasse, c’est avant tout l’amour du père. La rudesse de l’homme qui n’avait pas appris à faire de compliments se fendait devant les succès répétés de Joseph, qui repensait souvent au jour où son père lui avait dit, après avoir tiré un lièvre à plus de quatre-vingts mètres : “Tu es bien mon fils, tu es comme moi, mais en mieux. ” En économie comme dans les sentiments, c’est la rareté qui fait le prix. Joseph en avait eu les larmes aux yeux. »
Ségurian donc, village de chasseurs : « La société comptait cent membres pour quatre cents habitants. »
La vie du village et la propre vie de Joseph Anfonsso auraient pu ronronner ainsi durant des millénaires sans que rien ne change, sans que rien surtout ne doive changer, mais c’était sans compter l’arrivée de Guillaume, un 24 août en plus. La certitude des pierres est divisé en six chapitres allant de la première St Barthélémy à la sixième, la première étant celle où Guillaume donc est arrivé au village.
Les parents de Guillaume Levasseur s’étaient installés depuis quelques années à Ségurian, dans la maison d’un oncle décédé, un original dont ils ne savaient pas grand-chose. Les parents Levasseur après avoir travaillé toute leur vie en ville, avaient désiré s’éloigner des « fourmilières déshumanisées » et se rapprocher de la nature, d’autant plus que Guillaume était déjà parti depuis trois ans, pour l’Afrique sur un coup de tête. Mais donc la famille, avec un seul membre au cimetière, est « une pièce rapportée, des estrangers, des messieurs de la ville comme on dit. Va falloir qu’ils fassent leurs preuves, les Levasseur. Va falloir me remplir ce caveau avant d’élever la voix, avant de faire les fiers, avant de touiller la soupe au pistou. C’est comme ça, c’est l’ordre des choses. »
Et voici que Guillaume non seulement débarque dans le village, mais surtout, tombé amoureux de ce coin de montagne, il a un projet : y monter une bergerie. Et Guillaume, c’est une force de la nature, ce n’est pas juste un jeune illuminé malgré ses cheveux longs, c’est un rêveur certes, un intello qui grimpe dans les arbres pour y lire des livres, mais c’est un bosseur aussi, qui compte bien voir aboutir son rêve. Et il s’y met et le rêve peu à peu se concrétise, il y travaille comme un acharné, la bergerie voit le jour et même elle va s’agrandir d’année en année, des chèvres, des moutons, choisis avec soin, ça marche bien, sauf que cette bergerie elle se situe au-dessus de la maison de Joseph et que les moutons paissent sur des terrains habituellement dédiés à la chasse au sanglier et que dès le départ, ça pose problème. Pour Joseph, la montagne, c’est chez lui et « pas pratique de chasser au milieu de toute cette laine. »
« On était là avant, pensa-t-il. C’est une question de bon sens. »
La tension va monter crescendo jusqu’à la quatrième fête de St Barthélémy après l’arrivée de Guillaume : alors que ce dernier, sollicité pour sa force physique, porte comme Joseph, la statue du Saint Patron sur la procession, Joseph a une défaillance qui provoque la chute de la statue du Saint Patron qui en perd la tête. L’irritation envers le berger va basculer alors définitivement dans une véritable haine.
« Le berger avait jeté une mauvaise onction sur le village. C’était un gâcheur de fête, un empêcheur de tourner en rond, un perturbateur d’horizon, un branleur de situation. Il dérangeait l’ordre établi, il barbouillait les lignes, troublait l’air comme l’eau le pastis. Un mouton noir, c’était le mouton noir, un Boche, un Turc. (…) Avec le berger, brillait la lumière maléfique des sabbats. Un jour, les aiguilles de l’église se mettraient à trotter à l’envers et, ce jour là, on serait perdu, toutes les sources seraient taries, de la mousse pousserait au sud et l’ogre marcherait sur le village pour manger les enfants. »
La certitude des pierres, est un portrait précis, ironique, mordant, sans concession mais malheureusement réaliste cependant, d’une communauté qui n’accepte pas facilement ceux qui ne sont pas d’ici et c’est un drame quasi biblique qui y prend place — Joseph le chasseur et Guillaume le berger. L’écriture de Jérôme Bonnetto est belle, poétique, âpre et minérale comme la montagne et c’est avec un évident talent que l’auteur met en relief l’entêtement et la folie des hommes, leur lâcheté tout autant que leur courage, la bêtise et la mesquinerie quotidienne, les silences complices et ce refus d’analyser en soi les véritables racines de la rage en les affublant au contraire de tous les déguisements possibles de légitimité.
« On est un bois, un bloc, une race.
On se comprend. On fait à notre idée. On a nos règles, les seules qui vaillent. Les autres peuvent passer, on les salue, de loin, comme ça. Du plus loin possible. »
La certitude des pierres est un roman dont on se régale, malgré l’amertume certaine qui reste en travers de la gorge, surtout si on a soi-même connu cet entre-soi qui entraine l’exclusion d’autrui et qui est une réalité certaine de la ruralité comme de bien d’autres communautarismes.
L’auteur ne porte pas directement de jugement mais décrit de l’intérieur même des personnages, le mécanisme de la violence, la loi du silence et le poids d’un orgueil écrasant qui transmis de père en fils et poussé jusqu’à son extrême, peut mener l’homme à sa propre perpétuelle impasse.
Cathy Garcia

Jérôme Bonnetto est né à Nice en 1977, il vit désormais à Prague où il enseigne le français. La certitude des pierres est son troisième roman.
09:21 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
20/12/2019
L’œil du paon de Lilia Hassaine
Gallimard, 3 octobre 2019
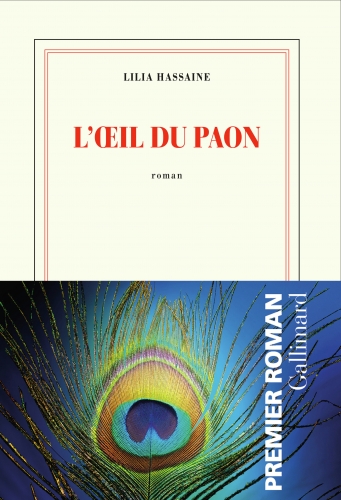
230 pages, 18,50 €.
Très bien écrit, fluide, on se laisse facilement aspirer par L’œil du paon qui trace un portrait acerbe d’un certain milieu parisien plutôt huppé. Dans ce roman qui a quelque chose d’un conte moderne froid et cruel, il y a une esthétique de l’écriture qui tient de la peinture. Il y est d’ailleurs fait mention des tableaux de Hopper, dont l’univers colle assez bien en effet avec l’atmosphère du roman.
Le côté froid, vaniteux, désabusé, à la fois superficiel et pesant de cette vie parisienne, auquel se confronte Héra, la jeune femme, personnage principal du roman, contraste avec la chaleur, la liberté, les couleurs, les parfums de l’île au large de la Croatie, dans laquelle elle a grandi, sorte d’éden à l’abri du monde, peuplé de paons. Oiseau emblématique, délibérément choisi par l’auteur pour ce qu’il évoque : la beauté mais aussi et surtout l’orgueil, caractéristique typiquement humaine, que nous projetons sur lui. Sur cette île où Héra a vécu seule avec son père, gardien de l’île — sa mère étant morte là-bas très prématurément — plane une menaçante légende en lien avec une ancienne abbaye détruite durant les campagnes napoléoniennes.
Lilia Hassaine décortique ses personnages au fil des pages, comme des crevettes qui laisseraient sortir un jus pas toujours appétissant, tout en laissant une part de flou, de mystère, d’inaccessible, car l’humain n’est pas en noir et blanc comme les photographies qu’aime prendre Héra. Chacun est comme absorbé dans son propre monde, ses propres secrets, projetant juste une apparence sur une grande toile de cinéma. La salle reste obscure. Les relations humaines sont tristes, artificielles, le mensonge dissimule le malaise ou pire, nul ne semble être vraiment à sa place mais chacun joue son rôle comme dans un théâtre antique. L’intrigue laisse cependant deviner et c’est dommage, la fin bien trop tôt, mais cela n’empêche pas d’apprécier la lecture quasiment jusqu’au bout. L’œil du paon ayant une originalité certaine que la qualité littéraire de l’ensemble sert au mieux.
L’auteur parvient à ne rendre aucun de ses personnages réellement attachant, ce qui traduit bien l’angoisse sourde qui coule en-dessous de la trame comme un égout. Ici l’humanité est un condensé de tentatives avortés dans une quête de beauté, de perfection, inaccessibles car toujours extérieures à elle. Et puis il y a Hugo, l’unique enfant au centre de la toile, terriblement seul dans un vide qui ne tient plus que par quelques apparences et une bonne dose de cynisme. Quelle place ici pour la fraîcheur, l’innocence ?
L’œil du paon est un premier roman, que l’on peut qualifier de prometteur.
Cathy Garcia
 Lilia Hassaine est journaliste, diplômée en 2015 de l’Institut Français de Presse. Par la suite, elle effectue de nombreux stages dans la presse écrite, notamment pour Le Parisien et à la télévision pour la chaîne Arte, avant de se faire remarquer grâce à son web-documentaire De mèche contre le cancer où elle traite du don de cheveux. En parallèle, elle intègre le groupe TF1 où elle officie en tant que journaliste avant de rejoindre l’équipe de l’émission Quotidien en janvier 2016, équipe qu’elle a quitté pour écrire ce premier roman.
Lilia Hassaine est journaliste, diplômée en 2015 de l’Institut Français de Presse. Par la suite, elle effectue de nombreux stages dans la presse écrite, notamment pour Le Parisien et à la télévision pour la chaîne Arte, avant de se faire remarquer grâce à son web-documentaire De mèche contre le cancer où elle traite du don de cheveux. En parallèle, elle intègre le groupe TF1 où elle officie en tant que journaliste avant de rejoindre l’équipe de l’émission Quotidien en janvier 2016, équipe qu’elle a quitté pour écrire ce premier roman.
13:34 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
16/12/2019
Le soleil sur ma tête (O sol na cabeça) de Geovani Martins
traduit du portugais (Brésil) par Matthieu Dosse
Gallimard 17 octobre 2019

135 pages, 15 €.
« – C’est parce-que le monde entier est foncedé, frère. Comme si tu ne savais pas ça. Je te le répète : une semaine sans came et tout Rio de Janeiro s’arrête. Plus de médecins, plus de chauffeurs de bus, plus d’avocats, plus de policiers, plus d’éboueurs, plus rien. Tout le monde va devenir ouf à cause de l’abstinence. Cocaïne, Rivotril, LSD, ecstasy, crack, cannabis, antidouleurs, peu importe, frère. La came c’est le combustible de la ville. (…)
– La came et la peur, j’ai ajouté.»
Ceci n’est pas un livre qui parle des favelas de Rio, ce sont les favelas qui y prennent la parole et donnent à voir une autre image, bien plus réelle, de cette ville qui fait rêver avec sa façade de carte postale, ses plages faussement paradisiaques, son carnaval à paillettes, sa samba perpétuelle. Rio de Janeiro a un autre visage, un visage balafré par la violence, fille bâtarde de l’exclusion sociale, un visage recouvert de la poussière humaine déposée par les exodes ruraux, populations nordestines et d’ailleurs, fuyant l’aridité extrême de leur existence et dont les espoirs s’échouent dans les quartiers nord et les bidonvilles nommés ici favelas, en mémoire d’une fleur qui pousse – poussait ? - sur les mornes abrupts qui dominent la ville. Visage cependant non dénué de beauté et capable de séduire par sa force et sa vivacité.
Dans ces favelas, génération après génération, grandissent des enfants, des adolescents, pour qui l’avenir offre peu de perspectives. Geovani Martins est de ceux là, de ces enfants qui vivent dans la pauvreté excentrée et dont le quotidien est à la fois bousculé et balisé par la violence des trafics de drogue et celle de la police très corrompue. Dans ces zones que se disputent les factions rivales, ce sont les habitants toujours qui en prennent plein la gueule, les balles qui sifflent et les cadavres au petit matin rythment leur quotidien déjà difficile.
Pour la jeunesse, assignée à faire le guet dès son plus jeune âge pour les dealers, il n’y a que l’amitié, le rire, la fête, les virées à la plage où le touriste inconscient se fait régulièrement dépouiller, pour faire la nique à la mort, au plomb de leur vie mal barrée. Les joints, les acides, la coke, les ecstas, le lança perfume — une drogue à base d'éther très en vogue au Brésil depuis des décennies, au départ comme accessoire de carnaval — tout est bon même si pas bon, pour s’évader et s’amuser. La défonce devient le dénominateur commun de la jeunesse du monde entier, mais ici la pente est raide et rapidement sans-retour. L’enfer est facile d’accès et ceux qui touchent au crack en reviennent rarement. Mais dans Le soleil sur ma tête, Geovani Martins ne fait pas dans le pathos, le sensationnel, il parle simplement et avec talent de ce qu’il connait. Il raconte une jeunesse comme n’importe quelle jeunesse, qui a juste besoin de vivre et de mettre des coups de bombes de couleur à une existence qui sent trop vite l’égout.
L’auteur trempe sa plume dans une encre désabusée mais légère cependant et sensible, le ton est lucide, direct, plein d’humour, de fraîcheur malgré la fièvre de cette ville folle et l’horizon bouché et la langue utilisée est celle de la rue, pas de prise de distance, la littérature est là aussi : dans ce bouillon de la langue populaire.
Geovani Martins est de ceux qui savent la débrouille et le rire envers et contre tout. Cette joie inconditionnelle qui est un passeport pour la survie et l’énergie d’une jeunesse défavorisée qui ne part pas perdante pour autant. Certains s’en sortent, armés pour la vie par des expériences fortes et des difficultés qui les obligent à être plus malins que la mort. Les favelas elles-mêmes peuvent devenir des centres qui produisent leur propre énergie culturelle et économique. Les possibles ressuscitent encore et encore, malgré tout.
Treize nouvelles qui vous font passer là où nul touriste n’est censé se promener, treize nouvelles qui évoquent le quotidien de ces cariocas qui n’apparaissent pas sur les cartes postales, la vie sans paillettes des laissés pour compte d’une des villes les plus inégalitaires au monde. La vie telle qu’elle vient jour après jour et telle qu’il faut faire avec. Et puis la magie aussi, la magie de la macumba, de tous les sangs mêlés, les légendes urbaines, tout un univers populaire carioca haut en couleurs auquel l’auteur donne la dimension qu’il mérite, dans la lignée prometteuse d’un Jorge Amado version XXIe siècle.
Treize nouvelles d’un réel non coupé, d’un pur réel sur la corde raide avec le vide de chaque côté.
Cathy Garcia
 Né en 1991 à Bangu, une favela de la périphérie ouest de Rio de Janeiro, Geovani Martins déménage en 2004, avec sa mère et ses frères à Vidigal, dans la Zona Sul : autre favela, autres règles, autre monde. Le choc provoqué par ce déménagement fut la genèse de chacune de ces treize nouvelles. C’est lors d’une journée en garde à vue, faute d’autre occupation, que découvrant l’œuvre du romancier Roberto Drummond, il prend goût à l’écriture. Après des années de petits boulots et une tentative d'écrire un roman, il travaille à écrire des nouvelles sur une machine à écrire offerte par sa famille et présente son premier recueil à un salon en mars 2017. Il devient un modèle local avec ce premier livre qui connaîtra un grand succès au Brésil avant même d'être publié.
Né en 1991 à Bangu, une favela de la périphérie ouest de Rio de Janeiro, Geovani Martins déménage en 2004, avec sa mère et ses frères à Vidigal, dans la Zona Sul : autre favela, autres règles, autre monde. Le choc provoqué par ce déménagement fut la genèse de chacune de ces treize nouvelles. C’est lors d’une journée en garde à vue, faute d’autre occupation, que découvrant l’œuvre du romancier Roberto Drummond, il prend goût à l’écriture. Après des années de petits boulots et une tentative d'écrire un roman, il travaille à écrire des nouvelles sur une machine à écrire offerte par sa famille et présente son premier recueil à un salon en mars 2017. Il devient un modèle local avec ce premier livre qui connaîtra un grand succès au Brésil avant même d'être publié.
16:39 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
15/12/2019
Le dernier grenadier du monde de Bakhtiar Ali
traduit du kurde sorani par Sandrine Traïdia
Métailié éd., 29 août 2019

336 pages, 22 €.
« Au-dessus de sa tête, il voit les branches d’un grenadier. Il entend le bruit de la destruction et de la pulvérisation des objets, il a entendu parler de la poussière mortelle de verre que le vent répand la nuit sur le monde. »
Un roman bien déstabilisant que nous offre ici cet auteur d’origine kurde, un roman dont le rythme et la narration est tout à fait atypique pour un lecteur occidental, comme une litanie qui s’étire, se distend, se ressasse par des répétitions, comme un conteur qui aurait un peu perdu la tête, une sorte d’errance littéraire traversée de fulgurances d’une beauté telle, que le livre reste collé aux mains du lecteur.
« Regardez, toutes les histoires sont comme un tout petit ruisseau qui, à la fin, vient se jeter dans la vaste mer, riche de milliers d’autres histoires… Et chaque fois qu’un conteur meurt en chemin, il faut qu’un autre conteur prenne sa place et que, rivière après rivière et mer après mer, il poursuive cette histoire. »
Mouzaffar Soubdhdam est un ancien officier supérieur peshmerga que l’on sort soudain de vingt et un an d’emprisonnement et d’isolement quelque part dans le désert. Il s’était livré pour sauver son meilleur ami, un légendaire chef révolutionnaire kurde. Libéré, il est emmené dans un palais vide entouré d’un immense jardin, qui appartient à cet ancien ami qui a bien changé et là il se retrouve isolé à nouveau, mais cette fois, il refuse cette réclusion, aussi dorée soit-elle.
Il a besoin de savoir, de comprendre ce qu’est devenu son pays et aussi de retrouver son fils Saryas Soubdham, son fils qu’il n’a jamais connu. Cette quête lui fait parcourir un pays méconnaissable, que les guerres ont miné de toutes parts et il découvre en chemin, qu’il n’existe pas un seul Saryas Soubdham, mais plusieurs : trois garçons du même âge, portant le même nom, qui n’ont pas vécu au même endroit mais qui sont reliés par un fil énigmatique. Un fil, un arbre — le dernier grenadier du monde — et trois fragiles grenades de verre.
Trois vies défigurées.
« (…) l’histoire des Saryas, du début à la fin, qu’elle que soit la couleur qu’elle prenne, quel que soit le chemin qu’elle emprunte, n’échapperait pas au fait qu’elle est l’histoire de tous ceux qui se sont retrouvés abandonnés sur cette terre au-milieu des tourbillons de poussière. »
Et Mouzaffar Soubdhdam raconte, raconte inlassablement son histoire et surtout ce qu’il a pu découvrir de celle de ces trois Saryas et des personnages que chacun d’eux a rajouté à la trame, dont deux sœurs étranges, les sœurs Spi, qui ont fait un pacte avec l’un d’eux, après avoir fait longtemps avant, un pacte entre elles.
« Lawlaw Spi et Chadarya Spi s’étaient fait très jeunes le serment éternel de ne jamais se marier de leur vie, de ne jamais se couper les cheveux, de ne jamais chanter l’une sans l’autre et de ne porter que des robes blanches. »
Et quand Mouzaffar raconte, c’est la nuit sur une embarcation en plein milieu de la Méditerranée, une parmi ces centaines et centaines qui se jettent sur l’eau à destination de l’Europe.
Le dernier grenadier du monde est un roman indescriptible, poétique, tragique, lancinant, comme une lente, très lente traversée d’un espace mélancolique et interminable, celui d’une humanité désertée de toute possibilité d’avenir, une humanité corrompue et détruite de l’intérieur par sa propre folie.
« Les grandes catastrophes donnent à la vie un cours qu’il n’est plus possible de remanier par la suite. (…) Une nuit, nous nous sommes réveillés et nous avons vu qu’il ne restait plus un carré de ciel au-dessus de nos têtes. Nous avons fui sur les ossements et sur les crânes de nos amis. »
Le dernier grenadier du monde est l’histoire de tous les innocents broyés par cette folie, l’histoire de tous les enfants renversés par les guerres et sur la nécessité, l’impérieuse nécessité cependant d’un amour fou, un amour qui n’abandonne jamais. Et le long tissu de la langue qui se déroule, avec ces motifs qui se répètent encore et encore, est comme un voile de pudeur qui revêt la trop brutale réalité.
Et puis il y a cet arbre, cet arbre légendaire et salvateur que trois adolescents, perdus dans une de « ces nuits où la réalité enfonce ses dents les plus laides dans le corps de l’homme », peuvent atteindre.
« (…) le dernier grenadier du monde, ce grenadier était le seul représentant de leurs rêves, à la frontière qui se trouve entre le ciel et la terre, ce rêve auquel ils ne pouvaient pas donner de nom, le rêve d’une compréhension mutuelle entre les hommes, les frères et les ennemis. »
Quand les pères sont happés par le tumulte et la violence de l’Histoire, les fils errent en aveugle.
« Cette nuit-là je compris les malheurs que la disparition et l’impréparation d’un homme pouvait causer. Je compris combien était grande, étrange et importante la place de l’homme sur cette terre. L’homme qui, une fois qu’il est né, laisse pour toujours des traces claires dans la vie des autres. La vie n’est rien d’autre qu’une chaîne éternelle, continue, ininterrompue.»
« Je sais que l’homme est un être pour qui les chemins se brouillent vite, je sais que l’homme ne trouve pas les chemins. Aucun être sur terre ne perd autant sa route que l’homme… »
Et cette histoire, c’est donc aussi la nôtre et « c’est un sale temps, une époque dont l‘odeur n’est pas meilleure que celle du cul d’un âne. » et c’est cependant envers et contre tout, un message d’espoir que porte Mouzaffar Soubdham, un message qui espère illuminer cette longue nuit noire de l’humanité perdue.
« Non, ne dites pas que nous sommes fatigués de cette mer et ne demandez pas jusqu’à quand nous devrons tourner en rond sur cette mer. Demandez-moi pourquoi je suis devenu comme le prophète des souffrances. Pendant vingt et un ans, jour et nuit, j’ai regardé le désert de ma fenêtre et je l’ai appelé à l’aide. Depuis cette fenêtre, j’ai vu quelque chose. Une chose sans laquelle je n’aurais pas survécu… Depuis cette fenêtre, j’ai vu le bonheur du désert, j’ai vu le jeu entre le sable et la lumière. Si, durant ces vingt et un ans, je n’avais pas cru voir une beauté immense et infinie dans ce sable, je m’y serais noyé. Jusqu’à son dernier souffle, jusqu’après sa mort même, l’homme ne doit pas perdre la foi dans son bonheur, il ne doit pas perdre la foi en la beauté… Non je ne suis pas un homme à deux visages. Moi aussi, comme chacun de vous, j’ai crié de tout mon cœur contre toutes les absurdités. Moi aussi j’étais très désespéré. Souvent, j’ai été vaincu, je me suis incliné et j’ai été anéanti. Mais je parle de la lumière qui jaillit après tout désespoir. »
Cathy Garcia
 Bakhtiar ALI est né à Sulaimaniya, dans le Kurdistan irakien, en 1966. Il est devenu un romancier important dans les années 90. Ses livres sont des best-sellers en Iran et en Irak, il a reçu de nombreux prix littéraires au Moyen-Orient. Il est un des auteurs kurdes contemporains les plus connus. Il vit à Cologne depuis 1998. Il est traduit en farsi, en anglais, en allemand, en italien et en arabe.
Bakhtiar ALI est né à Sulaimaniya, dans le Kurdistan irakien, en 1966. Il est devenu un romancier important dans les années 90. Ses livres sont des best-sellers en Iran et en Irak, il a reçu de nombreux prix littéraires au Moyen-Orient. Il est un des auteurs kurdes contemporains les plus connus. Il vit à Cologne depuis 1998. Il est traduit en farsi, en anglais, en allemand, en italien et en arabe.
22:54 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
18/09/2019
Kintu de Jennifer Nansubuga Makumbi
traduit de l’anglais (Ouganda) par Céline Schwaller
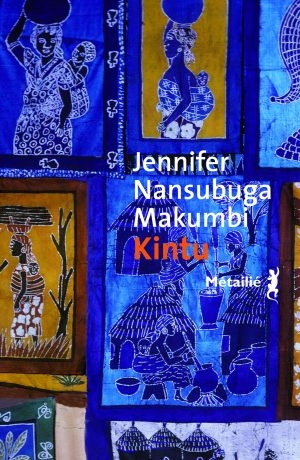
Métailié éd., 22 août 2019. 480 pages.
Ce roman est une fresque étourdissante d’une densité telle qu’il est impossible de le résumer, et d’ailleurs tel n’est pas le but de cette note, mais il faut tout de même pouvoir donner quelques pistes au lecteur. De quoi s’agit-il ? D’une histoire de famille sur plusieurs générations, trois siècles, en Ouganda, donc bien avant que ce pays ne soit arbitrairement nommé ainsi par le colon britannique, en référence à l’ethnie Ganda, occultant ainsi toutes les autres qui peuplaient cette terre.
Kintu est donc une histoire de famille, mais à vrai dire, c’est avant tout l’histoire d’un geste malheureux et de ses conséquences : la répétition transgénérationnelle d’une malédiction. La gifle d’un père, Kintu, à son fil adoptif, Kalema, lors d’une déjà difficile traversée de désert, ayant entraîné accidentellement la mort de ce dernier, qui de plus, fut vite et mal enterré par mégarde à coté d’un arbuste épineux auprès duquel on enterre habituellement les chiens.
Le roman démarre par un prologue, nous sommes en janvier 2004 à Bwayse, un bidonville situé dans une zone marécageuse au pied de Kampala. Kamu Kantu y est assassiné. Kamu Kantu est un descendant de Kintu Kidda, l'ancêtre qui a attiré la malédiction sur sa lignée. Et ce prologue laisse place au premier chapitre qui nous ramène à l’origine donc de cette malédiction : en 1750, dans la Province du Buddu, au Buganda.
Plusieurs générations vont ainsi se succéder, depuis le temps des clans, des royaumes jusqu’au début du XXIe siècle. L’histoire des individus mêlée, emmêlée à l’Histoire d’une terre sur laquelle sont venues, les unes après les autres, se greffer des religions importées et conflictuelles, dont la pas si petite dernière : la très activiste évangéliste. Une terre démembrée par la colonisation, ce qui a entre autre ravivé et compliqué les guerres tribales, et qui essaie d’avancer avec de douloureuses prothèses occidentales comme tout le reste du continent, et tous les flux migratoires consécutifs, la modernisation et la paupérisation qui va avec, les guerres encore, le sida… Y est évoqué bien-sûr la sinistrement célèbre figure d’Idi Amin Dada, mais d’un point de vue ougandais, notamment dans une discussion entre deux amis qui ne sont pas d’accord. La figure était cependant déjà suffisamment et atrocement sanguinaire, sans besoin que les fantasmes occidentaux n’en rajoutent pour en faire une caricature révélatrice de leur propre peur du « noir », tout en faisant oublier ainsi leur responsabilité dans l’instauration de ce dictateur, comme tant d’autres en Afrique.
Kintu est un roman, écrit forcément dans la langue de l’ancien colon britannique, mais c’est vraiment un roman ougandais, sans compromis.
Si la toile de fond se transforme au cours des siècles, Jennifer Nansubuga Makumbi tisse sa trame avec tant de subtilité, l'art de montrer sans dire, que ce n'est pas ce qu’on pourrait appeler une fresque historique. L’Histoire est un grand fleuve, mais ce sont les êtres humains qui sont ici au centre de la fresque, ils sont bien-sûr entraînés par le courant, roulés, malaxés, modelés et parfois brisés par lui, mais, comme des galets, ils sont solides. Ils ont leur propre densité, identité, ils sont tous reliés à une montagne originelle, ancestrale et si la destinée de chacun est à la merci des événements, il existe aussi une forme de prédestination. La force du fleuve ne change rien à la malédiction qui poursuit les descendants de Kintu Kidda, génération après génération, mais cela pourrait tout aussi bien être une bénédiction, ce qui émerge de ce roman, c’est le fil qui nous relie les uns aux autres et qui traverse le temps.
Roman foisonnant, puissant, où l’on se perd facilement mais, comme les personnages, nous sommes entraînés par la force du courant. Une liste et un arbre généalogique en début d’ouvrage peut nous aider à reprendre pied, mais à vrai dire on n’en a pas forcément envie, car très vite, il n’est pas tant question de tout comprendre, mais plutôt de se laisser emporter et peu à peu imprégner de cette langue franche et magnifique avec laquelle Jennifer Nansubuga Makumbi nous raconte sa terre d’origine.
Un premier roman magistral.
Cathy Garcia
 Jennifer Nansubuga MAKUMBI est née à Kampala. Elle a étudié et enseigné la littérature anglaise en Ouganda, avant de poursuivre ses études en Grande-Bretagne, à Manchester, où elle vit aujourd'hui. Son premier roman, Kintu, lauréat du Kwani Manuscript Project en 2013, sélectionné pour le prix Etisalat en 2014, a reçu un accueil critique et public extraordinaire, aussi bien en Afrique qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, qui lui a valu d'être comparée à Chinua Achebe et considérée comme un « classique » instantané. Elle a remporté le Commonwealth Short Story Prize en 2014 et le prix Windham Campbell en 2018. En sélection pour le Prix Médicis étranger 2019.
Jennifer Nansubuga MAKUMBI est née à Kampala. Elle a étudié et enseigné la littérature anglaise en Ouganda, avant de poursuivre ses études en Grande-Bretagne, à Manchester, où elle vit aujourd'hui. Son premier roman, Kintu, lauréat du Kwani Manuscript Project en 2013, sélectionné pour le prix Etisalat en 2014, a reçu un accueil critique et public extraordinaire, aussi bien en Afrique qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, qui lui a valu d'être comparée à Chinua Achebe et considérée comme un « classique » instantané. Elle a remporté le Commonwealth Short Story Prize en 2014 et le prix Windham Campbell en 2018. En sélection pour le Prix Médicis étranger 2019.
14:21 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
19/08/2019
Tout est provisoire même le titre de Mix ô ma prose
Cactus Inébranlable, coll. Les p’tits cactus # 49

2019. 80 pages, 9 €.
« Être fier d’aller de l’avant,
Debout sur un tapis roulant »
En voilà un drôle de zèbre (clin d’œil à ceux qui se reconnaîtront) ce Mix ô ma prose ! Son Tout est provisoire même le titre est un vrai festin, un concentré de nourriture aussi délicieuse que corrosive, le lecteur n’en fera cependant pas indigestion car le plat est drôlement bien équilibré. Avec intelligence, justesse, une lucidité à vif et une ironie salvatrice, l’auteur qui n’aime pas signer de son nom, pose des pensées qui claquent, des mots kits de survie dans un monde carré à sens unique où l’impératif d’avoir, de réussir, mentir, gonfler, tricher, paraître mieux pour gagner du creux, assomment toute tentative de réelle humanité.
« Je voulais être,
Je me suis fait avoir. »
Et savoir exprimer l’essentiel en deux phrases, c’est un art.
« Entre moi et le bleu du ciel,
Le langage institutionnel. »
Tout est provisoire même le titre est une sorte de pense pas bête libert’air qui sans se prendre au sérieux, ni donner de leçons à personne, creuse des issues de secours vers des cieux plus sauvages, plus authentiques, vers la liberté d’être soi envers et avec tout en échappant aux injonctions de l’artifice.
« Connaissant la musique,
Je reste hors de portée. »
« De nos jours,
Réfléchir,
C’est refléter
Ce qui est proposé. »
« La nature enfin dominée,
Belle et triste comme un herbier. »
« Tout est cher,
Même la réalité a augmenté. »
« C’est vous qui composez votre menu,
Et c’est comme cela qu’ils nous ont eus. »
« Avoir un cœur de pierre
Pour faire carrière. »
Mais l’auteur, s’il pense que son nom n’a pas d’importance, ne se cache pas tant que ça : maniant l’humour sans céder à la facilité, il s’expose au contraire, se dénude, dans sa fragilité, son handicap à la normalité et ses « rêves savonnettes ».
« Si je devais résumer ma vie :
Tant pis ! »
« J’ai pris de la mort avec sursis. »
« Avec la société d’aujourd’hui,
J’ai des rapports non consentis. »
« Ma vie parmi les hommes :
Syndrome de Stockholm. »
« Pas évident,
quand nos centres d’intérêt
Sont à la marge. »
« Mes utopies
Sur un bûcher
Sont accusées
De sorcellerie. »
« Depuis le temps que la lutte est finale... »
« Je me suis coupé de la société
Et la plaie ne s’est jamais refermée. »
Si vains les efforts pour « en être ».
« L’ego gonflé à bloc
Pour aller en soirée
Tenter de s’éclater. »
« Toujours à fond,
Mais en surface. »
« Merde, le fond de ma pensée est percé ! »
« Miroir, miroir, mon beau miroir,
Suis-je le plus rebelle ? »
« Suis-je négatif parce que j’ai refusé
d’être un cliché ? »
« Je reste à l’écart
Et il se creuse. »
Comme il le dit lui-même, Mix ô ma prose fait
« de la poésie
Par souci d’intégrité
Car c’est bien connu,
Elle ne se vend pas. »
« Pour être précis,
La formule exacte est :
Poète autotorturé »
Mais le poète a pris l’option linguistique pour mettre à jour nos tics de langage.
« Ah des tics !
J’ai eu peur, j’avais compris
"d’éthique" ! »
« J’ai beau lécher les vitrines,
Aucune trace de cyprine. »
« Et pour une fois
Qu’il y a quelque chose de gratuit
c’est la méchanceté »
« Ainsi les publicités pourraient être
mensongères ? »
« Au lieu de la campagne
C’est la ville qu’on devrait battre. »
Il gratte le vernis qui recouvre nos mots pour nous faire entendre ce qui est vraiment dit :
« Même pour la lecture,
Ils nous ont foutu des grilles. »
« Même le respect
Il faut le forcer. »
« Avec tous ces profils,
On ne se regarde plus en face. »
« Quand on aime, on ne compte pas
Mais on se calcule. »
« Les décisions sont si lourdes
Qu’il nous faut un porte-parole. »
« Je ne connais pas le prix de la vie,
Mais il m’a tout l’air soldé ces temps-ci. »
« On a plus de compassion pour les batteries ;
Quand elles sont faibles, on les recharge. »
« Sinon pour la prise de conscience,
C’était le bon voltage ? »
« Ne dites pas que l’on va droit dans le mur ;
Faites comme tout le monde, dites futur. »
Il dévoile l’absurde dont nos cécités quotidiennes camouflent l’évidence.
« À part l’épargne,
Y’a quoi comme plan ? »
« Rien ne marche,
Tout fonctionne. »
« Même nos codes se barrent. »
« Le plus inquiétant
C’est que tout soit normal. »
« Tellement intégré
Que j’ai disparu. »
« Il y a un scénario à la base
Ou c’est improvisé ? »
« Putain les gens,
Merde, quoi !
Ça se voit !!! »
Tout est provisoire même le titre est un petit shoot qui devrait être remboursé par la Sécu :
« Bien sûr que l’on a progressé ;
Au départ, il y avait un point
Et on a une ligne à l’arrivée. »
« Franchement, Dieu n’est pas si con
Aucune enquête de satisfaction. »
Petite mais efficace piqûre de rappel pour temps sombre : tant qu’il y a de l’humour, il y a encore une chance pour qu’il y ait de la vie, de la vraie, vivante, impertinente qui se glisse en douce sous des plumes de poètes, là où elle sait qu’elle sera respectée, protégée.
Cathy Garcia
 Derrière Mix ô ma prose se cache Olivier Boyron, un Viennois d’origine qui a eu le privilège de grandir dans la « vallée de la mort ». Malgré un cadre apaisant et propice au recueillement, il peine à s’adapter au monde qui l’encercle. Pour lui, le chaos n’est déjà plus une théorie mais une réalité dont il dépassera la friction au travers de nombreuses expériences : écriture, dessins, peintures, théâtre de rue… Mix ô ma prose, lui, nait en 2002 d’une rencontre avec le slam dont il devient un des pionniers en Rhône-Alpes avec La Section lyonnaise des Amasseurs de Mots et Les Polysémiques, association qu’il fonde à la même période. En 2006 il co-fonde La Tribut du Verbe, une compagnie de slam poésie qui propose toujours spectacles et performances. En 2016 Les Polysémiques rajoutent une branche éditions à leurs activités, il en devient le responsable d’éditions. Malgré tout, toujours mal à l’aise avec les conventions, il stoppera net sa déjà courte bio.
Derrière Mix ô ma prose se cache Olivier Boyron, un Viennois d’origine qui a eu le privilège de grandir dans la « vallée de la mort ». Malgré un cadre apaisant et propice au recueillement, il peine à s’adapter au monde qui l’encercle. Pour lui, le chaos n’est déjà plus une théorie mais une réalité dont il dépassera la friction au travers de nombreuses expériences : écriture, dessins, peintures, théâtre de rue… Mix ô ma prose, lui, nait en 2002 d’une rencontre avec le slam dont il devient un des pionniers en Rhône-Alpes avec La Section lyonnaise des Amasseurs de Mots et Les Polysémiques, association qu’il fonde à la même période. En 2006 il co-fonde La Tribut du Verbe, une compagnie de slam poésie qui propose toujours spectacles et performances. En 2016 Les Polysémiques rajoutent une branche éditions à leurs activités, il en devient le responsable d’éditions. Malgré tout, toujours mal à l’aise avec les conventions, il stoppera net sa déjà courte bio.
00:17 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
22/06/2019
Le Singe sous la montagne d’Aodren Buart
Phébus éd., mars 2019. 128 pages, 13 €.
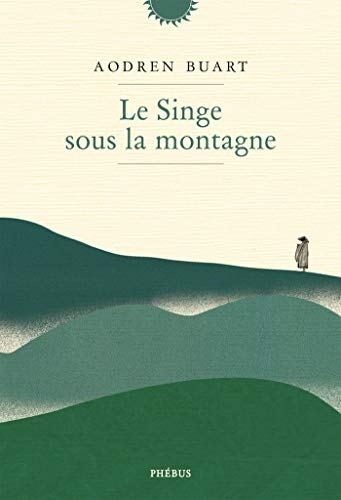 Nous ressentons à travers ce conte très directement inspiré d’un grand classique chinois : la deuxième partie de la très populaire légende du Roi Singe, l’attrait qu’a exercé la culture ancienne chinoise sur l’auteur lors de son voyage en solo en Chine. Cette quête l’aura poussé vers l’Est, mais donc ici, comme dans la seconde partie de la légende du Roi Singe — le Voyage vers l’Occident —, c’est vers l’Ouest que le moine Sanzang est envoyé par l’Empereur, pour aller chercher au-delà de bien des montagnes et sur des chemins parfois dangereux, les sutras du Bouddha. « La route, jusqu’au Grand Bouddha de l’Ouest, ne sera pas un simple sentier battu menant sereinement aux confins du monde. Et si je l’ai pensé, c’est par stupidité ou candeur. » L’Ouest étant, dans la légende originelle, l’Inde. On reconnaîtra donc dans ce texte divers éléments du Bouddhisme qui figurent dans la légende, mais aussi des références à la poésie et la peinture traditionnelles chinoises taoïstes, si bien que l’on a parfois la sensation de traverser des tableaux.
Nous ressentons à travers ce conte très directement inspiré d’un grand classique chinois : la deuxième partie de la très populaire légende du Roi Singe, l’attrait qu’a exercé la culture ancienne chinoise sur l’auteur lors de son voyage en solo en Chine. Cette quête l’aura poussé vers l’Est, mais donc ici, comme dans la seconde partie de la légende du Roi Singe — le Voyage vers l’Occident —, c’est vers l’Ouest que le moine Sanzang est envoyé par l’Empereur, pour aller chercher au-delà de bien des montagnes et sur des chemins parfois dangereux, les sutras du Bouddha. « La route, jusqu’au Grand Bouddha de l’Ouest, ne sera pas un simple sentier battu menant sereinement aux confins du monde. Et si je l’ai pensé, c’est par stupidité ou candeur. » L’Ouest étant, dans la légende originelle, l’Inde. On reconnaîtra donc dans ce texte divers éléments du Bouddhisme qui figurent dans la légende, mais aussi des références à la poésie et la peinture traditionnelles chinoises taoïstes, si bien que l’on a parfois la sensation de traverser des tableaux.
Malgré ses références marquées, c’est un conte initiatique qui se veut intemporel — où le voyage extérieur est un reflet du cheminement intérieur du moine qui n’avait jusque là jamais quitté l’abri du monastère —, servi par une belle et sensible écriture à travers laquelle une authentique sagesse semble transparaître. On le lit avec plaisir et il exerce sur le lecteur une influence apaisante, comme la méditation et la poésie taoïste. Et c’est cet effet qui est le plus remarquable et qui prouve que ce très jeune auteur a su saisir l’essence de ces philosophies orientales et cela donne vraiment envie de savoir quel sera son prochain livre, en espérant qu’il saura s’appuyer après avoir cheminé comme disciple, sur sa propre intériorité, son propre imaginaire qui sans nul doute, ont beaucoup de richesses à offrir.
« Chaque homme se découvre dans les traces qu’il laisse sur la poussière du chemin, et il t’a fallut briser ta jeunesse en durcissant la plante de tes pieds pour trouver celui que tu es. »
Cathy Garcia
 Aodren Buart est né en 1996. Il a fait des études littéraires et cinématographiques avant de pratiquer le théâtre baroque. En 2016, il voyage seul en Chine durant un mois. Cette rencontre avec la culture et le territoire chinois nourrit alors profondément son regard et son écriture. De cela, entre autres, est né Le Singe sous la montagne qui est son premier roman.
Aodren Buart est né en 1996. Il a fait des études littéraires et cinématographiques avant de pratiquer le théâtre baroque. En 2016, il voyage seul en Chine durant un mois. Cette rencontre avec la culture et le territoire chinois nourrit alors profondément son regard et son écriture. De cela, entre autres, est né Le Singe sous la montagne qui est son premier roman.
12:08 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
24/05/2019
Des hommes en noir de Santiago Samboa
traduit de l’Espagnol (Colombie) par François Gaudry
Ed. Métailié, 18 avril 2019
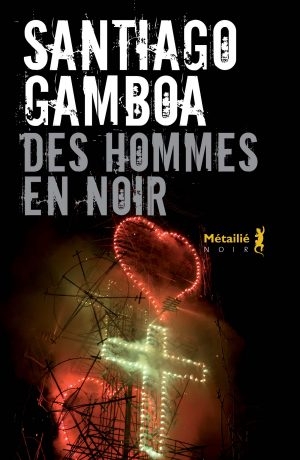
368 pages, 21 €.
La réalité est une forêt sauvage, ses yeux de serpent brillent dans l’obscurité avant qu’elle attaque sa proie. Mais le plus dangereux au monde est l’amour qui s’assèche. Celui qui n’a pas pu sortir du tronc de l’arbre, qui s’est enroulé sur lui-même et a mordu son propre cœur.
Voilà un polar à la fois subtil et énergique, une enquête captivante dans une Colombie qui soigne tant bien que mal ses blessures, menée par des personnages plutôt atypiques : Julieta Lezama, quarante ans, qui vit à Bogotá, « journaliste indépendante aguerrie » et reconnue, mère de deux ados, en cours de divorce, supporte mal son corps, libido cependant bien active, elle compense par du sexe alcoolisé. Son péché pas mignon justement : l’alcool, avec un goût prononcé pour le gin tonic en dose très déraisonnable. Et sinon elle se passionne pour « la mort violente que des êtres humains, un beau jour, décident d’infliger à d’autres, pour tous les motifs possibles. »
La journaliste pour son travail s’appuie sur l’aide de Joana Triviño, originaire des quartiers pauvres de Cali, secrétaire assistante multifonctions et entre autre « le maniement de tout types d’armes, des plus petites aux moins conventionnelles car elle a passé douze ans dans le bloc occidental des FARC ».
« Ce putain de pays où j’ai eu malheur de naître est une cour d’exécution, une salle de torture, une presse mécanique pour étriper paysans, Indiens, Métis et Noirs. C'est-à-dire les pauvres. Les riches, en revanche, sont des dieux parce que c’est comme ça. Ils héritent fortune et patronymes et se foutent complètement du pays, qu’ils méprisent. Mais qu’est-ce qu’il y a derrière tous ces noms élégants ? Un arrière-grand-père voleur, un arrière-grand-père assassin. Des pilleurs de ressources et de terres. »
Les FARC donc, cette partie de la population colombienne « séparée du pays pendant plus de cinquante ans et qui, aujourd’hui, avec le retour de la paix et l’accès au pouvoir de l’extrême droite, se trouvait dans une position fragile, sur la corde raide. »
« L’onde expansive de la guerre, aujourd’hui terminée, rejetait encore des cadavres sur le rivage. » Mais certains vivants disparaissent encore, les règlements de compte sont, semblent-il, loin d’être terminés.
C’est grâce à Joana que Julieta a trouvé son principal allié : Edilson Javier Jutsiñamuy, cinquante-neuf ans, procureur de la brigade des affaires criminelles, d’origine indienne — witoto nipode exactement — de la région d’Araracuara dans le Caquetá.
Le bureau de Jutsiñamuy se trouve à Bogotá et le procureur, qui préfère dormir là que dans son appartement, est bien placé pour connaître la sauvagerie de cette ville « indifférente et féroce, les cicatrices et les plaies de cette cité impitoyable, qui dévorait ses enfants les plus faibles. »
C’est ce dernier qui met Julieta sur la piste d’une affaire étrange : des témoignages auraient fait mention d’un combat violent à l’arme lourde avec plusieurs voitures et un hélicoptère près de Tierradentro, dans une région autrefois tenue par les FARC, avant que les témoins ne se rétractent et que toutes traces semblent avoir été effacées. Le dossier est classé comme un banal accrochage entre deux chauffeurs dont un complètement ivre.
Julieta et Joana se rendent donc sur place et ce sera le début d’une enquête qui les mènera — avec en parallèle celle du procureur et de ses propres assistants — vers un personnage énigmatique, charismatique mais inquiétant, peut-être bien l’homme en noir qui aurait réchappé au mystérieux affrontement : un pasteur d’une Église pentecôtiste, une de ces puissantes églises évangéliques qui envahissent l’Amérique latine. Et puis il y a la soudaine disparition de Franklin, un tout jeune adolescent du coin — élevé par ses grands-parents qui sont des indiens nasa — et qui, réfugié dans un arbre, aurait été un témoin direct de l’affrontement.
Cette enquête, qui mènera Julieta jusqu’en Guyane, nous tient bien agrippés au roman, on ne s’ennuie pas une seule seconde, un vrai régal : la personnalité des personnages est des plus attachantes, il y a de l’humour, de l’ironie, de l’aventure, la narration est fluide, mais surtout cette enquête permet aussi à l’auteur de dresser un portrait social de la Colombie d’aujourd‘hui et d’hier avec les fantômes qui n’ont pas fini de la hanter et de braquer un projecteur sur ces nouvelles formes de maffias qui prêchent la « bonne parole ». Ceci de façon spectaculaire, avec de véritables shows, dont l’emphase et le grotesque n’empêchent pas de captiver les foules de pauvres gens en leur distillant l’espoir qui scintille sous le feu des paillettes : drogue redoutable pour exploiter les plus fragiles de toutes les façons possibles.
Mais Des hommes en noir n’est pas non plus un polar manichéen, avec les gentils d’un côté et les méchants de l’autre, bien au contraire, c’est plus un polar psychologique et vraiment original qui nous fait pénétrer au plus profond des êtres, de leur histoire, de leurs failles, qui expose leur détresse et la façon dont ils luttent, au-delà de tout moralisme, pour en sortir.
« Et la pauvreté c’est très moche et très triste, et encore plus dans ce pays si injuste, si dur avec les pauvres. On rêve, on rêve pour rien. La pauvreté est une pierre tombale qu’on porte sur le dos et qui refroidit le soir. »
Cathy Garcia
Santiago Gamboa est une des voix les plus puissantes et originales de la littérature colombienne. Né en 1965, il étudie la littérature à l’université de Bogotá, la philologie hispanique à Madrid, et la littérature cubaine à La Sorbonne. Journaliste au service de langue espagnole de RFI, correspondant à Paris du quotidien colombien El Tiempo, il fait aussi de nombreux reportages à travers le monde pour des grands journaux latino-américains. Sur les conseils de García Márquez qui l’incite à écrire davantage, il devient diplomate au sein de la délégation colombienne à l’Unesco, puis consul à New Delhi. Il vit ensuite un temps à Rome. Après presque trente ans d’exil, en 2014, il revient en Colombie, à Cali, prend part au processus de paix entre les FARC et le gouvernement, et devient un redoutable chroniqueur pour El Espectador. Sa carrière internationale commence avec un polar implacable, Perdre est une question de méthode (1997), traduit dans de nombreux pays, mais sa vraie patrie reste le roman (Esteban le héros, Les Captifs du Lys blanc). Le Syndrome d’Ulysse (2007), qui raconte les tribulations d’un jeune Colombien à Paris, au milieu d’une foule d’exilés de toutes origines, connaît un grand succès critique et lui gagne un public nombreux de jeunes adultes.
Suivront, entre autres, Nécropolis 1209 (2010), Décaméron des temps modernes, violent, fiévreux, qui remporte le prix La Otra Orilla, et Prières nocturnes (2014), situé à Bangkok. Ses livres sont traduits dans 17 langues et connaissent un succès croissant, notamment en Italie, en Allemagne, aux États-Unis. Il a également publié plusieurs livres de voyage, un incroyable récit avec le chef de la Police nationale colombienne, responsable de l’arrestation des 7 chefs du cartel de Cali (Jaque mate), et, dernièrement, un essai politico-littéraire sur La Guerre et la Paix où il passe le processus de paix colombien au crible de la littérature mondiale. Parce que « le seul endroit où l’on puisse toujours revenir, c’est la littérature ».
00:20 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
15/05/2019
je m’enneige de Benoît Sourty
Asphalte éditions, janvier 2019

158 pages, 16 €.
Elle est plutôt sombre la neige, dans ce court roman où le sort de trois des protagonistes principaux semble scellé dès le départ. Deux frères jumeaux, âgés de 25 ans, une mère en clinique. Autrefois brillante et belle infirmière, maintenant malade en état végétatif, absente.
« Une femme, mains serrées l’une contre l’autre, ânonne presque à voix basse et sans arrêt : “Varsovie Varsovie”. »
C’est une maladie génétique et ses deux fils en ont hérité, ils finiront très probablement comme elles. L’un d’eux est le narrateur. Il vit encore avec son père alors que l’autre est parti à 20 ans. Chacun gère à sa façon cette dégénérescence programmée dans leur corps. Celui qui parle préfère ne pas y penser, oublie d’aller chez le neurologue pour faire des examens, porte des dreadlocks, fume des joints, beaucoup de joints, travaille un peu et quand il ne file pas un coup de main à son copain Marc qui vit de petits trafics, il prend la vie comme elle vient : entre potes à la terrasse du Grand Café, à boire des bières, puis chez l’un ou chez l’autre, parfois il couche avec une copine, parfois il passe des nuits dans la forêt et il va voir sa mère à la clinique. Il y a en lui comme un fond d’espoir auquel il s‘accroche. Sa façon de vivre au jour le jour, de se laisser porter sans se prendre la tête, mode de vie d’une génération en fait, prend chez lui l’allure d’une forme de philosophie. Il semble s’en sortir mieux que son frère qui est plus autonome mais qui a renoncé à tout espoir, qui ne veut plus parler au père, le prof qui continue à vivre sa vie, ne va pas visiter la mère, mais le lien avec son jumeau reste puissant même s’ils ne se voient plus que rarement. Tous deux ont gardé un brin de folie de leur enfance, une manie de se lancer des défis où la prise de risque est le challenge et ce mot que leur mère répète : « Varsovie Varsovie » va leur donner envie de faire quelque chose d’un peu fou pour elle.
Mais déjà le corps fait souffrir, ils le sentent dans leurs muscles. « Ça fait atrocement mal. C’est une crise. Je sais qu’elle va partir au bout de quelques minutes. Tenir juste quelques minutes, le temps de porter mon frère incapable de se hisser d’une marche à l’autre tout seul. ».
« Varsovie Varsovie ». Cette énigme contenue dans le seul et unique mot que prononce encore la mère, va initier une sorte de voyage dont la destination n’est pas celle que l’on croit.
Benoît Sourty nous donne à lire dans ce roman un portrait de famille écartelée, avec les souvenirs, les rêves, les colères, les non-dits, le fossé qui s’est creusé entre père et fils et comment chacun se dépatouille avec une réalité plombante. Quel sens peut avoir la vie quand on sait, avant même d’avoir commencé à vivre vraiment, qu’on est en train de se transformer, lentement mais sûrement, en légume ? Quel sens peut avoir la famille quand la mère bien que vivante, n’est elle-même qu’un souvenir ? Qu’est-ce que l’amour quand il ne peut rien changer ?
Pas de réponse : je m’enneige est un constat dépouillé, direct, désabusé, tragique, qui prend à la gorge et laisse un drôle de goût en bouche. Amer oui, mais avec toutefois un tout petit quelque chose qui crépite, qui pétille.
« La vache ! C’est quand même un beau jour pour mourir. »
Cathy Garcia
 Benoît Sourty est scénariste et réalisateur. Il dirige la pédagogie d’une école de cinéma. Je m’enneige est son troisième roman.
Benoît Sourty est scénariste et réalisateur. Il dirige la pédagogie d’une école de cinéma. Je m’enneige est son troisième roman.
20:04 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)



