31/07/2015
Mauvaise Grèce
Source : http://linsatiable.org/spip.php?article1169
(de notre envoyé spécial à Berlin)
28 juillet 2015, par
« Europe ou Nation ? » C’est le choix qui semble nous être posé de manière un peu plus aigüe chaque jour, assorti d’épithètes adaptés à l’opinion qu’on s’en fait. « Europe de la finance », « égoïsmes nationaux », c’est selon. Cette dichotomie devient plus floue dès lors qu’on vit dans un pays d’Europe qui n’est pas son pays de naissance. Peu importe au fond que cette émigration soit choisie ou subie, la question n’est en tous cas plus posée dans les mêmes termes.
Quelqu’un a inventé ce jeu / Terrible, cruel, captivant
La faiblesse des tout-puissants / Comme un légo avec du sang
La force décuplée des perdants / Comme un légo avec des dents
(Gérard Manset, Comme un légo)
Pour l’auteur de ces lignes, qui vit une « émigration choisie », cela soulève en ces temps troublés de multiples questions, dont celle-ci : à quelle condition (au-delà de l’acquisition de la nationalité) devient-on pleinement, intimement, citoyen d’un pays qu’on a choisi ? Il me semble aujourd’hui que ça tient à la capacité à critiquer son pays d’accueil, à dépasser le caractère affectif éventuellement lié à ce choix.
Critiquer, non de l’extérieur, du haut de l’extériorité de sa terre natale : critiquer de l’intérieur. La différence est importante, parce qu’alors on souffre soi-même de la critique qu’on formule au lieu d’en jouir. C’est vrai pour mes amis qui se sont expatriés en Grèce et doivent aujourd’hui formuler la critique d’un gouvernement qui a porté les espoirs les plus fous. C’est vrai aussi pour moi, qui ai choisi ce qui constitue, à mon corps défendant et à mon grand dam, l’envahisseur. Et même si l’on a coutume de dire que Berlin n’est pas l’Allemagne, je suis peut-être devenu, en ce 13 juillet, pleinement allemand, à travers la honte ressentie en lisant les nouvelles. On parlait d’un « accord » : j’ai beau être habitué à ce hiatus médiatico-politique désormais courant entre le sens classique des mots et l’utilisation qu’on en fait, mais tout de même. Entendre parler d’accord quand il s’agit de reprendre la politique d’austérité interrompue par l’arrivée de Syriza, m’a fait le même effet que si on m’avait parlé d’un modus vivendi entre un assassin et sa victime. J’ai pris sur moi cette honte de voir le pays que j’ai choisi être le maître d’œuvre d’une politique de destruction à l’échelle d’un continent ; la honte que m’inspire trop souvent mon pays natal m’a paru cette fois n’être qu’un écho lointain, sans importance réelle [1]. Cette honte, je l’ai partagée avec de nombreux amis allemands, révoltés eux aussi.
Bien sûr, à défaut de voir le combat de David contre Goliath se solder par la victoire du premier, on peut se réjouir que les masques soient tombés et qu’on puisse enfin appeler les choses par leur nom. Les assassins agissent maintenant à visage découvert, ce qui n’est pas confortable quand on a pris l’habitude d’habiller ses crimes d’un idéal européen permettant d’exiger l’assentiment des peuples sans autre explication [2]. Au vu des souffrances et injustices infligées, on pourrait considérer comme un détail le fait que les choses soient nommées : mais en considérant ce qui pourrait advenir dans les prochains mois, ça peut être un point fondamental.
Comme un légo mais sans mémoire
Parce que le projet de « sauvetage » de la Grèce - qui évoque d’emblée une curée étrangère sur les biens d’un pays -, est modélisé sur un précédent qu’on peut, avec le recul, considérer comme très fâcheux : celui de la Treuhand allemande. En effet, le projet secret Eureca [3], ne cache pas ses sources d’inspiration, ce qui prouve une fois de plus que dans le monde des puissant, on peut (doit ?) agir sans la moindre once d’autocritique et de perspective historique. Il semblerait même que la mémoire y soit considérée comme un défaut. Ce qui a manqué à l’époque de la Treuhand, c’est justement cette possibilité de nommer les choses, submergés que nous étions par la force du symbole de la chute, dont les effets psychotropes perdurent jusqu’à nos jours.
Si je me refuse à céder aux fantasmes de la germanophobie (l’éternelle référence au nazisme, l’envie génétique de dominer et j’en passe), je n’en suis pas moins forcé de reconnaître la place que prend le gouvernement allemand [4] dans la gestion des affaires européennes. La question de savoir si cette domination révèle plus une volonté néo-impériale de l’Allemagne que l’extrême-faiblesse (lâcheté ?) des autres partenaires est une question cruciale et complexe qui ne sera pas traitée ici. En revanche, la conscience du poids objectif de la position de l’Allemagne m’avait fait croire possible, il y a un moment déjà, de comprendre la position du gouvernement Merkel dans la gestion du dossier grec à travers le processus de réunification allemande. Ce qui n’était il y a quelques mois qu’une intuition est devenu, avec la révélation de l’existence de ce projet de « Treuhand à la grecque », une certitude ; que ce projet ait eu comme nom de code secret « Eureca » laisse rêveur (ou furieux, c’est selon). Je n’ai pas la prétention de décrire en détail les mécanismes complexes et tordus de la Treuhandanstalt [5] qui a présidé à la privatisation des biens de l’ex-Allemagne de l’Est… Mais j’essaierai d’en dire assez pour éclairer le lien systémique et surtout idéologique entre ce processus qui a acté « économiquement » la réunification politique de l’Allemagne et ce qui pourrait se passer en Grèce. Et l’on verra, puisqu’on a souvent parlé de « miracle allemand », que les « miracles » ont (presque) toujours une explication rationnelle. Et un prix.
La faiblesse des tout-puissants
Deux précisions sémantiques s’imposent d’abord. On parle souvent de « réunification » allemande (je l’ai fait à dessein). Ce terme, en réalité inexact, n’est quasiment pas employé en Allemagne [6]. Au-delà du résultat effectif (deux pays qui n’en forment qu’un à la fin du processus), une réunification aurait supposé, sur un principe de symétrie, une nouvelle constitution et une remise à plat du fonctionnement des institutions des deux pays ; un « accord », dirons-nous. Or dans les faits, la R.D.A. a adhéré à la loi fondamentale de la R.F.A. Et ça change tout. Car ça signifie que tout ce qui serait décidé par la suite concernant l’ancienne Allemagne de l’Est se ferait selon les critères de l’Ouest. Le processus qui donne naissance à la Treuhand est à ce titre révélatrice : le parlement est-allemand, quatre mois avant sa disparition, décide de la création de cette agence de droit ouest-allemand (donc de droit étranger au moment du vote). Ce point est tout sauf un détail : il acte dès le départ la priorité de l’économie sur le droit constitutionnel et consacre la défaite du peuple des deux Allemagnes. Or, que fait l’UE aujourd’hui, lorsqu’elle exige du parlement grec qu’il « vote » (ratifie en fait) les points de l’accord, en méprisant dans le même temps toutes les propositions et décisions contraires émanant du même parlement ?
En s’attardant un instant sur le terme de « Treuhand », on notera que si la traduction du dictionnaire est « agence fiduciaire », les deux parties de ce mot laissent rêveur. « Hand » a le double sens de « main » et « d’entreprise publique » (la main de l’État, donc) ; « Treu » signifie « Fidèle ». Intéressant, n’est-ce pas ? Toute la question est de savoir à qui on jure fidélité.
Dans le cas de l’Allemagne, on commence à avoir une idée.
Quelle est la mission exacte de cette Treuhand et de ses filiales [7] ? L’idée semble de bon sens (les pires forfaitures s’habillent toujours de bon sens et de morale) : vu l’état du tissu économique de la R.D.A., l’économie planifiée ne permettant pas la levée de capitaux pour moderniser l’appareil productif, on décide de « privatiser » les biens en question afin à la fois de financer la réunification et d’aligner l’Est sur l’Ouest en terme de valorisation et de compétitivité. On parle, comme pour la Grèce, d’éviter que les actifs ne soient bradés. Un détail condamne par avance l’entreprise : tout comme la Troïka, le fonctionnement de la Treuhand échappe au contrôle de l’État, ce qui est un peu regrettable quand il s’agit de négocier avec des intérêts privés, qui n’ont pas vocation à rechercher l’intérêt général. Comme l’a dit Werner Schulz [8], la mission de départ, faire passer la R.D.A. d’un système d’économie planifiée à l’économie de marché, s’est transformée en processus de désindustrialisation massive. Entre autres parce que l’industrie est-allemande, dotée d’une main d’œuvre qualifiée et de savoir-faire dans de nombreux domaines, représentait une concurrence réelle pour des entreprises de l’Ouest [9]. La logique, si l’on s’en tient aux objectifs énoncés, aurait été d’investir pour soutenir la modernisation de ces industries. Le contraire s’est produit : on a rendu ces structures non-rentables pour pouvoir les racheter à bas prix et, pour la plupart d’entre elles, les faire disparaître. Comment réussit-on un tel tour de passe-passe ? L’outil-maître a été (tiens, tiens…) la monnaie. L’alignement du DDR-Mark sur le Deutsch Mark ouest-allemand (alors que la valeur réelle était plutôt de 1 contre 6) a ruiné mécaniquement, d’un seul coup, la compétitivité des entreprises est-allemandes, en provoquant un renchérissement de près de 400%. Ce que le gouvernement Ouest-allemand a organisé avec l’aide de la Treuhand, c’est l’insolvabilité des entreprises est-allemandes… [10].
On arguera qu’en échange, la R.F.A. a évité l’écroulement de la R.D.A. Et que ça a couté très cher. Le coût de la réunification est d’ailleurs un argument souvent avancé pour tout justifier, et exiger en sus que les tondus disent merci : toute ressemblance avec la situation grecque… Cela dit, ce coût est réel si l’on regarde le déficit final de la Treuhand, qui était d’environ 250 milliards de Deutsche Marks (125 mds d’Euros). Mais le patrimoine de départ étant estimé à 600 Milliards de Marks, on peut légitimement se demander où est passé l’argent. En fait on le sait : 85% des entreprises (celles qui existent encore) et des biens immobiliers sont dans les mains des allemands de l’Ouest. Et peu importe l’ampleur de la criminalité financière liée à ces privatisations, aboutissant in fine à la dissolution de la Treuhand, seul le résultat compte : sur les 180 personnes poursuivies pour… 6 ont été condamnées (puis relaxées pour la plupart) ! La traduction dans les faits de cette politique « généreuse » de l’Ouest vers l’Est, c’est l’enrichissement de quelques-uns, majoritairement « étrangers » (de l’Ouest) aux dépends des 16 millions d’Allemands de l’Est.
Quand on regarde la situation économique, sociale et politique des « nouveaux Länder », on mesure la « réussite » de l’entreprise : le chômage y est presque partout endémique, et les mouvements néo-nazis [11] (venus de l’Ouest il faut le préciser) y prospèrent ; le récent mouvement Pegida [12] est là pour en témoigner. Le mépris de l’Ouest pour ces populations est réel, les régions les plus riches estimant avec un égoïsme amnésique qu’il est anormal de continuer à payer pour l’Est. C’est d’ailleurs pour cela que le FDP (libéraux) et la CDU (droite) dans une moindre mesure plaident régulièrement pour la remise à plat du Finanzausgleich (mécanisme de péréquation financière entre les régions).
Cet aveuglement idéologique au service d’une politique d’annexion économique, ces clichés culturalistes vis-à-vis de ces allemands de seconde zone, rappellent fortement la position de l’Allemagne et de l’Eurogroupe vis-à-vis de la Grèce. Cependant, comme le rappelait Gregor Gysi [13] à Angela Merkel et Wolfgang Schaüble dans une intervention récente au Bundestag il y a une différence de taille : à la différence de l’ex-R.D.A., la Grèce ne fait pas partie de l’Allemagne. Et quand il rappelle qu’il avait pronostiqué la montée en puissance des extrême-droites du fait de la peur de la pauvreté, c’est pour dire que c’est arrivé en Europe du Sud, en France et… en Allemagne !
La force décuplée des perdants
Quelles leçons tirer de ce précédent germano-germanique ? Peut-être en premier lieu relativiser l’idée du fantasme d’empire prêté aux « allemands », ou au moins la circonscrire à ceux qui tiennent l’économie de ce pays. Le peuple, quand bien même il soutiendrait (les sondages le prétendent) la position psycho-rigide de Wolfgang Schaüble, est la principale victime de cette politique, et pas seulement à l’Est. La preuve en est que la « réunification sociale » entre Est et Ouest s’est faite par le bas, avec l’introduction des lois Hartz par un gouvernement… social-démocrate ! Il semble clair au regard de l’histoire de la réunification allemande, que l’argent ne connaît aucune frontière, ni extérieure, ni intérieure. Il est important d’identifier la seule vraie frontière, celle qui est dressée entre la finance et les peuples. C’est sûrement ce qui donne à Wolfgang Schaüble, ministre de l’Intérieur du gouvernement Kohl au moment de la réunification, tant d’inspiration pour exporter le « modèle allemand » à l’étranger.
C’est pourquoi il est contre-productif, fût-ce sous l’effet de la colère, de répondre aux clichés essentialistes et culturalistes sur les Grecs par d’autres clichés : la réalité suffit à pointer du doigt l’iniquité de l’Eurogroupe, ainsi que l’ampleur des conflits d’intérêts.
À ce titre, il est intéressant, à un niveau presque psychanalytique, de noter que les principaux dirigeants européens énoncent, parlant des grecs, le péché par lequel ils ont eux-même fauté : Schaüble, l’homme des caisses noires de la CDU, parlant de mettre fin à la corruption ; Verhofstadt, l’homme qui double son salaire de député en émargeant aux conseils d’administration d’entreprises actives dans le lobbying européen, prétendant vouloir mettre fin au clientélisme ; et Juncker, inimitable, tançant les grecs sur la fiscalité. On rêve.
Je repense à cette affaire de « concurrence libre et non-faussée », terme inscrit dans le fonctionnement de l’Europe, qui pose problème dans son énoncé même : en apprenant que deux entreprises, Vinci (France) et Fraport (Allemagne), se disputent avant même qu’ils ne soient en vente les aéroports grecs les plus rentables pour un prix ridicule, j’ai compris ce que voulaient dire les technocrates qui ont accouché de ce concept. On voit bien qu’il ne s’agit pas de protéger l’exercice libre d’une activité, mais au contraire de garantir aux prédateurs que leurs démarches ne seront entravées ni par le droit ni par les gouvernements et encore moins par les peuples. On comprend mieux aussi l’apostrophe hystérique de Verhofstadt admonestant Tsipras en l’enjoignant de privatiser « même si c’est dur pour un gauchiste ». On comprend mieux enfin en quoi la Treuhand a pu constituer un exemple pour l’Europe [14]. Et on voit sous un autre angle la politique d’élargissement de l’UE.
Peut-on encore dans ces conditions croire à l’Europe ? Si l’on met de côté la monnaie et les institutions actuelles, donc (hélas) toute la matérialité actuelle de l’UE, que reste-t-il ? Croire encore à l’idée de l’Europe contre les nationalismes (quand l’UE actuelle renforce de fait ces nationalismes) suppose de faire table rase. Tout reste à inventer. À ce titre, soutenir la Grèce dans sa lutte contre les Thugs de l’Eurogroupe n’est pas seulement un acte de fraternité : c’est le destin de l’Europe des peuples qui se joue là.
Pierre-Jérôme Adjedj
[1] Peut-être parce que le trop grand cas fait par les commentateurs à « l’intervention » de François Hollande ne m’a arraché qu’un triste haussement d’épaule.
[2] Même la tromperie sur le traité de 2005 n’a pas eu autant de conséquence, parce que ses dommages, pourtant bien réels, restaient abstraits en frappant à la fois tout le monde et personne. Ici, le supplicié a une taille reconnaissable, l’échelle d’un peuple, et se divise en visages, en voix. On sait depuis l’extermination nazie que c’est ce qui passe le moins bien.
[3] Conçu par le cabinet allemand Roland Berger Strategy…
[4] la position dominante de l’Allemagne dessine d’ailleurs en creux l’immense lâcheté de la France et de son Président, dont la posture pseudo-conciliante peine à dissimuler les grossiers appétits économiques en jeu. Hollande / Merkel, une énième version du good cop / bad cop ? ça se décline pour l’Allemagne de façon gigogne, puisque sur le plan intérieur, Schaüble et Merkel font le même numéro.
[5] la commission d’enquête, les procédures judiciaires et plusieurs documentaires n’ont pas permis de circonscrire complètement ce scandale politico-financier.
[6] On parle le plus souvent de « Wende », c’est-à-dire « Tournant ». C’est plus juste au regard de la réalité que « Wiedervereinigung » (réunification) ou « Einheit » (Unité).
[7] TLG, celle chargée de l’immobilier a été revendue en 2012 par l’État allemand à un investisseur américain pour 1,1 mds d’Euros. À propos de TLG, cf. Article sur Teepee Land dans Cassandre/Horschamp N°101.
[8] Député européen Allemand (Verts), ancien membre de la commission d’enquête sur la Treuhand.
[9] voir pour une illustration, voir l’extrait de ce documentaire en deux parties (en allemand) : https://youtu.be/1YmxTojrls0?t=4m12s
[10] On parle là de 11 000 entreprises, pour ne parler que de l’appareil productif : on laisse de côté l’immobilier et le foncier, qui est un réservoir sans fond de scandales potentiels. Aujourd’hui, même ceux qui ont enquêté sur la Treuhand sont impuissants à mesurer l’ampleur de la spoliation.
[11] le Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) principalement, fondé en 1964, et qui a eu pour la première fois des représentants en Hesse et… en Bavière !
[12] Mouvement contre « l’islamisation de l’Occident » :https://fr.wikipedia.org/wiki/PEGIDA
[13] Chef du groupe parlementaire de die Linke
[14] à défaut d’un laboratoire parce que je ne pense pas que ça ait été pensé comme tel en amont.
- See more at: http://linsatiable.org/spip.php?article1169#sthash.0L8HVtT7.dpuf
13:37 Publié dans LE MONDE EN 2015 | Lien permanent | Commentaires (0)
Le violon pisse sur son powète d'Eric Dejaeger
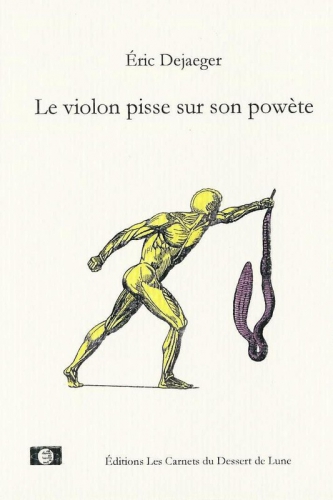
Un clin d'œil posthume à Pierre Autin-Grenier
une flopée d'aphorismes drôlement grinçants
spéciale dédicace à tous les powètes
qui se reconnaîtront même s'ils ne le veulent pas
Parmi les morceaux les plus tendres :
Ceci n'est pas un powème peut en être un pour le powète.
*
Le powète continue à écrire pour se convaincre qu'il restera incompris
*
le poète rêve sans arrêt. De Gallimard en particulier.
*
Pleine lune ! Les powètes vont surpowéter !
*
Quand le powète donne une lecture publique, les cinq personnes présentes sont priées d'applaudir (à tout casser si possible).
ça vous a ouvert l'appétit ?
rendez-vous aux éditions Les Carnets du Dessert de Lune
http://dessert-de-lune.123website.be/354029100/product/13...
Collection Pousse-Café
Couverture Le poète écorché
collage d'André Stas
20 pages
6 euros
11:11 Publié dans CG - NOTES DE LECTURES POÉSIE | Lien permanent | Commentaires (1)
27/07/2015
J’écoule mes pensées
Lorsqu’on l’appelle
Entre ses cuisses froides
S’ouvre un oursin
Profond et noir
Qui luit
Et nous regarde
(…)
Et par les cercles
Limpides
De l’orage
Sourdant du fond des silex
J’écoule mes pensées
Anna Maria Celli in Prémonitoires
Lieu du larcin : Traction Brabant n°61, février 2015
19:21 Publié dans LES MOTS DÉROBÉS DU JOUR | Lien permanent | Commentaires (0)
Tomates sans eau ni pesticide : cette méthode fascine les biologistes
Les méthodes de Pascal Poot, loin de l’agriculture moderne, sont aussi hyperproductives que naturelles et peu coûteuses. Des scientifiques pensent y trouver des réponses au changement climatique.
Ici, le terrain est si caillouteux et le climat si aride que les chênes vieux de 50 ans sont plus petits que les hommes.
Pourtant, à l’entrée de la ferme de Pascal Poot, sur les hauteurs de Lodève (Hérault), trône une vieille pancarte en carton : « Conservatoire de la tomate ».
Pourtant, chaque été, les tomates Poire jaune et autres Noires de Crimée poussent ici dans une abondance folle.
Sans arrosage malgré la sécheresse, sans tuteur, sans entretien et bien sûr sans pesticide ni engrais, ses milliers de plants produisent jusqu’à 25 kg de tomates chacun.
Son secret ? Il tient dans les graines, que Pascal Poot sème devant moi, avec des gestes qui mêlent patience et nonchalance.

C’est le début de la fin de l’hiver dans la région, le temps est venu pour lui de confier ses graines à la terre. Ce sont ses premiers semis de l’année.
L’homme a 52 ans mais semble sans âge. Ce fils d’agriculteurs, qui a quitté l’école à 7 ans, se dit « complétement autodidacte ». Il a élevé des brebis et cultivé des châtaignes avant de se spécialiser dans les semences. Il dissémine aujourd’hui ses graines sur du terreau, dans des jardinières fatiguées.
Puis il place ses jardinières sur un énorme tas de fumier en décomposition, dont la température atteindra bientôt 70 degrés pendant plusieurs jours, chauffant la serre et permettant la germination des graines.
La technique, appelée couche chaude, est très ancienne. C’est elle qui permettait aux maraîchers parisiens du XIXe siècle de récolter des melons en pleine ville dès la fin du printemps. C’est elle qui permet à Pascal Poot de faire germer chaque année des milliers de plants de tomates, aubergines, poivrons... Avant de les planter sur son terrain et de ne plus s’en occuper jusqu’à la récolte.
Tout en semant ces graines, Pascal me révèle les détails de sa méthode :
« La plupart des plantes qu’on appelle aujourd’hui “mauvaises herbes” étaient des plantes que l’on mangeait au Moyen-Age, comme l’amarante ou le chiendent... Je me suis toujours dit que si elles sont si résistantes aujourd’hui c’est justement parce que personne ne s’en est occupé depuis des générations et des générations.
Tout le monde essaye de cultiver les légumes en les protégeant le plus possible, moi au contraire j’essaye de les encourager à se défendre eux-mêmes. J’ai commencé à planter des tomates sur ce terrain plein de cailloux il y a une vingtaine d’années, à l’époque il n’y avait pas une goutte d’eau.
Tout le monde pense que si on fait ça toutes les plantes meurent mais ce n’est pas vrai. En fait, presque tous les plants survivent. Par contre on obtient de toutes petites tomates, ridicules. Il faut récolter les graines du fruit et les semer l’année suivante. Là on commence à voir de vraies tomates, on peut en avoir 1 ou 2 k par plant.
Et si on attend encore un an ou deux, alors là c’est formidable. Au début on m’a pris pour un fou mais au bout d’un moment, les voisins ont vu que j’avais plus de tomates qu’eux, et jamais de mildiou, en plus, alors les gens ont commencé à parler et des chercheurs sont venus me voir. »
Parmi ces chercheurs, on compte Bob Brac de la Perrière, biologiste et généticien des plantes et coordinateur de l’association environnementale Bede :
« A la fin des années 90, au moment du combat contre les OGM, on s’est dit qu’il fallait aussi travailler sur les alternatives, et on a commencé à faire l’inventaire des agriculteurs qui faisaient leurs propres semences. On a dû en trouver entre 100 et 150 en France.
Mais le cas de Pascal Poot était unique. Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il a une grande indépendance d’esprit, il suit ses propres règles et à ma connaissance personne ne fait comme lui. Il sélectionne ses semences dans un contexte de difficulté et de stress pour la plante, ce qui les rend extrêmement tolérantes, améliore leur qualité gustative et fait qu’elles sont plus concentrées en nutriment.
En plus de ça il cultive plusieurs centaines de variétés différentes, peu d’agriculteurs ont une connaissance aussi vaste de l’espèce qu’ils cultivent. »
Les chercheurs commencent seulement à comprendre les mécanismes biologiques qui expliquent le succès de la méthode de Pascal Poot, assure Véronique Chable, spécialiste du sujet à l’INRA-Sad de Rennes et qui a mené des recherche sur les sélections de Pascal Poot depuis 2004 :
« Son principe de base, c’est de mettre la plante dans les conditions dans lesquelles on a envie qu’elle pousse. On l’a oublié, mais ça a longtemps fait partie du bon sens paysan.
Aujourd’hui, on appelle cela l’hérédité des caractères acquis, en clair il y a une transmission du stress et des caractères positifs des plantes sur plusieurs générations.
Il faut comprendre que l’ADN est un support d’information très plastique, il n’y a pas que la mutation génétique qui entraîne les changements, il y a aussi l’adaptation, avec par exemple des gènes qui sont éteints mais qui peuvent se réveiller.
La plante fait ses graines après avoir vécu son cycle, donc elle conserve certains aspects acquis. Pascal Poot exploite ça extrêmement bien, ses plantes ne sont pas très différentes des autres au niveau génétique mais elles ont une capacité d’adaptation impressionnante ».
Cette capacité d’adaptation a une valeur commerciale. Pendant ma visite, plusieurs personnes ont appelé Pascal pour commander des semences. L’agriculteur vend ses graines à plusieurs semenciers bio, dont Germinance.
Kevin Sperandio, artisan semencier chez Germinance, nous explique :
« Le fait que les semences de Pascal Poot soient adaptées à un terroir difficile fait qu’elles ont une capacité d’adaptation énorme, pour toutes les régions et les climats.
Nous n’avons pas les moyens de faire ce genre de tests mais je suis sûr que si on faisait un test entre une variété hybride, celle de Pascal Poot et une semence bio classique ce serait celles du conservatoire de la tomate qui obtiendraient les meilleurs résultats. »
Une partie de ces graines sont vendues dans l’illégalité, parce qu’elles ne sont pas inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés végétales du GNIS (Groupement national interprofessionnel des semences et plants). Cela énerve beaucoup Pascal Poot, jusque là très calme :
« L’une de mes meilleures variétés, c’est la Gregori Altaï. Mais elle n’est pas inscrite au catalogue, peut-être parce qu’elle n’est pas assez régulière pour eux. Beaucoup de variétés sont comme ça. A l’automne dernier, le semencier Graines del Païs a eu un contrôle de la répression des fraudes qui a établi près de 90 infractions dans leur catalogue.
Le principe c’est qu’on ne nous autorise à vendre que les graines qui donnent des fruits qui sont tous pareils et qui donnent les mêmes résultats à chaque endroit. Pour moi, c’est le contraire du vivant, qui repose sur l’adaptation permanente. Cela revient à produire des clones mais on veut en plus que ces clones soient des zombies. »
Interrogé au sujet de ces contrôles, un délégué du GNIS expliquait en mars 2014 :
« Notre objectif est d’apporter une protection à l’utilisateur et au consommateur. Le secteur français des semences est très performant, mais il a besoin d’une organisation qui a fait ses preuves et d’un système de certification. »
Sauf que l’uniformisation des fruits et des semences se fait souvent au détriment du goût et des qualités nutritives. Et pourrait, à l’avenir, nuire aux agriculteurs, estime Véronique Chable :
« Le travail de sélection des semences montre qu’on peut pousser le végétal vers des conditions impressionnantes. Mais l’agriculture moderne a perdu ça de vue, elle ne repose pas du tout sur la capacité d’adaptation.
Or dans un contexte de changement rapide du climat et de l’environnement c’est quelque chose dont le monde agricole va avoir besoin. Il va falloir préserver non seulement les semences mais aussi les savoir-faire des agriculteurs, les deux vont ensemble. »
Pour partager ce savoir-faire, j’ai demandé à Pascal de m’expliquer comment il sélectionne et récolte ses semences. Voici ses conseils :
- « Il faut prendre le fruit le plus tard possible, si possible juste avant les premières gelées comme ça il aura vécu non seulement à la sécheresse de l’été mais aussi aux pluies de l’automne. »
- « Les tomates, c’est tout à fait spécial. Quand on ouvre une tomate, les graines sont dans une sorte de gélatine, comme un blanc d’œuf. Cette gélatine empêche les graines de germer à l’intérieur du fruit, qui est chaud et humide. Les graines ne germent pas avant que cette gélatine ait pourri et fermenté. »
- « Il faut donc faire fermenter les graines. Pour ça il faut ouvrir la tomate, extraire les graines et les laisser plusieurs heures dans leur jus, par exemple dans un saladier. Il va se produire une fermentation lactique. »
- « Il faut surveiller la fermentation comme le lait sur le feu, ça peut durer entre 6 et 24 heures mais contrairement à ce qu’on dit, il ne faut pas attendre qu’une pellicule de moisissure apparaisse. On prend une graine on la pose sur la main, si on peut la déplacer avec l’index sans que la gélatine ne vienne avec la graine, c’est que c’est bon. »
- « Ensuite on passe le tout dans une passoire à thé, on lave à l’eau et on met à sécher. Là on arrive à un taux de germination entre 98% et 100%. »
- « Le poivron c’est différent, il faut juste laver les graines, les faire sécher sur un tamis très fin et les stocker. Pour le piment c’est la même chose mais ça devient dangereux parce que les graines brûlent, c’est très fort, ça passe même à travers les gants. Une fois j’ai récolté les graines d’un cageot de piments d’Espelette sans gant, j’ai dû passer la nuit avec les mains dans l’eau glacée ! »

Pascal Poot dans sa serre, à Lodève le 26 février 2015 (Thibaut Schepman)
http://rue89.nouvelobs.com/2015/03/09/tomates-sans-eau-ni...
16:07 Publié dans ALTERNATIVES | Lien permanent | Commentaires (0)
asinus in fabula de Guido Furci
Cardère, avril 2015
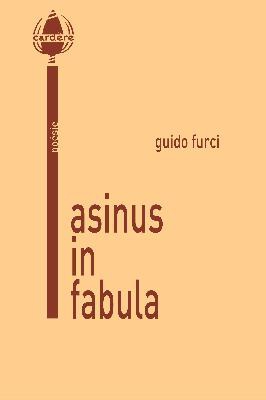
61 pages,12 €
Comme une comptine à tue-tête, un refrain qui s’entête, asinus in fabula, c’est bizarre, c’est étrange et ça remue en dedans, ça nous embarque, nous entraîne comme un manège un peu fou, une comptine un peu noire, un peu effrayante même, « comme les coiffures des années 80 », comme le joueur de flûte de Hamelin qui viendrait chercher les mots pour aller les perdre quelque part, loin, là où ils ne pourraient plus dire le « cauchemar cauchemardesque », parce qu’ici les mots tricotent un texte de douleur et il faut absolument le détricoter. Au beau milieu des mots, un âne s’envole pour la lune, car il a les oreilles en forme d’hélice, vrillées c’est sûr, à force d’écouter la ritournelle qui s’emballe, tricote, détricote, et à la fin, les mots se répètent mais c’est raturé, barré, terminé, annulé. Asinus in fabula c’est dans la tête, un manège dans la tête qui rend un peu fou, un peu cruel et absurde, comme la mort quand elle prend un enfant de trois ans, un enfant comme Nicolas qui avait une maladie rare, Nicolas le cousin de Marion, moi je ne l’ai pas dit, c’est dans le livre et ça n’y est pas, c’est comme ça qu’on peut parler de ce qui ne tient pas dans les mots, alors on les jette en l’air, on les bat, on les mélange, on les rebat
Avant que la nuit tombe
Avant de tomber par terre
asinus in fabula c’est drôle parfois car le rire c’est du désespoir barré, c’est de l’enfance, de la poésie, de la poésie dans un livre, mais peut-être pas, peut-être que « c’est juste un courant d’air », qui s’échappe par une portée de silence.
Cathy Garcia
 Guido Furci (1984) a fait ses études à l’université de Sienne et à l’université de Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. Il a également été élève de la sélection internationale à l’École normale supérieure de Paris (section Lettres et Sciences Humaines) et visiting scholar au département de littérature française de l’université de Genève. Actuellement boursier de la FMS (Fondation pour la Mémoire de la Shoah), il poursuit son travail de thèse entre la France et les États-Unis. A déjà publié : Figures de l’exil, géographies du double. Notes sur Agota Kristof et Stephen Vizinczey (par Marion Duvernois et Guido Furci) – Giulio Perrone Editore, Rome, 2012 ; Fin(s) du monde (textes rassemblés par Claire Cornillon, Nadja Djuric, Guido Furci, Louiza Kadari et Pierre Leroux, Centre d’études et de recherches comparatistes, université Sorbonne nouvelle Paris 3) – Pendragon, Bologne, 2013.
Guido Furci (1984) a fait ses études à l’université de Sienne et à l’université de Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. Il a également été élève de la sélection internationale à l’École normale supérieure de Paris (section Lettres et Sciences Humaines) et visiting scholar au département de littérature française de l’université de Genève. Actuellement boursier de la FMS (Fondation pour la Mémoire de la Shoah), il poursuit son travail de thèse entre la France et les États-Unis. A déjà publié : Figures de l’exil, géographies du double. Notes sur Agota Kristof et Stephen Vizinczey (par Marion Duvernois et Guido Furci) – Giulio Perrone Editore, Rome, 2012 ; Fin(s) du monde (textes rassemblés par Claire Cornillon, Nadja Djuric, Guido Furci, Louiza Kadari et Pierre Leroux, Centre d’études et de recherches comparatistes, université Sorbonne nouvelle Paris 3) – Pendragon, Bologne, 2013.
Pour se procurer asinus in fabula : http://www.cardere.fr/ficheLivre.php?idLivre=252
12:47 Publié dans CG - NOTES DE LECTURES POÉSIE | Lien permanent | Commentaires (0)
25/07/2015
Chers agriculteurs en colère, de quoi vous étonnez-vous ?
Je ne suis inscrit dans aucun parti ni syndicat, je ne suis pas un électeur bobo-écolo EELV, je ne travaille pas dans le secteur agricole ; je suis travailleur social. Rien à voir. Je suis un Mayennais qui a emménagé en Bretagne, dans le Coglais voisin.
Depuis plusieurs semaines, je lis dans les journaux locaux que des actions quasi simultanées sont organisées par les éleveurs devant des grandes surfaces de villes que je connais bien, comme Laval ou Fougères. Je tenais à vous dire que vos actions ne suscitent absolument pas l’empathie d’un citoyen comme moi.
Je m’explique. Je viens vous parler du fond et non de la forme.
C’est souvent la forme de vos actions qu’on vous reproche. Pas moi. La violence – même si elle est uniquement matérielle dans votre cas – règle rarement les problèmes. Elle prend le risque de susciter plutôt de la réaction du côté des forces de l’ordre au sens large (police, gendarmerie, préfecture...). Et à la fin, en général, ceux qui gagnent, ce ne sont jamais ceux qui sont en face des boucliers et des matraques.
Cependant, si la violence ne se justifie pas dans un contexte quelconque, elle peut toujours s’expliquer. Or, dans votre cas, je ne vois pas où est l’explication.
L’incohérence de vos positions
C’est donc sur le fond que je porte ma critique de vos positions. Vous vous êtes installés en acceptant de jouer le jeu de la soi-disant « modernité » qui vous fait raser vos haies et vos talus, acheter d’immenses engins à crédit ou encore investir, toujours à grands coups de crédits et de subventions, dans des salles de traite high-tech. Vous avez accepté de jouer ce jeu orchestré par une Union européenne ultralibérale et des banques qui s’enrichissent sur votre travail et sur vos réveils réglés à 4h30 du matin.
Aujourd’hui, vous vous plaignez des prix auxquels la grande distribution et ses intermédiaires vous achètent vos produits. Tout ça pour quoi ? Je suis désolé de le dire – et blesser n’est pas mon intention : pour produire des denrées de mauvaise qualité, impropres pour notre santé et mises en circulation dans un système qui encourage le gâchis en quantité industrielle. Quelle est votre cohérence de vouloir jouer ce jeu tout en critiquant le fait d’être pris pour les dindons de la farce libérale ? C’était écrit sur la boîte ! Pourquoi faire aujourd’hui les étonnés ?

Manifestation d’agriculteurs devant centre commercial près de Rennes, le 2 juillet 2015 (DAMIEN MEYER/AFP)
Dans ce qui m’apparaît comme de l’incohérence, combien des membres de votre syndicat sont allés faire leurs courses chez Carrefour, Leclerc, U, Netto, Liddl ou Leader Price le week-end dernier ?
Dans le Coglais, je connais deux adresses de paysans. Ils le sont encore. Ils ne sont pas encore devenus ces « exploitants » qui ne se contentent que « d’exploiter » la terre et les bêtes au lieu de la cultiver et de les élever. Ils produisent pour les uns légumes et œufs, pour les autres volailles. Une troisième adresse existe dans un village limitrophe du canton pour les volailles. Ces deux premières adresses font de la vente directe.
Ainsi peuvent-ils, eux, critiquer la PAC, l’Union européenne et la grande distribution. Ainsi sont-ils, eux, cohérents lorsqu’ils le font. Ainsi seraient-ils, eux, légitimes pour manifester leur colère face à ce que l’on nous vend dans les supermarchés.
Vivre de l’agriculture hors de ce système
Je suis petit-fils d’ouvriers agricoles devenus métayers au milieu du siècle dernier. Je suis Mayennais jusqu’aux os et j’ai fait le choix, après dix années passées en centre-ville de Rennes, de retrouver la campagne qui m’a vu grandir heureux. Je crois être attaché à la terre et à ces valeurs qui ont animé mes grands-parents. Or, la terre, ce sont eux qui me l’ont dit, elle produit simplement et naturellement, avec la force de nos bras – aidée de nos outils motorisés, ne soyons pas rétrogrades. Pas besoin de produits chimiques. D’ailleurs, les rendements sont meilleurs sur les petites exploitations qui diversifient leurs cultures.
Aujourd’hui, il est tout à fait possible de vivre de l’agriculture hors de ce quatuor infernal : chimie-UE-banques-gâchis. Cela existe déjà, d’ailleurs – vente directe avec ou sans Amap (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne). Aussi, celui qui décide volontairement d’entrer dans ce jeu, accepte d’être le dindon. Ou bien a-t-il toujours le choix de tourner le dos au productivisme et de partir faire une autre agriculture. Saine. Pour lui, psychologiquement, et pour nous, les consommateurs.
Vous qui devez aimer profondément l’agriculture, que faites-vous encore dans ce système ? Vous remarquerez qu’à aucun moment, je ne vous ai parlé de labels, de bio, d’écologie politique. Je ne mets pas non plus de majuscule quand je parle de la terre. Je parle de la matière et de rien d’autre. Je vous parle de bon sens, souvent qualifié à raison de « paysan » et de santé.
Par ces actions, vous vous isolez. Ayez également conscience que ce système vous fait passer pour des fainéants que vous n’êtes pas, et qui se contenteraient de grogner, salir et casser tout en profitant des subventions européennes. C’est bien sûr plus compliqué que cela. N’empêche qu’à la source de tout problème, il y a un choix individuel qui nous y a menés. Il est temps de le voir.
Source : http://rue89.nouvelobs.com/2015/07/10/chers-agriculteurs-...
20:11 Publié dans RÉSONANCES | Lien permanent | Commentaires (0)
Gilles LADES se livre sur Radio Occitania
« Le chemin est sans indulgence pour qui s’en détourne », avertissait Edmond Jabès. Gilles Lades ne s’est jamais détourné du chemin. Il chemine toujours, parfois dans des « Chemins contremonts ». Il nous ouvre la route et nous invite à le suivre pour contempler toutes choses comme elles sont, c’est-à-dire, infinies. Sa vision du monde qu’il nous livre au terme d’étincelants recueils, pourrait s’inscrire dans ces trois vers de Gary Snyder :
Ni paradis, ni chute
Seule la terre qui perdure
Le ciel toujours en mouvement.
Une assertion de René Char plaisait beaucoup à Gaston Puel : « Les peintres sont les témoins, nous les poètes, nous sommes les acteurs ». En écrivant cela, je prends conscience de ce que Gaston Puel manque. Et je me console avec le jugement de Michel Del Castillo : « Ceux qui manquent ne meurent point. Ils occupent ce vide qui nous hante et auquel nous nous heurtons ».
Gilles Lades est un acteur du monde. Ses livres sont des actes qui mettent le feu aux fusées éclairantes qui nous font deviner le monde dans une beauté inattendue et pourtant familière qu’il nous révèle. Ce poète d’une noble pudeur se livre dans l’émission du jeudi 16 juillet 2015 que je vous invite à écouter en cliquant sur :
http://les-poetes.fr/emmission/emmission.html
Le compte-rendu de l’émission:
*
Cette émission complète les émissions déjà consacrées à Gilles Lades. Dans les premières émissions, il a été donné essentiellement lecture des poèmes de cet auteur qui éclaire la poésie d’expression française depuis près de 40 ans et qui, à l’apogée de son art, poursuit son œuvre, la prolonge avec l’humilité - devant la force de la parole ainsi créée - des plus grands artistes de notre temps. L’homme est discret, s’efface et laisse généralement tout l’espace à ses textes.
Dans cette émission centrée sur l’entretien avec Christian Saint-Paul, fait rare, il se livre. Le poète se laisse approcher, s’explique sans détours sur les arcanes de sa création littéraire, dominée par la poésie. Gilles Lades est aussi un critique de talent qui saisit avec justesse le sens des textes et dispense cette clarté sur les livres et les poètes dont il parle.
Ce qui lui est demandé ce jeudi soir de juillet, c’est d’être à la fois l’objet et le sujet ; même s’il est plus facile de parler des autres que de soi, Gilles Lades réussit étonnamment l’exercice, avec toujours cette humilité naturelle au sens le plus noble du terme.
Nous apprenons qu’il a écrit au sortir de l’adolescence. Émergeant de « ces profondeurs difficiles », il vécut une sorte de crise d’identité. Il s’aperçut que l’écriture pouvait l’aider à se retrouver lui-même. Son premier réflexe fut de se réfugier dans la poésie classique. Puis la lecture des poètes contemporains l’orienta vers la modernité. L’aventure intérieure solitaire était en route. Très vite, elle prend une autre dimension.
Etudiant en Lettres, il comprend qu’il fait de la littérature. L’écriture est alors un enjeu bien au-delà de l’apprivoisement des tourments adolescents. Il va falloir dire le monde. Et évaluer cette parole. Il lance alors des messages. Il adresse des textes à Jean Malrieu qui lui répond : « vos poèmes sont bons ». Il voit Joseph Deltheil qui lui prodigue ce conseil : « il faut vous assurer que vous êtes plein de vous-même ». La formule fera mouche. Gilles Lades n’écrira que lorsqu’il sera assuré « d’être plein de lui-même ».
C’est alors que durant ces premières années de professorat, loin de son Sud-ouest chéri et immergé dans l’apprentissage d’un métier accapareur, il observa un silence initiatique. Six ou sept ans. Puis l’écriture revint. On se forge à travers le doute, constata-t-il. Ce doute, qui est donc une force, lui fait aussi connaître « des moments de désert ». La lecture de René-Guy Cadou lui a donné l’élan pour trouver sa propre harmonie.
Les recueils vont alors se succéder. Ils naissent d’une « liasse écrite pendant un ou deux ans ». Le livre « Le pays scellé » rend compte d’un temps et d’un espace un peu bloqué. Pour « Le chemin contremont », tous les poèmes venaient se magnétiser sur cette idée de montée. « Lente lumière » est le constat de ne pouvoir faire émerger la lumière que difficilement. Pour chaque livre, explique le poète, je suis animé d’une idée forte.
Cependant, l’auteur n’est jamais dans la certitude. Inguérissable maladie bienfaisante du doute. A chaque livre, il faut tout reprendre à zéro. Recommencer en innovant sans cesse.
Dans sa posture de poète, Gilles Lades se juge « désintéressé ». Le seul enjeu est l’aboutissement d’une écriture, la mieux réussie possible. « Je ne crois pas être doué pour le bonheur, avoue-t-il, vivre c’est magnifique pourvu qu’on ait un peu de liberté ».
C’est un grand lecteur de poésie. Il signe des critiques pour des revues, notamment pour « Friches ». Il aime relire Verlaine, Cadou, des ciseleurs comme Reverdy. Il a éprouvé un peu de crainte face au surréalisme, mais André Breton est un très grand poète. Il lit beaucoup les poètes étrangers, considérant que tous les grands auteurs sont à découvrir au fil de leurs œuvres.
A partir d’un certain moment, son écriture s’est resserrée. La poésie est l’art de la quintessence. Le choix des mots le hante assez. « Est-ce le mot juste ? » Pour s’en assurer, il faut ressentir un brusque décalage. Le mot doit être inattendu. C’est la pratique du discernement.
Pour Gilles Lades, la poésie n’est ni inutile ni gratuite. Elle est au commencement de l’homme. Dans la pratique de la poésie, on ne peut qu’être en prise avec le destin.
L’entretien est entrecoupé de lecture de poèmes.
Inédits de Gilles Lades :
Le bleu d'hiver
adouci de grands bois
questionne qui seras-tu
qu'as-tu perdu de toi ?
pourrais-tu demeurer
seul dans le cercle des jours
face aux pierres dressées
le chiffre des années
les versants d'ombre
sondant vers l'absolu silence ?
qui t'aurait forcé d'être
différent face aux mêmes collines
de t'assombrir comme renié
par le dévoilement de l'aube ?
que deviendraient les mots
une première fois tramés sur le métier
puis laissés libres à courir jusqu'au bord du vide
délaissés du souffle ?
*
Page nouvelle
pour le vers ou la ligne
continue ronde
emmeneuse de mots de mémoire
de villes de rumeurs
de front fermé sur l'impossible
page
qui m'attend
que j'espère
au début de moi-même
de barrières levées sur la piste blanchie
par l'arrivée soudaine d'un pépiement de fleurs
par le souffle écrivant le long des rameaux du jasmin
*
19:58 Publié dans COPINAGE | Lien permanent | Commentaires (0)
Forte de son autonomie alimentaire, la Crète résiste à la Troïka
et si le régime crétois était bon pas seulement pour la santé ?
22 juillet 2015 / Emmanuel Daniel (Reporterre)

Toute la Grèce est en train de sombrer sous les coups de boutoir de la Troïka. Toute ? Non ! La Crète, la plus grande des îles, résiste aux puissances de la finance et a voté non à plus de 70 % lors du dernier référendum. Leur autonomie alimentaire permet aux Crétois de s’indigner sans en craindre les conséquences. Quoi qu’il arrive, ils auront toujours de quoi manger.
- Crète, Grèce, reportage
Dans l’avion qui m’amenait en Crète, la plus grande île grecque, je tentais d’imaginer ce que j’allais y trouver. Je m’attendais à tomber sur un pays à genoux, une population aux abois, des queues interminables devant les distributeurs, de la misère à chaque coin de rue. Mais les seules files d’attente que j’ai pu observer sur place étaient celles des touristes à l’aéroport, et aux stations de bus et dans les magasins.
C’est comme si la crise grecque qui fait les gros titres des médias français avait épargné les Crétois. « La Crète est l’île la plus riche de Grèce, ici, il y a beaucoup moins de chômage qu’en métropole. On n’a pas trop à se plaindre. On a le tourisme l’été et l’agriculture l’hiver. C’est dur c’est vrai mais ça l’est encore plus dans le reste du pays », m’explique un chauffeur de taxi.
La Crète tire une bonne partie de ses ressources du tourisme, pourtant, l’idée d’une nouvelle hausse de la TVA (qui est passée de 13 à 23 % ce lundi, notamment pour la restauration) ne semble pas inquiéter outre mesure Vassilis, restaurateur à Heraklion, plus grande ville de l’île. « Ça fera augmenter les prix de quelques centimes, ça ne me fait pas plaisir mais bon, ce n’est pas la fin du monde », m’explique le commerçant qui n’a accepté de me répondre qu’à condition que je lui commande une bière.
Un peu plus bas sur le port, un pêcheur au visage buriné tente de dissimuler son amertume derrière d’énormes lunettes de soleil. Près de son étal quasiment vide, il s’ennuie ferme et fume cigarette sur cigarette. Il accueille ma question sur la nouvelle vague d’austérité avec un haussement d’épaules. « Mon problème c’est le vent force 8 Beaufort, qui m’empêche de travailler », m’explique-t-il. Comme lui, depuis deux jours, les petits pêcheurs sont bloqués au port et privés de revenus.
Dans le centre-ville envahi par les touristes, le tenancier d’une épicerie aux rayons clairsemés m’accueille avec un sourire dénué de tout signe de préoccupation. Il admet néanmoins que la fermeture des banques n’est pas bonne pour le commerce et se réjouit de les voir rouvrir lundi. Lui n’a même pas de compte bancaire. « Je n’aime pas les banques, je ne leur fais pas confiance », explique-t-il. Comme un nombre conséquent de Grecs, il fait plus confiance à ses bas de laine qu’à son banquier pour veiller sur ses euros. Et la situation de ces derniers jours ne risque pas de le faire changer d’avis.

« Mon père a une retraite de 300 € pour lui et mon petit frère »
La plupart de mes interlocuteurs refusent d’évoquer la difficulté de la situation, comme si en parler revenait à la rendre réelle. Mais même si les Crétois s’en sortent mieux que le reste de leurs compatriotes, ils ne sont pas à envier pour autant. Un couple de restaurateurs de Rethymnos, cité balnéaire au nord de l’île, qui souhaite rester anonyme, me déclare non sans gêne qu’ils vont être obligés de frauder la TVA pour s’en sortir.
Yorgos, qui tient lui aussi un « restaurant familial » non loin de là, ne décolère pas depuis qu’il a appris cette nouvelle hausse. « On ne peut pas se permettre de répercuter les prix sur les clients sinon on les ferait fuir. Papandreou, Samaras, Tsipras, ça fait cinq ans que l’on nous impose des sacrifices pour que l’économie redémarre mais on voit bien que ça ne marche pas et ce sont toujours les mêmes qui trinquent. Moi je m’en sors car je suis propriétaire mais beaucoup de mes confrères vont avoir du mal à payer le loyer cet hiver quand les touristes seront partis. »

Visiblement affecté par l’image véhiculée dans les médias sur le peuple grec, il se sent obligé de se justifier sans que je lui demande quoi que ce soit. « On nous dit que nous sommes des mauvais européens. Mais on n’est pas des fainéants, on travaille sept jours sur sept, enfin pour ceux qui ont la chance de trouver du travail. » Pour lui, c’est « une guerre économique où la dette a remplacé les canons. Ils veulent détruire notre pays et nous empêcher de nous relever. »
Pour illustrer les conséquences de l’austérité, il prend l’exemple de sa famille. « Mon père a une retraite de 300 € pour lui et mon petit frère qui n’a pas de travail. » Mais il se reprend vite et, comme s’il s’en voulait de s’être laissé aller, relativise sa situation en pensant aux habitants d’Athènes, où « il n’y a plus de liens familiaux aussi forts qu’ici qui permettent aux gens de survivre grâce à la solidarité ».
« Nous n’avons peur de rien »
Si les Crétois accueillent avec une passivité relative les mesures qui font hurler les Athéniens, c’est que leur économie ne repose pas que sur le tourisme. L’agriculture les aide à tenir le coup. Une femme aux grands yeux curieux me dresse une liste à la Prévert de ce que le pays produit : « Lait, miel, huile, céréales, citron, oranges, moutons, légumes en tous genres, chèvres, poissons, et bien sûr l’huile d’olive. Il y a même des bananes à l’Est de l’île. »
En effet, la Crète est l’une des rares îles grecques qui pourrait s’en sortir sans le tourisme. En plus de créer une manne d’emplois conséquente pendant l’hiver, ce secteur permet aux insulaires de se nourrir sans dépenser d’argent. Yorgos, le restaurateur mécontent, m’explique qu’il a quelques chèvres et un potager qui l’aident à tenir, notamment hors saison, quand les touristes et leurs euros ne sont plus là.
C’est donc là que réside le secret de la sérénité des Crétois. « Nous sommes autonomes. Tout le monde ici sait faire pousser des légumes. Nous n’avons peur de rien. Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici pour vivre. C’est pour ça qu’on n’a pas peur de la Troika », m’assure une vendeuse de produits locaux située dans la vieille-ville d’Heraklion.
Propagande pro-Oui
Comme elle, 70 % des Crétois ont dit non lors du référendum. Pour cette femme à la parole facile, l’autonomie de l’île n’est pas étrangère au refus net affiché lors du référendum. Beaucoup de mes interlocuteurs s’indignent quand je leur demande ce qu’ils ont voté : « OXI, évidemment ». Seule Aristea, conseillère municipale à Heraklion m’a avoué avoir voté Oui. « Je suis très heureuse que Tsipras ait réussi à trouver un accord. Une sortie de l’euro aurait été catastrophique pour le pays. Je ne veux pas d’un retour à la drachme. Je crois qu’on peut changer l’Europe. Je crois en la collaboration entre les peuples. »
Un argument que l’on entend aussi chez certains partisans du Non. « Pour beaucoup de grecs, l’euro c’était l’entrée dans la modernité. On n’était enfin plus considérés comme un pays des Balkans. Sortir de l’euro, c’est revenir en arrière, c’est perçu comme une régression », m’explique Dimitri. Et pour cet ancien publicitaire devenu activiste, cette croyance ne vient pas de nulle part. « Donne moi le contrôle des médias et je te dirai quoi penser », glisse-il en dénonçant la propagande pro-euro dans les médias depuis des années et celle encore plus frappante en faveur du Oui qui a eu lieu la semaine qui a précédé le referendum.
Aglae, une jeune femme impliquée dans les mouvements alternatifs « refuse de céder au chantage. On nous a fait croire que sortir de l’euro c’était la mort assurée, moi je vois que c’est en restant dans l’euro que l’on meurt », argue-t-elle en citant les conséquences sanitaires effroyables de l’austérité.
Yannis, membre d’un restaurant coopératif lui aussi souhaiterait un retour à la drachme. « Le seul effet positif de cet accord c’est qu’il a fait réfléchir les gens. Maintenant, on ne nous prend plus pour des fous quand on dit qu’on veut sortir de l’euro. Pour moi, c’est la seule possibilité pour mettre en place une autre politique : nationalisation des banques, annulation de la dette, économie alternative basée sur la coopération... », développe ce militant anti-fasciste.

Avancer dans l’incertitude
Pour Christine, une trentenaire en perpétuelle recherche de petits boulots, le refus de l’accord n’a rien à voir avec une quelconque rationalité économique mais trouve sa source dans la culture, la géographie et l’histoire de l’île. Elle prend son petit déjeuner dans une cuisine dont une des fenêtres donne directement sur la mer agitée. C’est avec poésie qu’elle analyse le OXI crétois au référendum, un non à l’humiliation et au colonialisme financier.
« La nature sauvage a forgé notre caractère. Les montagnes, la chaleur, le vent font qu’on ne se laisse pas faire, dit-elle en accueillant avec bienveillance les puissantes rafales qui s’engouffrent par la fenêtre. On a aussi une culture de la résistance. Nous avons subi de nombreuses attaques tout au long de notre histoire : les pirates, les Ottomans, les Byzantins, et même les nazis pendant la seconde guerre mondiale. Maintenant c’est la Troïka. Nous avons connu bien pire et on ne se laissera pas faire par quelques crapules en costume. »
Sans nier la propension à la résistance de ses compatriotes, Vassilis, jeune ingénieur au chômage, met en avant un paradoxe : « Nous sommes un peuple plutôt aisé mais je crois que nous aimons l’idée de révolution. » Et il précise que si les Crétois ont voté massivement pour le non, ils ont dans un passé proche fait des choix contraires : « Quand la mode était au Pasok, il ont voté Pasok [parti social démocrate], quand les conservateurs étaient au pouvoir, ils ont aussi voté pour eux. On suit le sens du vent ! »
Si la plupart des personnes rencontrées dénoncent unanimement les technocrates de la Troïka qui mènent « une guerre économique où la dette a remplacé les fusils », selon Yorgos, ils sont plus mesurés en ce qui concerne Tsipras et son gouvernement qui bénéficient d’une surprenante indulgence. « Il a été courageux, il n’aurait pas pu faire mieux », m’a-t-on souvent dit en expliquant qu’il devait résoudre une équation impossible : stopper l’austérité sans quitter la zone euro. Yannis au contraire est très remonté contre le premier ministre : « C’était le seul qui aurait pu faire passer ce nouveau plan d’austérité sans déclencher d’émeute grâce à sa côte de popularité. C’est un véritable traître. »

- Yannis et ses amis en discussion
Avec une trentaine d’amis activistes, il se réunissait ce dimanche dans un café pour tenter de réfléchir à une « alternative à l’austérité, par en bas sans les partis politiques », mais qui s’appuierait sur les nombreuses initiatives de solidarité qui ont émergé avec la crise. Leur but, faire barrage à Aube Dorée qui va tenter d’emprunter l’autoroute de déception et de colère créée par Syriza.
Mais quelles que soient leurs opinions politiques, ils sont tous d’accord pour dire que le chemin vers des jours meilleurs sera long et semé d’embûches. Yorgos, attablé dans son restaurant à l’ombre d’un parasol, n’a lui aucune idée de la marche à suivre pour sortir de l’impasse actuelle, mais il ne désespère pas pour autant. « On survit. Pour l’instant la situation est confuse. Je pense qu’on va s’en sortir mais je ne sais pas trop comment. »
Source et photos : Emmanuel Daniel pour Reporterre
11:07 Publié dans LE MONDE EN 2015 | Lien permanent | Commentaires (0)
Des paysans bretons s’en sortent bien… en changeant l’agriculture
" Dans "paysan", on entend habitant du pays, artisan du paysage, une ferme c'est du solide, mais dans "exploitation agricole", qu'entendez-vous ? cg"
7 mars 2015 / Marie Astier (Reporterre)

Plutôt que de casser des poternes d’écotaxe, les Bretons feraient mieux d’interroger le système productiviste qui les a conduit à l’impasse et à la crise. En Loire-Atlantique, des paysans ont choisi d’en sortir - et ils s’en sortent bien !
![]() Fercé (Loire-Atlantique), reportage
Fercé (Loire-Atlantique), reportage
"Mes parents sont arrivés ici en 1966, j’avais dix ans", commence Patrick Baron. "On avait cinquante hectares et trente vaches." Il montre une vieille bâtisse de pierres : "Au début, on habitait là. Le pré arrivait au pied de la maison et il y avait une mare, comme dans toutes les fermes de l’époque. Les bêtes venaient boire dedans."
Désormais, la petite maison de pierres est cernée de grands hangars de tôle et de parpaings. L’étable s’est agrandie. Patrick Baron (photo du chapô) a repris l’exploitation de son père. Il a 70 vaches, 120 truies et 100 hectares. Au fond, deux grands bâtiments gris abritent les porcs : c’est l’associé de Patrick qui s’en occupe.
A 57 ans, patrick est toujours resté fidèle à son village : Fercé (Loire-Atlantique), situé à cinquante kilomètres de Rennes. « Ce qu’on a vécu ici, la Bretagne a connu la même chose. » Il se souvient des débuts de ses parents dans les années 1960 : « C’était le tout début de la politique agricole commune. On a vu arriver le maïs, les phytosanitaires, le suivi technique... » A l’époque, ces nouvelles techniques paraissent faire des miracles : « Dès qu’on mettait un peu d’engrais sur des terres qui n’en avaient jamais reçu, l’effet était immédiat. Les rendements augmentaient ».
« Comme tout le monde, on a suivi », raconte-t-il. « Chaque année, on augmentait le nombre de vaches. Puis on a changé de race. Avant dans la région on était sur des races traditionnelles : des Normandes ou des Maine-Anjou. Tout ça a été remplacé par des Prim’Holstein. » Une vache d’Europe du Nord, réputée pour être « la Formule 1 de la production laitière ». « Le fonctionnement est simple, précise-t-il. Vous lui donnez à manger du maïs, vous lui mettez des compléments alimentaires avec les tourteaux de soja qui arrivaient des Etats-Unis et du Brésil à bon marché par les ports, et ça produit du lait en quantité. »

Puis Patrick se rembrunit. « C’est là qu’on a commencé à travailler pour les autres. La banque qui nous prête pour acheter du matériel, les concessionnaires agricoles qui nous vendent la mécanisation, les marchands d’aliments… Et pour nous, il reste les miettes. »
Son exploitation était en système intensif : "Les animaux sont nourris 365 jours par an sur le stock, à base du maïs qu’on cultive." Puis il s’est rendu compte que ce système n’était pas économiquement viable. "Les animaux restaient en bâtiment. On utilisait le tracteur pour leur amener l’aliment, pour ressortir leurs déjections, pour cultiver le maïs..." A trop utiliser le tracteur, on finit par trop dépenser en carburant.
Patrick a donc décidé de rendre son exploitation "économe", même s’il reste en système intensif. "Il faut limiter les dépenses, donc tous les achats extérieurs : carburant et aliments, notamment le soja importé", précise-t-il. Première mesure, il a remis les vaches au pré : "Elles vont chercher leur nourriture toutes seules et leurs déjections vont directement dans le champ !". A midi, elles rentrent spontanément à l’étable pour le déjeuner.
Deuxième mesure, il faut que le nombre de bêtes soit adapté à la surface de l’exploitation. Il faut avoir assez de champs pour épandre les déjections, mais aussi pour produire l’alimentation du bétail. "Ici, on est arrivés à un équilibre", se satisfait Patrick.
Mais il y a encore mieux, selon lui. Il propose d’aller chez un collègue passé en agriculture biologique, à quelques kilomètres de là. La petite route fait des lacets dans un paysage valonné. Une prairie ici, quelques vaches par là, un champ de maïs un peu plus loin... Patrick Baron arrête la voiture au sommet d’une colline : "Regardez comme c’est beau !" Puis il repart, désigne un hameau le long de la route : "Ici, avant, il y avait cinq fermes. Maintenant il n’y en a plus qu’une".
Représentant de la Confédération paysanne dans son département, il a toujours suivi de près les élections agricoles : « En 1983 en Loire-Atlantique, il y avait 33.000 chefs d’exploitation électeurs inscrits à la chambre d’agriculture. En 2013 il n’y en avait plus que 8.500. » Son village de Fercé aussi a été touché : l’INSEE décomptait 35 exploitations agricoles professionnelles en 1988. Il n’y en avait plus que 21 en 2000.
En revanche, leur taille n’a cessé d’augmenter. Patrick reconnaît avoir participé au mouvement : « On s’est agrandi, passant de cinquante à cent hectares, en profitant des départs en retraite de trois exploitants. Ils travaillaient en couple donc on a fait disparaître six emplois ! ». Autour de Fercé, les exploitation s’agrandissent, les paysans disparaissent. "Il n’y a plus d’emploi, les gens partent, c’est catastrophique pour la vie des communes", regrette Patrick.

Pourtant aujourd’hui, son exploitation est considérée comme plutôt petite : "Quand la nouvelle génération s’installe elle multiplie par trois l’outil de départ : on passe de 50 vaches à 150, de 150 truies à 1 000." Sauf que l’augmentation de la taille des exploitations ne suffit plus à palier les disparitions : "Pourquoi GAD ferme son abattoir à votre avis ? Mais parce que la production n’est plus là ! La baisse du nombre d’agriculteurs entraîne une baisse des volumes."
Patrick gare la voiture à Rougé, chez Jean-Michel Duclos. Celui-ci élève cinquante vaches en bio. Sur ses cent hectares, quatre-vingt douze sont des prairies. Ses animaux y pâturent neuf mois sur douze. En comparaison, Patrick n’a que trente hectares de prairies.
En ce moment de crise, Jean-Michel est fier de montrer son dernier investissement, un immense séchoir à foin pour stocker sa récolte en prévision de l’hiver : "Cela améliore la qualité du fourrage".
Son exploitation est encore plus économe que celle de Patrick : "On a un coût de mécanisation très bas et très peu d’intrants. On n’achète pas de fertilisants, pas de semences, juste quelques céréales pour nourrir les bêtes à un autre producteur."

Jean-Michel Duclos -
Le point commun entre Patrick et Jean-Michel, c’est qu’ils ont dit non au "Produire plus". "C’est très difficile d’y échapper, ils nous le répètent tout le temps !" Mais qui "ils" ? "Les coopératives surtout, répond Patrick. Elles sont en compétition. Elles ont investi dans des outils de transformation comme les abattoirs. Cela coûte cher. Pour rentabiliser il faut faire du volume."
Jean-Michel désigne un papier qu’il vient de recevoir de la coopérative agricole Terelevage. "Regardez, ils proposaient déjà un bâtiment d’élevage qui s’appelle le ’Palace’. Maintenant c’est le ’Grand Palace’, pour mettre encore plus de bêtes !" Le document promet "un gain de temps de 35 %" et de "réduire les coûts de 40%".
Patrick renchérit : "Et cette coopérative possède un abattoir qu’elle est obligée de fermer un jour par semaine, parce qu’elle ne reçoit pas assez de volume ! Ca leur coûte très cher. C’est pour cela qu’elle essaye de convaincre les agriculteurs de produire plus."
Sur la table, Jean-Michel montre aussi le dernier numéro de L’Avenir Agricole. Parmi les titres de Une : "Lait : produire plus, mais comment ?" L’agriculteur s’en amuse : "Et pourtant, je suis abonné à ce journal parce qu’il est indépendant des syndicats !"
Sur le chemin du retour à Fercé, Patrick admet qu’il pense depuis longtemps à cesser l’intensif. "Mais une exploitation, c’est un paquebot, c’est difficile de changer de cap. On des emprunts, un système de production, du matériel à amortir..." Et puis dans moins de deux ans, Patrick prend sa retraite. Mais il a su transmettre l’envie à son fils, Antoine. "Les choses ont toujours été claires, je veux être paysan", affirme ce dernier.
Indépendant de l’économie du pétrole
Avec le fils de l’associé de Patrick et leurs épouses, ils vont reprendre la ferme et la passer en bio. Les vaches produiront un peu moins de lait. Ils vont réduire drastiquement le nombre de porcs, de cent vingt à une vingtaine, pour vendre la viande en circuit court.
Et rester dans l’idée d’avoir une exploitation "économe". "On veut limiter tous nos achats extérieurs, explique Antoine. Les engrais, les phytosanitaires, le carburant... On veut au maximum être indépendants de l’économie du pétrole." Pour un passage en douceur, ils viennent s’installer sur la ferme en avril pour travailler avec leurs pères pendant un an. Puis Patrick et sa femme Marie quitteront la ferme : "Les enfants récupèrent la maison de l’exploitation, nous irons prendre notre retraite ailleurs."
Source et photos : Marie Astier pour Reporterre.
Première mise en ligne le 4 novembre 2013.
10:59 Publié dans ALTERNATIVES | Lien permanent | Commentaires (0)
En Grèce, des jeunes inventent leur mode de vie
10 février 2014 / Juliette Kempf (Reporterre)

Vivre de terre et de légèreté. C’est ce qu’ont voulu Nikos Kontonikas et Yiannis Papatheodorou. Tous deux nés dans des villes, ils ont choisi de tout quitter pour s’installer sur un terrain inhabité et cultiver la terre. Un projet qui s’est construit bien avant la crise et qui s’écarte fondamentalement de la société qui a amené celle-ci.
![]() Vlachia (Grèce), reportage
Vlachia (Grèce), reportage
Nikos Kontonikas et Yiannis Papatheodorou ont chacun grandi et vécu dans des villes, mais n’ont jamais vraiment aimé cela ni pensé qu’ils y resteraient.
En août 2012, pour 20 000 euros, les deux amis achètent ensemble un hectare de terre qui n’a jamais connu d’occupation humaine. Il se situe en Grèce centrale dans le département d’Eubée, immense île séparée du continent par le détroit de l’Euripe, que l’on traverse grâce au pont routier de Chalcis. Le massif forestier dans lequel est nichée leur nouvelle vie plonge dans la mer Egée.

Pour y accéder, nous avons roulé trois heures depuis Athènes. Nous avons laissé Pili derrière nous, village de mille âmes aux nombreuses petites tavernes, puis Vlachia, qui compte une centaine d’habitants, pour grimper jusqu’à l’entrée du terrain de leur ami Andréas, où nous laissons la voiture.
Andréas vit ici depuis plusieurs années, désormais bien installé : deux maisonnettes en paille, une cuisine extérieure en argile, un potager qui les nourrit, lui et sa famille. À partir de là, nous avons marché pendant une vingtaine de minutes sur d’étroits chemins de terre, alternant entre l’ombre des arbres et la puissante lumière estivale de l’après-midi, entourés par une nature aux verts époustouflants. Nous sommes au mois de juillet. À chaque pas l’odeur de sève et des herbes sauvages nous emplit davantage, et fait oublier la ville d’où nous sommes venus.
Nikos a 28 ans. Il me raconte comment il a arrêté d’étudier l’économie pour se consacrer à la recherche d’un mode de vie qui ferait sens pour lui. « Les perspectives que laissaient deviner ces années d’études m’inquiétaient vraiment. » Yiannis a 38 ans et travaillait comme ingénieur dans le bâtiment industriel, cultivant depuis longtemps le désir de s’installer à la campagne et d’y vivre en accord avec son éthique et son environnement. Natalia sa compagne, 28 ans, les a rejoints après avoir fini ses études d’architecture en Angleterre.
Pendant un an, les garçons ont vécu chez Andréas pour préparer leur terrain, qui est composé de parcelles de terre cultivable et de forêt, sur 10 000 mètres carrés de terrasses naturelles suivant le dénivelé de la montagne. Depuis le mois de mai, ils campent chez eux, protégés par les pins, et travaillent toute la journée pour faire émerger de la terre leur projet de vie commun.
Elle est creusée en plusieurs endroits, prête à recevoir les fondations de deux « chambres » de paille qui feront chacune vingt mètres carrés, à demi sur pilotis afin de créer des espaces de rangement. Ces constructions temporaires jetteront les bases du futur. Entre elles, il y aura une cuisine commune de trente mètres carrés, extérieure mais couverte. Un peu plus loin au détour d’un chemin, l’emplacement des toilettes sèches est déjà déterminé, abrité d’un côté, de l’autre s’ouvrant sur un panorama exceptionnel. Une douche de pierres, dont l’eau est réchauffée par le soleil, est joliment enclavée entre quelques arbres. Perchée à plusieurs mètres de hauteur dans un arbre légèrement isolé, une plateforme de méditation.

Natalia travaille essentiellement au plan des maisons. Les plantes, elle n’y connaît rien. Ce sont Nikos et Yiannis qui s’occupent de ce qu’ils ont planté : un petit verger de citronniers, d’orangers et de mandariniers, et un potager pour les légumes de saison. « Comment nous avons appris ? Grâce aux travaux que nous avons déjà faits, aux personnes que nous avons connues, et par des livres. Mais avant tout par la pratique. »
Ils vont bientôt prendre le statut d’agriculteurs pour des raisons administratives. Pour le moment, l’objectif est d’atteindre une production suffisante pour leur consommation personnelle, puis ils espèrent pouvoir en vendre une partie dans quelques années. Pour gagner un peu d’argent, ils envisagent aussi de faire de l’écotourisme à bas coût, ainsi que de construire des maisons en matériaux naturels, paille ou argile, chez d’autres particuliers. Nikos aimerait développer au maximum le troc avec leur voisinage proche.
Ils démarrent une expérience de culture sans eau, suivant une technique qui est utilisée tout autour de la Méditerranée. L’eau, ils auraient pu l’obtenir par le réseau du village, mais en très petite quantité. Alors ils ont choisi de se raccorder à une source naturelle, à deux kilomètres de là. Officiellement, ils auraient dû demander un permis légal. « On a préféré demander leur accord aux gens du coin, et ils nous l’ont donné. » Le flux qu’il tire est constant mais très faible, et ne déséquilibre pas le rythme naturel de la source. Un panneau solaire leur fournit de l’électricité. Ils envisagent d’en installer davantage, notamment pour pouvoir brancher un petit réfrigérateur à la saison chaude. « Mais rien de gros. Rien qui devrait excéder les véritables besoins. »
On ne cherche pas ici à éteindre et à faire redémarrer la société, mais à choisir consciemment dans ce qu’elle offre. Filtrer le règne de la quantité. Il leur serait notamment utile d’avoir une connexion à Internet, qui aujourd’hui ne vient pas jusqu’à eux. Le fait de « tout créer à partir de zéro » n’était pas forcément attendu dans le projet initial. Ils auraient aussi bien pu restaurer une vieille bâtisse abandonnée. Mais c’est le terrain ici qui les a choisis. Par contre, l’éloignement de la route pour automobiles est un véritable choix.
« Si tu en as une, il est facile de désirer des choses que tu peux apporter. Si tu n’en as pas, tu n’apportes que le nécessaire. »
Cela concerne les choses, mais pas les personnes. Les visiteurs sont toujours les bienvenus, et ils sont nombreux. Au fond de lui, Yiannis aimerait que ce lieu puisse devenir un exemple, un espace pédagogique pour tous ceux qui veulent changer leur mode de vie, mais ne savent pas comment faire. En ce sens leur projet, plutôt que politique, peut avoir un impact sociétal. Bien sûr il aimerait que davantage de monde fasse un choix similaire, mais ça reste rare.
« Et la crise, ou quoi que ce soit, comme Yiannis appelle le phénomène qu’il considère avec distance et une bonne dose d’ironie, ne change pas grand chose à cela. » Selon lui les villages de Grèce ne sont pas reconquis, ainsi que le laisse entendre une jolie rumeur qui court jusqu’à nos contrées occidentales, mais réhabités provisoirement par des jeunes en souffrance économique. « La plupart d’entre eux reviendront quand les choses seront redevenues normales, d’après ce que le système dominant prône comme étant normal. C’est la même histoire qui se répète. Il ne faut pas attendre que le mouvement se généralise. »
Elle est étrange, cette solution. Remettre les pieds sur la terre
Le projet de Nikos et de Yiannis dépend assez peu de la crise d’un système auquel ils ne croyaient déjà pas. Ils ne l’ont pas construit en réaction à elle, mais bien en amont. L’avantage qu’ils retirent de la situation politique du pays est qu’elle aide leurs proches à accepter leur choix. « Nos familles ne nous considèrent plus comme des fous, mais peut-être comme ceux qui ont trouvé une solution. » Elle est étrange, cette solution. Remettre les pieds sur la terre.
Ce soir nous savourons sa fraîcheur et son calme, à la terre, après l’intense chaleur qu’elle nous a offerte aujourd’hui. Nous partageons l’une de ces immenses pastèques qui se vendent 29 centimes d’euro le kilo sur le bord de toutes les routes du pays en cette période de l’année. Au chœur infatigable des dzidziki - les petits insectes qui chantent dzidzi dans les forêts grecques -, Yiannis répond par quelques délicieuses mélodies de bouzouka, le luth traditionnel.
 - Yiannis Papatheodorou -
- Yiannis Papatheodorou -
« Qu’est-ce qu’il vous manque, d’ ’en bas ’ ?
- Pas grand-chose. Les douches chaudes, et les chauffeurs de taxi !
- Est-ce que vous êtes plus libres depuis que vous êtes ici ? »
Ils rient.
« Je ne sais pas, mais plus fatigués, malaka ! »
Il use avec joie de ce terme - malaka - inséparable des Grecs, qui ponctue leurs états d’âme de toutes les sortes.
« Plus libres… ? On était déjà légers de toute façon », sourit Yiannis en jetant un coup d’œil au sac à dos de son ami, gentiment vide et pendu à un arbre, 90 Litres Lafuma.
De retour à Athènes, la rencontre de différentes jeunes personnes laisse penser que les choix et l’aventure de Yiannis, Nikos et Natalia ont plus d’écho qu’ils ne semblent le croire. Giulia, notamment, m’explique que pour le moment la « crise » ne l’a pas atteinte dans sa vie professionnelle et personnelle. « Mais je crois que j’attends que cela arrive, pour devoir enfin prendre une décision qui me taraude depuis un moment, quitter la ville, la surconsommation et embrasser un mode de vie plus sensé… »
Source et photos et dessin : Juliette Kempf pour Reporterre.
Première mise en ligne le 23 septembre 2013.
Contact : Stagones (en grec).
10:57 Publié dans ALTERNATIVES | Lien permanent | Commentaires (0)
Piller la Grèce
Source : http://iris-recherche.qc.ca/blogue/piller-la-grece
Par Julien MercilleL’accord du 12 juillet entre la Grèce et les autorités européennes confine le pays à un statut néo-colonial, c’est-à-dire, à devenir un protectorat de la troïka (Commission Européenne, Banque Centrale Européenne, Fonds Monétaire International).
L’accord demande au gouvernement grec d’annuler tous les projets progressistes légiférés par Syriza depuis son arrivée au pouvoir il y a 6 mois; de recevoir l’approbation de la troïka avant de décider de nouvelles lois; d’adopter des mesures d’austérité automatiques en acceptant des “coupures de dépenses gouvernementales quasi-automatiques” au cas où les objectifs de surplus budgétaires ne seraient pas atteints; d’accélérer la saisie et la liquidation de commerces et de résidences qui ne peuvent pas payer leurs dettes; et d’affaiblir, ou même éliminer, les normes du travail protégeant les recours collectifs par des employés.
Mais la clause peut-être la plus humiliante est celle qui force la Grèce à privatiser la somme effarante de €50 milliards de biens publics. Ceux-ci seront vendus à des investisseurs privés, dont plusieurs seront des étrangers.
Les fonds ainsi récoltés seront utilisés pour rembourser la dette du gouvernement et recapitaliser les banques, ainsi que pour de l’investissement en Grèce, bien qu’il pourrait ne pas rester tant d’argent pour ce dernier objectif.
L’accord a été décrit comme étant « une vente de garage désespérée de tout ce que peut trouver la Grèce. » Un conseiller du gouvernement grec l’a ainsi résumé : « Il s’agit en fait de vendre la mémoire de nos ancêtres, de vendre notre histoire. »
En particulier, l’accord mentionne explicitement que l’opérateur du réseau de transmission électrique (ADMIE) se doit d’être privatisé, et sera probablement acheté par des intérêts étrangers.
Le fonds qui gèrera le processus de privatisation se trouvera en Grèce, mais en pratique sera contrôlé par la troïka.
Ce n’est pas la première fois que les autorités européennes tentent de conclure un pareil accord. En 2011, Athènes avait aussi entrepris, avec la troïka, de privatiser de nombreux biens publics d’une valeur totale de €50 milliards, mais cette cible n’avait pas été atteinte, alors que seulement €3.2 milliards de biens avaient été privatisés. Il est donc peu probable que la somme soit atteinte cette fois-ci, mais elle demeure toutefois révélatrice des intentions de la troïka.
Il demeure aussi peu probable que des trésors archéologiques comme l’Acropolis soient soumis à une vente, étant donné la fureur que cela soulèverait auprès de la population. Cependant, deux politiciens allemands ont récemment suggéré que même ce genre de biens devrait faire partie de la vente de feu, donc on ne sait jamais. Des ruines moins importantes, par contre, pourraient bien être vendues.
Pour comprendre à quel point l’accord révèle l’agressivité de la troïka, il convient d’examiner ce qu’il contient exactement. Un bon endroit à cet égard est le site internet de l’agence établie en 2011 pour superviser le processus de privatisation de €50 milliards précédent. Elle s’appelle la Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF, Fonds de développement des biens de la République hellénique) et son site fascinant [http://www.hradf.com/en] liste tout ce que la Grèce doit vendre, avec photos, cartes géographiques et descriptions.
Il s’agit d’un réel marché aux puces, où l’on peut trouver monuments, plages ensablées, aéroports, ports, services postaux, services publics, et plus. Et le site est en anglais : après tout, les investisseurs étrangers se doivent de savoir ce qu’ils s’apprêtent à acheter.
Voici un échantillon. Les prix ne sont pas indiqués, mais j’inclus une brève description des biens tirée du site officiel.
1. Plages
La propriété a le potentiel d’être développée en un vaste projet intégrant tourisme, loisirs, et résidences près d’un terrain de golf au cœur d’une destination de vacances établie, à Rhodes.

2. Châteaux
Castello Bibelli est une propriété possédant une importante valeur historique et culturelle. Le bâtiment principal “CASTELLO” de 1.968 m2, de style néo-gothique, est fait de pierre, avec toits en tuiles, et ses deux tours et son balcon sont des caractéristiques remarquées. La propriété comprend aussi quatre édifices auxiliaires, couvrant une surface de 457 m2. Construite au début du siècle par l’amiral italien Bibelli, sur un flanc de colline boisé, sur 77 acres.

3. Sources thermales
La Grèce est dotée de sources thermales minérales et d’eaux géothermiques naturelles qui font partie de la richesse nationale. Leurs propriétés thérapeutiques sont reconnues depuis les temps anciens, offrant des traitements naturels pour de nombreuses maladies (hydrothérapie).

4. Stades
Le State de la Paix et de l’Amitié est un exemple typique du style architectural des dernières 20 années du 20ème siècle ainsi qu’un édifice reconnu mondialement, ayant accueilli de multiples événements sportifs et culturels d’envergue internationale et nationale.

5. Ports
Le portfolio de l’État grec contient 12 ports, incluant ceux de Piraeus, Thessaloniki, Volos, Rafina, Igoumenitsa, Patras, Alexandroupoli, Iraklio, Elefsina, Lavrio, Corfu et Kavala.

6. Compagnie de distribution et de traitement des eaux d’Athènes
Cette compagnie possède les droits exclusifs en ce qui a trait aux services de distribution et de traitement des eaux, le tout réglementé par un accord de 20 ans.

7. Infrastructures olympiques
Ceci comprend le Centre d’Aviron Schinia, le Centre Équestre Markopoulo et le Centre Olympique Galatsi.

En résumé, le message est clair : commencez à magasiner dès maintenant, ou ces aubaines vous fileront entre les doigts. En contrepartie, les progressistes devront organiser une forme de résistance sans délai, ou la Grèce sera pillée.
Julien Mercille est enseignant à University College Dublin, Irlande et membre du Comité de Solidarité Irlande-Grèce. Son livre, Deepening Neoliberalism, Austerity, and Crisis: Europe’s Treasure Ireland (Palgrave) sera publié cette semaine. Suivez-le sur twitter: @JulienMercille
ps : mais en fait c'est en cours partout, à l'échelle mondiale, le plus grand hold-up de l'histoire de l'humanité....
00:30 Publié dans LE MONDE EN 2015 | Lien permanent | Commentaires (0)
Varoufakis : "La zone euro est un espace inhospitalier pour les gens honnêtes"
Source ; http://www.marianne.net/varoufakis-zone-euro-est-espace-i...
Si les tenants européens du « tout austéritaire » pensaient s’être définitivement débarrassés de leur meilleur ennemi, l’ancien ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, avec son éviction du gouvernement Tsipras, c’est bel et bien raté. Puisque l’économiste à bécane, véritable cauchemar de ses homologues européens, vient de donner un entretien au magazine britannique New Statesman. Il y met à jour les petits et grands secrets des négociations qui se sont tenues entre les membres de l’Eurogroupe sur la crise grec et dénonce, sans ménagement, le déficit démocratique au sein des institutions européennes.
« Je me sens sur le toit du monde – je ne dois plus vivre à travers ce calendrier chargé, qui était absolument inhumain, tout simplement incroyable. Je n’avais que deux heures de sommeil chaque jour pendant cinq mois », résume Varoufakis sur son état d’esprit, quelques jours après sa retraite politique forcée. Dommage, les technocrates rancuniers n’auront même pas une petite dépression à se mettre sous la dent... Et d’embrayer sec en critiquant « l’absence totale de scrupules démocratiques de la part des défenseurs supposés de la démocratie en Europe ». Pis, se souvient-il, dans les discussions avec les partenaires européens, il explique qu’« il y avait un refus pur et simple de livrer des arguments économiques. (…) Vous mettez en avant un argument que vous avez vraiment travaillé — pour vous assurer qu'il est logique et cohérent — et vous êtes juste face à des regards vides. » Une mécanique particulièrement troublante « pour quelqu'un qui a l'habitude des débats académiques », avoue l’économiste.
"Dans notre cas, il est clair que notre Parlement grec a été traité comme de simples ordures"Surtout, Varoufakis est frappé par la place prédominante de Wolfgang Schaüble, l’austère — dans tous les sens du terme — ministre des Finances allemand. « [L’Eurogroupe] est comme un orchestre très bien réglé et [Schaüble] est le directeur. (…) Il y aura des moments où l'orchestre est désaccordé, mais il l’organise alors et le remet dans la ligne. » Le gouvernement grec aurait-il pu compter sur le soutien d’autres pays de la zone euro, endettés eux-aussi jusqu’au cou, et ayant subis des cures drastiques d’austérité ? « Dès le début, ces pays ont bien précisé qu'ils étaient les ennemis les plus énergiques de notre gouvernement. Car leur plus grand cauchemar était notre succès : notre réussite à négocier un meilleur accord pour la Grèce, aurait évidemment anéanti leur politique [d’austérité], ils auraient eu alors à justifier devant leur peuple pourquoi ils n’avaient pas négocié comme nous l’avions fait. » Une analyse politique qui éclaire d’un jour nouveau tous les reportages, que certains médias se sont empressés de réaliser, sur l’absence de soutien de la Grèce par les pays les plus pauvres de la zone euro…
En revanche, plus étonnant, on apprend que le gouvernement Tsipras a pu compter sur le soutien implicite de George Osborne, membre du parti conservateur anglais. « Les plus grands défenseurs de notre cause ont été les conservateurs ! En raison de leur euroscepticisme, hein… Mais pas seulement. Il y a dans le courant Burkean (du nom d'Edmund Burke, considéré comme le père du conservatisme anglo-américain, ndlr) une conception de la souveraineté du Parlement. Dans notre cas, il est clair que notre Parlement a été traité comme de simples ordures ».
"L'Eurogroupe n’a de comptes à rendre à personne, étant donné qu’il n’existe pas dans la loi !"Revenant sur l’épisode du 27 juin dernier, durant lequel le président de l’Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, avait signifié à Varoufakis son expulsion de l’Eurogroupe en raison de son refus de signer un communiqué, l’ancien ministre des Finances grec a fait une surprenante découverte. « J’ai demandé un avis juridique, relate-t-il au sujet de sa mise à l’écart, Ce qui a créé un peu de cafouillage. (…) Un expert juridique s’est adressé à moi et m’a alors dis "Eh bien, l’Eurogroupe n’existe pas dans la loi, il n’y a aucun traité qui le prévoit " ». L’économiste hétérodoxe en conclut donc : « Ce que nous avons est un groupe inexistant qui a pourtant cet immense pouvoir de déterminer qu'elle sera la vie des Européens. Il n’a de comptes à rendre à personne, étant donné qu’il n’existe pas dans la loi ; aucuns procès-verbaux ne sont conservés et tout est confidentiel. Donc, aucun citoyen ne saura jamais ce qu’il se dit en son sein ». Rassurant…
Le Grexit avait-il été envisagé par les dirigeants ? « Oui et non » répond-t-il. « Nous avions un petit groupe, un “cabinet de guerre” au sein du ministère, d'environ cinq personnes qui y travaillaient : nous avons donc travaillé dans la théorie, sur le papier, tout ce qui devait être fait pour préparer/dans le cas d'un Grexit. »Un scénario, avoue Varoufakis, utilisé plus comme un levier à actionner dans les négociations que comme un véritable souhait : « Je ne voulais pas que cela devienne une prophétie autoréalisatrice. » C’est d’ailleurs cette position qui a précipité l’économiste vers la sortie, au lendemain du vote du référendum en Grèce.
"Quand Doc Schäuble déterminait la ligne officielle, le ministre des Finances français, à la fin, pliait et acceptait toujours"Lui voulait remettre la pression sur l’Eurogroupe, et mettre en place « un triptyque » d’actions : « émettre des IOUs » (des reconnaissances de dettes en euros), « appliquer une décote sur les obligations grecques » détenues par la BCE depuis 2012 afin de réduire la dette et « reprendre le contrôle de la Banque de Grèce des mains de la BCE ». Mais Alexis Tsipras n’était pas de son avis. Et a préféré reprendre les discussions immédiatement. Se sont-ils fâchés pour autant ? Voilà qui pourrait être un lot de réconfort pour ses détracteurs… « J’ai le sentiment que nous sommes toujours proches. Notre séparation s’est faite à l’amiable. Il n’ y a jamais eu de problèmes graves entre nous » et de préciser, comme nous l’écrivions déjà, « Et je suis très proche de Euclide Tsakalotos [le nouveau ministre des Finances]. »
Et la France dans tout ça ? François Hollande, lors de son intervention du 14 juillet, a déclaré que la France avait « joué pleinement son rôle ». Reste à savoir lequel. Car si Michel Sapin, selon Varoufakis, « a fait des bruits qui étaient différents de la ligne allemande », ces bruits étaient « très subtiles » : « On sentait bien qu'il utilisait un langage très judicieux, pour ne pas être vu comme s'opposant. Car en dernière analyse, quand Doc Schäuble répondait efficacement et déterminait la ligne officielle, le ministre des Finances français, à la fin, pliait et acceptait toujours. » Varoufakis a raison d'expliquer que « la zone euro est un espace très inhospitalier pour les gens honnêtes »...
00:22 Publié dans LE MONDE EN 2015 | Lien permanent | Commentaires (0)
23/07/2015
Restos humanos de Jordi Soler
traduit de l’espagnol (Mexique) par Jean-Marie Saint-Lu
Belfond, mars 2015

170 pages, 17,50 €.
Difficile d’être un saint au Mexique, même si cette étrange vocation nous taraude comme elle taraude Empédocle, fils secret d’un curé licencieux qu’il appelait oncle, de même que son frère cadet, qui lui par contre ne vise pas la sainteté, mais le pouvoir et l’argent comme bien d’autres énergumènes qui garnissent ce roman. Un roman qui trace le portrait sans concession d’une société où la corruption est sans limite et les scrupules aussi volatiles que la vertu et la morale. Ainsi Empédocle, qui dans la vie ne s’est fixé d’autre but que d’aider ses semblables à s’améliorer, usant aussi bien d’inspiration jungienne, que de tarots et tout un méli-mélo new-ageux, aura bien du mal à se tenir à la sienne. Promenant sa sainteté autoproclamée qu’il s’offre de partager avec qui voudra, entre le marché et le bordel local, sa vocation est cependant réelle et affirmée, renforcée par les quolibets, les insultes et les volées de denrées plus ou moins avariées qu’il ne manque pas de recevoir sur son passage. Vêtu de ses sandales et d’une longue tunique blanche, sorte de christ bouffon et improbable au XXIe siècle, il est la risée de la plupart et révéré cependant par quelques bonnes femmes du cru. Tout aurait pu continuer longtemps comme ça, si seulement il n’était pas si difficile de suivre un chemin droit et immaculé au Mexique, surtout donc avec un frère qui suit un chemin totalement inverse, qui tendrait à devenir de plus en plus sulfureux, car rien n’est assez mauvais si ça permet de gravir l’échelle du pouvoir. C’est ainsi que notre ascète accroché à sa vocation coûte que coûte, bien décidé à ne pas se laisser déstabiliser par la peur ou la colère, se retrouve peu à peu au cœur de toutes sortes de trafics, sa cuisine transformée en magasin d’organes, sa maison en bordel clandestin, puis carrément associé, et toujours malgré lui, à la maffia russe et à des magouilles de plus en plus écœurantes, jusqu’à ne plus savoir qui il est et ce qu’il en est de sa sainteté, qui est devenue en fait un instrument de malfaisance entre les mains de son frère et ses comparses.
Un roman aussi loufoque que cruel sur l’absurdité de la société, ici mexicaine, une parmi d’autres, gangrénée jusqu’à la moelle, la face puante du pouvoir, l’exploitation sans vergogne de toute misère et où tout est bon pour faire de l’argent, où en un clin de bistouri, chacun peut finir en fournisseur de pièces détachées. C’est un roman où l’humanité se résume à son avidité, c’est lamentable mais c’est drôle et en cela Restos humanos trouve sa place dans toute une littérature typiquement latino-américaine.
Cathy Garcia
 Jordi Soler est né en 1963 près de Veracruz, au Mexique, dans une communauté d’exilés catalans fondée par son grand-père à l’issue de la guerre civile espagnole. Il a vécu à Mexico puis en Irlande avant de s’installer à Barcelone en 2005 avec sa femme, Franco-Mexicaine, et leurs deux enfants. Il est reconnu par la critique espagnole comme l’une des figures littéraires les plus importantes de sa génération. Cinq de ses livres ont été traduits en français : Les Exilés de la mémoire (Belfond, 2007), La Dernière Heure du dernier jour (Belfond, 2008), La Fête de l'ours (Belfond, 2011), Dis-leur qu’ils ne sont que cadavres (Belfond, 2013) et Restos Humanos (Belfond, 2015). Tous sont repris chez 10/18.
Jordi Soler est né en 1963 près de Veracruz, au Mexique, dans une communauté d’exilés catalans fondée par son grand-père à l’issue de la guerre civile espagnole. Il a vécu à Mexico puis en Irlande avant de s’installer à Barcelone en 2005 avec sa femme, Franco-Mexicaine, et leurs deux enfants. Il est reconnu par la critique espagnole comme l’une des figures littéraires les plus importantes de sa génération. Cinq de ses livres ont été traduits en français : Les Exilés de la mémoire (Belfond, 2007), La Dernière Heure du dernier jour (Belfond, 2008), La Fête de l'ours (Belfond, 2011), Dis-leur qu’ils ne sont que cadavres (Belfond, 2013) et Restos Humanos (Belfond, 2015). Tous sont repris chez 10/18.
Cette note paraîtra sur la Cause Littéraire http://www.lacauselitteraire.fr/
22:27 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
Cigogne (nouvelles) de Jean-Luc A. d’Asciano
Serge Safran éditeur – 5 mars 2015
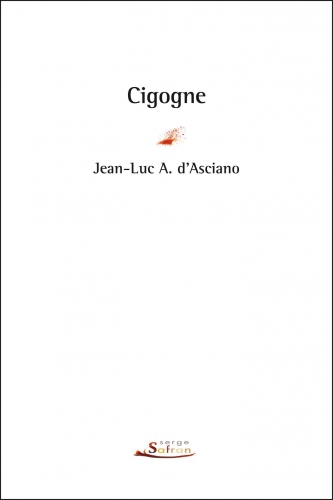
184 pages, 16,90 €.
C’est un véritable et déconcertant régal que nous sert ici Jean-Luc d’Asciano, en sept nouvelles, ciselées comme des joyaux rares, sept nouvelles étranges, dérangeantes, on en frissonne souvent. C’est beau et puis noir et mystérieux comme un lac profond. On navigue entre portraits de personnages atypiques, réalité sociale et contes initiatiques forcément un peu cruels, et drôles aussi. L’enfance y est très présente avec tout son potentiel de création et de destruction et puis des animaux, beaucoup d’animaux. En fait, c’est difficile à classer car c’est vraiment très original, l’auteur nous embarque dans un imaginaire d’une très grande richesse et on comprend tout de même que c’est le réel qui a servi de matériel de base, le réel comme une vase épaisse où puiser des choses qui paraissent si invraisemblables qu’elles sont forcément vraies. Il y est question des folies de chacun, des différences qui font que chaque humain est un continent à lui tout seul et de l’acceptation aussi, de la force du lien et de l’amour. Ainsi on y rencontrera bien-sûr une cigogne, qui a donné son nom à l’ensemble, mais aussi des frères siamois, une superbe trilogie chamane, inclassable, entre chasse aux cerfs, cirques et corbeaux, et puis un sdf doté d’antennes ultrasensibles qui trouve un abri sous la protection de l’esprit des ronces et un schizophrène reclus qui tente d’être lui-même dans un monde qui a du mal à lui laisser une place. Différentes façons d’y être justement, différentes façon de l’aborder ce monde, de le comprendre et quand la magie opère alors « la grimace arrive, la grande grimace, sa préférée : tout son visage se plisse, s’illumine, puis s’apaise en un immense, unique et calme sourire. »
Cathy Garcia
 Jean-Luc A. d’Asciano est né à Lyon, mais a grandi à Nantes. Passe un doctorat de littérature et psychanalyse. Écrit des articles sur le roman noir, l’architecture, les arts contemporains ou la cuisine. Fonde les éditions de L’Œil d’or où il publie Petite mystique de Jean Genet (2007). Cigogne est son premier livre de fiction, premier recueil de nouvelles.
Jean-Luc A. d’Asciano est né à Lyon, mais a grandi à Nantes. Passe un doctorat de littérature et psychanalyse. Écrit des articles sur le roman noir, l’architecture, les arts contemporains ou la cuisine. Fonde les éditions de L’Œil d’or où il publie Petite mystique de Jean Genet (2007). Cigogne est son premier livre de fiction, premier recueil de nouvelles.
Cette note paraîtra sur la Cause Littéraire http://www.lacauselitteraire.fr/
14:53 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
"Nous allions à Kobanê refleurir les espoirs détruits, construire une bibliothèque, un parc pour les enfants.[...] Je ne suis pas bien, je ne serai pas bien, ne soyez pas bien !"
je partage ce message reçu aujourd'hui, n'en connais pas directement l'auteur et le mets tel quel pour que ça se sache, je n'ai pas mis les photos des victimes, qui ne suivent pas au copier-coller :"Le 20 juillet, dans l'Est de la Turquie, une bombe explose. 31 morts. La révolution du Rojava ensanglantée.
La plupart des médias français n'en n'ont même pas parlé, faute de temps entre le reportage sur « les arnaques de l'été » et celui sur Paris plage. Et c'est peut être mieux car ceux qui en ont parlé ont évoqué un attentat « contre Erdogan et la Turquie » (RFI).
Comment expliquer ensuite les manifestations de colère qui ont suivit cet attentat ? Les « Etat islamique assassin, AKP complice » ? Et la répression qui s'en est suivi ? Expliquer quoi ? Pas le temps
Des journalistes un tant soit peu sérieux auraient parlé non pas d'un attentat contre le gouvernement turc, mais contre l'opposition, la gauche radicale pro-kurde.
Car à Suruç, les 31 victimes n'étaient pas membres du gouvernement. Ni même des passagers d'un bus pris au hasard d'un attentat aveugle .
Il s'agissait de 31 militants, en majorité jeune, qui récoltaient des vêtements et des jouets pour les enfants dans le cadre de la reconstruction de Kobanê.
Ils s'étaient réunis à Suruç, dans le sud-est de la Turquie, pas loin de Kobanê, avec 300 autres militants de différentes sensibilités, à l’appel de la Fédération Sosyalist Gençlik Derneği (Association de la Jeunesse Socialiste) pour aller à Kobanê participer à sa reconstruction.
A midi, à l'heure du repas, une « bombe humaine » s'est fait explosée lors de la conférence de presse de cette initiative.
Merve Kanak écrit, depuis Suruç :
« Ils ont tué les gens avec lesquels on a chanté dans le bus. Ils ont tué les gens avec lesquels on a dansé. Les gens avec lesquels on a papoté, les confrères que nous étions surpris de voir là bas, il les ont tués. Il ont tué les gens avec lesquels on a pris le petit déj à Amara, rigolé, mangé une pastèque. Ils ont tué les gens avec lesquels on a discuté théorie, politique. Les gens qui avaient des idéologies différentes mais qui étaient réunis par la réalité de la Révolution, ils les ont tués.
Nous étions tous des gens bien. Nous allions réaliser un rêve. Nous avions 3 sacs remplis de jouets pour les enfants, vous me comprenez ?
Nous avons marché attentivement pour ne pas marcher sur les cadavres de nos camarades, vous me comprenez ?
J’ai compris pourquoi les “Agits” (chants funebres) kurdes sont si tristes, vous me comprenez ? »
31 victimes, c'est un peu court comme formule. Ces 31 victimes, ce sont des personnes, des visages, des histoires, des projets.
C'est Hatice Saadet, étudiante, si heureuse de « participer à une révolution, en tant que femme et féministe »
C'est Süleyman Aksu, 28 ans, qui ne donnera plus de cours d'anglais au lycée de Yüksekova .
C'est Murat Yurtgül, en dernière année de psycho à Istanbul, passionné de théâtre et de lecture.
C'est Okan Pirinç, lycéen.
C'est Ferdane, sa fille, Sinem ...
... et son fils, Nartan Kılıç.
C'est Mustafa Seker, dont le fils avait été tué lors du siège de Kobanê.
C'est Mücahit Erol, qui n'avait pas encore 18 ans.
C'est Koray Çapoglu, qui avait participé au mouvement de Gezi et à divers mouvements environnementaux .
C'est Ferdane Dinç, du conseil jeune HDP d'Istanbul.
C'est Erdal Bozkurt, 27 ans.
C'est le photographe Kasım Deprem.
C'est Cemil Yıldız, ex-candidat du HDP.
C'est Nazlı Akyürek, étudiante à l'Université de Kocaeli.
C'est Çagdas Aydın, militant de la cause des transsexuel(le)s.
C'est Cebrail Günebakan, 27 ans.
C'est Nazegül Boyraz, militante des droits des alévis,
C'est Alper Sapan, 19 ans, militant anarchiste et étudiant en philo.
C'est Alican Vural
C'est Aydan Sancı.
C'est Yunus Sen, étudiant à l'Université de Van .
C'est Büsra Mete, 23 ans.
C'est Polen Ünlü, membre du HDP, militante des droits des objecteurs de conscience.
C'est Duygu Tuna, vice-présidente de la section HDP de Maltepe.
C'est Emrullah Akhamur
C'est Ugur Özkan, originaire de Cizre. 80 000 personnes ont assisté à ses obsèques, mardi.
Et les autres, dont j'ignore tout.
Loren Elva, militant LGBT, hospitalisé avec de nombreuses brûlures écrit
« Nous allions à Kobanê refleurir les espoirs détruits, construire une bibliothèque, un parc pour les enfants.[...] Je ne suis pas bien, je ne serai pas bien, ne soyez pas bien !" Cette formule (« #iyideğilim, #iyiolmayacagım, #iyiolmayin", devenue hastags, circule largement aujourd'hui. )
12:29 Publié dans LE MONDE EN 2015, QUAND LA BÊTISE A LE POUVOIR | Lien permanent | Commentaires (0)
Grèce - L’ancien ministre des finances Yanis Varoufakis explique les raisons de son vote contre le nouveau mémorandum

"Nous savions dès le départ à quel point ils étaient sans scrupules" | EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
J’ai décidé d’entrer en politique pour une raison : pour être aux côtés d’Alexis Tsipras dans la lutte contre la servitude de la dette. De son côté, Alexis Tsipras me fit honneur en me mobilisant pour une raison : une conception très précise de la crise fondée sur le rejet de la doctrine Papaconstantinou [conseiller économique (2004-2007) puis ministre des Finances (2009-2012) de Papandréou, NdT], selon laquelle entre la faillite désordonnée et les emprunts toxiques, l’emprunt toxique est toujours préférable.
Il s’agit d’une doctrine que je rejetais car elle faisait peser une menace constante dont le but était d’imposer, dans la panique, des politiques qui garantissent une faillite permanente et, en fin de compte, la servitude par la dette. Mercredi soir, au Parlement, j’ai été appelé à choisir entre (a) adopter la doctrine en question, en votant pour le texte que les « partenaires » avaient imposé à la manière d’un coup d’État et avec une brutalité inouïe à Alexis Tsipras lors du sommet européen, et (b) dire « non » à mon Premier ministre.
« S’agit-il d’un vrai ou d’un faux chantage ? », c’était la question que nous a posée le Premier ministre, exprimant ainsi le dilemme de conscience odieux qui se posait à nous comme à lui-même. De toute évidence, le chantage était vrai. J’y fus confronté pour la première dans mon bureau, où M. Dijsselbloem me rendit visite le 30 janvier pour me placer face au dilemme « mémorandum ou banques fermées ». Nous savions dès le départ à quel point les créanciers étaient sans scrupules. Et nous avons pris la décision de mettre en pratique ce que nous nous disions l’un à l’autre, encore et encore, lors des longues journées et des longues nuits à Maximou [résidence officielle du Premier ministre, NdT] : nous ferions ce qui est nécessaire pour obtenir un accord viable sur le plan économique. Nous ferions un règlement sans finir sur un compromis. Nous reculerions autant que nécessaire pour atteindre un accord de règlement au sein de la zone euro. Mais, si nous étions vaincus par la logique destructive des mémorandums, nous livrerions les clefs de nos bureaux à ceux qui y croient pour qu’ils viennent appliquer les mémorandums quand nous serions à nouveau dans les rues.
«Y avait-il une alternative ? », nous a demandé le Premier ministre mercredi dernier. J’estime que, oui, il y en avait. Mais je n’en dirai pas plus. Ce n’est pas le moment d'y revenir. L’important est que, au soir du référendum, le Premier ministre a estimé qu’il n’existait pas d’alternative.
C’est pourquoi j’ai démissionné, afin de faciliter son voyage à Bruxelles et lui permettre d’en ramener les meilleurs termes qu’il pourrait. Mais pas pour que nous les mettions en œuvre, quels qu’ils fussent !
Lors de la réunion de l’organisation centrale du parti, mercredi dernier, le Premier ministre nous a demandé de prendre une décision ensemble et d’en partager la responsabilité. Très correct. Mais, comment ? Une solution aurait consisté à faire, tous ensemble, ce que nous disions et répétions que nous ferions en cas de défaite. Nous dirions que nous étions soumis, que nous avions apporté un accord que nous considérons non viable et que nous demandons aux politiques de tous les partis qui le considèrent au moins potentiellement viables, de former un gouvernement pour l’appliquer.
Le Premier ministre a opté pour la deuxième solution : que le premier gouvernement de gauche reste en place, même au prix de l'application d’un accord - produit de chantage - que le Premier ministre lui-même considère inapplicable.
Le dilemme était implacable - et il l’était également pour tous. Comme Alexis Tsipras l'a bien affirmé, nul n’est en droit de prétendre être confronté à un dilemme de conscience plus fort que le Premier ministre ou les autres camarades. Mais, cela ne signifie pas que ceux qui se sont prononcés en faveur de l’application de l’ « accord » inapplicable par le gouvernement lui-même sont habités par un sens plus fort des responsabilités que ceux qui, parmi nous, se sont prononcés en faveur de la démission, remettant l’application de l’accord à des hommes politiques qui le considèrent potentiellement applicable.
À la séance plénière du Parlement, la réalité a été parfaitement bien décrite par Euclide Tsakalotos [nouveau ministre des finances, ndlr] qui a expliqué que ceux qui estimaient ne pas pouvoir mettre à charge du gouvernement de Syriza la ratification de cet accord disposaient d’arguments aussi puissants que ceux qui estimaient que le gouvernement Syriza est tenu, face au peuple, de mettre en œuvre ce mauvais accord pour éviter la faillite désordonnée.
Personne parmi nous n’est plus « anti-mémorandum » qu’un autre, et personne parmi nous n’est plus « responsable » qu’un autre. Tout simplement, lorsque l’on se trouve à un carrefour aussi dangereux, sous la pression de la (mal)Sainte Alliance du Clientélisme International, il est parfaitement légitime que certains camarades proposent l’une ou l’autre voie. Dans ces conditions, il serait criminel que les uns traitent les autres de « soumis » et que les seconds traitent les premiers d’ « irresponsables ».
En ce moment, en plein milieu de désaccords raisonnables, ce qui prévaut, c’est l’unité de Syriza et de tous ceux qui ont cru en nous, en nous accordant ce grandiose 61,5%. La seule façon de garantir cette unité est de reconnaître mutuellement les arguments, en partant du principe que les dissidents réfléchissent de manière aussi bonne, aussi responsable et aussi révolutionnaire que nous.
Partant de ces points, la raison pour laquelle j’ai voté « non » mercredi dernier était simple : nous aurions dû avoir remis les clefs de Maximou et des autres ministères, comme nous disions que nous le ferions en cas de capitulation. Nous aurions dû avoir remis les clefs à ceux qui peuvent regarder le peuple dans les yeux et lui dire ce que nous ne pouvions pas : « l’accord est dur mais il peut être appliqué d’une manière qui laisse un espoir de reprise et de renversement de la catastrophe sociale ».
Le gouvernement de gauche ne peut pas prendre, face à l’Europe officielle, des engagements dont il sait qu’il ne pourra pas les réaliser. Le bien suprême que le gouvernement de Syriza doit protéger est la promesse que nous donnions quand nous nous rendions dans les capitales européennes : contrairement à nos prédécesseurs, nous ne vous promettrons pas quelque chose (par exemple, un excédent primaire précis) qui ne peut pas être atteint. Le gouvernement de gauche n’a pas, en même temps, le droit de piller encore plus les victimes des cinq ans de crise sans pouvoir au moins répondre par l’affirmative à la question : « Avez-vous au moins obtenu quelque chose qui compense les mesures récessives ? »
Plusieurs camarades me disent : « N’est-ce pas mieux que ce soit nous qui tenions les rênes ? Nous qui aimons notre pays et qui avons de bonnes intentions concernant la lutte contre la corruption et l’oligarchie ? » Oui, c’est mieux. Mais, avec quels outils travailler ? La décision du Sommet européen fixe et étend l’absence totale de contrôle social sur les banques, alors que la société sera chargée de 10 à 25 milliards supplémentaires de dettes pour renflouer celles-ci.
Et, comme si cela ne suffisait pas, il se crée un super-TAIPED (fonds d’exploitation de la propriété publique), entièrement sous le contrôle de la troïka (indépendamment du lieu où se trouve le siège de ce fonds), qui privera une fois pour toutes la République hellénique du contrôle sur ses avoirs publics. Et comment l’austérité sera-t-elle vérifiée lorsqu'un trait de plume d’ELSTAT (agence des statistiques de Grèce que nous avons cédée à la troïka mercredi dernier) déterminera la taille de l’excédent primaire ?
Et, quand la société commencera à ressentir dans ses tripes l’étau des résultats de la nouvelle austérité désastreuse, quand les jeunes et les moins jeunes prendront les rues ou resteront, désespérés, chez eux, confrontés à ces effets -ces gens dont jusqu’à présent nous portions la voix, qui les représentera dorénavant dans l’arène politique ? Le parti qui a introduit ces mesures au Parlement pourra-t-il représenter ces gens en même temps que ses ministres bien-intentionnés seront forcés de défendre ces mesures, au parlement et sur les chaînes de TV, en se faisant la risée de l’opposition au mémorandum ?
« Mais, ne sers-tu pas le plan de Schäuble, en votant contre l’accord ? », me demande-t-on. Je réponds en posant ma propre question : « Êtes-vous certains que cet accord de capitulation ne fait pas partie du plan de Schäuble ? »
► Le dernier rapport du FMI prévoit une dette publique supérieure à 200% du PIB, ce qui interdit au FMI d’accorder de nouveaux prêts,
► L’exigence de l’ESM, sur ordre de Schäuble, que le FMI accorde de nouveaux prêts, pour prêter lui aussi à la Grèce,
► Le spectacle d’un gouvernement grec qui vote pour des réformes auxquelles il ne croit pas mais, en plus, qu’il qualifie de produit de chantage,
► Le spectacle d’un gouvernement allemand qui passe au Bundestag un accord avec la Grèce qu’il qualifie lui-même de non fiable et d’échec a priori.
Ne conviens-tu pas, cher lecteur, que ce qui vient d’être énoncé sont de puissants « alliés » de Schäuble ? Existe-t-il en effet une manière plus sûre de défenestrer le pays de la zone euro que cet accord non viable qui assure au ministre des Finances allemand le temps et les arguments pour mettre sur les rails le Grexit tant souhaité ?
Mais en voilà assez. Mon jugement m’a amené à voter contre la ratification de l’accord de capitulation, en estimant que la doctrine Papaconstantinou demeure inacceptable. D’un autre côté, je respecte parfaitement les camarades qui ont un autre point de vue. Je ne suis pas plus révolutionnaire-moral qu’eux mais ils ne sont pas plus responsables que moi, non plus. Aujourd’hui, ce qui est en balance, c’est notre capacité à préserver comme la prunelle de nos yeux, la camaraderie et la collectivité, en conservant le droit à l’opinion différente.
Pour conclure, il existe également un aspect philosophique au dilemme de conscience qui se pose à nous tous : existe-t-il des moments où le calcul du bénéfice net est dépassé par l’idée selon laquelle certaines choses ne doivent tout simplement pas être faites en notre nom ? Ce moment, est-il un de ces moments ?
Il n’existe pas de bonnes réponses. Seule existe la disposition honnête à respecter les réponses que donnent nos camarades avec lesquels nous ne sommes pas d’accord.
Source : efsyn.gr
12:29 Publié dans LE MONDE EN 2015 | Lien permanent | Commentaires (0)
22/07/2015
La déforestation ne décime pas que les arbres...
- Valdelice Veron, porte-parole du peuple des Guarani Kaiowá en Amazonie brésilienne
- Natanael Vilharva-Cáceres, learder indigène du peuple des Guarani Kaiowá en Amazonie brésilienne
- Gert-Peter Bruch, président de Planète Amazone
14:35 Publié dans AGIR, PEUPLES PREMIERS | Lien permanent | Commentaires (0)
La disparition des abeilles pourrait causer plus d'un million de morts par an
Cette accroissement de mortalité résulterait de la combinaison d'une augmentation des carences en vitamine A et en folates (vitamine B9 ou acide folique), vitales pour les femmes enceintes et les enfants, et d'une incidence accrue des maladies non transmissibles comme les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et certains cancers.
Tels sont les phénomènes que provoqueraient, par le biais de modifications alimentaires, un effondrement de la population des pollinisateurs. Les carences en vitamine A et folates peuvent atteindre les yeux, ce qui peut entraîner la cécité, et provoquer la malformations du système nerveux. Ces effets sur la santé toucheraient les pays développés et en développement, selon l'analyse publiée jeudi dans la revue médicale The Lancet.
Selon un scénario d'élimination complète des pollinisateurs, 71 millions de personnes dans les pays à faibles revenus pourraient se retrouver carencées en vitamine A, et 2,2 milliards, qui ont déjà une consommation insuffisante, verraient leurs apports se réduire encore. Pour les folates, ce sont 173 millions de personnes qui deviendraient carencées et 1,23 milliard de gens qui verraient leur consommation déficiente se détériorer encore.
Une baisse de 100% des "services de pollinisation" pourrait réduire les approvisionnements mondiaux en fruits de 22,9%, en légumes de 16,3%, et de 22,9% en noix et graines, mais avec des disparités selon les pays.
En somme, ces changements alimentaires pourraient augmenter la mortalité mondiale annuelle par les maladies non transmissibles et celles liées à la malnutrition de 1,42 millions de décès par an (+ 2,7 % de mortalité globale annuelle), selon l'étude dirigée par le Dr Samuel Myers (Boston, Etats-Unis, Harvard TH Chan School).
Une perte des services de pollinisation limitée à 50% équivaudrait à la moitié (700.000) de la mortalité supplémentaire qu'entraînerait la suppression totale des pollinisateurs, selon ces estimations. Une autre étude, publiée dans "The Lancet Global Health", quantifie une menace spécifique, jusqu'à présent jamais mesurée, pour la santé mondiale provenant des émissions de dioxyde de carbone (CO2) dues à l'activité humaine.
Selon cette seconde étude, la réduction de la teneur en zinc des cultures vivrières importantes liées à l'augmentation des concentrations de CO2 dans l'atmosphère exposera au risque de carence en zinc (retard de croissance, problèmes de défenses immunitaires, morts prématurées) 138 millions de personnes supplémentaires dans le monde d'ici 2050.
Par ailleurs, avec la Fondation Rockefeller, The Lancet publie un rapport sur les changements environnementaux "qui vont bien au-delà des changements climatiques et menacent les progrès en matière de santé réalisés au cours des dernières décennies".
Source © Belga
11:19 Publié dans LE MONDE EN 2015 | Lien permanent | Commentaires (0)
Japon: Fukushima : les habitants forcés au retour en zone contaminée
Alors que la centrale ravagée continue de déverser sa radioactivité, le gouvernement japonais, farouchement pro-nucléaire, veut donner l'illusion d'un retour à la normale.
« Ma maison est inhabitable. Elle est beaucoup trop radioactive. » Assis en tailleur sur son tatami, M. Nakano, 67 ans, ouvre son quotidien local à la page qui donne chaque jour, comme si c'était la météo, les taux de radioactivité de chaque hameau situé autour de la centrale dévastée de Fukushima Daiichi. Au feutre rouge, il a dessiné un point devant le taux de son village : 14,11 µSv/h. « C'est très élevé et très dangereux. En plus, c'est une mesure officielle, à laquelle je ne fais pas confiance. Je pense que la radioactivité y est en réalité encore plus forte. »
Dans les zones évacuées, les courtes visites sont tout de même autorisées la journée. M. Nakano s'est ainsi rendu avec sa femme, en décembre dernier, dans leur maison désertée, située dans la commune d'Okuma, pour une cérémonie et des prières à la mémoire de son père défunt. Sur des photos prises lors de la visite, le couple apparaît couvert de protections de la tête aux pieds : blouse, masque, sac plastique autour des chaussures. « Nous n'aimons pas trop y aller. La maison est abîmée, les animaux sauvages y entrent, nous avons été cambriolés. Il n'y a rien à faire, à part prier, laisser des fleurs et regarder. La dernière fois, on est restés 20 minutes, et on est repartis. »
M. et Mme Nagano vivent depuis 4 ans dans un petit deux-pièces, situé dans une barre de logements provisoires et préfabriqués, construits en urgence après l'explosion de la centrale. Au lendemain de la tragédie du 11 mars 2011, toute la commune d'Okuma, sa mairie, son administration et ses 11 500 habitants ont déménagé dans la ville d'Aizu-Wakamatsu, à 120 km du lieu de l'accident. Autour de cette cité d'accueil se sont multipliées ces barres de logements temporaires gris, sans étage et impeccablement entretenus.
Dans le salon minuscule des Nakano, une table basse, un tatami et deux télés. Sur les murs beiges où les vis sont apparentes, ils n'ont accroché que deux photos : des clichés aériens de leur grande maison abandonnée, avec la centrale en arrière-plan. De leur unique fenêtre, la vue donne sur les autres préfabriqués.
« Au début, tous ces logements étaient remplis. Mais ils sont à moitié vides maintenant, soupire M. Nakano. Seuls les plus âgés, 70 ans en moyenne, sont restés. Les jeunes partent s'installer ailleurs et refont leur vie. »
Comme Yoshida Kuniyoshi, 34 ans. Cheveux long, petite barbiche, voix posée et déterminée, ce diplômé d'une université de Tokyo s'exprime en anglais. Originaire lui aussi d'Okuma, il vit dans une maison vacante d'Aizu-Wakamatsu, dont le loyer lui est payé par le gouvernement. Éditeur d'une petite revue locale, il gagne sa vie en donnant des cours de soutien scolaire dans une salle de classe improvisée, au premier étage de son domicile. « Le lendemain du tsunami, les haut-parleurs de la commune nous ont donné l'ordre d'évacuer à cause des radiations, se souvient-il. Avec mes parents, nous nous sommes enfuis à bord de camions de l'armée. Je suis très reconnaissant envers les habitants d'Aizu-Wakamatsu qui nous ont accueillis. »
Yoshida Kuniyoshi sort d'un placard son compteur Geiger, soigneusement enveloppé dans une pochette en plastique. « Quand je retourne chez moi, ça bipe comme un fou, c'est flippant. » Sur son tableau noir, à la craie, il indique les doses maximales de radioactivité, bien trop élevées selon lui, autorisées par le gouvernement dans les zones où l'ordre d'évacuation sera bientôt levé. « Je ne leur fais pas confiance. Quand ils nous disent "c'est sûr", je les soupçonne surtout de servir les desseins de l'industrie nucléaire. »
Jeune marié, il n'a aucune envie de retourner s'installer dans sa maison irradiée, malgré la probable fin, d'ici deux ans, des indemnités et des aides financières.
« Les journaux proches du gouvernement écrivent que les évacués coûtent trop cher. Il y a une pression pour mettre fin aux compensations données aux réfugiés nucléaires. Je pense que dans mon cas, elles cesseront dès 2017, comme c'est déjà prévu dans certaines zones. 2017 sera une année de combat », prévient-il, dans un petit rire amer.
Ces indemnités sont pourtant modestes : 100 000 yens par mois (725 euros), une somme qui permet à peine de survivre dans un Japon où le coût de la vie est très élevé. Leur fin programmée est l'une des mesures les plus coercitives mises en place par le gouvernement du premier ministre Shinzo Abe, arc-bouté sur sa politique pro-nucléaire, pour contraindre les populations à retourner vivre dans les zones contaminées. Un grand nombre des 120 000 réfugiés nucléaires (officiellement enregistrés comme tels) étaient propriétaires de leur maison ou de leur ferme ; or la région n'est pas riche, et beaucoup n'auront pas les moyens financiers de s'installer ailleurs.
Pour rassurer les populations déplacées sur leur retour, le gouvernement a lancé des travaux gigantesques de « décontamination » : pendant des mois, dans les zones évacuées parmi les moins irradiées, des milliers de travailleurs grattent les sols, enlèvent 5 cm de terre autour des habitations et dans les rizières, reconstruisent les routes, tentent de retirer le césium radioactif qui s'accroche aux surfaces. Ces travaux sont très onéreux, produisent des milliers de tonnes de déchets radioactifs qu'il faudra entreposer quelque part... et leur efficacité est remise en doute.
« Ce que nous observons en pratique, c'est que dans ces soi-disant "zones décontaminées", 90 % du territoire reste contaminé. La région possède beaucoup de forêts, qui sont impossibles à nettoyer. Les gens vont donc revenir dans des zones constituées d'îlots et de couloirs décontaminés, alors que le reste est toujours irradié, accuse Jan van de Putte, expert nucléaire de Greenpeace, interviewé dans le petit bureau de l'ONG à Tokyo.
Ce n'est pas un endroit où vous voulez laisser vos enfants jouer dans la nature. Nous pensons que les populations évacuées devraient au minimum avoir le droit de choisir de rentrer, ou pas. Mais le gouvernement leur impose son opinion, ce qui est totalement irresponsable. »
L'administration Abe veut à tout prix relancer une partie des 48 réacteurs à l'arrêt
Dans la plupart des pays, la dose maximale de radioactivité admissible (en dehors de la radioactivité naturelle et des doses reçues lors de traitements médicaux comme les scanners) est fixée à 1 milliSievert (mSv) par an. C'est notamment le cas en France. Pour les travailleurs du secteur nucléaire, cette dose maximale passe à 20mSv/an. Or, à Fukushima, le gouvernement entend bientôt lever l'ordre d'évacuation dans des zones fortement irradiées, où même après « décontamination », les populations seront exposées à des doses proches de 20 mSv/an, « et jusqu'à 50 mSv/ an dans les endroits non-nettoyés », avertit Jan van de Putte.
« C'est considérable. Je rappelle que c'est la norme pour les employés français du nucléaire, une norme qui sera appliquée à des enfants, à des nouveau-nés, à tout le monde ! Et il est évident que cela aura des conséquences sanitaires énormes », dénonce Cécile Asanuma-Brice, directrice adjointe du bureau du CNRS à Tokyo et chercheuse associée à la maison franco-japonaise de la capitale.
Cette sociologue considère que la politique d'incitation au retour va au-delà de la fin des subventions et des travaux d'une décontamination illusoire : elle relève de la manipulation psychologique.
« Le gouvernement cherche à créer un sentiment de nostalgie par rapport au territoire d'origine. C'est extrêmement vicieux. Par exemple, alors que les enfants commençaient enfin à s'établir et à se réintégrer sur leur lieu de refuge, on a organisé des ateliers avec leurs anciens camarades de classe de Fukushima. On les replonge avec leurs anciens amis, on les fait cuisiner, en leur expliquant que les légumes viennent du jardin du grand-père, de la tante. On leur raconte des légendes fabuleuses. Et quand le gamin revient chez lui, il demande : "Maman, on rentre quand à la maison ?" Cela génère une plaie ouverte. Les gens ne peuvent jamais s'établir. Psychologiquement, c'est invivable. »
Cécile Asanuma-Brice pointe du doigt la complicité des organisations internationales du nucléaire dans cette politique de retour et dans les efforts sémantiques déployés pour dédramatiser la situation.
« Par exemple, on ne parle plus de victimes, mais de "personnes affectées". L'affect, cela renvoie à une attitude qui n'est pas rationnelle, c'est contraire à l'intellect. »
Ces efforts considérables déployés par le gouvernement de Shinzo Abe s'expliquent par une stratégie de normalisation : les autorités veulent faire croire qu'un retour à la normale est possible et qu'elles sont capables de gérer le désastre. L'administration Abe, soutenue par un puissant lobby nucléaire, veut à tout prix relancer une partie des 48 réacteurs nippons, tous à l'arrêt depuis plus d'un an. Avant l'explosion de Fukushima, le Japon était la 3e puissance nucléaire civile mondiale. La réticence face à l'atome d'une majorité de la population - la seule à avoir été victime d'attaques nucléaires, à Hiroshima et Nagasaki, en 1945 - n'entame pas la résolution des autorités.
Or, pour donner l'impression d'un retour à la normale, il faut que le plus grand nombre de réfugiés nucléaires acceptent de rentrer chez eux. Pas seulement les personnes âgées (moins préoccupées que les jeunes générations par les effets à long terme de la radioactivité), mais aussi les jeunes, les médecins, les commerçants... D'où ces opérations massives de « décontamination » dans les zones évacuées, alors que d'autres zones toujours habitées et contaminées (comme par exemple la ville de Fukushima) ne font l'objet d'aucune opération de nettoyage. La contamination n'est en effet pas uniforme : elle se présente plutôt sous la forme d'un patchwork, avec des « points chauds » disséminés un peu partout, certains jusque dans la banlieue de Tokyo.
Ces points chauds ne sont pourtant pas nettoyés.
« Ces zones ne sont pas la priorité du gouvernement, regrette Jan van de Putte, de Greenpeace. On assiste à une concentration de moyens basée sur un agenda purement politique, et non pas sur la protection des populations. C'est une approche très cynique et scandaleuse. »
Un même sentiment de colère exprimé par Cécile Asanuma-Brice : « On fait prendre le risque d'un investissement nucléaire à des populations qui ne bénéficient pas des risques pris. D'un point de vue des droits de l'homme, on marche sur la tête. »
Face à ces pressions croissantes, les 120 000 évacués nucléaires sont divisés, entre partisans au retour et les autres. Des tensions ressenties jusqu'au sein des familles :
« Je vois autour de moi de nombreux cas de divorces ou de séparations, observe Mme Furukawa, 51 ans, assistante maternelle, qui vit dans l'une des barres de logements provisoires d'Aizu-Wakamatsu. Dans mon village évacué, la radioactivité est retombée à 1 µSv/h (soit 8,8 mSv/an). Je sens que nous sommes forcés d'y retourner, mais je refuse. Pas pour moi, mais pour mes trois enfants. » Et son mari ? Elle rigole : « Mon mari, il m'obéit ! »
Au début, les opposants au retour étaient très critiqués. Comme Mme Kowata, 59 ans, originaire d'Okuma, rencontrée dans la salle communale d'un lotissement provisoire. Cette toute petite dame alerte, aux yeux pétillants et au sourire communicatif, arbore une belle paire de chaussettes colorées à orteils séparés... et a fondé un réseau de femmes qui refusent de rentrer. Elle a entamé un long combat contre son maire pour que les sommes immenses perdues dans une décontamination jugée inutile soient utilisées pour construire, ailleurs, une nouvelle ville d'Okuma. « J'ai été très critiquée pour cela. Mais maintenant, quand les réfugiés voient la radioactivité toujours présente chez eux, ils refusent d'y retourner. »
« Chez moi, les tatamis et le toit sont pourris. Je pense que quelqu'un y vit : j'ai retrouvé des baguettes utilisées et des bols de nouilles instantanées. Je lui ai laissé un message : "Cette maison est dangereuse, vous allez tomber malade..." » Mme Kowata a intenté un procès contre sa mairie et accuse son maire de contraindre ses administrés au retour alors que lui-même s'est construit une maison dans une zone sûre. « Le maire nous promet de l'emploi, il dit qu'il construira des usines et une ferme d'aquaculture... »
C'est le contribuable japonais qui paie la facture de la gestion de la catastrophe
« Fin mai, une enquête, menée auprès de 16 000 réfugiés nucléaires par un professeur de l'université de Waseda à Tokyo, a révélé que 40 % d'entre eux souffraient de stress post-traumatique et "d'angoisse de mort face au nucléaire", souligne Cécile Asanuma-Brice. Comment peut-on contraindre ces personnes à retourner vivre sur le lieu de leur traumatisme, alors que la centrale en déliquescence n'est pas stable et que les tremblements de terre sont nombreux ? »
Contrairement à une idée reçue, la crise dans la centrale de Fukushima-Daiichi est loin d'être terminée. Chaque jour, la Tokyo Electric Power Company (TEPCO), l'exploitant, y déverse 300 tonnes d'eau pour refroidir les barres de combustible. Cette eau radioactive est stockée dans d'immenses cuves à l'étanchéité remise en doute. Les cœurs de trois réacteurs - inaccessibles - ont fondu et ont traversé la première enceinte de confinement ; on ne sait pas jusqu'à quel point ces masses à très haute température ont traversé la deuxième enceinte pour atteindre le sol en béton de la centrale.
Problème : la centrale fuit de partout et sa radioactivité contamine les nappes phréatiques et l'eau qui passe dessous pour rejoindre l'océan Pacifique. Ces fuites sont appelées à s'aggraver au fur et à mesure que les fissures s'élargissent avec le temps. C'est pour empêcher cette contamination souterraine que TEPCO a entamé la construction d'un « mur de glace » profond de 30 mètres et long de 1,5 km, une technologie incertaine qui n'a jamais été mise en œuvre à cette échelle.
Autre sujet d'inquiétude : la structure de la centrale, en particulier le 4e réacteur, est très endommagée. En cas de nouveau séisme, d'autres dégagements d'intense radioactivité ne sont pas à exclure, s'alarme Jan van de Putte : « Je m'inquiète notamment de l'impact, impossible à évaluer, d'un éventuel dégagement de strontium radioactif. »
Le gouvernement et TEPCO visent 2045 pour le démantèlement complet de la centrale.
« Personne n'y croit ! s'emporte Shaun Burnie, autre expert de Greenpeace, en visite au Japon. Un dirigeant de TEPCO a reconnu qu'on ne disposait pas encore des technologies nécessaires pour retirer le combustible fondu. Il a même spéculé sur un démantèlement qui prendrait 200 ans. Personne n'en sait rien. »
Entre 6 000 et 7 000 travailleurs sont employés chaque jour sur ce chantier cauchemardesque. Parmi eux, se trouve le fils de M. et Mme Nagano, le couple réfugié à Aizu-Wakamatsu. « Notre fils a besoin de gagner sa vie pour nourrir ses enfants », expliquent-ils. Sont-ils inquiets ? Haussement d'épaules : « La famille sait bien qu'il n'a pas d'autre choix. » TEPCO fait d'ailleurs face à une pénurie d'ouvriers : les plus expérimentés ne peuvent plus travailler car ils ont atteint la dose radioactive accumulée maximale.
« La majorité de ces travailleurs ne sont pas des salariés de TEPCO, rappelle Shaun Burnie. Ce sont des sous-traitants, des sous-traitants de sous-traitants. Certains ouvriers sont des sans-abri, recrutés dans la rue. Leurs conditions de travail sont terribles, leurs salaires misérables, leur retraite inexistante. Nous avons le respect le plus total pour ces hommes qui font de leur mieux dans une situation impossible. »
La situation fait en tout cas le bonheur des yakuzas : les gangsters japonais sont spécialisés dans le business du recrutement de travailleurs temporaires dans des conditions douteuses. TEPCO aussi s'en sort très bien : c'est le contribuable japonais qui paie la facture de la gestion de la catastrophe. En 2014, l'entreprise a même fait des bénéfices.
Le premier ministre Shinzo Abe encourage les décontaminateurs de TEPCO, en septembre 2013
Il est encore trop tôt pour mesurer les conséquences de la catastrophe nucléaire en termes de santé publique : après l'explosion de la centrale ukrainienne de Tchernobyl, la hausse notable du nombre de cancers de la thyroïde, en particulier chez les enfants, a commencé à être observée 5 ans après la catastrophe. Au Japon, 4 ans seulement après les premières retombées radioactives, selon l'université médicale de Fukushima, sur 385 000 Japonais de moins de 18 ans, 127 ont été opérés ou sont en phase de l'être pour un cancer de la thyroïde. Soit un taux d'incidence de 330 cancers pour 1 million d'enfants, à comparer au taux de 1,8 pour 1 million observé en France (entre 1997 et 2001).
Cette augmentation déjà visible des maladies liées à l'irradiation s'explique en partie « par le fait que le gouvernement n'a pas toujours dévoilé les informations les plus importantes après le début de la crise », regrette le Dr Hasegawa Hiroshi. Cet agronome spécialiste de la culture bio a démissionné de son poste de fonctionnaire après l'explosion de la centrale : il s'était disputé avec son patron, qui refusait de publier des informations liées à la radioactivité.
« Les gens ne savaient pas quoi faire après l'accident : rester, ou partir ? Ils devaient prendre une décision, et je me suis dit que je pouvais les aider avec mes connaissances scientifiques. » Le Dr Hasegawa dirige désormais un « laboratoire citoyen » de mesure de la radioactivité dans la ville de Fukushima. Son labo fournit des mesures indépendantes du sol, de la nourriture et des doses accumulées par les individus. « Avec ces informations, nous donnons aux citoyens de Fukushima les moyens de prendre une décision. » Pour les enfants, les examens de mesure de la radioactivité du corps sont gratuits. Le laboratoire est financé grâce à des donations.
Certains savent qu'ils ne retourneront jamais chez eux. Comme M. et Mme Watanabe, 65 et 62 ans, agriculteurs : leur ferme, située à 3 km de la centrale, se trouve sur un futur site de stockage des déchets issus de la « décontamination ». Un site « temporaire », prévu pour durer au moins 30 ans. Ce qui ne les empêche pas de retourner chez eux tous les mois, pour nettoyer, désherber, et prendre soin des tombes. « C'est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'y retourner pour l'entretenir. » Mme Watanabe, le visage expressif et vif, retient ses larmes en parlant de leur maison et de leur ferme, dont une grande photo encadrée orne le mur de leur chambre à coucher.
Mais les Watanabe refusent de s'apitoyer sur leur sort. Ils ont préféré éviter les logements préfabriqués et vivent dans un petit appartement d'Aizu-Wakamatsu. Lui fait du jardinage, elle travaille dans la cuisine d'un onsen, une source thermale locale. Sur le mur du salon, chacun a son calendrier, couvert d'activités et de rendez-vous. Ils sont fiers de montrer qu'ils ne restent pas inactifs, qu'ils ne sont pas des assistés. Ils demandent au gouvernement des indemnités qui leur permettraient d'acheter une ferme et de recommencer leur vie ailleurs. « Nous sommes les victimes. Pourtant, les bureaucrates nous disent : "Vos terres sont contaminées" et ce qu'ils nous offrent en échange ne nous permettra pas de nous installer ailleurs. Le Japon est-il toujours un État de droit ? »
« Avant la catastrophe, nous nous inquiétions un peu de la possibilité d'un accident nucléaire, mais jamais nous n'aurions pensé que cela puisse être si grave. Quand nous avons été évacués, nous pensions être de retour trois jours plus tard. Tous ces experts de l'industrie nucléaire nous assuraient : c'est une énergie sûre. Sûr, sûr, sûr, on entendait ce mot tout le temps. »
Yoshida Kuniyoshi, l'éditeur de revue, lance un avertissement similaire, en nous raccompagnant hors de sa petite salle de classe : « Vous, les Français, vous devriez réfléchir aux conséquences d'un accident nucléaire chez vous. Les villes que vous aimez, les souvenirs que vous chérissez... Un accident nucléaire peut tout détruire. Ici, l'industrie nucléaire a tué nos vies, et tout ce que nous ont légué nos ancêtres. »
Même écho chez les activistes de Greenpeace : « Contrairement à une idée reçue, les campagnes japonaises ne sont pas densément peuplées. À Fukushima, 230 000 personnes vivaient dans un rayon de 30 km. En Europe, la plupart des centrales nucléaires sont situées dans des régions plus peuplées. Un accident similaire en Europe aurait un impact beaucoup plus grave », remarque Jan van de Putte. Avec 73 % de son électricité produite par le nucléaire (au Japon : 28 % avant la crise, 0 % aujourd'hui), l'économie française est beaucoup plus dépendante de l'atome. Donc beaucoup plus vulnérable en cas d'accident.
Source © Mediapart
11:13 Publié dans NUCLEAIRE | Lien permanent | Commentaires (0)
21/07/2015
Le Succube du tyran, Pascal Pratz
Éditions Lunatique, collection 36e DEUX SOUS, avril 2015.
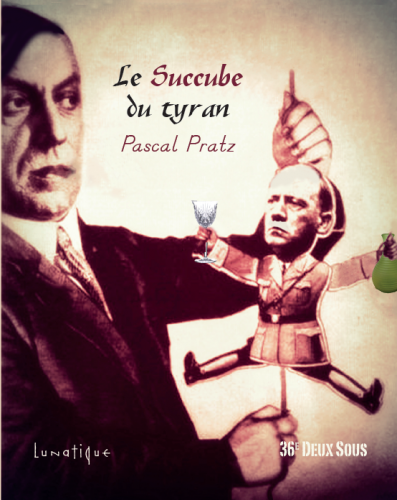
32 pages, 4 €.
On l’avale tout cru ce petit bouquin des éditions Lunatiques ! Aussi drôle que triste et pathétique finalement, comme le sont tous les tyrans, pathétiques je veux dire, mais on jubile à la lecture de cette courte mais dense satyre. Dense parce que tout y est, toute la panoplie et les délires des affreux qui tachent et pourrissent le monde de leur folie sanguinaire, avec leur cour de polichinelles cupides et tordus, imbéciles malsains au-delà du possible, qu’importe le nom du tyran, ils se ressemblent tous, à croire qu’ils sortent du même moule, et vrai que la meilleure des armes avec eux, ça pourrait bien être le ridicule. Le ridicule ne tue pas, dit-on et bien dans Le Succube du tyran, il tue, avec en renfort quelques potions et gouttes tantôt diurétiques, tantôt laxatives, aphrodisiaques ou bois débandé… « C’est un texte un peu potache » en dit l’auteur, la dernière cartouche peut-être dans un monde où de nouveaux genre de tyrans pullulent et se pavanent, le genre dont on n’a même pas envie de se moquer dans des livres, quoique… Parce que Pascal Pratz a raison sans doute en disant que « le rire potache est devenu, aujourd’hui, hélas, un très beau combat. » En tout cas, il nous régale d’un texte rageur, impertinent, et vraiment bien écrit, ce qui ne gâche rien, on aurait envie d’en tirer une pièce de théâtre. On ne peut pas se moquer de tout, mais du tyran, non seulement on peut, mais on doit se moquer. Et ouvertement si possible !
Cathy Garcia
 Pascal Pratz est ce qu’il est convenu d’appeler un touche-à-tout. Après des études (brillantes) en physique, il fut tour à tour et tout à la fois professeur de physique, mari (trois fois), musicien, chanteur, père (en cinq exemplaires dont il ne reste que quatre, hélas), peintre, photographe, écrivain et, finalement, éditeur, créant, en 2008, les éditions associatives Asphodèle. Il est aujourd’hui l’auteur d’une dizaine de livres dont deux romans (éd. du Petit Pavé), de récits, de nouvelles et d’un recueil d’aphorismes aux éd. Durand Peyroles.
Pascal Pratz est ce qu’il est convenu d’appeler un touche-à-tout. Après des études (brillantes) en physique, il fut tour à tour et tout à la fois professeur de physique, mari (trois fois), musicien, chanteur, père (en cinq exemplaires dont il ne reste que quatre, hélas), peintre, photographe, écrivain et, finalement, éditeur, créant, en 2008, les éditions associatives Asphodèle. Il est aujourd’hui l’auteur d’une dizaine de livres dont deux romans (éd. du Petit Pavé), de récits, de nouvelles et d’un recueil d’aphorismes aux éd. Durand Peyroles.
20:17 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)






















