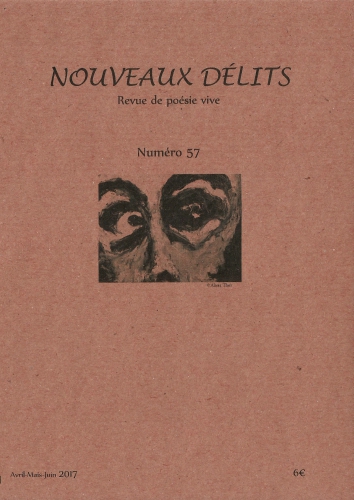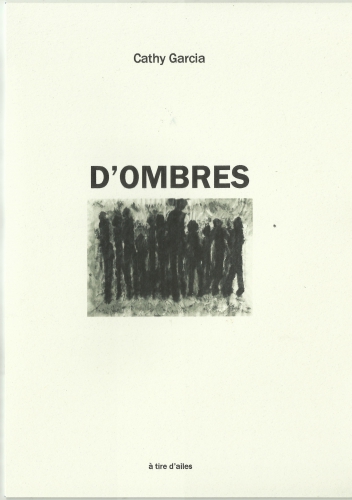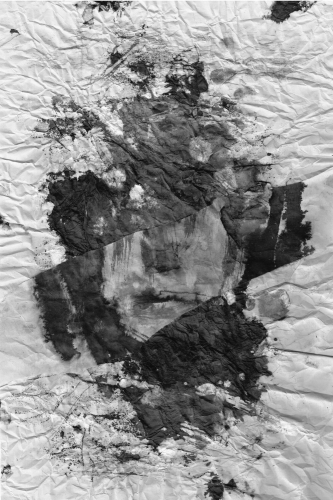Abd El Hafid Benchouk est membre de la confrérie soufie naqshbandi et créateur de la société Chifa — « santé, guérison » en arabe — qui conditionne et vend des produits de santé naturelle. Né en Algérie et arrivé en France à l’âge de 5 ans, son parcours l’a amené à trouver en islam sa voie spirituelle, dans le soufisme.
Reporterre — Qu’est-ce que le soufisme et la voie naqshbandi ?
Abd El Hafid Benchouk — Chaque voie soufie, dans la religion musulmane, a une lignée, une chaîne initiatique qui remonte de cœur à cœur, d’homme en homme, de maître en maître — on les appelle « cheikh » — jusqu’au prophète Mohammad. Ainsi, l’enseignement spirituel se transmet de façon directe et personnelle aux disciples. La voie naqshbandi prend sa source en Ouzbékistan, à Boukhara, où est enterré le cheikh fondateur, Bahaouddin Naqshbandi. Elle n’était pas connue en Occident jusqu’à cheikh Nazim Al Haqqanî, qui est mort en 2014. C’est en France que je l’ai découverte.
Quelle place la nature tient-elle dans cette voie ?
La particularité de notre maître cheikh Nazim, et de son fils cheikh Mehmet qui a pris sa suite, est qu’ils vivent dans un petit village, Lefke, à Chypre Nord, où se trouve la zaouiya — centre spirituel et social où se réunit la communauté. Là-bas, il y a des jardins, des orangeraies, on se reconnecte immédiatement. Cheikh Nazim a toujours insisté sur le retour à la nature. Il est devenu cheikh dans les années 1970, et dans les années 1980, au moment du « boum » de la modernité, il a commencé à donner la directive de sortir des villes et de s’installer à la campagne. Il a appris à ses disciples l’économie dans le sens vrai du terme, c’est-à-dire de respecter toute chose. Il les réprimandait gentiment s’ils gâchaient la nourriture. Là-bas, tout est naturel. On mange surtout des légumes, et un peu de viande. Il a remis au goût du jour les parfums naturels. Les parfums sont très recherchés par les musulmans parce que le prophète les avait désignés comme l’une des choses les plus aimables de ce monde. Hélas, aujourd’hui beaucoup de musulmans utilisent des espèces de muscs synthétiques, chimiques. Dans la voie, on a redécouvert la rose, le jasmin, l’ambre ; des disciples ont commencé à faire des commerces de ces parfums naturels extraordinaires. C’est un retour aux sources et à l’essence des choses. À la zaouiya de Lefke, on fait le pain sur place, on se chauffe au feu de bois, et surtout : on est bienvenu 365 jours par an, sans condition. Tu viens n’importe quand, musulman, pas musulman, tu dors, tu manges… Une fois, on a rencontré et accueilli un groupe du mouvement rainbow, certains sont venus prier avec nous.
La création de Chifa est-elle liée à votre engagement dans la voie naqshbandi ?
J’ai toujours aimé être à la campagne. Le problème de la ville est que la nature en est absente. Et pour nous croyants, elle est la manifestation directe du Créateur. Il y a un besoin inné, chez l’être humain, de s’y reconnecter. La voie a confirmé ce qu’il y avait au fond de notre être, ensuite on a continué. Chifa est un concours de circonstances. J’étais responsable de la librairie soufie du quartier des libraires, à Paris. J’avais remarqué qu’un produit était très demandé par les musulmans : l’huile de nigelle. La nigelle, cette petite graine noire qu’on trouve sur les pains arabes, a des vertus dont celle de renforcer le système immunitaire. Mais tout le monde en rapportait du bled. On a monté une société qui proposerait des produits à base de nigelle conditionnés en France. Cet engouement vient d’un dire du prophète (un hadith) : « Guérissez-vous par la graine de nigelle. Elle soigne tous les maux sauf la mort. » Des études scientifiques ont établi qu’elle contient un principe actif, la thymoquinone, qui stimule le système immunitaire. Ce n’est pas la nigelle elle-même qui guérit, mais elle aide à la guérison en renforçant le corps… On décline donc la nigelle sous toutes ses formes : huile, capsules, poudre, savon, mélangée avec du miel, ainsi que d’autres produits de santé naturelle : des tisanes, d’autres huiles, etc.
-
Pourriez-vous dire à quelqu’un qui ne connaît pas l’islam ce qui, dans cette religion, est lié à la nature ?
La première indication la plus claire, la plus directe, c’est le compte des mois, qui est lunaire. Cela nous met en connexion constante avec le cycle lunaire. Il s’agit d’observer la Lune, de savoir dans quel état elle est à chaque instant. L’un des noms du prophète lui-même est « la pleine Lune », qui signifie la réflexion totale du Soleil sur la Lune, le Soleil symbolisant la présence divine, et la Lune l’âme humaine.
Un autre lien plus fort est la prière, qui se fait selon le rythme du Soleil et des saisons. Les horaires de la prière de l’aube et de celle du coucher du Soleil varient énormément au cours de l’année. En hiver, elles se font environ entre 7h30 et 17h, et en été la distance peut aller de 4h à 22h. Le pratiquant va donc au rythme des saisons. Plus les jours s’allongent, plus sa prière change d’amplitude en s’allongeant elle-même. Toutes les années, il respire avec le cosmos, inspire, expire, avec tout son être. On n’est pas dans un temps mécanisé comme aujourd’hui.
-
Cela va encore plus loin : dans les positions de la prière, l’homme doit réaliser tous les règnes existants. La première est la position axiale, debout. C’est la particularité de l’homme d’être le lien entre ciel et terre. La seconde est l’inclinaison, qui symbolise le règne animal, c’est une glorification à l’immensité, à l’étendue de Dieu. La troisième est la prosternation, qui symbolise le règne minéral. On devient moins que rien, c’est là qu’on est le plus proche de Dieu, quand l’ego disparaît et que peut apparaître le soleil de la présence divine. La quatrième posture est assise. C’est l’état contemplatif, le règne végétal. On a réuni tous les règnes. Si l’on fait ce rite avec conscience, il se passe quelque chose qui est au-delà des mots. D’ailleurs il est improprement appelé « prière ». Il s’agit en arabe du mot « salat », qui signifie « connexion, jonction ». La prière, c’est l’invocation. Dans la salat, on se met en connexion, on disparaît de ce monde, puis on y revient en souhaitant la paix autour de soi. On est en état de pacification totale. Ce qui est à l’intérieur peut alors se manifester à l’extérieur.
On le perd très vite en retournant dans la vie active, c’est pour cela qu’un autre rite précède la salat : les ablutions, liées à l’eau. Il s’agit de se purifier intérieurement et cela se manifeste par une purification extérieure. Tout a toujours un sens extérieur et intérieur. On purifie nos mains — ce que l’on fait —, notre bouche — ce que l’on dit —, notre nez — ce que l’on sent —, notre visage — ce que l’on représente —, nos bras — notre force —, nos pieds — où l’on va. Une fois cette intention faite, tu peux entrer dans la connexion.
Si l’on n’a pas d’eau, on se purifie avec de la terre. Tous les éléments naturels sont symboles de purification. Si l’on n’a pas de terre, on le fait avec une pierre, que l’on peut toujours avoir sur soi, en voyage par exemple. Le minéral est omniprésent dans la vie des croyants.
-
Est-il possible de conserver ce lien avec la nature pour ceux qui vivent en ville ?
On se déconnecte si l’on fait les choses mécaniquement. Le problème de l’islam aujourd’hui, qui n’est pas le problème de l’islam mais le problème de notre époque, c’est le manque de spiritualité. Dans l’islam lui-même, si on évacue le côté spirituel, on arrive à quelque chose de quantitatif, mécanique, à faire la prière à une minute près... S’il n’y a pas cette spiritualité que le soufisme apporte, cette profondeur de la vision, alors on va dans le même matérialisme que tout le monde, et on ne va pas faire attention à ce qui nous entoure, à ce que nous mangeons, etc.
Une attention, une vigilance permanentes sont demandées. Cela élargit-il la perception ?
La salat nous coupe du rythme effréné de la vie de tous les jours. On court toujours après le temps, et dans ces moments de méditation, on se reconnecte avec l’éternité, avec l’éternel présent. C’est ce qui se passe pendant le ramadan. C’est extraordinaire parce que toute une communauté s’arrête pour se dire : stop, je suis peut-être autre chose qu’un animal.
Faites-vous un lien entre le manque de spiritualité et la détérioration de la planète ?
Forcément. « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme », comme a dit Rabelais. Le matérialisme et l’absence du spirituel sont liés, parce qu’il n’y a pas de conscience de l’au-delà, du jugement, plus de sens. Les personnes qui se posent la question de la planète ont le sens spirituel ouvert, la conscience de l’autre, de la responsabilité personnelle.
L’ensemble de la communauté soufie est-elle d’accord là-dessus ?
Oui, sans aucun doute.
Diriez-vous la même chose de l’ensemble de la communauté musulmane non soufie ?
Non, je dirais qu’elle est atteinte des mêmes maux que l’Occident à cause de la frénésie matérialiste, du vouloir consommer à tout prix.
Comment la communauté soufie se positionne-t-elle d’un point de vue politique ?
Certains soufis aujourd’hui se sont ouverts à la réflexion politique. J’ai été invité aux premières Assises musulmanes de l’écologie, en octobre dernier, pour donner une conférence. Mais dans le soufisme, on ne poussera personne à militer dans un sens, c’est une voie qui ouvre la personnalité à sa réalisation particulière, lui apprend à être à l’écoute de ce qui est juste pour elle. Si des gens s’intéressent, on les encourage forcément. C’est pour cela qu’on a mis en place une ferme spirituelle, dans le Perche, sur le modèle de la zaouiya mère à Chypre. Ce qu’on y fait est toujours en lien avec la vie intérieure. Par exemple, on taille les arbres pour tailler les défauts de notre âme, on retourne la terre… terre intérieure pour faire germer, etc.
-
Que pouvez-vous dire du pèlerinage à la Mecque, n’est-il pas devenu un lieu de business ?
Martin Lings raconte le changement des lieux saints dans un film… Il y est allé en 1948, puis en 1976. En 1948, d’où que tu arrivais, tu voyais tout de suite la Kabba, qui était le bâtiment le plus haut, et aujourd’hui… je ne vous dis pas, c’est catastrophique ! La mentalité wahhabite des Saoudiens, qui tiennent les lieux sacrés, manifeste très bien leur matérialisme. Elle est à l’opposée du soufisme. Le voyage initiatique, avant le monde moderne, était dans le voyage lui-même, qui prenait du temps, et dans les rites. Aujourd’hui, il se fait par la difficulté, parce qu’il y a énormément de monde : comment retrouver sa centralité au milieu de la foule…
Donc si on le fait vraiment avec conscience…
On devient un avec le cosmos !
Se fait-on souvent une mauvaise idée de la religion ?
Tout à fait, on ne la voit qu’extérieurement. Je dirais que la religion musulmane est voilée à l’extérieur, comme une femme voilée, et ce n’est qu’en donnant la dot qu’on peut l’épouser. Le soufisme au sein de l’islam est voilé lui aussi, et ce n’est qu’avec la pureté d’intention qu’on peut le voir, et voir les choses telles qu’elles sont réellement, recevoir les autres avec le cœur et pas avec la tête. Le mental est utile mais il n’est pas le principal, il est comme la Lune, il doit refléter le Soleil.
 Propos recueillis par Juliette Kempf
Propos recueillis par Juliette Kempf





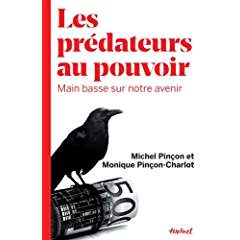 A lire : Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, Les prédateurs au pouvoir. Main basse sur notre avenir, Textuel, 2017, 64 pages.
A lire : Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, Les prédateurs au pouvoir. Main basse sur notre avenir, Textuel, 2017, 64 pages.
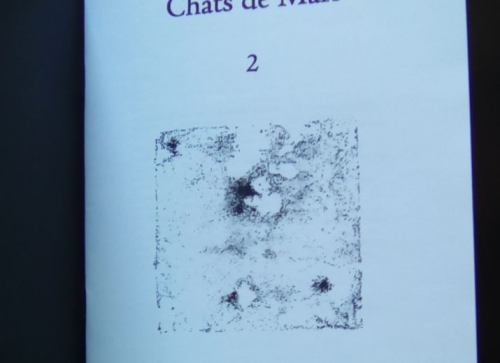

 Corinne Pluchart est née le 7 mars 1966, à Meaux, en Seine-et-Marne. Elle vit à Sains, où elle enseigne en école maternelle. Depuis l’adolescence, elle écrit, marche, interroge, observe le paysage, l’océan. Elle compose en écriture et peinture, mue par un profond désir de lumière. De l’abbaye du Mont-Saint-Michel jusqu’au lointain Finistère, son pays de cœur, le chemin la traverse dans une solitude amie.
Corinne Pluchart est née le 7 mars 1966, à Meaux, en Seine-et-Marne. Elle vit à Sains, où elle enseigne en école maternelle. Depuis l’adolescence, elle écrit, marche, interroge, observe le paysage, l’océan. Elle compose en écriture et peinture, mue par un profond désir de lumière. De l’abbaye du Mont-Saint-Michel jusqu’au lointain Finistère, son pays de cœur, le chemin la traverse dans une solitude amie.  La revue Cabaret fête ses 5 ans ! Pour célébrer cette date, un numéro hors-série, #1, sort ce mardi 11 avril.
La revue Cabaret fête ses 5 ans ! Pour célébrer cette date, un numéro hors-série, #1, sort ce mardi 11 avril. 



 Edyr Augusto est né en 1954 à Belém. Journaliste et écrivain, il a débuté sa carrière en tant que dramaturge à la fin des années 1970. Il écrit toujours pour le théâtre et endosse parfois le rôle de metteur en scène. Edyr a également écrit des recueils de poésie et de chroniques.
Edyr Augusto est né en 1954 à Belém. Journaliste et écrivain, il a débuté sa carrière en tant que dramaturge à la fin des années 1970. Il écrit toujours pour le théâtre et endosse parfois le rôle de metteur en scène. Edyr a également écrit des recueils de poésie et de chroniques. 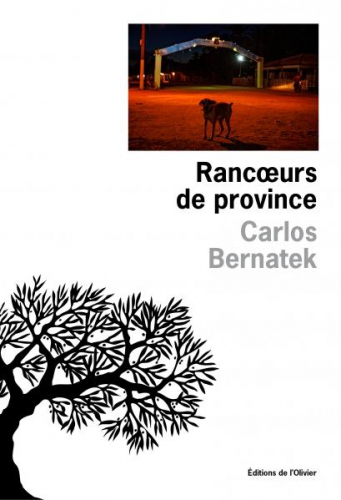
 Né en 1955 à Buenos Aires, Carlos Bernatek a notamment été finaliste du prix Planeta en 1994 et premier prix du prestigieux Fondo Nacional de las Artes en 2007. Banzaï est son premier roman traduit en France.
Né en 1955 à Buenos Aires, Carlos Bernatek a notamment été finaliste du prix Planeta en 1994 et premier prix du prestigieux Fondo Nacional de las Artes en 2007. Banzaï est son premier roman traduit en France. 


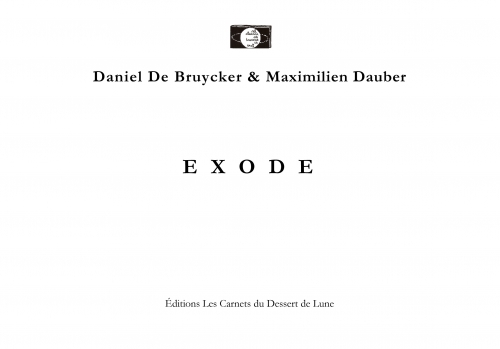
 Dans le désert, nous sommes transportés, nuées, ombres, nous avançons dans la lecture comme on marche, lentement, avec cette sensation que l’espace s’ouvre tout autour et en nous et le sentiment de se dissoudre dans cette immensité. Nous nous sentons de plus en plus petits, insignifiants, à chercher des signes qui se font et se défont, désert que nul langage ne saurait contenir.
Dans le désert, nous sommes transportés, nuées, ombres, nous avançons dans la lecture comme on marche, lentement, avec cette sensation que l’espace s’ouvre tout autour et en nous et le sentiment de se dissoudre dans cette immensité. Nous nous sentons de plus en plus petits, insignifiants, à chercher des signes qui se font et se défont, désert que nul langage ne saurait contenir. 
 Daniel De Bruycker
Daniel De Bruycker Maximilien Dauber
Maximilien Dauber
 Jean Azarel
Jean Azarel