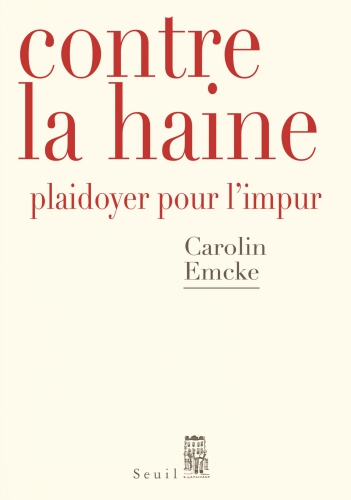Une exploration sans fin. Il fallait un face-à-face avec le tueur, avec le criminel contre l’humanité, pour répondre à une question qui amène à penser l’impensable : Comment devient-on tortionnaire ? C’est le titre d’un livre-enquête ambitieux que signe la psychologue Françoise Sironi (photo DR), par ailleurs maître de conférences à l’université Paris-VIII et experte auprès des tribunaux pénaux internationaux. Elle a longuement rencontré Douch, le directeur du centre de torture et d’extermination S-21 dans le Cambodge des Khmers rouges qui ont exécuté au moins deux millions de personnes entre 1975 et 1979. A partir de cette histoire, Françoise Sironi explore les coulisses individuelles et collectives, les dimensions psychologiques et géopolitiques de la fabrique des tueurs de masse. Elle décortique les ressorts des exécuteurs et déconstruit la mécanique de la machine de mort mise en place par les nazis, les Khmers rouges, les Hutus rwandais ou les jihadistes de l’Etat islamique.
En reparcourant l’histoire de Douch et en vous intéressant également aux nazis et aux jihadistes, vous voulez démontrer que nous ne naissons pas tortionnaires…
En effet, je ne partage absolument pas l’idée qu’en chacun de nous il y a la pulsion de mort, la pulsion de vie. Depuis vint-cinq ans, je m’occupe des victimes et des auteurs de violence et les choses ne se présentent pas ainsi. Si c’était naturel d’être tortionnaire, les systèmes tortionnaires ne prendraient pas le soin de former les gens, ne forceraient pas les exécuteurs à s’habituer à la violence. Je pense aux précautions prises par les nazis avec la shoah par balle [distiller les ordres, compartimenter les opérations préalables aux meurtres, ndlr]. Je pense à Douch qui accompagnait certains exécuteurs qui avaient du mal à assassiner leurs proches car il ne fallait pas mollir, pas faiblir. Si tuer était inné, il n’y aurait pas besoin de forcer des gens à massacrer, comme on l’a vu au Rwanda, dans les Balkans, avec les nazis ou l’Etat islamique.
Ces tueurs souffrent-ils de maladie psychiatrique ? Cherchez-vous à montrer qu’il y a une forme de normalité dans l’anormalité ?
Je pars de mon expérience. J’ai réalisé seize entretiens de trois heures avec Douch à Phnom Penh. J’ai également fait des expertises de criminels accusés de génocide au Rwanda, des psychothérapies d’auteurs de violences collectives. Je me suis plongée dans les thèses de ceux qui assurent que ces tueurs sont des monstres. En 1945, on ne pouvait pas penser que les nazis faisaient partie de l’ordre de l’humanité, et c’est bien normal. Maintenant, si en tant que psychothérapeute, on considère que c’est normal de penser comme cela, alors je vais jardiner, je ne sers à rien. Ces tueurs ne sont pas nés monstres, ils le sont devenus. J’ai voulu être psychologue pour comprendre cela et tenter de soigner. Ce ne sont pas des malades mentaux. Ils ne rentrent pas dans les catégories de névrose, psychose, perversions, etc. Je crois plutôt qu’il faut établir une nouvelle nosographie [une classification des types de maladies] qui prenne en compte l’histoire collective et l’histoire singulière. Car il faut donner toute son importance au facteur géopolitique, historique, et comprendre que cela structure tout autant le psychisme humain que des éléments plus habituels, comme les manques précoces, les traumatismes, les problèmes relationnels.
A partir du cas de Douch, et sans tomber dans la caricature, arrive-t-on à dégager des traits communs pour tenter de dresser une sorte de portrait-robot du criminel contre l’humanité ?
D’abord, il faut dire que les profils et les causes pour lesquelles on va basculer peuvent être très diversifiés. Ensuite, on trouve en effet des dominantes. Ils ont tous renoncé à avoir une identité singulière. Après, dans leur histoire personnelle précoce, on va souvent recenser des vécus d’humiliations, d’ostracisme, des blessures narcissiques. Ce n’est évidemment pas cela qui va faire d’eux des bourreaux, mais c’est dans cela qu’ils vont puiser consciemment ou inconsciemment. Leur devenir tortionnaire va se nourrir de ce vécu traumatique qui peut être individuel ou collectif. Il faut se souvenir de la défaite de l’Allemagne après la Première Guerre mondiale et de la manière dont cela a été ressenti par les futurs nazis. Ils renoncent à leur propre identité car ils ont des prêts-à-penser qui leur sont proposés : c’est simple, binaire, avec des bons et des méchants. Ils ont du mal à fonctionner dans la complexité du monde. Ils ont une aptitude à devenir des hommes-systèmes : ils se comportent comme le système dont ils font partie. Il y a une analogie entre la manière dont l’Etat totalitaire fonctionne et leur propre fonctionnement psychologique. L’individu, le sujet singulier disparaît, il est tué. Le psychiatre américain Robert Jay Lifton, qui a travaillé sur les médecins nazis, avait parlé du meurtre du moi, l’expression est juste.
Le meurtre du moi est-il un suicide ? Est-ce le parti nazi ou l’Angkar chez les Khmers rouges qui amène le tortionnaire en devenir à se nier ?
Là encore, il faut penser l’articulation entre l’individuel et le collectif. Effectivement, chez les Khmers rouges, c’est l’Angkar qui veut construire un homme nouveau avec une idée de la psychologie nouvelle exprimée dans les maximes du genre «éteignez vos cœurs», etc. On façonne des individus. Mais isolément, les individus veulent surmonter l’humain, la faiblesse. Douch va surmonter ce qui est déplaisant. Il va agir en conscience, c’est-à-dire faire son boulot sans état d’âme, voire avec beaucoup de zèle. Il ne faut pas mollir, pas faiblir. Avoir des états d’âme, ce n’est pas être un bon Khmer rouge. Lui-même donnait des leçons de déshumanisation, en quelque sorte. Ces tortionnaires veulent tuer l’humain en eux. La question de la responsabilité individuelle versus responsabilité collective est bien sûr une question de juriste, mais je voulais la traiter car cela concerne aussi le psychologique. Enfin, tous fonctionnent dans le clivage. Ils compartimentent leur vie. Quand Douch dirigeait S-21, des enfants étaient tués et, au même moment, il a eu trois enfants. La question lui a été posée, mais pour lui cela n’avait rien à voir.
Tous ont en commun une désempathie totale…
Certains sont devenus désempathiques très tôt, après une humiliation, un trauma. Pour d’autres, ça peut être plus tardif, mais tous auront à devenir désempathique pour tuer, torturer.
C’est «l’animalisation de la victime», comme l’a écrit l’historien Jacques Semelin (1)…
Oui c’est l’animalisation qui justifie également le zèle. Ils vont trouver toutes les raisons de détester l’autre. Ils sont obligés. Pour tuer, c’est l’indifférence dans ce type de contexte qui l’emporte plutôt que la haine. C’est vrai chez les nazis, les Khmers rouges ou les jihadistes. Cette totale indifférence est nécessaire pour tenir. Lorsque des torturés se mettent à parler à leurs bourreaux, en tentant d’établir une relation avec eux sur ce qu’ils vont faire après la séance, s’ils vont aller voir leur femme, serrer dans leurs bras leurs enfants, etc., les tortionnaires se remettent à torturer de plus belle, et souvent ils tuent. Pour eux, c’est insupportable. La désempathie est une nécessité psychique, une armure. C’est dur d’en sortir. J’ai été étonnée de voir comment Douch, lors des audiences au tribunal, redevenait le chef de S-21 quand il affrontait ses subordonnés au procès.
Est-ce pareil chez les nazis, chez les terroristes jihadistes ?
Ce sont des traits communs que l’on peut retrouver, en effet. Il y a la nécessité de cliver parce que si vous mettez en lien ce que l’on vous fait faire avec ce que vous êtes réellement, votre éducation votre passé, cela s’appelle la conscience unifiée. Et pour eux, c’est insupportable, c’est un danger.
C’est ce qu’a écrit Hannah Arendt au sujet d’Adolf Eichmann : «Qu’est-il arrivé à votre conscience ?»
Oui. C’est une question importante pour moi, que j’ai posée à Douch. Alors qu’il parle très bien français, il m’a dit qu’il ne la comprenait pas. J’ai vérifié avec l’expert cambodgien si cette incompréhension venait d’un facteur culturel, mais il ne s’agissait absolument pas de ça car nos discussions et nos échanges sur ce point précis ont été détaillés, contextualisés, traduits en khmer… Non, je crois qu’en lui posant cette question, je l’amenais dans une situation où il devait s’unifier, rassembler toutes ces parties clivées.
Douch a reconnu ses actes mais il n’y a pas chez lui de sentiment de culpabilité. Comment est-ce possible ?
Il a dit qu’il reconnaissait ses actes dans une responsabilité collective. Il a bien insisté sur cette question. Le sentiment de culpabilité s’accompagne d’une douleur psychologique, morale, d’une dépression. Pour certains, c’est très dangereux. Pour un auteur de ce type de crime, accéder à ce sentiment de culpabilité et à la pleine reconnaissance et conscience de ses actes, c’est très dangereux. Il y a des problèmes somatiques, des maladies, voire des suicides, comme si, inconsciemment, il y avait la connaissance que cela est périlleux et définitif. Douch a rencontré Dieu. C’est son nouveau système. Il est en prison. Il n’a aucune raison d’accéder à cette zone qui serait dangereuse pour lui.
Que voulez-vous dire quand vous écrivez que ces hommes sont «sur-adaptés» à leur environnement social, comme s’ils étaient «trop normaux».
Ils sont malades de la norme. Ils ont un besoin absolu d’être dans la norme du système. Ils veulent être tel qu’un autre les pense. Il y a un énorme besoin de reconnaissance qui va les amener à être extrêmement obéissants d’une manière aveugle. Douch obéit à ses maîtres à l’école, à ses supérieurs dans la clandestinité, puis à la machine de mort khmère rouge, et après il se convertit au christianisme, en convainquant quatorze familles d’en faire autant. Il devient un super chrétien. La dernière obéissance, c’est avec le tribunal. Il a absolument bien collaboré, obéi toute sa vie.
(1) Purifier et détruire, Seuil, 2005, 492 pp., 24,30 €.





 Murièle Modély est née en 1971 à Saint-Denis, île de la Réunion. Installée à Toulouse depuis une vingtaine d'années, elle écrit depuis toujours, essentiellement de la poésie qu’elle publie régulièrement sur son blog :
Murièle Modély est née en 1971 à Saint-Denis, île de la Réunion. Installée à Toulouse depuis une vingtaine d'années, elle écrit depuis toujours, essentiellement de la poésie qu’elle publie régulièrement sur son blog : 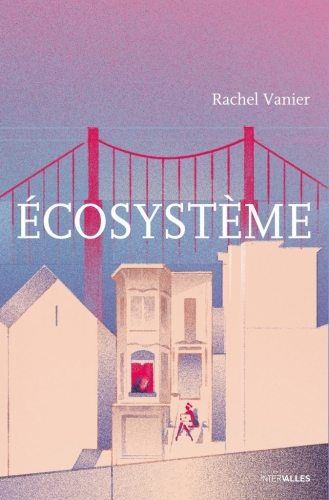
 Rachel Vanier est née à Budapest en 1988. Après avoir grandi à Lille, fait ses études à Paris, s’être échappée à Boston puis avoir crapahuté au Cambodge, elle travaille dans le monde non moins dépaysant de l’innovation et des start-up. Après le remarqué
Rachel Vanier est née à Budapest en 1988. Après avoir grandi à Lille, fait ses études à Paris, s’être échappée à Boston puis avoir crapahuté au Cambodge, elle travaille dans le monde non moins dépaysant de l’innovation et des start-up. Après le remarqué 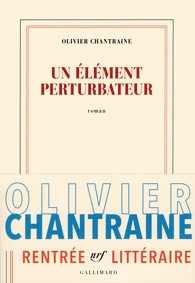
 Olivier Chantraine travaillait comme responsable de l’innovation pour une multinationale agroalimentaire, qu’il a quitté saturé « de l’inculture, de l’obsession de la performance et de la surenchère des chiffres » pour un retour aux sources en 2013, dans les Alpilles. Il y crée la biscuiterie artisanale bio A & O. « Une entreprise humaniste avec un modèle d’économie durable. Plus proche de mes convictions », confie-t-il. Le moyen, surtout, de donner enfin une chance à l’écrivain qui attend sagement son heure depuis l’adolescence. Un élément perturbateur est son premier roman.
Olivier Chantraine travaillait comme responsable de l’innovation pour une multinationale agroalimentaire, qu’il a quitté saturé « de l’inculture, de l’obsession de la performance et de la surenchère des chiffres » pour un retour aux sources en 2013, dans les Alpilles. Il y crée la biscuiterie artisanale bio A & O. « Une entreprise humaniste avec un modèle d’économie durable. Plus proche de mes convictions », confie-t-il. Le moyen, surtout, de donner enfin une chance à l’écrivain qui attend sagement son heure depuis l’adolescence. Un élément perturbateur est son premier roman.







 Rachel Vanier est née à Budapest en 1988. Après avoir grandi à Lille, fait ses études à Paris, s’être échappée à Boston puis avoir crapahuté au Cambodge, elle travaille dans le monde non moins dépaysant de l’innovation et des start-up. Elle est aujourd'hui en charge de la communication du campus de start-up STATION F.
Rachel Vanier est née à Budapest en 1988. Après avoir grandi à Lille, fait ses études à Paris, s’être échappée à Boston puis avoir crapahuté au Cambodge, elle travaille dans le monde non moins dépaysant de l’innovation et des start-up. Elle est aujourd'hui en charge de la communication du campus de start-up STATION F. 
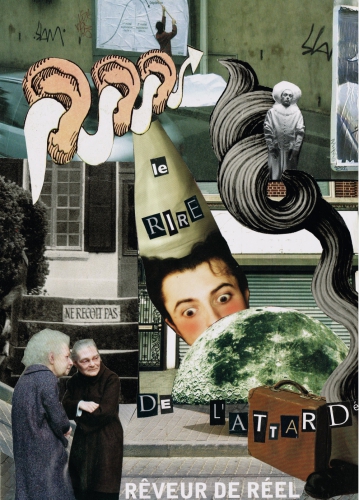

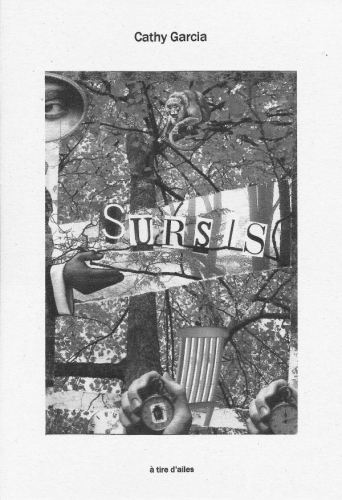


 Guiomar de Grammont est née à Ouro Preto où elle enseigne à l’université. Elle y a créé le Forum des Lettres. Elle est l’auteur d’un essai sur le sculpteur baroque Aleijadinho. Elle a reçu le prix Casa de las Américas pour un de ses recueils de nouvelles et le prix Pen Club du Brésil 2017 pour Les ombres de l’Araguaia. Elle est traduite en français pour la première fois.
Guiomar de Grammont est née à Ouro Preto où elle enseigne à l’université. Elle y a créé le Forum des Lettres. Elle est l’auteur d’un essai sur le sculpteur baroque Aleijadinho. Elle a reçu le prix Casa de las Américas pour un de ses recueils de nouvelles et le prix Pen Club du Brésil 2017 pour Les ombres de l’Araguaia. Elle est traduite en français pour la première fois.