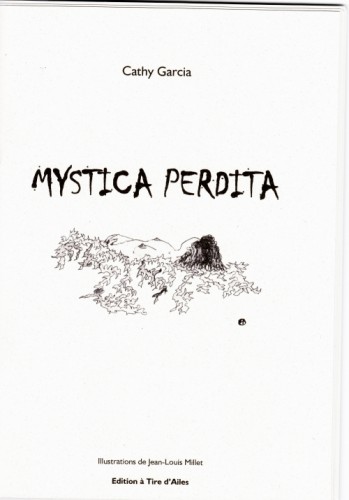manifeste pour une désobéissance générale
Ne sauvons pas le système qui nous broie !
« Aujourd’hui, c’est l’empire des multinationales qui implose sous nos yeux, et la plupart continuent à se lamenter plutôt que de mettre en place une société où la solidarité et le bien commun seraient restaurés. Il s’agit de rompre avec un système qui nous détruit et de bâtir des collectivités et un environnement où il nous sera donné de commencer à vivre. […] En dépit de la répression meurtrière, des exactions et des tortures, la résistance n’a pas cessé à Oaxaca. Le feu est entretenu sous la cendre. Le mouvement des barricadiers, des libertaires et des communautés indiennes s’est débarrassé des ordures gauchistes – lénino-trotskysto-maoïstes – qui prétendaient récupérer le mouvement. Les choses sont claires et quand le combat reprendra, il sera sans crainte et sans ambiguïté. En revanche, en Europe, où l’on ne fusille plus personne, ce qui domine c’est la peur et la servitude volontaire. Le système financier s’écroule et les gens sont encore prêts à payer leurs impôts pour renflouer les caisses vidées par les escrocs qu’ils ont portés à la tête des États. Ici, à la différence d’Oaxaca, les citoyens élisent le boucher qui les conduira à l’abattoir. »
Raoul Vaneigem, octobre 2008
« Les mots nous divisent, les actes nous unissent. »
Tupamaros (Uruguay)
Depuis des décennies, les dirigeants de la planète sèment un vent mauvais. L’instabilité des vies des individus, ballottés entre un présent peu satisfaisant et un no future érigé en idéal de la soumission a été, pour « nos » dirigeants, ainsi que celles et ceux qui les servent, une excellente façon d’asseoir leur domination, ôtant aux individus toute perspective d’avenir sûr. Tel est le fond de la thèse du dernier livre de Naomi Klein, qui affirme que nous sommes entrés dans l’ère de « la stratégie du choc », selon son titre même : le système soumet les populations à des catastrophes sociales, économiques et guerrières répétées, désorganisant la vie des individus, lesquels ne cherchent plus qu’à se préserver du mieux possible des drames alentour. C’est le chacun-pour-soi généralisé, sous prétexte de sauver encore les médiocres avantages que nous espérons conserver contre toute évidence. Cette thèse est étayée avec beaucoup plus de brio dans Catastrophisme. Administration du désastre et soumission durable, de René Riesel et Jorge Semprun, dont le titre dit avec exactitude ce qu’est l’époque dans laquelle nous nous engouffrons. Il est temps, aujourd’hui, que « nos » dirigeants soient balayés par la tempête qu’ils annoncent.
Ce système aboutit à la misère de deux ou trois milliards d’êtres humains, selon les statistiques des organismes officiels eux-mêmes ; 963 millions de personnes étaient sous-alimentées en 2008, soit 120 millions de plus que trois ans auparavant. Cette misère est liée au système économique bien sûr, aux transnationales sans aucun doute. Elle a des conséquences non seulement sociales et individuelles, mais aussi culturelles, écologiques – par exemple, c’est bien la misère des paysans du Nordeste qui les pousse à participer à la dévastation de l’Amazonie –, et ainsi de suite. Dans le même temps, les alternatives semblent incertaines, ou peu crédibles. La fin et surtout le refus de la croissance sont encore loin d’être acceptés dans la pensée politique ici, pour ne rien dire des États-Unis ou de la Chine. Quant aux réformes profondes, qui prônent une redistribution totale des cartes sur un mode humaniste radical, elles semblent à beaucoup d’entre nous irréalistes.
Pourtant, il n’y a rien là d’extraordinaire. Ce système nous a proposé jusqu’à maintenant d’accumuler, de vivre à fond dans l’avoir. Et il a acheté notre complicité, alors que des êtres humains n’avaient même pas la possibilité de vivre décemment. Cette misère s’étend à tout être vivant. La terreur d’État, l’asservissement industriel, l’abêtissement capitaliste et la misère sociale nous frappent tous et toutes. Insidieusement et continuellement, ces forces néfastes séparent notre être intime. Une partie de nous se voit subrepticement contrainte à être le bourreau de notre autre moi, celui qui rêve, sait et veut que ce monde ne soit pas celui-là. Combien d’entre les citoyens tentent difficilement de défaire la nuit ou pendant leur maigre temps libre ce dont ils ont été complices chaque jour travaillé ?
Ce mépris dans lequel nous tient le système est essentiel, comme est fondamentale la négation de nos envies authentiques au profit d’un seul désir : consommer. Or, avec le krach, possible ou probable voire proche, de l’économie, il s’agit maintenant d’être, et de nous passer de ces avoirs frelatés. Car le système, dans les mois qui viennent, va se montrer de plus en plus incapable de satisfaire nos simples besoins, même de produits empoisonnés.
Au moment où la perspective de l’implosion du système capitaliste devient enfin plausible, dans la mesure où la consommation qui semble la condition de son maintien, est en train de chuter, il s’agit d’accompagner son effondrement et de s’organiser en « communes » qui privilégient l’être à l’avoir (parce qu’il n’y a plus rien à attendre de l’État, comme le montre l’analyse des démocratures sud-américaines qui suit), et offrent la possibilité à chacun d’entre nous d’accéder librement (en limitant dans la mesure du possible les échanges d’argent) à la nourriture, au logement, à l’éducation, et à une activité choisie.
Des « démocratures » annoncées par l’histoire politique et sociale de l’Amérique latine entre 1970 et 2000
Qu’y aura-t-il demain à la place du système actuel ? Ne soyons pas naïfs, le système politique en place a déjà construit sa réponse. Il s’est doté en France (aux États-Unis et dans la plupart des pays d’Europe) depuis les années 1980 d’une législation spéciale dite antiterroriste qui l’autorise à se passer désormais de la « justice ». Dans le même mouvement, il a déjà effectué le transfert de ses moyens de sa main gauche à sa main droite : de la main qui soigne à celle qui punit, des services sociaux et hospitaliers aux bons soins de la police et de la prison. Nous sommes entrés, déjà, dans une période d’interpellations arbitraires, de comparutions immédiates suite à des manifestations, ou encore de condamnations à des amendes disproportionnées.
Le système est donc prêt à fonctionner, d’autant qu’il a déjà été testé grandeur nature en Amérique latine dans les années 1970-2000. On se contentera de tracer les grands traits d’une analyse de la dictature démocratique, ce qu’Eduardo Galeano appelle la « démocrature », une dictature ayant l’apparence formelle de la démocratie (élections libres, notamment). Pour plus de détails, nous renvoyons, encore, à Naomi Klein, René Riesel et Jorge Semprun, Angela Davis et ses Goulags de la démocratie, ou d’autres analyses prenant en compte l’évolution récente du système capitaliste, sur un mode non paranoïaque – car nous refusons les théories du complot qui n’effleurent que la superficie des choses, tout en anticipant la défaite et « justifiant » ainsi le refus préalable de livrer combat.
En 1973, Augusto Pinochet et l’armée chilienne, puissamment aidés par la CIA, ont mis à bas un régime qui était de toute façon devenu impopulaire – il ne faut pas oublier que Allende n’avait pas su gagner à lui de larges secteurs de la population pauvre des grandes villes. Ce qui nous intéresse surtout est que Pinochet a mis en place une Constitution conforme à sa dictature, mais qui permettait aussi de repasser à la « démocratie », et cela sans remettre jamais en cause le système économique chilien. Le Chili est en effet une réussite en Amérique latine du point de vue du système économique, puisque le pays est passé sans encombres d’une dictature musclée à une démocratie. C’est une leçon que n’oublient pas Sarkozy, Berlusconi et tous les autres : on peut passer de la démocratie à la dictature puis à la démocratie sans que cela gêne en quoi que ce soit le système économique. Point fondamental dans une société où le seul horizon que les dirigeants offrent aux masses est de travailler pour produire pour consommer. Dans les années 1990, deux pays firent l’expérience inverse de celle du Chili : l’Argentine et le Pérou.
En Argentine, Carlos Menem fut élu en 1989, fit modifier la Constitution qui ne prévoyait qu’un seul mandat pour être réélu en 1995. Il ne quitta le pouvoir qu’à reculons en 1999, après avoir mis le pays à sac. Menem ne vit plus en Argentine, et, jouant le rôle trop théâtral du bon dictateur désavoué par un peuple ingrat, a pris la route de l’exil doré – comme le Péruvien Fujimori, le Zaïrois Mobutu ou le Mexicain Salinas de Gortari. L’étonnant dans le cas Menem est qu’il a pu procéder comme un véritable dictateur tout en étant élu et réélu de manière démocratique. Tel est son tour de passe-passe réalisé de façon magistrale. Plus besoin de coup d’État pour faire parvenir au pouvoir des oligarchies aux vues étroites qui servent les intérêts de groupes extrêmement restreints. Mais la démocratie n’est rien sans la volonté républicaine, au sens étymologique du terme, res publica, « chose publique », c’est-à-dire un pouvoir exercé au nom de tous, pour leur intérêt. Or, il y a bien longtemps désormais que la démocratie n’est plus républicaine : les élections ne sont plus qu’un rite creux, lors duquel on nous demande de choisir entre l’un et l’un, ou l’autre et l’autre, tandis que les intérêts de tous – la res publica – sont constamment bafoués par la tyrannie économique et le profit de quelques-uns.
Au Pérou, Alberto Fujimori fut élu en 1990, réélu en 1995 et encore en 2000 – après avoir dû modifier la Constitution et avoir été accusé de corruption, de pratiques électorales frauduleuses, etc. Peu importe : aucun argument n’a atteint le tyran, car il en fut bien un. Fujimori a tiré argument de la lutte contre le terrorisme et le narcotrafic pour faire avaliser des pratiques illégales, de la part de l’armée et des escadrons de la mort – militaires ou paramilitaires –, allant jusqu’à l’assassinat collectif d’étudiants, par exemple. La torture est redevenue sous son règne monnaie courante dans cette démocratie d’Amérique du Sud. La démocratie au Pérou n’a pas été « remise en cause », pas plus que la démocratie américaine après les actes inhumains commis par des militaires à Abou Ghraïb ou à Guantanamo. Il nous faut réfléchir à ces faits fondamentaux, et suivre Angela Davis dans Les Goulags de la démocratie lorsqu’elle constate que la démocratie s’accommode d’actes qui n’ont rien à voir avec l’idée que l’on peut se faire d’un peuple exerçant son propre pouvoir sur lui-même…
Un système total-démocrate peut-il s’imposer aussi en France ?
Et en France ? « La démocratie ne fait pas toute la légitimité d’une république. Un pouvoir tyrannique peut se mettre en place démocratiquement. Depuis des années, il est déjà à l’œuvre pour des catégories de population telles que les habitant-e-s des quartiers (pourtant déclarés sensibles), les sans-papiers, la jeunesse dans son ensemble – et n’oublions pas que l’âge de la responsabilité pénale vient d’être porté à douze ans tandis que le dépistage de la déviance commence à la maternelle ! L’histoire comme on sait ne se répète pas et les formes de totalitarisme à venir sont forcément inédites. Nous sentons bien qu’une nouvelle sorte de régime politique, insidieusement, se met en place. Quand, à l’heure du laitier, un journaliste est brutalement interpellé chez lui, devant ses enfants ; quand des enfants innocents sont arrachés de l’école et renvoyés dans leur pays d’origine ; quand une association caritative est condamnée à de lourdes amendes pour être venue en aide aux sans abris ; quand… » Tel est le constat de Jacky Dahomay, professeur de philosophie à la Guadeloupe, démissionnaire du Haut-Conseil à l’Intégration.
Certains diront qu’il existe encore des contre-pouvoirs, que l’on peut « faire confiance » à nos concitoyens, à nos qualités d’humanité, que les pouvoirs quels qu’ils soient n’ont pas encore réussi à extirper. Il serait facile d’allonger la liste de ces exhortations pieuses qui reposent sur quelle analyse ? Car, faire confiance a priori aux êtres humains, aux Français et aux autres, au moment même où ils sont le plus gangrenés, isolés, acculturés, par des conditions de travail et d’éducation dégradées et par la télévision et l’Internet qui déversent leur message de consommation à outrance est de plus en plus difficile – c’est d’ailleurs une des clés de la réussite de ce système qui nous oppresse –, et à la fois dangereux et injustifiable.
Vers un monde totalitaire et mortifère ?
Le système actuel représente le danger majeur, celui de la continuation de cet existant qui détruit la planète, qui nie les vies humaines, qui insuffle dans nos esprits les relents mortifères de l’individualisme jusqu’à la désintégration du corps social. Le système n’est pas en train de s’effondrer du fait de notre contestation ou de quelque cause qui lui serait externe. Ce que nous vivons en 2009 est l’effondrement du système sous le poids de ses propres contradictions. Pensons par exemple à la crise écologique, qui est née de l’explosion de la consommation couplée à la nécessité de produire à bas prix, donc en ne respectant aucune des limites qu’impose la préservation de notre environnement.
Bien entendu, le système n’a pas une seule carte à jouer, celle de la dictature. Il espère par exemple que le « réalisme » l’emportera dans les familles et que nous nous contenterons d’une vie au rabais, comme les Français des années 1940-1944 soumis aux restrictions des libertés et de la nourriture. Les États engagent aussi une course effrénée au « capitalisme vert », à cette écologie à la Al Gore, qui espère ou prétend que nous pouvons sortir de tous les gouffres à la fois – écologique et économique, financier et social – en devenant tous de bons petits citoyens écolos, capables de réduire leur consommation, de se serrer la ceinture et de laisser nos élites actuelles continuer à nous diriger, et à voyager en avion de congrès en symposium. Il faudrait dans ce cas que tout se passe sans heurts et que nous réprimions la montée de nos envies contestataires, au nom de la survie du vaisseau planétaire… que nos élites elles-mêmes conduisent dans le mur.
Là encore, nous pourrions allonger la liste des « solutions » qui s’offrent au système. N’oublions pas d’en citer encore une, la guerre, tout simplement, car un bon moyen pour les États-Unis d’effacer leur dette serait de faire comme l’ont toujours fait les États endettés : refuser de payer leurs créanciers. C’est ainsi que le Régent, en France, a renfloué les caisses du Trésor grâce à la banqueroute de Law – c’est-à-dire la faillite des bourgeois créanciers du Trésor royal. Mais le hic, aujourd’hui, est que les créanciers des États-Unis s’appellent la Chine et les pays arabes producteurs de pétrole ; refuser de les rembourser de façon unilatérale, cela signifie sans doute la guerre. En temps de guerre, la dictature s’imposerait d’elle-même… D’ailleurs, le capitalisme vert dans sa version la plus crédible est dictatorial : imposition sans discussion de nouveaux critères de consommation, que seuls les puissants pourront ne pas respecter, s’assurant ainsi, comme toujours, la position dominante et le pouvoir réel sur l’emploi de nos vies.
Il faut donc œuvrer à l’effondrement rapide de ce système. On peut espérer que cet effondrement aboutira de fait à des recompositions des solidarités, à des niveaux locaux et non plus transnationaux – les AMAP (associations pour le maintien d’une agriculture paysanne), les SEL (systèmes d’échanges locaux), les jardins solidaires en sont quelques exemples. On peut envisager que les individus et les groupes sociaux chercheront enfin à sortir du système qui ne pourra même plus satisfaire les envies qu’il suscite pour subsister – car la consommation est le moteur de la croissance, mais pas seulement : elle est le boulet au bout de notre chaîne qui nous attache à la conservation de nos « avantages » (mal) acquis, envers et contre tout.
Au lieu de ce monde mortifère et bientôt dictatorial, nous nous entendrons ensemble, sur place, découvrant à la fois notre capacité à nous organiser et en même temps l’impossibilité de compter sur un système failli. Ce peut être du rêve que de penser cela. Une utopie ! Quoi qu’il en soit, avant l’effondrement, il serait dramatique d’y renoncer d’emblée. Déclarer le combat perdu avant même de l’engager reviendrait à souhaiter que, d’une façon ou d’une autre, ce système perdure, avec son cortège d’iniquités, de destructions, d’inhumanité. C’est pour cela que nous devons retrouver la confiance perdue en nos propres utopies. Ce n’est pas de « croyance » dont il s’agit ici, mais plutôt de construction d’un futur à la fois utopique et réaliste.
Non-coopération intégrale !
Désobéissance civile généralisée !
Les dernières décennies ont été fécondes en luttes diverses partout dans le monde. Certaines peuvent nous inspirer dans le contexte actuel. En Uruguay, les Tupamaros avaient lancé comme slogan, au début des années 1970, « Les mots nous divisent, les actions nous unissent ! » C’est un excellent début. En France, et sans doute dans d’autres pays d’Europe, nous pourrions peut-être sortir de nos éternelles manies de cogitations stériles et à perte de vue, qui n’entraînent entre nous que des divisions microscopiques. On dirait que nous prenons un malin plaisir à chercher ce qui nous divise et nous singularise plutôt que ce qui pourrait nous réunir dans une action contre un ennemi commun. Tel est le fond du problème : nous imposer en tant qu’individu singulier, même si le prix est de ne pouvoir coopérer dans nos luttes. Or, nous avons un ennemi commun sans nul doute, du moment que nous le désignons ainsi : la dictature qui monte et qui, de jour en jour, nous force de fait à coopérer avec elle pour sauver de médiocres avantages matériels.
Le pouvoir cherche à nous faire adhérer de fait, par de petites renonciations, à sa politique. Ce n’est pas entièrement nouveau, peut-être, mais ça l’est quand même dans la mesure où la situation économique, sociale et politique se dégrade, pour le pouvoir et pour l’État d’une façon brusque et rapide. Il est donc amené à resserrer les rangs. Ainsi, dans l’Éducation nationale, les enseignants et les chefs d’établissement sont forcés d’appliquer des circulaires diverses dont ils ne veulent pas et sur lesquelles ils n’ont pas été consultés.
Puisque l’État exige notre soumission…
Les personnels des services sociaux se retrouvent face aux mêmes contraintes, en gros gérer – c’est bien de cela qu’il s’agit – le cheptel humain défavorisé avec des moyens de plus en plus réduits. Ces fonctionnaires comprennent bien désormais que c’est sur leur humanisme et leur dévouement que l’État compte pour faire passer ses propres mesures antisociales. C’est un réalisme du pire : « On ne peut pas faire mieux et ça pourrait bien être pire. » Réalisme de pacotille, mais formidablement efficace dans un contexte catastrophiste de prétendue guerre économique, de restriction des subventions et des crédits sociaux tous azimuts.
Autre exemple : dans les centres de rétention des aéroports dans lesquels attendent les expulsés, les bénévoles des associations les moins compromises avec l’État, sa police et son Ofpra, sont aux prises chaque jour avec ce dilemme. Les bénévoles de l’Anafé et de la Cimade doivent continuer à aider les migrants sans papiers tout en sachant que la majorité d’entre eux seront expulsés, ou cesser la mascarade mais alors abandonner les migrants à leur triste sort. On pourrait multiplier à l’infini les exemples. Chacun sent confusément ou précisément cette montée de la demande de l’État, qui exige, mais en douceur, que nous consentions à ses décrets et lois, de plus en plus iniques.
Il convient ici de rappeler que le processus, dans l’Allemagne nazie, a été exactement du même ordre. Les « ennemis de l’État », les juifs et autres « ennemis » de la prétendue race aryenne n’ont pas été conduits directement en camps de concentration et d’extermination. Le cas des juifs est exemplaire : ils ont d’abord été contraints de s’identifier en tant que juifs, de se déclarer, puis spoliés de leurs biens, avant d’être contraints à quitter leurs domiciles, puis leur ville de résidence pour être confinés dans certains quartiers, dans des ghettos puis expédiés dans des camps, d’abord de concentration, et enfin exterminés comme on le sait. Le processus, on ne devrait pas l’oublier, a été graduel et non brutal. D’ailleurs, tout avec Hitler fut graduel ; c’est Mussolini qui a avancé le plus brutalement.
De nos jours, en France et en Europe, le modèle est bien l’organisation dictatoriale avançant pas à pas, légiférant sans cesse et créant de multiples étages administratifs dans le but de mettre en œuvre sa politique en divisant et en répartissant les tâches ignobles, les faisant ainsi accepter par la majorité. La dictature qui se profile s’avance en tâchant de ne pas nous laisser la moindre possibilité de refus. Le système s’est attelé depuis longtemps à modeler la langue pour qu’elle serve à domestiquer les esprits. Dans son ouvrage, LQR, la propagande du quotidien (pour Lingua Quintae Respublicae), Éric Hazan analyse la langue de la Cinquième République et rend hommage aux analyses de Victor Klemperer, qui dans un essai sur la langue du III e Reich, paru en 1947, expliquait comment la propagande nazie avait pu s'insinuer dans toutes les couches de la population allemande et rendre acceptable l'inacceptable. Il montre ainsi comment « par imprégnation lente, la langue du néolibéralisme créée et diffusée par les publicitaires et les économistes, reprise par les politiciens et les journalistes, est devenue l’une des armes les plus efficaces du maintien de l’ordre ».
C’est la même politique que le « Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous » de George W. Bush au moment de la guerre en Afghanistan puis contre l’Irak en beaucoup plus subtil !
… refusons de nous soumettre !
La réponse à apporter se dessine d’elle-même : non-coopération radicale à partir de maintenant avec le pouvoir. Refusons dès maintenant d’appliquer les lois et de mettre en œuvre la politique qu’il nous impose, que nous soyons fonctionnaire, cheminot, enseignant, policier, magistrat, élève ou étudiant, ou encore que nous travaillions dans le privé, car là aussi nous devons appliquer des politiques ignobles, cela dans à peu près tous les secteurs, y compris dans l’édition, prétendu bastion culturel.
Pour cela, nous pouvons nous inspirer du mouvement de désobéissance civile mis en œuvre en Inde par tous ceux qui ont voulu chasser les Britanniques de leur pays dans les années 1920-1947. Durant toutes ces années, des Indiens ont refusé de payer l’impôt sur le sel, de remplir les tâches administratives imposées par les Britanniques, ou d’acheter des marchandises fabriquées au Royaume-Uni. cela n’a pas suffi à obtenir le départ des Britanniques d’Inde, puisqu’il a fallu attendre la fin de la guerre pour que Londres, subissant la pression idéologique et diplomatique des États-Unis, soit contraint de liquider son empire colonial. Mais, de nos jours, le contexte est différent, et il est plus favorable. Nous vivons dans un pays dominant ; nous n’avons pas à lutter, comme les Indiens de la première moitié du xxe siècle, contre l’illusion que le progrès viendrait de la puissance coloniale installée chez nous – illusion qui a tant retardé la mise en marche du monde indien vers la liberté, comme l’explique Nehru dans La Découverte de l’Inde, ou encore Tagore dans Vers l’homme universel. Sans oublier que le pays n’avait jamais été vraiment uni dans les siècles précédent la domination britannique.
En France, la situation est très favorable à l’extension de la désobéissance généralisée. Elle se développe d’ailleurs chez tous ces professeurs ou directeurs d’établissements scolaires qui refusent d’appliquer les directives gouvernementales, à commencer par celles qui concernent le fichage administratif et policier des élèves, ou encore l’installation de dispositifs biométriques pour contrôler l’accès aux cantines. Cette désobéissance est aussi celle des autoréducteurs qui récupèrent gratuitement dans les supermarchés des marchandises qu’ils redistribuent aux pauvres et aux sans-abri qui en ont un besoin impérieux. Et elle est en germe ou fleurit dans nombre de luttes des sans-abri, dans la lutte permanente des squatteurs, dans le mouvement de 1995 et dans l’embrasement de 2005. La désobéissance se généralise sous nos yeux ! Et si parfois nous nous trompons de colère, n’oublions pas qu’elle existe et sourd partout et à tout moment dans chaque cœur de tout citoyen du monde qui a maille à partir avec les pouvoirs. Faisons savoir que, décidément, nous refusons dès maintenant d’appliquer les mesures dictatoriales ou pré-dictatoriales que le gouvernement fait voter presque chaque jour.
Nous appelons les individus qui n'acceptent plus les faux semblants démocratiques à désobéir aux lois injustes qui criminalisent le mouvement social et enferment nos camarades, à déserter les partis et les organisations qui collaborent avec les démocratures en place, à préparer la grève générale et à se joindre à toutes les actions de démonstration de force, dans la rue et ailleurs. Saisissons toutes les occasions pour construire au quotidien, dans les rencontres et dans la lutte, l’outil dont nous avons besoin pour mener nos actions. Parti pour certains, syndicat, coordination ou organisation révolutionnaire pour d’autres, peu importe si l'objectif de ces formes politiques est d'établir la démocratie directe que le pouvoir en place et les capitalistes craignent bien plus que la dictature policière et militaire qu'ils préparent activement. Agissons dès maintenant en profitant du peu de liberté qui nous reste, pour construire ensemble par la grève générale cette démocratie directe qui nous permettra de nous regrouper, de lutter, de nous organiser et de vaincre.
Sous-Comité décentralisé
des gardes-barrières en alternance
sccdgbea@free.fr
Petite bibliographie
Angela Davis, Les Goulags de la démocratie, Au diable vauvert, 2006.
Edouardo Galeano, Sens dessus dessous. L’école du monde à l’envers, Homnisphères, Paris, 2004. ???
Éric Hazan, LQR, la propagande du quotidien, Raisons d’agir, 2007.
Naomi Klein, La Stratégie du choc : la montée d'un capitalisme du désastre, Actes sud, 2008.
Herbert Marcuse, Tolérance répressive, éditions Homnisphères, 2008.
Jawaharlal Nehru, La Découverte de l’Inde, Picquier, 2002.
René Riesel & Jorge Semprun, Catastrophisme. Administration du désastre et soumission durable, L’Encyclopédie des nuisances, 2008.
RabindranathTagore, Vers l’homme universel, Gallimard, 1964.
Et aussi :
Big Brother Awards. Les surveillants surveillés, Zones, 2008.
Comité invisible, L’Insurrection qui vient, La Fabrique, 2007.
Patrick Chamoiseau & Édouard Glissant, Quand les murs tombent, Galaade Éditions (43 rue des Cloÿs - 75018 Paris), 2007.
Alain-Claude Galtié, Renversement et rétablissement de la culture conviviale, Pli Zetwal (Coppéré - 42830 St-Priest La Prugne), 2005.
Georges Lapierre (avec une préface de Raoul Vaneigem), La commune d’Oaxaca, chroniques et considérations, Rue des Cascades, 2008.
Raoul Vaneigem, Entre le deuil du monde et la joie de vivre, Verticales, 2008.