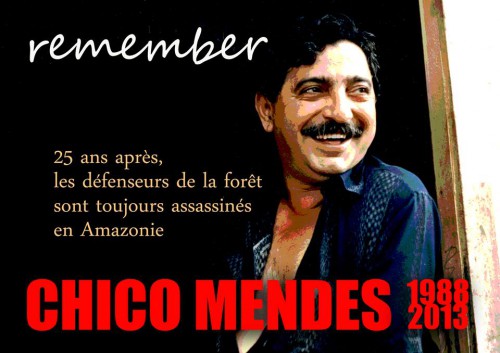Quelle est la genèse d’Ondinnok et comment êtes-vous venu au théâtre ?
Yves Sioui-Durand : Mon parcours est fait de bifurcations et zigzags : j’ai étudié la musique, avant de créer en 1985 mon premier spectacle au festival des Amériques, dont c’était la première édition. Si Catherine Joncas, ma compagne, est passée par le Conservatoire, je suis un dinosaure relativement autodidacte, passé d’abord par la musique.
Je n’avais pas décidé, à l’époque, de fonder une compagnie de théâtre. Les œuvres ont précédé l’organisation. Je n’ai jamais pensé que cela durerait vingt-cinq ans ! Une compagnie, pour moi, cela signifiait instituer quelque chose. Peut-être sommes-nous désormais devenus une institution en raison de notre persistance, sans pour autant que cela passe par une reconnaissance sociale ni une contrainte de production. C’est parce qu’il y a des œuvres à naître qu’il y a un futur.
« Compagnie », cela induit aussi l’idée de collectif, de troupe. Autour de Catherine Joncas et vous, une troupe s’est-elle constituée ?
Au départ, nous étions trois. Jean Blandin nous a rejoints dans un premier temps, mais a malheureusement très vite disparu. Nous avons connu bon nombre de collaborateurs attitrés : techniciens, musiciens…Mais il n’y avait pas d’acteurs autochtones au Québec au moment où j’ai commencé, ni d’école. Et cela n’a pas beaucoup changé. Ces dernières années, nous avons formé des acteurs avec l’École nationale de théâtre. Mais l’École ne s’est pas beaucoup investie, et nos institutions politiques autochtones ne sont pas très ouvertes à l’art et à la culture. Le théâtre, ils ne connaissent pas ! La colonisation politique et spirituelle pèse toujours, et nos leaders politiques ont beaucoup de misère à envisager la culture comme un moteur de civilisation essentiel pour survivre. Ils sont beaucoup plus axés sur les luttes politiques pour le territoire et les conditions de vie, parfois d’une dureté extrême, des communautés confrontées aux problèmes de drogue et de pauvreté.
C’est un paradoxe que cette fermeture à la culture telle que nous l’entendons. Les traditions culturelles des Amérindiens n’étaient-elles pas une condition de leur survie ?
Tout dépend de l’angle de la lunette d’observation ! Historiquement, des traditions ont perduré, mais pas chez tous les peuples autochtones. Ceux du Québec ont vécu un problème majeur : l’acculturation religieuse initiée notamment par les Jésuites de la Nouvelle France. La démonisation du chamanisme a détruit les traditions. Les peuples du Nord sont des chasseurs, dépendants du caribou. Il existe une relation évidente entre spiritualité et survie : le chamanisme est lié à la chasse. En le détruisant, les Jésuites ont atteint le cœur de cette culture, et la révolution industrielle a aggravé les choses : les Indiens n’étaient plus utiles comme au moment du commerce des fourrures. Ils ont été les dupes de cette économie de marché qui les appauvrissait et qui, à l’époque, a presque fait disparaître le castor, surchassé ! Les questions d’écologie sociale et culturelle se sont posées très vite : surchasser, c’est aller contre la tradition.
La création du Canada en 1877 a donné le coup de grâce avec la fin des guerres indiennes aux États-Unis et la sédentarisation forcée des Indiens du Nord. Il reste encore quelques groupes qui savent nomadiser, mais ils sont aliénés par la religion et la structure des réserves, et ne constituent que de petits groupes à l’intérieur des communautés.
Dans les années 1970, un cinéaste français, Arthur Lamothe, a réalisé sa filmographie sur les derniers grands nomades, particulièrement les Innus [1]. À l’époque, on a achevé de les déstructurer en enlevant les enfants pour les scolariser de force dans des pensionnats, où ils ont souvent été abusés sexuellement [2]. L’assimilation, l’extinction culturelle étaient programmées. Encore aujourd’hui, des procès sont intentés pour ces abus qui ont augmenté l’alcoolisme, le désespoir, et la coupure générationnelle. Cette tragédie conjugue le mépris de soi. Mon père était un chasseur, chrétien. Mon grand-père, christianisé, avait encore des pratiques rituelles. Comment aimer quelqu’un qui t’a élevé dans le catholicisme et qui ensuite t’a maltraité ? Pour connaître l’héritage, c’est très dur de passer le mur du père.
Donc, il a vous a fallu aller rechercher les traditions initiatiques avec lesquelles vous travaillez. Quelles voies avez-vous empruntées ?
Je suis un privilégié : je n’ai pas connu ces sévices. Je viens du monde des Iroquois [3], différent de celui des Innus, les Indiens de la forêt. Mon théâtre ne se relie pas à ma seule culture : il se veut le théâtre des autochtones à travers le monde.
Nous sommes des cultivateurs de maïs, en lien avec un axe nord-sud qui va du Guatemala de l’ère maya jusqu’aux Grands Lacs au Nord, jusqu’au Chili au sud. Très peu de gens considèrent l’histoire de l’Amérique en fonction de ces niches écologiques !
Les Iroquois ont réintroduit les grandes cérémonies interdites par le gouvernement canadien de 1890 à 1947 et sont revenus à leur structure fondée sur ce que l’on appelle la Longue Maison [4]. Le concept est celui d’une seule famille : on vit tous ensemble dans la même maison, organisée autour d’un feu. Et notre structure de décision s’appelle aussi la Longue Maison : c’est un Parlement, lieu de prise de décision par consensus – dont on dit qu’il a influencé la constitution américaine ! –, très organisé pour l’époque et basé sur les différents clans représentés par des hommes eux-mêmes nommés par les femmes. Il s’agit d’un système matrilinéaire, les chefs sont les porte-parole des femmes.
Je viens d’achever un travail avec les Mayas du Guatemala sur un texte précolombien, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, dont les fondements remontent plus loin que la tragédie grecque. C’est l’ultime vestige de l’existence d’un théâtre amérindien, de formes traditionnelles qui ont chacune leurs caractéristiques, liées à des mythologies ou des drames ritualisés. Je me situe dans le sillon de ces grandes traditions. Je suis remonté à la source, avec une forme théâtrale qui date peut-être de 2000 av. J.-C., et un texte dont l’argument se situe juste avant l’arrivée des Espagnols, entre 1100 et 1300. Pour moi, c’est extraordinaire : quand j’ai commencé, je cherchais les racines d’un théâtre amérindien, qui existe !
Ma première pièce s’intitulait Le Porteur des peines du monde. Les autochtones de toutes les Amériques n’avaient pas d’animaux de trait, à l’exception des lamas. Le portage, l’homme qui porte, est un archétype fondamental. Le Soleil est vu comme un portageur. Dans le calendrier maya, chaque jour est un soleil, chaque soleil un esprit qui porte le monde plus loin. En espagnol, on dit : « cargar días », celui qui va prendre le poids du monde. Le chef, c’est celui qui prend la charge de son peuple pour l’emmener plus loin. Donc Le Porteur, dès le départ, collait à cet archétype.
C’est un archétype que l’on retrouve dont bon nombre de mythologies : on pense à Chronos…
Cela vient de la grande histoire du peuplement de l’humanité, de l’Asie à l’Amérique, qui s’est faite à pied ou à dos d’âne, enracinée dans le corps de l’homme américain. Encore aujourd’hui, si tu voyages avec les Indiens en canoë, inévitablement le portage s’impose. Dans la fonction sociale ritualisée, les chefs traditionnels de la culture maya urbaine de l’époque classique étaient ceux qui portaient la responsabilité de l’empire, en lien avec le Cosmos. Un rituel populaire a survécu dans les villages mexicains et guatémaltèques : les conseils indiens font une cérémonie de transmission du cargo, de la charge.
J’ai joué Le Porteur des peines du monde dix ans d’affilée et il m’a fallu tout ce temps pour comprendre la métaphore spirituelle qui se jouait là. J’avais touché une racine du grand alphabet mythologique des Amérindiens, une fonction non de rédemption, mais de renaissance. Pour renaître, il faut être capable de mourir à soi.
Dans l’alphabet mythologique des Trois Amériques, un principe fondamental est de mettre les morts à la bonne place. Tu ne peux pas prendre la mort de tes ancêtres sur ton dos, tu ne peux pas racheter l’histoire, il faut faire la paix avec les morts pour pouvoir avancer. C’est le problème des peuples autochtones du Canada et des Amériques en général face à la conquête. Comment transcender la souffrance qui vient de la conquête, du viol, de la dépossession, de la colonisation ? Le malaise de l’autochtone fait vivre le système global : on n’essaie donc pas de le régler. La seule façon de sortir de l’aliénation, c’est de retrouver une autonomie de pensée.
Le théâtre est le lieu pour cela, pour tout groupe humain. L’une de ses fonctions, c’est d’ouvrir cette brèche. De déjouer ce qu’on nomme le connu pour réénoncer le début du monde. Comment sommes-nous devenus humains ? Quels sont les liens entre le Dieu et l’homme, entre les hommes entre eux, entre les hommes et les animaux, les hommes et les esprits des ancêtres, cette famille liée au territoire ? En iroquois, on dit Onkwéonwé et on traduit « les êtres humains ». De même que Innu ou Inouit signifie « être humain ».C’est ainsi que se définissent la plupart des groupes humains ! Mais c’est un sens restrictif. On touche là une autre lettre de l’alphabet universel profond : qu’est-ce qui nous fait humain ? Le nom des peuples désigne à la fois l’humain et sa terre : l’homme et le lieu sont indissociables. On ne peut définir l’homme sans le lieu.
Dans ce que vous décrivez, on retrouve des fondamentaux du théâtre que l’on aimerait revoir partagés. À une époque où le théâtre est devenu spectacle et le spectateur, passif, comment votre travail peut-il s’accommoder des lieux et des dispositifs habituels ?
C’est la grande question. J’ai joué Le Porteur des peines du monde en extérieur, dans un terrain vague à Montréal, pour rapatrier un territoire originel, mais ce choix restait un peu inconscient. Je ne maîtrisais pas tout ce que je mettais en jeu. Nous connaissons une surabondance du spectaculaire ; je travaille de façon très consciente depuis quelques années contre le spectacle et sa structure préexistante. Dans mes premiers travaux, je tentais d’apprivoiser les langages du théâtre, je n’avais pas de maître.
C’est en 1999 que j’ai trouvé quelque chose, en me posant cette question : pourquoi nous, peuples autochtones, ne nous référons-nous plus à nos mythologies d’origine, matrices de nos psychés ? Avec Iwouskéa et Tawiskaron, j’ai travaillé sur le mythe de la Création du monde des Hurons et des Iroquois. Les spectateurs étaient capturés un à un par les esprits et conduits à l’intérieur d’une grande tente. Pendant au moins trois minutes, rien ne se passait. Il s’agissait de les placer dans le mythe comme matrice de civilisation, de les « iroquoïser » une heure et demie durant !De les adopter, parce que notre culture est une culture d’adoption des étrangers en son sein. Je voulais savoir si le mythe fonctionnait encore, si, ensemble, l’on pouvait devenir iroquois en partageant un ventre commun à travers le théâtre. Ce mythe – la longue histoire de la création du monde – était raconté pour reconstruire la psyché collective. Il faut que cette parole soit très forte pour restructurer la psyché. Comment va-t-elle reconstruire un homme qui a tué ?
Mes ancêtres iroquois ont maintenu jusqu’à nous cette idée fondamentale : on devient humain lorsque l’on reconnaît la perte, que l’on pleure, que l’on s’émeut et que l’on traduit cette émotion en mémoire. Ce spectacle évoquait la création du monde à travers une cérémonie funéraire. Le public était prisonnier de la tente, acteurs et spectateurs en contact direct, pour une dissolution du spectacle : nous étions témoins, comme une famille. Dans la seconde partie, quelqu’un du public « mourait » et assistait à sa propre cérémonie. Au tournant du millénaire, j’ai voulu réintroduire cette approche de la mort, à la fois banalisée et exclue de nos sociétés. Les sépultures anciennes nous disent : « Nous étions des humains. »
Par la suite, je suis revenu à du théâtre déambulatoire, en croisant un mythe des Indiens des Rocheuses et un mythe sibérien, deux groupes témoins de la grande migration transcontinentale. Dans Kmùkamch l’Asierindien, le personnage central voit tuer son fils, prend sa jeune femme et l’esprit de son fils vient se venger. Cela touche quelque chose de notre monde, le refus de vieillir.
Comme dans la tragédie grecque, il s’agit d’histoires de famille. La tragédie naît dans la destruction des liens familiaux, le bris du tabou de l’inceste notamment. La pièce touchait quelque chose de très contemporain, dans notre société où les hommes vivent une angoisse terrible face à la vieillesse. La mort est exclue, mais la vieillesse aussi. Cela convoque des choses très profondes, comme le cannibalisme. Dans une société où les rôles sont interchangeables et dont le seul but est de jouir, pourquoi ne pas manger tout de suite ce qu’il y a de plus beau ? Nous sommes dans un monde de prédateurs…
… et qui ne laisse pas de place à sa jeunesse : on le constate aujourd’hui en Espagne.
Dans Xajoj Tun-Rabinal Achi, le dernier texte que j’ai travaillé avec les Mayas [5], nous sommes dans un théâtre de la cruauté : les Mayas pratiquaient des sacrifices humains. C’est un spectacle sur la guerre, universel : sa violence et son absurdité font partie de l’alphabet mythologique de toute l’humanité. C’est inscrit dans notre nature, nous sommes des êtres agressifs, prédateurs. Dans leurs récits historiques à la limite de la mythologie, les Mayas mettent en scène deux guerriers, dont l’un, rebelle, va essayer de tuer le roi et sera capturé et mis à mort. Dans ce théâtre de cour, on demandait au prisonnier de rejouer ses faits d’armes et sa capture, et on le tuait au cours d’un festin rituel où il prenait des boissons hallucinogènes. On exauçait ses derniers vœux : danser avec la reine, s’affronter aux guerriers. Ce théâtre dont on connaissait la finalité énonçait la vérité de la guerre et de la mort : il est chargé d’humanité, selon d’autres codes que les codes occidentaux.
Au-delà de l’histoire, j’ai voulu travailler avec les habitants du village de Rabinal qui ont conservé la forme cérémoniale de leur théâtre traditionnel présenté un jour par an, comme une offrande pour leur village et leurs ancêtres. Eux aussi vivent le choc de la mondialisation, des technologies, les jeunes se désintéressent de leur culture… Ils sont conscients d’être devenus un musée vivant. Toute tradition doit sortir des ornières de la folklorisation pour atteindre ses buts : construire de grands êtres humains, dépasser par l’entendement les archétypes qui nous poussent à la violence, à l’abus de sa propre famille, au refus de prendre sa charge comme être humain ou à l’absence d’émotion devant la mort. Nous avons quitté le monde figé de la tradition pour l’universel : les Mayas, grande civilisation urbaine qui a connu l’apogée comme le désastre écologique, nous enseignent des choses que nous devons réapprendre. Nous, autochtones du Canada, nous nous sommes rapprochés de la source du théâtre amérindien pour retrouver nos ancêtres communs. Dans ce travail, les acteurs étaient conviés à ne pas fabriquer les personnages, mais à les laisser venir en eux chaque soir au travers des huit masques utilisés. On ne savait jamais qui incarnerait le personnage principal : il se laissait choisir chaque soir par le masque ! Cela m’a permis d’énoncer beaucoup de choses auxquelles je continue à travailler. Xajoj Tun-Rabinal Achi a fermé un cycle de vingt-cinq ans. Je suis venu au théâtre parce que, en 1978, je suis allé au Guatemala, en suivant un itinéraire fondé sur la grande mythologie maya d’après les codex traduits. C’est un acte de civilisation. Amener dans le monde contemporain du théâtre ces vestiges, faire entendre ces mots-là dans la cité et permettre une participation du public à un effort de transcendance, un théâtre de quête des ancêtres transcontinentale. Des acteurs du Chili, de Bolivie, de l’Équateur et du Québec y ont participé.
On pourrait dire que les peuples autochtones ont été des sortes de lanceurs d’alerte, comme on le dit aujourd’hui des écologistes. Tout ce qu’ils ont dénoncé, c’est ce que subit actuellement la plus grande partie de l’humanité : destruction des ressources, acculturation… Les gens qui résistent à cela ne vont-ils pas être remis dans des réserves, comme les artistes ?
Ce qui s’est vécu à l’échelle de Sumer, de l’Égypte ancienne, des anciennes mégapoles, c’est ce que nous sommes en train de reproduire à l’échelle de la planète. Les nouvelles Babylone sont à Djakarta ou Mexico, dans les grandes cités qui polarisent l’énergie de la planète. 52 % de la population mondiale vit en métropole : cela témoigne de la disparition de la diversité des cultures humaines, comme celle de la biodiversité animale.
En même temps, la ville n’a pas créé que du négatif : elle permet la rencontre, d’échapper à une communauté parfois trop étouffante, le croisement des arts…
C’est paradoxal. Comment échapper à l’effondrement des grandes civilisations urbaines ? Pourquoi les gens se rassemblent-ils dans les mégapoles ? C’est attirant, cela nous rassemble, c’est la galaxie humaine. On a besoin des hommes. On nous parle de la fin de l’histoire, de l’espace-temps réduit avec les télécommunications… Le cerveau humain peut s’adapter, mais le corps ne suit pas. La fiction collective de l’urbanité exponentielle, tous ces cerveaux combinés les uns les autres créent un monstre ingérable. Plus on ordonne les choses, plus la théorie du chaos se vérifie : le désordre s’accélère sous une prétention d’ordre mondial. Bien sûr que la ville est libératrice : elle mixe toutes les populations et toutes les cultures.
L’humanité, présentement, au-delà des difficultés de la mondialisation, vit un tsunami, une vague de fond encore tout juste perceptible. Ce que la postmodernité appelle le métissage, propre aux grandes cités comme Montréal et Paris, est inévitable. Ce brassage de l’humanité est peut-être une partie de la solution. Je vois cela comme positif et négatif, c’est la question fondamentale énoncée par Shakespeare : « Être ou ne pas être ? » Comment faire pour survivre, et survivre à quel prix ? Le risque est d’abolir les cultures fragiles. Sans territoire, il est très difficile de maintenir une culture comme celle des Innus, qui ont perdu les moyens de vivre d’une manière autonome.
Ce que je trouve terrible, c’est ce contact incessant à travers les technologies, qui dissipe l’angoisse de la relation véritable. Le théâtre est le lieu de la mise en lumière des relations. Tout notre travail est d’obliger à être présent un spectateur qui nous dit : « Je suis venu pour être distrait » ! À mon échelle, après avoir beaucoup lutté comme résistant culturel, je vois bien qu’on perd du terrain auprès des jeunes. Trouver l’essence d’une culture, décoder son alphabet mythologique : si on n’y parvient plus, c’est que quelque chose est dissous. Une vision du monde suppose un agir. C’est de plus en plus rare.
Ce n’est pas un hasard si l’archaïque tel que vous le définissez rejoint des pratiques qualifiées d’avant-garde, la performance dans ce qu’elle a de plus intéressant, une forme de rituel.
Le théâtre, dans sa fonction archaïque, est le lieu d’une réénonciation culturelle. Dans notre travail, on utilise des pierres, on les fait rougir, on les écoute chanter. Ce sont les os de la terre, l’os qui contient la moelle, c’est là qu’est l’esprit, la génétique. On fait le lien avec les premiers hommes qui ont vécu de la pierre pendant des millénaires. Retourner à la pierre, c’est retourner à la racine même d’une connaissance et l’utiliser pour rêver comme acteur ; pour entrer en contact avec la mémoire génétique enfouie dans notre squelette. C’est par ce moyen qu’on a rencontré théâtralement les Mayas : comme chez Grotowski, il s’agissait de briser l’occidentalité.
Je voudrais réunir des gens de toutes provenances pour étudier avec eux leur mythologie personnelle. « De qui descends- tu, d’où viens-tu ? », pour réinventer l’humanité. Tout le monde a des ancêtres, et on n’échappe pas au poids de ce qu’ils ont fait. Et la guérison passe par la mémoire, mettre les morts à leur place, accepter d’aimer, accepter de mourir, de porter une charge et de souffrir.
Offrir au lieu de prendre, c’est aussi un archétype des cultures amérindiennes. On ne peut pas juste se contenter de prendre, à la terre, aux bêtes : tout ce qu’on leur fait, on le fait à soi-même. Quand les Indiens disent qu’il y a des esprits (manitous) qui peuvent dialoguer avec leur frère animal, cela vient de milliers d’années de respect et de connaissance, ce n’est pas une fable. Les anthropologues et Claude Lévi-Strauss ont montré que les mythes sont un langage, une connaissance, une énonciation du cosmos aussi valables que la physique quantique. Les angoisses primaires des premiers hommes sont les nôtres et, en situation de régression, on se retrouve dans leur position. Il nous faut apprendre des civilisations qui nous ont précédés pour savoir qui nous sommes.
Propos recueillis par Valérie de Saint-Do
• www.ondinnok.org
• Le film d’Yves Sioui-Durand, Mesnak, a été présenté le 30 octobre 2011 au Festival d’Abitibi.