07/03/2020
El Ninõ de Hollywood de Óscar & Juan José Martínez
traduit de l’Espagnol (Salvador) par René Solis
Métailié, février 2020
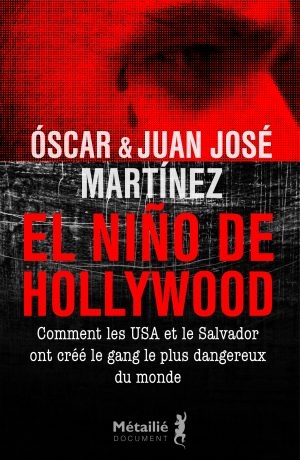
332 pages, 22 €
« Je voudrais pouvoir revenir en arrière, et pas aller avec la Mara…
Aux mioches, moi je leur dis, ne le faites pas, disait El Niño. »
Miguel Ángel Tobar, celui qui fut d’abord El Payaso, Le Clown, puis El Niño de Hollywood, du nom de la branche de la Mara Salvatrucha 13 à laquelle il appartenait, les Hollywood Locos, dont il fut l’un des plus redoutables sicario, avant de devenir un misérable témoin protégé de l’État salvadorien, après avoir dénoncé un bon nombre de mareros, dont son pandillero, son chef, Chepe Furia. Chepe Furia, de son vrai nom José Antonio Terán, avait été dans les années 70, un policier de l’ultra brutale police d’État, la Garde Nationale de sinistre mémoire où il était alors connu sous le nom d’El Veneno, le Poison, ce n’est que bien plus tard qu’il reviendra au Salvador, sous le nom de Chepe Furia, membre de la Mara Salvatrucha 13.
José Antonio Terán avait fui le pays, sa guerre intestine et ses propres exactions. Dans les années 70, il y avait eu une fuite en masse des Salvadoriens vers le sud de la Californie, puis ces derniers — dont bon nombre avaient rejoint les gangs — furent expulsés sous le gouvernement de Reagan. Des centaines de membres de la Mara Salvatrucha 13 (la MS-13), qui en 1992 était le gang le plus puissant de Californie et du Barrio 18 qui lui s’était rallié au système des gangs sureños, principalement d’origine mexicaine, comme l’indique le chiffre 18, contrairement à la MS-13. Les deux gangs étaient ennemis et se disputaient des territoires. Les Salvadoriens n’ayant connu que l’ultra-violence dans leur propre pays, dressés tout jeunes à tuer, n’avaient respecté aucune règle des autres gangs des ghettos californiens à leur arrivée. Sales, adeptes des drogues et de l’alcool, tous vêtus de noir avec les cheveux longs, jeunes fans absolus et très perturbés de heavy metal aux pratiques macabres, la MS-13 s’était vite fait une réputation avant de s’organiser en gang plus conforme niveau look à l’image des autres gangs californiens, mais avec toujours une longueur d’avance sur leur capacité de violence pure.
Une fois de retour au Salvador, les deux gangs ennemis se sont donc reformés. La MS-13, avec ses différentes branches, a alors conforté et prouvé sa réputation de gang du XXIe siècle le plus violent au monde, aussi bien vis-à-vis de l’extérieur qu’à l’intérieur même de celui-ci. C’est le seul a être sur la liste noire du département du Trésor des États-Unis, ses membres qualifiés d’animaux par Trump, « ce président ignorant (….) et non d’animaux humains créés par d’autres humains ».
El Niño de Hollywood n’a jamais mis les pieds aux États-Unis, encore moins à Hollywood, mais il fait partie de ses enfants perdus, issus de familles totalement éclatées, dans un pays ravagé par des décennies de guerre et qui n’ont déjà connu que la violence et la misère.
Ainsi, en un peu plus de trois cents pages, parfois très dures, le lecteur pourra comprendre ce qui a bien pu faire de ce tout petit pays d’Amérique centrale, le pays le plus meurtrier du monde avec un taux d’homicides absolument dément. Il faut pour cela remonter au XIXe siècle, à l’époque où des propriétaires terriens faisaient fortune avec l’indigo et avaient pour cela relégué les populations indiennes sur les terres non exploitables à flanc de montagnes. Quand la découverte inopinée, à Londres, du premier colorant de synthèse, bleu donc, fait chuter brutalement la demande et le cours de l’indigo, l’élite des propriétaires terriens à l’initiative du président alors en place, Gerardo Barrios, va se reconvertir très vite dans le café et pour cela elle a besoin des terres en pente qu’elle avait laissées aux Indiens, mais aussi de leurs mains pour récolter. Le traitement qui est infligé alors à cette main d’œuvre, déjà humiliée par le régime colonial espagnol, est tel que cette population dont la colère et la frustration a atteint un point de non retour, n’ayant rien de plus à perdre, commence à se rebeller au début des années 30, ce qui entraînera aussitôt une répression féroce, la Matanza : en 1932, « au moins quinze mille personnes, des hommes jeunes dans leur majorité, ont été assassinées dans la région occidentale du Salvador en quelques mois (…) et une bien plus grande quantité encore a été exécutée durant le reste de l’année. Aucun de ces morts n’a été enregistré dans les registres d’homicides. »
Roque Dalton, poète salvadorien membre de l’organisation insurgée Armée révolutionnaire du peuple dans les années 1970, qui sera assassiné sur ordre des dirigeants de cette même organisation pour insoumission, écrivit à ce sujet :
« Nous sommes tous nés à demi morts en 1932
Nous survivons à demi vivants
Et chacun de nous porte une dette de trente mille morts bien entiers
Dont les intérêts ne cessent de gonfler
Et qui aujourd’hui suffit pour enduire de mort ceux qui continuent
À naître
À demi morts
À demi vivants
Nous sommes tous nés à demi morts en 1932
Être Salvadorien c’est être à demi mort
Ce qui bout
C’est la moitié de la vie qu’on nous a laissée… »
Mais comme souvent l’injustice et l’atrocité furent rentables : « Les riches sont devenus très riches dans les décennies qui ont suivi 1932. Les pauvres, eux, ne pouvaient être plus pauvres. »
Mais ces pauvres soutenus par les idéaux marxistes s’organisent dans les années 70, le pays entre alors dans l’une des dictatures les plus sadiques d’Amérique centrale, composée de militaires putschistes d’extrême-droite avec comme d’habitude la participation de la CIA, le but étant comme toujours de protéger les possessions et privilèges de la classe dominante. La guérilla est forte et brutale elle aussi, nourrie de plus d’un siècle d’injustices sans réparation. Dans un pays composé alors « à plus de 60 % par des enfants, le résultat était prévisible. Des milliers de mineurs de moins de 15 ans ont été recrutés des deux côtés. (…) Le Salvador, un pays vingt fois plus petit que la Californie, s’est lancé avec ses armées adolescentes dans l’abîme dont il devait ressortir en 1992 avec pour bilan plus de soixante-quinze mille morts et une immense quantité de personnes déplacées.»
Voilà le terreau de tant de morts déjà décomposés, dans lequel les gangs made in USA viendront semer leurs graines assassines.
Qui dit guerre, dit ennemi, la nécessité d’avoir un ennemi à combattre, « l’envie irrépressible de détester quelqu’un sans motif idéologique a été fondamentale dans la construction du Salvador ». La minorité possédante demeurant, quoiqu’il arrive, intouchable, on entre donc dans la logique des clans, où la raison de vivre est la mort de l’autre. Quand les membres des gangs comme Chepe Furia et bien d’autres, dont certains étaient partis trop jeunes pour connaître leur pays, sont expulsés de Californie vers la fin des années 90, une certaine aura les entoure aux yeux de la jeunesse qui a grandi dans la misère au Salvador dans un environnement très rural.
« Les États-Unis vomissaient.
Sans comprendre ce qu’ils faisaient.
La migration est un cercle.
Des recruteurs pour tout le Salvador.
Des recruteurs d’enfants perdus pour tout le Salvador.
Des chefs de clans pour tout le Salvador.
Un pays en reconstruction.
Un pays en ruines.
Un pays qui n’avait pas le temps pour les enfants perdus.
La guerre expulsée des rues de Californie aux rues du Salvador.
Une guerre s’achevait. Une autre commençait. »
Il fut très facile pour Chepe Furia, auréolé de son parcours de « combattant » et fort de son expérience d’ex-policier de la Garde Nationale, de manipuler ces « enfants de personne », les enfants de la guerre. « Enfants de familles dysfonctionnelles fabriquées avec des restes d’autres familles », leur seule consigne : survivre. « Beaucoup d’entre eux faisaient face aux déceptions de la vie de la même façon que leurs pères, à grandes rasades d’alcool de canne, le guaro. ». Illettrés, misérables, déjà confrontés à la violence, ils étaient d’autant plus manipulables qu’ils étaient mus par un désir de valorisation, de reconnaissance et notamment de la part d’un père souvent inexistant ou minable comme celui d’El Niño, alcoolique lui-même victime de son propre tragique destin, qui vendait sa fille de 15 ans à son contremaître.
C’est le 24 décembre 1994 exactement, que Miguel Ángel Tobas, celui qui deviendra El Niño de Hollywood, né en 1981 dans une plantation de café, a pour la première fois, tenté de tuer un homme : le contremaître qui violait sa sœur. Une première tentative ratée à coups de gourdin et de pierres, « grosses comme les pierres qu’un enfant de 11 ans mal nourri peut soulever », l’enfant déçu de lui-même avait toutefois emporté un révolver .38, qu’il avait trouvé à la ceinture de cet homme.
Cette reconnaissance, les enfants de personne achetés par quelques bouteilles d’alcool par Chepe Furia, l’obtiendront ou croiront l’obtenir au prix du sang.
« Le secret, c’est que leur rêve n’est pas de devenir riche, mais d’être quelqu’un. Quelqu’un de différent de ce qu’ils étaient, (…) le rebut. »
Ils devront prouver leur allégeance totale à la Hollywood Locos Salvatrucha en assassinant violemment d’autres gamins absolument semblables à eux, dans une guerre contre cet ennemi déclaré, ceux de l’autre gang, avec bon nombre de victimes collatérales, mais aussi une guerre à l’intérieur même du gang contre les tièdes, les faibles et les traîtres, qui seront cruellement éliminés. Ainsi El Payaso, s’auto-nommera El Niño de Hollywood, — il a autour de 16 ans — par un meurtre particulièrement atroce car il ne s’agit pas seulement de tuer, mais aussi d’écrire avec le corps des victimes, celui-ci devenant un support pour transmettre un message qui doit faire horreur.
« Difficile d’arrêter une horde de chevaux emballés. Surtout si personne ne cherche à les arrêter. Surtout si quelqu’un les suit en les excitant. La haine qui s’est mise à rouler au Salvador a trouvé une interminable pente descendante. Elle roule toute seule. La première impulsion a suffi. La mort a donné du sens à toutes ces vies. »
Et à celle d’El Niño de Hollywood, devenu sicaire reconnu comme l’un des plus redoutables et le plus sanguinaire du gang des Hollywood Locos de la MS-13, dont il deviendra cependant lui aussi un traître et ne connaîtra plus jamais le repos, pas même après sa mort.
La boucle est bouclée, l’ultra-violence au Salvador est le mode de vie psychopathe de toute une partie de la jeunesse la plus pauvre. Les gangs, « une mafia, oui, mais toujours une mafia de pauvres. ».
« Tuer, haïr celui qui, sans te connaître, te tue, te hait », avec toute une mythologie, une mystique presque du meurtre, avec la Bête qui réclame sa part de sang. « Notre Bête à nous, elle est noire, c’est un cheval noir qui a le pouvoir, d’après l’Apocalypse, d’enlever la paix sur la terre. C’est une Bête de couleur noire avec une épée pointue. »
« Chepe Furia était intelligent pour créer des symboles, pour revêtir de transcendance ce qui n’était qu’un bain de sang contre des jeunes gens ».
On ne lit pas ce type de livre pour se divertir, à moins d’être soi-même un gros malade, non, on le lit pour comprendre comment cette violence est possible, comment des enfants de 10, 12 ans peuvent commettre des crimes aussi abominables, et devenir vers 16, 18 ans des tueurs déjà professionnels et à moitié, si ce n’est complètement, fous. On lit pour comprendre quel est le mécanisme à l’œuvre, pour comprendre comment tout cela a pu commencer et comme trop souvent, on trouvera à l’origine une élite possédante qui opprime, exploite et accule des populations à des situations d’injustice et de misère extrêmes et dans une spirale infernale, des décennies plus tard, toute une partie de la jeunesse d’un pays se retrouve pourrie jusqu’aux os, tellement qu’il n’est plus possible de distinguer les victimes des bourreaux.
Si les deux frères, auteurs de cet ouvrage magistral dans lequel la réalité pulvérise la fiction et qui ont réalisé là un travail de journalisme d’investigation courageux et réussi, s’intéressent de si près à El Niño de Hollywood qu’ils ont interviewé pendant des centaines d’heures, c’est bien parce que comme il le lui ont dit : « malheureusement, nous croyons que ton histoire est plus importante que ta vie… ».
On lit pour entrevoir l’humain derrière le monstre, pour nous rassurer nous-mêmes sans doute et il se trouve que l’humain est bien là, pris dans cette logique implacable qui le dépasse. Une multitude de fils de vies microscopiques qui se trouvent piégés ensemble dans la même trame, la toile souillée d’un sang qui n’en finit plus de couler.
« Au fil des mois et des années nous avons pu nous rendre compte que la vie de cet homme était conditionnée par des processus globaux, par des histoires à l’échelle mondiale dont il ignorait tout. Nous avons découvert que le pouvoir de décision, ce qu’on peut appeler la possibilité d’agir, a toujours était limité, toujours étroitement lié à des mécanismes lointains conçus par de hauts fonctionnaires aux États-Unis et au Salvador durant tout le XXe siècle. »
Personne ne voudrait être Miguel Ángel Tobar. « À présent il n’est plus que terre et racine. De l’engrais pour ce coin pourri du monde », laissant derrière lui, une très, trop jeune maman d’à peine 18 ans et leurs deux petites filles. Quelle histoire, quelle légende cette dernière leur racontera-t-elle à propos de leur père ?
Cathy Garcia
 Oscar MARTÍNEZ est un journaliste d'investigation et écrivain salvadorien qui travaille pour elfaro.net, journal en ligne spécialisé sur les sujets de violence, migration et crime organisé. Il a remporté de nombreux prix tout au long de sa carrière, notamment le prix Fernando Benítez de journalisme, le Prix des droits de l'homme et le Prix international de la liberté de presse.
Oscar MARTÍNEZ est un journaliste d'investigation et écrivain salvadorien qui travaille pour elfaro.net, journal en ligne spécialisé sur les sujets de violence, migration et crime organisé. Il a remporté de nombreux prix tout au long de sa carrière, notamment le prix Fernando Benítez de journalisme, le Prix des droits de l'homme et le Prix international de la liberté de presse.
 Juan José MARTÍNEZ est un anthropologue né au Salvador en 1986. Il étudie les gangs et la violence depuis 2008 et a collaboré avec diverses institutions telles que l'Unicef, Action on Armed Violence et l'American University.
Juan José MARTÍNEZ est un anthropologue né au Salvador en 1986. Il étudie les gangs et la violence depuis 2008 et a collaboré avec diverses institutions telles que l'Unicef, Action on Armed Violence et l'American University.
18:52 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
02/03/2020
Nicaragua. Décès d’Ernesto Cardenal, prêtre, poète et figure révolutionnaire
Le poète, prêtre catholique et homme politique nicaraguayen Ernesto Cardenal, figure de la révolution sandiniste et de la théologie de la libération, est décédé dimanche à l’âge de 95 ans.

publié sur Ouest-France le 2 mars 2020 à 2h42
Le poète, prêtre catholique et homme politique nicaraguayen Ernesto Cardenal, figure de la révolution sandiniste et de la théologie de la libération, est décédé dimanche à l’âge de 95 ans, a annoncé son assistante.
« Il est mort aujourd’hui. Il s’en est allé dans une paix absolue, il n’a pas souffert », a déclaré à l’AFP Luz Marina Acosta, collaboratrice depuis plus de quarante ans de Cardenal. Le prêtre, hospitalisé depuis deux jours, a succombé à un arrêt cardiaque, a-t-elle précisé.
Le président Daniel Ortega, qui fut son compagnon d’armes au sein du Front sandiniste de libération nationale (FSLN) pendant la révolution, a aussitôt décrété trois jours de deuil national au Nicaragua.
Révolution sandiniste en 1979
Né le 25 janvier 1925 à Granada, près de la capitale Managua, Cardenal avait été ordonné prêtre en 1965. Embrassant la théologie de la libération, il avait participé à la révolution sandiniste qui en 1979 avait abouti à la chute du régime autoritaire d’Anastasio Somoza.
Devenu ministre de la Culture dans le premier gouvernement du FSLN, il avait été publiquement réprimandé par Jean Paul II sur le tarmac de l’aéroport de Managua à son arrivée en 1983 pour une visite officielle. Le pape polonais avait refusé sa bénédiction au prêtre-ministre, agenouillé devant lui, et, un doigt impérieux levé, l’avait tancé en lui demandant de « se réconcilier d’abord avec l’Église ».
Deux ans plus tard, le prêtre n’ayant pas quitté ses fonctions politiques, le pape l’avait suspendu « a divinis ».
Plusieurs ouvrages poétiques
Cette sanction avait été levée par le pape François en février 2019. Ernesto Cardenal, revêtu de l’étole, symbole de ses pouvoirs sacerdotaux recouvrés, avait alors reçu l’eucharistie des mains du nonce apostolique sur son lit d’hôpital, où il était soigné pour des problèmes rénaux.
Ernesto Cardenal avait pris ses distances avec Daniel Ortega et quitté le FSLN en 1994.
Il était l’auteur de plusieurs ouvrages poétiques comme « Hora Cero » (« L’Heure zéro »), « Oracion por Marilyn Monroe y otros poemas » (« Prière pour Marilyn Monroe et autres poèmes ») et surtout « El Evangelio de Solentiname » (« L’Evangile de Solentiname »), écrit au sein d’une célèbre communauté chrétienne de pêcheurs et d’artistes qu’il avait fondé dans les îles Solentiname, au milieu du lac Cocibolca.
Source : Ouest-France
08:27 Publié dans LATINA AMERICA | Lien permanent | Commentaires (0)
17/02/2020
La certitude des pierres de Jérôme Bonnetto
éditions Inculte, 8 janvier 2020

192 pages, 16.90€.
Ségurian est un village isolé et perché dans la montagne, dont le saint patron est St Barthélémy, fêté comme il se doit tous les 24 août, avec la sortie du saint en procession et la traditionnelle préparation et dégustation bien arrosée de la soupe au pistou. Tout un symbole si on pense au massacre du même nom et nul doute que l’auteur ne l’a pas choisi par hasard.
Ségurian est un village de chasseurs et les chasseurs forment un clan avec un chef qui est aussi le chef, de père en fils, d’une entreprise familiale de construction qui a bâti une bonne partie du village : ce sont les Anfonsso. Joseph Anfonsso est donc un chef : chef de famille, chef d’entreprise, chef des chasseurs. Et plus tard, il passera la main à son propre fils Emmanuel. Tout est bien qui tourne bien, immuablement, dans ce village refermé sur lui-même.
« L’amour de Joseph pour la chasse n’était pas feint. Première carabine à six ans, la première grive à sept sous le fier regard du père, la main tendre qui décoiffe l’enfant. L’amour de la chasse, c’est avant tout l’amour du père. La rudesse de l’homme qui n’avait pas appris à faire de compliments se fendait devant les succès répétés de Joseph, qui repensait souvent au jour où son père lui avait dit, après avoir tiré un lièvre à plus de quatre-vingts mètres : “Tu es bien mon fils, tu es comme moi, mais en mieux. ” En économie comme dans les sentiments, c’est la rareté qui fait le prix. Joseph en avait eu les larmes aux yeux. »
Ségurian donc, village de chasseurs : « La société comptait cent membres pour quatre cents habitants. »
La vie du village et la propre vie de Joseph Anfonsso auraient pu ronronner ainsi durant des millénaires sans que rien ne change, sans que rien surtout ne doive changer, mais c’était sans compter l’arrivée de Guillaume, un 24 août en plus. La certitude des pierres est divisé en six chapitres allant de la première St Barthélémy à la sixième, la première étant celle où Guillaume donc est arrivé au village.
Les parents de Guillaume Levasseur s’étaient installés depuis quelques années à Ségurian, dans la maison d’un oncle décédé, un original dont ils ne savaient pas grand-chose. Les parents Levasseur après avoir travaillé toute leur vie en ville, avaient désiré s’éloigner des « fourmilières déshumanisées » et se rapprocher de la nature, d’autant plus que Guillaume était déjà parti depuis trois ans, pour l’Afrique sur un coup de tête. Mais donc la famille, avec un seul membre au cimetière, est « une pièce rapportée, des estrangers, des messieurs de la ville comme on dit. Va falloir qu’ils fassent leurs preuves, les Levasseur. Va falloir me remplir ce caveau avant d’élever la voix, avant de faire les fiers, avant de touiller la soupe au pistou. C’est comme ça, c’est l’ordre des choses. »
Et voici que Guillaume non seulement débarque dans le village, mais surtout, tombé amoureux de ce coin de montagne, il a un projet : y monter une bergerie. Et Guillaume, c’est une force de la nature, ce n’est pas juste un jeune illuminé malgré ses cheveux longs, c’est un rêveur certes, un intello qui grimpe dans les arbres pour y lire des livres, mais c’est un bosseur aussi, qui compte bien voir aboutir son rêve. Et il s’y met et le rêve peu à peu se concrétise, il y travaille comme un acharné, la bergerie voit le jour et même elle va s’agrandir d’année en année, des chèvres, des moutons, choisis avec soin, ça marche bien, sauf que cette bergerie elle se situe au-dessus de la maison de Joseph et que les moutons paissent sur des terrains habituellement dédiés à la chasse au sanglier et que dès le départ, ça pose problème. Pour Joseph, la montagne, c’est chez lui et « pas pratique de chasser au milieu de toute cette laine. »
« On était là avant, pensa-t-il. C’est une question de bon sens. »
La tension va monter crescendo jusqu’à la quatrième fête de St Barthélémy après l’arrivée de Guillaume : alors que ce dernier, sollicité pour sa force physique, porte comme Joseph, la statue du Saint Patron sur la procession, Joseph a une défaillance qui provoque la chute de la statue du Saint Patron qui en perd la tête. L’irritation envers le berger va basculer alors définitivement dans une véritable haine.
« Le berger avait jeté une mauvaise onction sur le village. C’était un gâcheur de fête, un empêcheur de tourner en rond, un perturbateur d’horizon, un branleur de situation. Il dérangeait l’ordre établi, il barbouillait les lignes, troublait l’air comme l’eau le pastis. Un mouton noir, c’était le mouton noir, un Boche, un Turc. (…) Avec le berger, brillait la lumière maléfique des sabbats. Un jour, les aiguilles de l’église se mettraient à trotter à l’envers et, ce jour là, on serait perdu, toutes les sources seraient taries, de la mousse pousserait au sud et l’ogre marcherait sur le village pour manger les enfants. »
La certitude des pierres, est un portrait précis, ironique, mordant, sans concession mais malheureusement réaliste cependant, d’une communauté qui n’accepte pas facilement ceux qui ne sont pas d’ici et c’est un drame quasi biblique qui y prend place — Joseph le chasseur et Guillaume le berger. L’écriture de Jérôme Bonnetto est belle, poétique, âpre et minérale comme la montagne et c’est avec un évident talent que l’auteur met en relief l’entêtement et la folie des hommes, leur lâcheté tout autant que leur courage, la bêtise et la mesquinerie quotidienne, les silences complices et ce refus d’analyser en soi les véritables racines de la rage en les affublant au contraire de tous les déguisements possibles de légitimité.
« On est un bois, un bloc, une race.
On se comprend. On fait à notre idée. On a nos règles, les seules qui vaillent. Les autres peuvent passer, on les salue, de loin, comme ça. Du plus loin possible. »
La certitude des pierres est un roman dont on se régale, malgré l’amertume certaine qui reste en travers de la gorge, surtout si on a soi-même connu cet entre-soi qui entraine l’exclusion d’autrui et qui est une réalité certaine de la ruralité comme de bien d’autres communautarismes.
L’auteur ne porte pas directement de jugement mais décrit de l’intérieur même des personnages, le mécanisme de la violence, la loi du silence et le poids d’un orgueil écrasant qui transmis de père en fils et poussé jusqu’à son extrême, peut mener l’homme à sa propre perpétuelle impasse.
Cathy Garcia

Jérôme Bonnetto est né à Nice en 1977, il vit désormais à Prague où il enseigne le français. La certitude des pierres est son troisième roman.
09:21 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
03/02/2020
Philippe Descola : « La nature, ça n’existe pas »
1er février 2020 / Propos recueillis par Hervé Kempf
Source : https://reporterre.net/Philippe-Descola-La-nature-ca-n-ex...
L’anthropologue Philippe Descola nous a fait reconsidérer l’idée de nature. Sa pensée a profondément influencé l’écologie, et dessine la voie d’une nouvelle relation entre les humains et le monde dans lequel ils sont plongés. Reporterre a conversé avec lui : voci son interview, à écouter en podcast et/ou à lire.
Philippe Descola est titulaire de la chaire d’Anthropologie de la nature au Collège de France et directeur du Laboratoire d’anthropologie sociale (ENS/EHESS). Il est l’auteur des Lances du crépuscules (Plon, 1993) et de Par delà nature et culture (Gallimard, 2005).
Ecoutez l’émission, enregistrée au Ground Control, à Paris
Reporterre – Philippe Descola, vous êtes un penseur ‘cardinal’ dans l’évolution de la pensée écologique depuis 20 à 30 ans. Jeune étudiant, dans les années 1970, vous êtes parti au fin fond de l’Amazonie, entre l’Equateur et le Pérou, à la découverte des Achuars. Vous y avez passé deux à trois ans en immersion et plus tard plusieurs séjours. Comment avez-vous vécu chez ce peuple, que s’est-il passé ?
Philippe Descola - Je suis parti parce que j’avais de l’intérêt pour la façon dont les sociétés entretiennent des liens de diverses sortes avec leur environnement. Il m’avait semblé que pour étudier cela d’une façon complète et minutieuse, il fallait : séjourner au sein d’une société qui avait eu peu de contacts avec le monde extérieur. Leurs premiers contacts pacifiques, les Achuars les ont entretenus avec quelques missionnaires à la périphérie de leurs territoires à la fin des années 60. Cela garantissait que je pouvais observer un système que j’appelais alors de ‘socialisation de la nature’ qui n’avait pas été trop affecté par l’économie de plantation, le capitalisme marchand et toutes les formes dévastatrices d’utilisation des forêts tropicales que l’on connaît.
Pourquoi l’Amazonie m’intéressait-elle ? Parce qu’il y a dans les descriptions que l’on donne des rapports que les Indiens des basses terres d’Amérique du Sud entretiennent avec la forêt, une constante qu’on dénote dès les premiers chroniqueurs du XVIe siècle : d’une part, ces gens là n’ont pas d’existence sociale, ils sont ‘sans foi, ni loi sans roi’ comme on disait à l’époque. C’est-à-dire ils n’ont pas de religion, pas de temple, pas de ville, pas même de village quelquefois. Et en même temps, disiait-on, ils sont suradaptés à la nature. J’emploie un terme moderne, mais l’idée est bien celle-là : ils seraient des sortes de prolongements de la nature. Buffon parlait au XVIIIe siècle « d’automates impuissants », d’« animaux du second rang », des termes dépréciatifs qui soulignaient cet aspect de suradaptation. Le naturaliste Humbold disait ainsi des Indiens Warao du delta de l’Orénoque qu’ils étaient comme des abeilles qui butinent le palmier – en l’occurrence, un palmier Morisia fructosa dont on extrait une fécule. Et donc ils vivraient de cela comme des insectes butineurs.
Donc, les récits occidentaux donnaient une vision d’êtres libres mais déterminés et qui n’avaient pas de conscience…
… qui n’avaient pas la conscience de transformer la nature et qui étaient suradaptés à la nature, des êtres véritablement primitifs parce qu’ils étaient naturalisés. C’étaient des « peuples naturels ». Cela pose des questions quand on s’intéresse au rapport que des sociétés entretiennent avec leur environnement. Où est le social, où est la médiation sociale dans un tel système ?
Donc aiguillonné par cette espèce de contradiction que les chroniqueurs, les proto-ethnographes puis les premiers ethnologues avaient mis en avant, j’ai été en Amazonie avec l‘idée que peut-être, s’ils n’avaient pas d’institutions sociales immédiatement visibles c’était parce qu’ils avaient étendu les limites de la société au-delà du monde des humains.

Et vous l’avez découvert ?
C’était un pressentiment. L’enquête ethnographique prend du temps, surtout dans une société de ce type dont on ne parle pas la langue au départ. Quand ma femme, Anne-Christine Taylor, et moi sommes arrivés, il y avait un jeune homme qui parlait quelques mots d’espagnol et c’est tout. C’est une langue qui n’est pas enseignée donc il faut l’apprendre sur le tas. Nous avons commencé à comprendre ce qui se passait lorsque nous avons discuté avec les gens de l’interprétation qu’ils donnaient à leurs rêves. C’est une société – on le retrouve dans bien des régions du monde – où, avant le lever du jour, les gens se réunissent autour du feu, il fait un peu frais, et où l’on discute des rêves de la nuit pour décider des choses que l’on va faire dans la journée. Une sorte d’oniromancie.
Oniromancie ?
L’oniromancie, c’est-à-dire l’interprétation des rêves. Il y avait des rêves étranges, dans lesquels des non-humains, des animaux, des plantes se présentaient sous forme humaine au rêveur pour déclarer des choses, des messages, des informations, se plaindre. Là, j’étais un peu perdu, parce qu’autant l’oniromancie est quelque chose de classique, autant l’idée qu’un singe ou qu’un plant de manioc va venir sous forme humaine pendant la nuit déclarer quelque chose au rêveur était inattendue.
Qu’est-ce que peut dire le manioc ?
C’était donc une femme qui racontait son rêve et disait qu’une jeune femme était venue la voir pendant la nuit. L’idée du rêve est simple et classique dans de nombreuses cultures : l’âme se débarrasse des contraintes corporelles, et entretient des rapports avec d’autres âmes qui sont également libérées des contraintes corporelles et s’expriment dans une langue universelle. Celle-ci permet donc de franchir les barrières de la communication qui rendent difficile pour une femme de parler à un plant de manioc.
Donc, la jeune femme venue la visiter lui avait dit : « Voilà, tu as cherché à m’empoisonner » « Comment ? Pourquoi ? » Et elle répondait : « Parce que tu m’as plantée très près d’une plante toxique ». Celle-ci est le barbasco, une plante utilisée dans la région pour modifier la tension superficielle de l’eau et priver les poissons d’oxygène. Elle n’a pas d’effet sur la rivière à long terme mais elle asphyxie les poissons, et c’est d’ailleurs une plante qu’on utilise pour se suicider. La jeune femme disait : « Tu m’as planté tout près de cette plante. Et, tu as cherché à m’empoisonner ». Pourquoi disait-elle cela ? Parce qu’elle apparaissait sous une forme humaine, parce que les plantes et les animaux se voient comme des humains. Et lorsqu’ils viennent nous parler, ils adoptent une forme humaine pour communiquer avec nous.

Cela veut-il dire que la femme savait qu’elle avait « mal agi » avec ce manioc ? Ou pensez-vous que le manioc - l’être manioc - est vraiment venu visiter sa soeur humaine ?
Je ne sais pas. On peut supposer qu’en effet, elle avait soupçonné qu’elle avait planté ses plants de manioc trop près de ses plants de barbasco. Et que c’est apparu sous la forme d’un rêve. En tout cas, ce genre de rêve met la puce à l’oreille puisque les non-humains y paraissent comme des sujets analogues aux humains, en mesure de communiquer avec eux.
Cette communication prend une autre forme : des incantations magiques qui sont chantées par les humains et adressées soit à d’autres humains, mais distants dans l’espace et l’on s’adresse directement à l’âme de ces humains ; soit à des non-humains. La difficulté pour un ethnologue est que ces incantations sont chantées mentalement. Donc, on ne voit pas quand les gens chantent. Nous nous sommes aperçus, Anne-Christine Taylor et moi, que les Achuars maintenaient en permanence une sorte de fil de communication avec des interlocuteurs humains et non-humains par l’intermédiaire de ces incantations magiques. Nous avons commencé à comprendre et à recueillir ces chants, nous les avons traduits et discutés avec les Achuars, et nous avons compris aussi que les non-humains étaient tout sauf la nature. C’étaient des partenaires sociaux qui n’étaient pas divinisés ni sacralisés puisqu’on les chassait, qu’on les mangeait, plantes comme animaux. Néanmoins, ils étaient dotés d’une dignité de sujets qui permettait une communication de sujet à sujet. Cela était quelque chose qui apparaissait en filigrane dans beaucoup de théories des religions dites primitives, depuis longtemps. Depuis Fraser, au début du XXe siècle.
L’auteur du Rameau d’or.
Oui. Il y avait d’autres livres, comme Totémisme et exogamie, de Salomon Reinach, et d’anthropologie religieuse par lesquels l’anthropologie s’est établi, il y a plus d’un siècle, avec aussi Les formes élémentaires de la vie religieuse, de Durkheim, etc. Mais cela n’avait pas la puissance et la force d’évidence que ces pratiques peuvent acquérir lorsqu’on les observe au quotidien. Je voyais au quotidien des gens faire cela. C’est-à-dire qu’au fond, ils étaient plongés dans un mode totalement différent du mien.
Est-ce qu’à la fin vous-même rêviez aussi ?
Oui, bien sûr.
Et vous rêviez que l’arbre venait vous voir, le tapir, le…
Non, on ne devient pas animiste comme çà. Il y a un rêve que je faisais de façon récurrente, c’était un rêve d’angoisse. C’est normal. On est très loin de chez soi, chez des gens qui en général nous ont très bien reçu, mais c’est un peuple guerrier, on était très loin de la civilisation. Et donc, cette angoisse se manifestait de façon récurrente par un rêve que je faisais dans lequel j’étais couché sur un bat-flanc. Les Achuars ne dorment pas dans des hamacs. Ils dorment sur des bats-flancs qui sont faits avec des tiges de palmiers ou des bambous. Dans mon rêve, au lieu d’être dans la maison commune, j’étais au milieu d’un marécage, la nuit, où j’entendais des bruits bizarres et puis des voix que je n’arrivais pas à distinguer et qui m’entouraient. Quand je racontais cela aux Achuars, ils me disaient : « Tu as été dans la maison des pecaris, c’est cela que tu as entendu. » Cela transformait au fond un contenu onirique singulier, qui était un rêve d’angoisse, en une interprétation marquée au sceau de ces interrelations entre humains et non-humains.
Après avoir vécu des expériences très fortes, pensez-vous que, puisque le rêve est le voyage de l’âme, ces âmes communiquent dans le rêve et se parlent les unes aux autres quelles que soient leurs formes corporelles ? Pensez-vous que le manioc, l’arbre, la rivière, le pecari ont des âmes et parlent vraiment ?
Je ne le dirais pas comme çà. Je dirais que l’attention que chaque être vivant requiert et le soin qui est nécessaire pour le maintenir en vie… C’est le cas dans un jardin. Les jardins des Achuars, c’est une cinquantaine d’espèces cultivées et à peu près autant d’espèces sylvestres transplantées, avec de très nombreuses variétés pour les espèces cultivées. Ce sont des écosystèmes d’une grande complexité, un petit monde. Et ce petit monde a des relations quasiment sociales. Il y a des espèces qui cohabitent bien, et d’autres comme le manioc et le barbasco qui cohabitent mal. Le fait que tous ces êtres soient installés dans un lieu qui a été choisi par les humains pour se substituer à la forêt permet de penser, non pas que le manioc a une âme, mais l’idée que les non-humains sont animés par une intention, des projets, des buts qui les font entrer en communication les uns avec les autres. Et qui permet la communication entre humains et non-humains. C’est-à-dire que ce sont des êtres qui ne diffèrent pas tant de nous par leurs capacités ou par leurs dispositions à établir des relations que par des atouts physiques qui leur sont particuliers.
C’est comme cela que j’ai développé l’idée de l’animisme : l’idée que les non-humains pour les Achuars mais aussi pour d’autres sociétés ont des dispositions physiques qui les font vivre dans un monde qui leur est propre.
Lorsque j’ai commencé à comprendre cela, cela m’avait amusé parce que cela correspond à l’idée que le grand éthologue Jacot von Uexkül avait développée. Que chaque espèce vit dans un monde singulier qui est fondé sur sa capacité à utiliser du fait de sa biologie propre, des éléments de sa niche écologique. Mais alors que chez Yacob von Uexkül, chaque espèce vit dans une bulle, chez les animistes, la communication est rendue possible par cette espèce de langue universelle qu’est le dialogue des âmes.

Nous avons interrogé des visiteurs du Ground control, le partenaire de Reporterre en leur demandant : La nature a t elle une conscience ? Ecoutons leurs réponses
- « Moi, j’imagine que la nature a une conscience. Parce que la nature respire, la nature vit, la nature grandit, la nature interagit avec ce qui l’entoure. »
« Cela ne se voit pas peut être autant que chez l’homme, mais les animaux font des erreurs et ils apprennent de leurs erreurs. Pour moi, çà c’est une conscience. »
« Les femelles ont un instinct maternel qui est assez développé, je pense que cela peut se rapprocher de la conscience. »
« On a un peu voyagé. On voit que la nature s’adapte en fonction des événements. Et là, elle est complètement perdue. »
« La nature est assez résiliente parce que quand on voit par exemple Tchernobyl maintenant c’est bourré de nature, il y a des arbres qui ont poussé dans des maisons, il y a des meutes de loups incroyables, il y a des chevaux sauvages. Je pense que la nature nous enterrera tous. »
Philippe Descola, que vous inspirent ces paroles ?
C’est très intéressant parce que la question au départ était un peu déséquilibrée. « La nature a une conscience ? » : cela renvoie à des interprétations romantiques parce que la nature est une abstraction. La nature, je n’ai cessé de le montrer au fil des trente dernières années : la nature, cela n’existe pas. La nature est un concept, une abstraction. C’est une façon d’établir une distance entre les humains et les non- humains qui est née par une série de processus, de décantations successives de la rencontre de la philosophie grecque et de la transcendance des monothéismes, et qui a pris sa forme définitive avec la révolution scientifique. La nature est un dispositif métaphysique, que l’Occident et les Européens ont inventé pour mettre en avant la distanciation des humains vis-à-vis du monde, un monde qui devenait alors un système de ressources, un domaine à explorer dont on essaye de comprendre les lois.
Là, ce qui est intéressant dans la façon dont les gens répondent, c’est qu’ils ne parlent pas de la nature, mais des arbres, des loups, des animaux. Ils sont complètement hors de cette idée de la nature comme étant une sorte d’abstraction.
Dans un autre micro-trottoir, on leur a demandé « C’est quoi la nature ? » .
« Elle est partout la nature. La nature de l’homme, la spontanéité. Tout est naturel. »
« Les grands espaces verts, les forêts. Pour moi, c’est tout cela la nature. Les prés, les champs, les animaux. »
« L’homme fait partie de la nature. »
« Au final on est des animaux. »
« On a fait partie de la nature, mais on l’a oublié. »
« Cela peut être la nature humaine. Cela peut être entre guillemets, la nature ‘végétale’, la nature ‘animale’, tout ce qui n’a pas été touché par l’Homme. »
« Tout ce qui fait partie de la création humaine, pour moi ce n’est pas de la nature. »
« C’est le vivant. C’est ce qui fait que la vie existe. C’est la vie. »
« C’est un endroit où l’on n’est pas, en fait. »
« C’est un chaos de feuilles, de branches, de lianes. C’est quelque chose dans lequel on ne peut pas passer. »
Là aussi c’est très intéressant. On voit que la nature n’est pas un domaine d’objets en tant que tel. C’est une construction qui permet de donner une saillance à tout ce à quoi le concept est opposé. Donc, on va parler de la nature et de la société, de la nature et de l’homme, de la nature et de l’art, de la nature et de la religion,… Heidegger avait bien mis en évidence que la nature est une sorte de boîte vide qui permet de donner une saillance à tous les concepts auxquels on va l’opposer. Moi, je m’en sers pour signifier la distance qui s’est établie entre les humains et les non-humains. Les rapports entre humains et non-humains, pour un anthropologue comme moi, sont caractérisés par des formes différentes de continuité et de discontinuité. Les Achuars mettent l’accent - et d’autres peuples dans le monde - sur une continuité des intériorités, sur le fait qu’on peut déceler des intentions chez des non-humains qui permettent de les ranger avec les humains sur le plan moral et cognitif.
Mais les européens ont inventé l’idée d’une nature, - ce n’est pas une invention d’ailleurs -,cela s’est fait petit à petit. C’est une attention à des détails du monde qui a été amplifiée. Et cette attention a pour résultat que les dimensions physiques caractérisent les continuités. Effectivement les humains sont des animaux. Tandis que les dimensions morales et cognitives caractérisent les discontinuités : les humains sont réputés être des êtres tout à fait différents du reste des êtres organisés, en particulier du fait qu’ils ont la réflexivité. C’est quelque chose qui a été très bien thématisé au XVIIe siècle, avec le cogito cartésien : « Je pense donc je suis. » Je suis capable réflexivement de m’appréhender comme un être pensant. Et, en cela je suis complètement différent des autres existants.

- « Non seulement les Achuars n’ont pas de terme pour désigner la nature, mais c’est un terme quasiment introuvable ailleurs que dans les langues européennes, y compris dans les grandes civilisations japonaise et chinoise. »
Cela, c’est la philosophie européenne. Mais il y a énormément d’autres cultures où on ne pense pas du tout cette opposition. Vous écrivez que les Achuars n’ont pas de mot pour désigner ce que nous appelons la nature.
Non seulement les Achuars n’ont pas de terme pour désigner la nature, mais c’est un terme quasiment introuvable ailleurs que dans les langues européennes, y compris dans les grandes civilisations japonaise et chinoise.
Que pensez-vous de cette formule que, personnellement, j’emploie souvent quand j’interviens en public : « Ce que nous occidentaux appelons la nature »
Ce n’est pas une mauvaise formule.
Que diriez-vous ?
Je parle de non-humains. Ce n’est pas non plus une solution parfaitement satisfaisante parce que c’est aussi une définition anthropocentrique. Quand on parle de non-humains on les définit comme privés de la qualité d’humain. Mais je pense qu’il est préférable d’utiliser une expression comme celle là, que de parler de nature, parce qu’avec le mot de nature, on fait entrer dans notre univers métaphysique tous les autres, et on les dépossède de l’originalité par laquelle ils constituent le mobilier qui peuple leur monde.
Vous arrivez à ne pas utiliser le mot nature ?
J’essaye.
Mais c’est difficile
J’ai intitulé ma chaire au Collège de France : « Anthropologie de la Nature », justement pour mettre l’accent sur une contradiction évidente. Comment peut-il y avoir une anthropologie d’un monde où les humains ne sont pas présents ? [Le mot anthropologie signfie Etude de l’homme – NDLR.] Or non seulement que les humains sont présents partout dans la nature, mais la nature est le produit d’une anthropisation, y compris dans des régions qui ont l’air extrêmement peu touchées par l’action humaine. Je prends l’exemple de l’Amazonie. Mes collègues et moi en ethnobotanique, en ethno-agronomie et en archéologie, avons montré que cette forêt a été transformée par les pratiques culturales. L’Amazonie n’est pas une forêt vierge. La pratique de l’horticulture sur brûlis et la domestication des plantes par les Amérindiens depuis douze mille ans ont profondément transformé le matériel végétal et la composition floristique de la forêt. On y trouve une biodiversité très élevée, dont une biodiversité de plantes qui sont utiles à l’Homme. Donc, la nature comme espace vierge n’a aucun sens. Quelquefois cette artificialité de la forêt est reflétée d’une façon singulière : chez les Achuars, la forêt est vue comme une plantation. Mais c’est la plantation d’un esprit. Quand les Achuars coupent la forêt pour faire une clairière, ils brûlent les déchets végétaux, plantent une grande diversité de plantes domestiquées sylvestres, et substituent les plantations des humains aux plantations d’un esprit. Et quand au bout de quelques années, on abandonne la forêt, la plantation des esprits va regagner sur la plantation des humains.
Sont-ce les esprits qui plantent ? Ou les plantes elles-mêmes qui…
Ah non, ce sont les esprits. Le détail exact des opérations par les esprits n’est pas mentionné. Mais cela souligne le fait important que dans un cas pareil, l’opposition entre ‘sauvage et domestique’ n’a pas plus de sens que l’opposition entre ‘nature et société’. Pour les Achuars la forêt n’est pas sauvage. La forêt est une plantation, travaillée par des non-humains, elle n’est pas un endroit vierge.
Dans les interviews qu’on a écouté, la dernière personne citait l’exemple de Tchernobyl, et disait « Tchernobyl, c’est là que la nature est revenue, les loups, les plantes, la forêt… ». Que pensez-vous de ce paradoxe où l’extrême artificialité c’est-à-dire une construction humaine a conduit à un désastre mais aussi, même si c’est dans des conditions malsaines en termes de radioactivité, à un retour de... du mot que je ne prononcerai pas, au retour d’animaux, de plantes, d’insectes, d’oiseaux …
C’est très porteur d’espoir. Je suis toujours ravi quand je vois une plante folle entre des pavés ou de voir un renard en ville. Cela dit, les conditions que nous avons imposées par le réchauffement climatique, vont profondément transformer la capacité régénératrice des milieux. L’un des effets du réchauffement global sera un appauvrissement de la biodiversité considérable. L’anthropisation continue de la planète depuis que Homo sapiens exerce sa sapiens sur la Terre a franchi un point de bascule avec le développement des énergies fossiles et le réchauffement climatique qu’il engendre. On n’est plus du tout dans le même registre que l’anthropisation de la forêt amazonienne ou que la transformation de l’Australie centrale par les feux de brousse des aborigènes.
Comment ressentez-vous cette anthropisation, cette destruction peut-être irréversible ?
Entre l’anthropisation de la forêt amazonienne par les Amérindiens durant les derniers millénaires, qui n’est détectable que par des gens capables de faire la différence entre des parcelles qui n’ont jamais été utilisées et des parcelles anthropisées au cours des millénaires avec le même taux de diversité, peut-être une centaine d’arbres par hectare, entre cela et le défrichement systématique par les grands propriétaires terriens par le feu pour ouvrir des pâturages qui vont ensuite devenir des plantations de palmes à huile ou de cacao, ce n’est pas du tout le même degré d’anthropisation. C’est pour cela que le terme qui est devenu courant d’anthropocène, s’il est intéressant parce qu’il définit un changement profond dans le rapport entre les humains et la Terre, a comme inconvénient qu’il dilue la responsabilité d’un système économique et politique, qui est celui qu’on a mis sur pied en Europe à partir de la révolution industrielle, avec un effet destructeur que n’ont pas les autres formes d’anthropisation.
Ce système, est-ce le capitalisme ou autre chose ?
Oui, c’est le capitalisme. Moi, j’appelle cela le ‘naturalisme‘ parce que le capitalisme a besoin de ce sous-bassement que j’ai appelé le naturalisme ; c’est-à-dire cette distinction nette entre les humains et les non-humains, la position en surplomb des humains vis-à-vis de la nature. Alors là on peut parler de la nature comme une ressource à exploiter, comme un endroit animé par des phénomènes que l’on peut étudier, etc. Le capitalisme s’est greffé là dessus, le naturalisme est un bon terreau pour cela. Mais le capitalisme peut aussi se développer par transposition. C’est le cas en Chine, et même d’une certaine façon dans ce qu’a été l’expérience industrielle de l’Union Soviétique, fondée sur l’idée des humains démiurges transformant et s’appropriant la nature. Il y a là un sous-bassement singulier dans l’histoire humaine et dont le capitalisme est une des manifestations les plus exemplaires.

- « Il faut inventer des formes alternatives d’habiter la Terre, des formes alternatives de s’organiser entre humains et d’entretenir des relations avec les non-humains. »
Si l’on veut arrêter la dégradation, la crise écologique sidérante qui se produit en ce début du XXIe siècle, que faut-il faire ?
Inventer des formes alternatives d’habiter la Terre, des formes alternatives de s’organiser entre humains et d’entretenir des relations avec les non-humains. Je reprends la formule de Gramsci, « le pessimisme de la lucidité et l’optimisme de la volonté ». Moi, je dirais « le pessimisme du scientifique et l’optimisme de la volonté » c’est-à-dire que je pense qu’on arrive toujours à changer les choses. Comment ? Et bien par la multiplication d’expériences que je trouve originales dans le monde européen. J’étais à Notre-Dame- des-Landes, il n’y a pas très longtemps, sur la Zad. Et, je trouve que c’est une expérience - ce n’est pas la seule, il y en a d’autres, y compris en France -, qui m’a particulièrement frappé par le degré de réflexivité qu’elle manifeste.
Réflexivité ?
La capacité à poursuivre un projet dont on va examiner toutes les composantes. Au départ il s’agissait d’empêcher un grand aménagement d’aéroport, inutile, couteux, destructeur du milieu. Mais,au-delà, qu’est-ce qu’on fait lorsqu’on pense qu’on a une identité profonde avec un certain milieu avec des non-humains ? Comment on se débrouille pour faire vivre cela en faisant un pas de côté par rapport aux contraintes politiques légales et administratives d’un État moderne capitaliste ou libéral ?
Effectivement, à la Zad, les personnes vont avoir des relations avec les non-humains.
Je crois que le caractère original de cette Zad et, peut être de certaines autres, c’est précisément l’identité qui s’est constituée peu à peu ou l’identification entre les humains et certains non-humains menacés, les tritons, les salamandres, les grenouilles, etc.. Ce qui m’a frappé par exemple, c’est l’attention des gens qui s’intéressent à la forêt. Il y a une petite forêt, qui est exploitée d’ailleurs, dans une attention à l’individualité des arbres.
Cette attention à la cohabitation tranche complètement avec la foresterie industrielle, de même que les techniques de maraîchage tranchent là avec l’agriculture industrielle. Cette attention profonde à la singularité des êtres vivants avec lesquels les zadistes entrent en contact me frappe parce que j’ai vu la même chose en Amazonie.
Ce qui est intéressant, c’est que ce sont des gens qui ne viennent la plupart du temps qui pas d’un milieu paysan et qui vivent une sorte d’Epiphanie. Ils essayent de travailler à l’intérieur d’un collectif où l’on partage à peu près tout, avec cette espèce d’identité profonde, d’identification profonde, qui est singulière.
Pouvons-nous tous devenir des Achuars ?
On ne peut pas devenir des Achuars. On peut devenir des humains différents de ce que nous avons été ou de ce que nous sommes. Découvrir des façons alternatives de vivre pour essayer de nous transformer nous-mêmes.
Les Reporterriens numéro 4
Les Reporterriens, c’est le podcast de l’écologie, réalisé par Reporterre en partenariat avec Ground Control. Retrouvez les autres épisodes à écouter ici : Les Reporterriens
Puisque vous êtes ici…
… nous avons une faveur à vous demander. La crise écologique ne bénéficie pas d’une couverture médiatique à la hauteur de son ampleur, de sa gravité, et de son urgence. Reporterre s’est donné pour mission d’informer et d’alerter sur cet enjeu qui conditionne, selon nous, tous les autres enjeux au XXIe siècle. Pour cela, le journal produit chaque jour, grâce à une équipe de journalistes professionnels, des articles, des reportages et des enquêtes en lien avec la crise environnementale et sociale. Contrairement à de nombreux médias, Reporterre est totalement indépendant : géré par une association à but non lucratif, le journal n’a ni propriétaire ni actionnaire. Personne ne nous dicte ce que nous devons publier, et nous sommes insensibles aux pressions. Reporterre ne diffuse aucune publicité ; ainsi, nous n’avons pas à plaire à des annonceurs et nous n’incitons pas nos lecteurs à la surconsommation. Cela nous permet d’être totalement libres de nos choix éditoriaux. Tous les articles du journal sont en libre accès, car nous considérons que l’information doit être accessible à tous, sans condition de ressources. Tout cela, nous le faisons car nous pensons qu’une information fiable et transparente sur la crise environnementale et sociale est une partie de la solution.
Vous comprenez donc sans doute pourquoi nous sollicitons votre soutien. Il n’y a jamais eu autant de monde à lire Reporterre, et de plus en plus de lecteurs soutiennent le journal, mais nos revenus ne sont toutefois pas assurés. Si toutes les personnes qui lisent et apprécient nos articles contribuent financièrement, la vie du journal sera pérennisée. Même pour 1 €, vous pouvez soutenir Reporterre — et cela ne prend qu’une minute. Merci.
14:19 Publié dans RÉSONANCES | Lien permanent | Commentaires (0)
19/01/2020
Le Silence des Autres (documentaire) de Pedro Almodovar (2019)
1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de la transition démocratique, l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui libère les prisonniers politiques mais interdit également le jugement des crimes franquistes.
Les exactions commises sous la dictature et jusque dans les années 1980 (disparitions, exécutions sommaires, vols de bébés, torture) sont alors passées sous silence.
Mais depuis quelques années, des citoyens espagnols, rescapés du franquisme, saisissent la justice à 10.000 kilomètres des crimes commis, en Argentine, pour rompre ce « pacte de l’oubli » et faire condamner les coupables.
09:53 Publié dans FILMS & DOCUMENTAIRES A VOIR & A REVOIR | Lien permanent | Commentaires (0)
05/01/2020
Les années chiennes (extraits) lu par Ana Minski
16:44 Publié dans CG 2007 - LES ANNÉES CHIENNES | Lien permanent | Commentaires (0)
03/01/2020
Revue Nouveaux Délits numéro 65
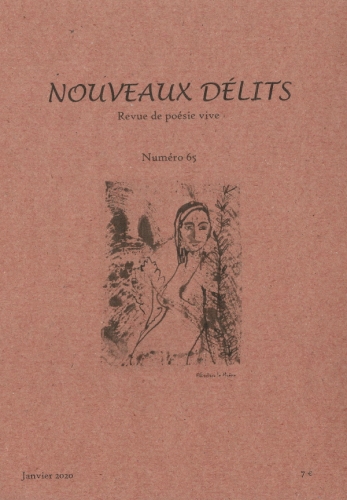
Janvier 2020
Une époque qui semble de plus en plus violente, oppressante, rapide, bruyante, voire cacophonique, absurde, déshumanisée trop souvent, et pour inaugurer une nouvelle année, j’ai vraiment ressenti le besoin d’une énergie plus apaisée — non pas que la douceur soit le monopole de la femme bien au contraire, et quelle merveille que la tendresse d’un homme — mais juste débuter l’année avec une énergie plus yin. Une énergie sacrément puissante, qu’on ne s’y trompe pas, comme peut l’être l’eau, mais peut-être plus aisément dans l’intériorité, moins frileuse dans ses émotions, plus sensuelle aussi et reliée à la nature hors et au-dedans de nous. Un numéro de femmes, il y en a eu un seul avant ça, c’était en janvier 2010, donc 9 ans, c’est un bon cycle pour recommencer. Voici donc un numéro offrant différentes couleurs, saveurs et textures en bouche. Femmes poètes, femmes à différentes saisons de la vie. Femme, mère, grand-mère peut-être et fille… Et là je dois vous avouer mon immense émotion et ma grande joie, cela faisait longtemps qu’il n’y avait pas eu de délit coup de pouce — c'est-à-dire la publication d’un poète mineur dans la revue — ce qui ne signifie par pour autant une écriture mineure, loin de là ! La poésie serait-elle génétique, ou bien serait-elle une sorte de virus que l’on pourrait transmettre par l’éducation ou par amour ? C’est la question que je me pose car pour ce que j’en sais, cela s’est fait sans aucune volonté de ma part, j’en suis la première ébahie et c’est donc avec une grande émotion que j’accueille dans ce numéro mon enfant, qui fêtera ses 17 ans en 2020, comme la revue. Je n’en dis pas plus, je vous souhaite seulement pour cette nouvelle année qui débute, beaucoup de magie, beaucoup de lumière et de la belle obscurité, de celle qui chavire l’âme sans lui faire de mal. Je nous souhaite à toutes et tous, la paix, la sérénité intérieure car on le sait, 2020 ne sera pas un miracle, mais j’ose espérer cependant que quelque chose bouge au cœur même de l’humanité, que quelque chose brille de plus en plus dans nos consciences. J’ose espérer oui et puis 2020, tout le monde l’a remarqué, ça rime avec vin, un bon petit vin de derrière les fagots dans sa belle robe rubis. Allez santé !!
CG

AU SOMMAIRE
Délit de poésie : Danielle Laurent Carcey ; Barbara Le Moëne ; Patricia Castex Menier ; Diane Bifrare ; Zoé Besmond de Senneville ; Cindy Lajournade
Délit coup de pouce : Key Mignot, troubadour onirique
Résonances : Radicelles de Murièle Modély & Dé-camper de Florentine Rey
Délits d’(in)citations décoiffent les coins de pages.
Vous trouverez la bulletin de complicité au fond en sortant, facultatif mais nécessaire, il compte sur vous.

Illustratrice : Barbara le Moëne

Lorsqu'un soir je rentrais dans la chambre, complètement hagarde, par hasard je me regardais dans la glace. Elle reflétait l'image d'une possédée, sauvage et lubrique, repoussante et fascinante. Échaudée, les yeux enfoncés dans les orbites, la chemise de nuit de travers, le corps sans forme. La voilà la sorcière. Cette créature de la terre, aux instincts dénudés, débridés, avec son insatiable appétit de vie, femme et bête en même temps.
Mary Wigman

Les vrais compagnons, ce sont les arbres, les brins d'herbe, les rayons du soleil, les nuages qui courent dans le ciel crépusculaire ou matinal, la mer, les montagnes. C'est dans tout cela que coule la vie, la vraie vie, et on n'est jamais seule quand on sait la voir et la sentir.
Alexandra David-Néel
in Journal de Voyage, Tome 1

C’est quoi une femme à quarante-huit ans passés ?
Quarante-huit ans passés, plus envie de faire semblant. C’est quoi une femme à quarante-huit ans passés ? C’est quoi une femme seule à quarante-huit ans passés? Plus d’un an que je n’ai pas été touchée dedans, pire encore : ça fait longtemps qu’un homme ne m’a pas donné envie d’écrire.
J’ai eu l’art de m’être laissée mal choisir. On appelle ça des expériences, mais c’est juste parce que j’ai mis trop longtemps à me rencontrer pour de vrai. Est-ce que quarante-huit ans passés, c’est enfin la maturité ?
C’est un âge où certain-e-s ressentent le besoin de mentir, mentir sur leurs rêves, mentir sur leur corps, sur les traces que la vie y a laissé, sur la graisse qu’on a tassé pour se protéger, d’autres justement, n’ont plus envie de mentir. Un besoin de vérité, de nudité, de douceur, d’un authentique jus de vie : être aimé vraiment, aimer vraiment. Avec outrance, avec sagesse, avec puissance, avec lenteur, avec autant de subtilité que d’intensité, avec du rire et de la poésie, avec de l’audace et du tournis, parce qu’Éros versus Thanatos, là ça ne rigole plus.
C’est un âge où on se dit que si à vingt ans on avait su tout ce qu’on savait maintenant… Et on préfère ne rien s’en dire.
C’est un âge où soudain on n’a plus envie d’attendre, plus envie d’être fidèle à son malheur. Un âge de volcan qui n’a pas dit son dernier mot.
Cathy Garcia Canalès, octobre 2018
Nouveaux Délits - Janvier 2020 – ISSN : 1761-6530 - Dépôt légal : à parution - Imprimée sur papier recyclé et diffusée par l’Association Nouveaux Délits - Coupable responsable : Cathy Garcia Canalès - Illustratrice : Barbara le Moëne - Correcteur : Élisée Bec
http://larevuenouveauxdelits.hautetfort.com/
23:53 Publié dans LA REVUE NOUVEAUX DELITS | Lien permanent | Commentaires (0)
The turning point par Steve Cutts
25/12/2019
Silvano Mello

16:09 Publié dans RÉSONANCES | Lien permanent | Commentaires (0)
20/12/2019
L’œil du paon de Lilia Hassaine
Gallimard, 3 octobre 2019
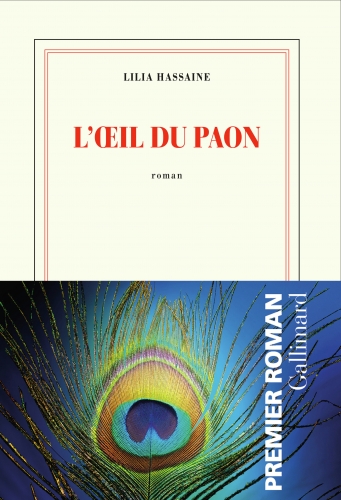
230 pages, 18,50 €.
Très bien écrit, fluide, on se laisse facilement aspirer par L’œil du paon qui trace un portrait acerbe d’un certain milieu parisien plutôt huppé. Dans ce roman qui a quelque chose d’un conte moderne froid et cruel, il y a une esthétique de l’écriture qui tient de la peinture. Il y est d’ailleurs fait mention des tableaux de Hopper, dont l’univers colle assez bien en effet avec l’atmosphère du roman.
Le côté froid, vaniteux, désabusé, à la fois superficiel et pesant de cette vie parisienne, auquel se confronte Héra, la jeune femme, personnage principal du roman, contraste avec la chaleur, la liberté, les couleurs, les parfums de l’île au large de la Croatie, dans laquelle elle a grandi, sorte d’éden à l’abri du monde, peuplé de paons. Oiseau emblématique, délibérément choisi par l’auteur pour ce qu’il évoque : la beauté mais aussi et surtout l’orgueil, caractéristique typiquement humaine, que nous projetons sur lui. Sur cette île où Héra a vécu seule avec son père, gardien de l’île — sa mère étant morte là-bas très prématurément — plane une menaçante légende en lien avec une ancienne abbaye détruite durant les campagnes napoléoniennes.
Lilia Hassaine décortique ses personnages au fil des pages, comme des crevettes qui laisseraient sortir un jus pas toujours appétissant, tout en laissant une part de flou, de mystère, d’inaccessible, car l’humain n’est pas en noir et blanc comme les photographies qu’aime prendre Héra. Chacun est comme absorbé dans son propre monde, ses propres secrets, projetant juste une apparence sur une grande toile de cinéma. La salle reste obscure. Les relations humaines sont tristes, artificielles, le mensonge dissimule le malaise ou pire, nul ne semble être vraiment à sa place mais chacun joue son rôle comme dans un théâtre antique. L’intrigue laisse cependant deviner et c’est dommage, la fin bien trop tôt, mais cela n’empêche pas d’apprécier la lecture quasiment jusqu’au bout. L’œil du paon ayant une originalité certaine que la qualité littéraire de l’ensemble sert au mieux.
L’auteur parvient à ne rendre aucun de ses personnages réellement attachant, ce qui traduit bien l’angoisse sourde qui coule en-dessous de la trame comme un égout. Ici l’humanité est un condensé de tentatives avortés dans une quête de beauté, de perfection, inaccessibles car toujours extérieures à elle. Et puis il y a Hugo, l’unique enfant au centre de la toile, terriblement seul dans un vide qui ne tient plus que par quelques apparences et une bonne dose de cynisme. Quelle place ici pour la fraîcheur, l’innocence ?
L’œil du paon est un premier roman, que l’on peut qualifier de prometteur.
Cathy Garcia
 Lilia Hassaine est journaliste, diplômée en 2015 de l’Institut Français de Presse. Par la suite, elle effectue de nombreux stages dans la presse écrite, notamment pour Le Parisien et à la télévision pour la chaîne Arte, avant de se faire remarquer grâce à son web-documentaire De mèche contre le cancer où elle traite du don de cheveux. En parallèle, elle intègre le groupe TF1 où elle officie en tant que journaliste avant de rejoindre l’équipe de l’émission Quotidien en janvier 2016, équipe qu’elle a quitté pour écrire ce premier roman.
Lilia Hassaine est journaliste, diplômée en 2015 de l’Institut Français de Presse. Par la suite, elle effectue de nombreux stages dans la presse écrite, notamment pour Le Parisien et à la télévision pour la chaîne Arte, avant de se faire remarquer grâce à son web-documentaire De mèche contre le cancer où elle traite du don de cheveux. En parallèle, elle intègre le groupe TF1 où elle officie en tant que journaliste avant de rejoindre l’équipe de l’émission Quotidien en janvier 2016, équipe qu’elle a quitté pour écrire ce premier roman.
13:34 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
16/12/2019
Le soleil sur ma tête (O sol na cabeça) de Geovani Martins
traduit du portugais (Brésil) par Matthieu Dosse
Gallimard 17 octobre 2019

135 pages, 15 €.
« – C’est parce-que le monde entier est foncedé, frère. Comme si tu ne savais pas ça. Je te le répète : une semaine sans came et tout Rio de Janeiro s’arrête. Plus de médecins, plus de chauffeurs de bus, plus d’avocats, plus de policiers, plus d’éboueurs, plus rien. Tout le monde va devenir ouf à cause de l’abstinence. Cocaïne, Rivotril, LSD, ecstasy, crack, cannabis, antidouleurs, peu importe, frère. La came c’est le combustible de la ville. (…)
– La came et la peur, j’ai ajouté.»
Ceci n’est pas un livre qui parle des favelas de Rio, ce sont les favelas qui y prennent la parole et donnent à voir une autre image, bien plus réelle, de cette ville qui fait rêver avec sa façade de carte postale, ses plages faussement paradisiaques, son carnaval à paillettes, sa samba perpétuelle. Rio de Janeiro a un autre visage, un visage balafré par la violence, fille bâtarde de l’exclusion sociale, un visage recouvert de la poussière humaine déposée par les exodes ruraux, populations nordestines et d’ailleurs, fuyant l’aridité extrême de leur existence et dont les espoirs s’échouent dans les quartiers nord et les bidonvilles nommés ici favelas, en mémoire d’une fleur qui pousse – poussait ? - sur les mornes abrupts qui dominent la ville. Visage cependant non dénué de beauté et capable de séduire par sa force et sa vivacité.
Dans ces favelas, génération après génération, grandissent des enfants, des adolescents, pour qui l’avenir offre peu de perspectives. Geovani Martins est de ceux là, de ces enfants qui vivent dans la pauvreté excentrée et dont le quotidien est à la fois bousculé et balisé par la violence des trafics de drogue et celle de la police très corrompue. Dans ces zones que se disputent les factions rivales, ce sont les habitants toujours qui en prennent plein la gueule, les balles qui sifflent et les cadavres au petit matin rythment leur quotidien déjà difficile.
Pour la jeunesse, assignée à faire le guet dès son plus jeune âge pour les dealers, il n’y a que l’amitié, le rire, la fête, les virées à la plage où le touriste inconscient se fait régulièrement dépouiller, pour faire la nique à la mort, au plomb de leur vie mal barrée. Les joints, les acides, la coke, les ecstas, le lança perfume — une drogue à base d'éther très en vogue au Brésil depuis des décennies, au départ comme accessoire de carnaval — tout est bon même si pas bon, pour s’évader et s’amuser. La défonce devient le dénominateur commun de la jeunesse du monde entier, mais ici la pente est raide et rapidement sans-retour. L’enfer est facile d’accès et ceux qui touchent au crack en reviennent rarement. Mais dans Le soleil sur ma tête, Geovani Martins ne fait pas dans le pathos, le sensationnel, il parle simplement et avec talent de ce qu’il connait. Il raconte une jeunesse comme n’importe quelle jeunesse, qui a juste besoin de vivre et de mettre des coups de bombes de couleur à une existence qui sent trop vite l’égout.
L’auteur trempe sa plume dans une encre désabusée mais légère cependant et sensible, le ton est lucide, direct, plein d’humour, de fraîcheur malgré la fièvre de cette ville folle et l’horizon bouché et la langue utilisée est celle de la rue, pas de prise de distance, la littérature est là aussi : dans ce bouillon de la langue populaire.
Geovani Martins est de ceux qui savent la débrouille et le rire envers et contre tout. Cette joie inconditionnelle qui est un passeport pour la survie et l’énergie d’une jeunesse défavorisée qui ne part pas perdante pour autant. Certains s’en sortent, armés pour la vie par des expériences fortes et des difficultés qui les obligent à être plus malins que la mort. Les favelas elles-mêmes peuvent devenir des centres qui produisent leur propre énergie culturelle et économique. Les possibles ressuscitent encore et encore, malgré tout.
Treize nouvelles qui vous font passer là où nul touriste n’est censé se promener, treize nouvelles qui évoquent le quotidien de ces cariocas qui n’apparaissent pas sur les cartes postales, la vie sans paillettes des laissés pour compte d’une des villes les plus inégalitaires au monde. La vie telle qu’elle vient jour après jour et telle qu’il faut faire avec. Et puis la magie aussi, la magie de la macumba, de tous les sangs mêlés, les légendes urbaines, tout un univers populaire carioca haut en couleurs auquel l’auteur donne la dimension qu’il mérite, dans la lignée prometteuse d’un Jorge Amado version XXIe siècle.
Treize nouvelles d’un réel non coupé, d’un pur réel sur la corde raide avec le vide de chaque côté.
Cathy Garcia
 Né en 1991 à Bangu, une favela de la périphérie ouest de Rio de Janeiro, Geovani Martins déménage en 2004, avec sa mère et ses frères à Vidigal, dans la Zona Sul : autre favela, autres règles, autre monde. Le choc provoqué par ce déménagement fut la genèse de chacune de ces treize nouvelles. C’est lors d’une journée en garde à vue, faute d’autre occupation, que découvrant l’œuvre du romancier Roberto Drummond, il prend goût à l’écriture. Après des années de petits boulots et une tentative d'écrire un roman, il travaille à écrire des nouvelles sur une machine à écrire offerte par sa famille et présente son premier recueil à un salon en mars 2017. Il devient un modèle local avec ce premier livre qui connaîtra un grand succès au Brésil avant même d'être publié.
Né en 1991 à Bangu, une favela de la périphérie ouest de Rio de Janeiro, Geovani Martins déménage en 2004, avec sa mère et ses frères à Vidigal, dans la Zona Sul : autre favela, autres règles, autre monde. Le choc provoqué par ce déménagement fut la genèse de chacune de ces treize nouvelles. C’est lors d’une journée en garde à vue, faute d’autre occupation, que découvrant l’œuvre du romancier Roberto Drummond, il prend goût à l’écriture. Après des années de petits boulots et une tentative d'écrire un roman, il travaille à écrire des nouvelles sur une machine à écrire offerte par sa famille et présente son premier recueil à un salon en mars 2017. Il devient un modèle local avec ce premier livre qui connaîtra un grand succès au Brésil avant même d'être publié.
16:39 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
15/12/2019
Le dernier grenadier du monde de Bakhtiar Ali
traduit du kurde sorani par Sandrine Traïdia
Métailié éd., 29 août 2019

336 pages, 22 €.
« Au-dessus de sa tête, il voit les branches d’un grenadier. Il entend le bruit de la destruction et de la pulvérisation des objets, il a entendu parler de la poussière mortelle de verre que le vent répand la nuit sur le monde. »
Un roman bien déstabilisant que nous offre ici cet auteur d’origine kurde, un roman dont le rythme et la narration est tout à fait atypique pour un lecteur occidental, comme une litanie qui s’étire, se distend, se ressasse par des répétitions, comme un conteur qui aurait un peu perdu la tête, une sorte d’errance littéraire traversée de fulgurances d’une beauté telle, que le livre reste collé aux mains du lecteur.
« Regardez, toutes les histoires sont comme un tout petit ruisseau qui, à la fin, vient se jeter dans la vaste mer, riche de milliers d’autres histoires… Et chaque fois qu’un conteur meurt en chemin, il faut qu’un autre conteur prenne sa place et que, rivière après rivière et mer après mer, il poursuive cette histoire. »
Mouzaffar Soubdhdam est un ancien officier supérieur peshmerga que l’on sort soudain de vingt et un an d’emprisonnement et d’isolement quelque part dans le désert. Il s’était livré pour sauver son meilleur ami, un légendaire chef révolutionnaire kurde. Libéré, il est emmené dans un palais vide entouré d’un immense jardin, qui appartient à cet ancien ami qui a bien changé et là il se retrouve isolé à nouveau, mais cette fois, il refuse cette réclusion, aussi dorée soit-elle.
Il a besoin de savoir, de comprendre ce qu’est devenu son pays et aussi de retrouver son fils Saryas Soubdham, son fils qu’il n’a jamais connu. Cette quête lui fait parcourir un pays méconnaissable, que les guerres ont miné de toutes parts et il découvre en chemin, qu’il n’existe pas un seul Saryas Soubdham, mais plusieurs : trois garçons du même âge, portant le même nom, qui n’ont pas vécu au même endroit mais qui sont reliés par un fil énigmatique. Un fil, un arbre — le dernier grenadier du monde — et trois fragiles grenades de verre.
Trois vies défigurées.
« (…) l’histoire des Saryas, du début à la fin, qu’elle que soit la couleur qu’elle prenne, quel que soit le chemin qu’elle emprunte, n’échapperait pas au fait qu’elle est l’histoire de tous ceux qui se sont retrouvés abandonnés sur cette terre au-milieu des tourbillons de poussière. »
Et Mouzaffar Soubdhdam raconte, raconte inlassablement son histoire et surtout ce qu’il a pu découvrir de celle de ces trois Saryas et des personnages que chacun d’eux a rajouté à la trame, dont deux sœurs étranges, les sœurs Spi, qui ont fait un pacte avec l’un d’eux, après avoir fait longtemps avant, un pacte entre elles.
« Lawlaw Spi et Chadarya Spi s’étaient fait très jeunes le serment éternel de ne jamais se marier de leur vie, de ne jamais se couper les cheveux, de ne jamais chanter l’une sans l’autre et de ne porter que des robes blanches. »
Et quand Mouzaffar raconte, c’est la nuit sur une embarcation en plein milieu de la Méditerranée, une parmi ces centaines et centaines qui se jettent sur l’eau à destination de l’Europe.
Le dernier grenadier du monde est un roman indescriptible, poétique, tragique, lancinant, comme une lente, très lente traversée d’un espace mélancolique et interminable, celui d’une humanité désertée de toute possibilité d’avenir, une humanité corrompue et détruite de l’intérieur par sa propre folie.
« Les grandes catastrophes donnent à la vie un cours qu’il n’est plus possible de remanier par la suite. (…) Une nuit, nous nous sommes réveillés et nous avons vu qu’il ne restait plus un carré de ciel au-dessus de nos têtes. Nous avons fui sur les ossements et sur les crânes de nos amis. »
Le dernier grenadier du monde est l’histoire de tous les innocents broyés par cette folie, l’histoire de tous les enfants renversés par les guerres et sur la nécessité, l’impérieuse nécessité cependant d’un amour fou, un amour qui n’abandonne jamais. Et le long tissu de la langue qui se déroule, avec ces motifs qui se répètent encore et encore, est comme un voile de pudeur qui revêt la trop brutale réalité.
Et puis il y a cet arbre, cet arbre légendaire et salvateur que trois adolescents, perdus dans une de « ces nuits où la réalité enfonce ses dents les plus laides dans le corps de l’homme », peuvent atteindre.
« (…) le dernier grenadier du monde, ce grenadier était le seul représentant de leurs rêves, à la frontière qui se trouve entre le ciel et la terre, ce rêve auquel ils ne pouvaient pas donner de nom, le rêve d’une compréhension mutuelle entre les hommes, les frères et les ennemis. »
Quand les pères sont happés par le tumulte et la violence de l’Histoire, les fils errent en aveugle.
« Cette nuit-là je compris les malheurs que la disparition et l’impréparation d’un homme pouvait causer. Je compris combien était grande, étrange et importante la place de l’homme sur cette terre. L’homme qui, une fois qu’il est né, laisse pour toujours des traces claires dans la vie des autres. La vie n’est rien d’autre qu’une chaîne éternelle, continue, ininterrompue.»
« Je sais que l’homme est un être pour qui les chemins se brouillent vite, je sais que l’homme ne trouve pas les chemins. Aucun être sur terre ne perd autant sa route que l’homme… »
Et cette histoire, c’est donc aussi la nôtre et « c’est un sale temps, une époque dont l‘odeur n’est pas meilleure que celle du cul d’un âne. » et c’est cependant envers et contre tout, un message d’espoir que porte Mouzaffar Soubdham, un message qui espère illuminer cette longue nuit noire de l’humanité perdue.
« Non, ne dites pas que nous sommes fatigués de cette mer et ne demandez pas jusqu’à quand nous devrons tourner en rond sur cette mer. Demandez-moi pourquoi je suis devenu comme le prophète des souffrances. Pendant vingt et un ans, jour et nuit, j’ai regardé le désert de ma fenêtre et je l’ai appelé à l’aide. Depuis cette fenêtre, j’ai vu quelque chose. Une chose sans laquelle je n’aurais pas survécu… Depuis cette fenêtre, j’ai vu le bonheur du désert, j’ai vu le jeu entre le sable et la lumière. Si, durant ces vingt et un ans, je n’avais pas cru voir une beauté immense et infinie dans ce sable, je m’y serais noyé. Jusqu’à son dernier souffle, jusqu’après sa mort même, l’homme ne doit pas perdre la foi dans son bonheur, il ne doit pas perdre la foi en la beauté… Non je ne suis pas un homme à deux visages. Moi aussi, comme chacun de vous, j’ai crié de tout mon cœur contre toutes les absurdités. Moi aussi j’étais très désespéré. Souvent, j’ai été vaincu, je me suis incliné et j’ai été anéanti. Mais je parle de la lumière qui jaillit après tout désespoir. »
Cathy Garcia
 Bakhtiar ALI est né à Sulaimaniya, dans le Kurdistan irakien, en 1966. Il est devenu un romancier important dans les années 90. Ses livres sont des best-sellers en Iran et en Irak, il a reçu de nombreux prix littéraires au Moyen-Orient. Il est un des auteurs kurdes contemporains les plus connus. Il vit à Cologne depuis 1998. Il est traduit en farsi, en anglais, en allemand, en italien et en arabe.
Bakhtiar ALI est né à Sulaimaniya, dans le Kurdistan irakien, en 1966. Il est devenu un romancier important dans les années 90. Ses livres sont des best-sellers en Iran et en Irak, il a reçu de nombreux prix littéraires au Moyen-Orient. Il est un des auteurs kurdes contemporains les plus connus. Il vit à Cologne depuis 1998. Il est traduit en farsi, en anglais, en allemand, en italien et en arabe.
22:54 Publié dans CG - NOTES DE LECTURE | Lien permanent | Commentaires (0)
11/12/2019
CROISSANCE : 2 % AVANT LA FIN DU MONDE
"En tant que jeunes ingénieurs on nous répète que le progrès technique et la croissance sont les solutions aux problèmes de notre société. Face à la crise écologique comment peut-on continuer à croire que l'innovation rendra la croissance infinie possible ? Le paradigme de la croissance du PIB et le mythe du progrès technique font parti du discours dominant dans les sociétés capitalistes, pourtant nous constatons un manque de recul critique à l'égard de l'innovation. Les interviews de ce documentaire présentent une réflexion nécessaire sur la neutralité de la technique, les limites physiques de notre planète et les choix structurants d'organisation de la société. Et si les solutions étaient politiques plutôt que techniques ? --------------------------------
Une réalisation associative : Ingénieur·e·s Engagé·e·s Lyon, La Mouette, Objectif21 Avec la participation de : Monsieur Bidouille, Philippe Bihouix, Alexandre Monnin, Baptiste Mylondo, Baptiste Nominé et Clément Poudret. Les interviews complètes de chaque intervenant seront publiées plus tard sur cette chaîne ! Peertube : https://pe.ertu.be/videos/watch/667c2...
Mastodon : @docu@pe.ertu.be Nous contacter : ie.contact@asso-insa-lyon.fr"
21:37 Publié dans ALTERNATIVES, RÉSONANCES | Lien permanent | Commentaires (0)
Interview de Mathieu Rigouste, sociologue et essayiste le 13/02/2018
10:08 Publié dans COMPRENDRE LE MONDE | Lien permanent | Commentaires (0)
10/12/2019
Kalushi: The Story of Solomon Mahlangu de Mandla Dube (2017)
Basé sur un fait vécu, Kalushi relate l’histoire de Solomon Mahlangu, un marchand ambulant de dix-neuf ans issu des rues de Mamelodi, un ghetto situé en marge de Pretoria, en Afrique du Sud. Brutalement battu par la police, Kalushi s’exile pour joindre le mouvement de libération à la suite des émeutes de Soweto en 1976. Alors que lui et son camarade Mondy revenaient d’une formation militaire à Angola, en route vers leur lieu d’assignation, Mondy perd le contrôle et tire sur deux innocents sur la rue Goch, à Johannesburg. Mondy est violemment battu et torturé tandis que Kalushi fait l’objet d’un procès régi par la doctrine de la communauté d’intérêts. L’État se prononce en faveur d’une mort par pendaison, la sentence la plus sévère qui soit. Adossé contre le mur, Kalushi utilise la salle d’audience comme dernier champ de bataille. Son sacrifice fera de lui un héros de guerre et une figure marquante des événements du 16 juin 1976, connue sur la scène internationale.
23:08 Publié dans FILMS & DOCUMENTAIRES A VOIR & A REVOIR | Lien permanent | Commentaires (0)
08/12/2019
La garde de nuit (enfer hospitalier) Acte I
- 8 déc. 2019
- Par LAURENT THINES
- Blog : Le blog de LAURENT THINES
Prologue
Quand le dragon vole.
Long soir d’été.
Un dragon insomniaque, déterminé, détonnant et oblong, escarboucle lumineuse au front, escalade en flammes rouges et vertes l’à-pic de mon jardin d’étoiles pour mieux se précipiter à l’assaut du fleuve.
Tournesol guerrier saigné au flanc, il tourne ses pétales au son doux et velouté d’un elfe crachant lentement sa soupe de lamier blanc.
Il découpe de ses pales sombres la voie lactée qui retombe en goutte-à-goutte d’étoiles filantes dans les veines de l’être qu’il porte au ventre, bien loin du sol, au delà de la forêt des ombres.
Cette âme pâle et souffrante, heurtée et paralysée comme cette lune d’été, il l’a gobée sur la plaine, au milieu des tôles froissées. Il la régurgitera bientôt sur l’esplanade ronde de la Tour des miracles.
Ici, l’air du soir, à nouveau calme, se recouche. La Garde veillera d’un œil intranquille sur le silence des remparts de ma nuit.
Au cœur de mes rêves, l’écran s’embrase de bleu et alors monte l’alerte…
Premier Acte :
La pierre
La Tour
Informe architecturale, elle trône tel une diva sous sa peau criblée par le vitriol des ans. Neuf bourrelets de souffrance étagée seyant sur un fondement au sous-sol sismique.
Dans ses entrailles grises ou colorées, presque désamiantées, des trachées artères pompent de leurs plèvres cancéreuses un air retraité, qu’elles exsufflent par leurs gueules grillagées.
Des veines translucides ramènent, par pulsations rythmées, les capsules de sang étiquetées vers le cœur du laboratoire de la méga cité.
Des barges, poussées par des cygnes bleus, portent les malades et glissent, au flux péristaltique des canaux hospitaliers, aux mains de gondoliers asservis à leurs tablettes connectées.
Sur les berges escarpées, on observe la ronde perpétuelle des spectres d’humanité - rose morose, verte de rage, blanche de saignée - qui filent au rythme des machines à pointer. Âmes garrotées puis vidées de leur vocation, encloîtrées entre leur vœu d’Hospitalité et la boulimie de la bête à rentabilité.
Pourtant, aux parois de ses boyaux sombres, on voit encore flamboyer quelques torches de générosité. En ombres chinoises, donneurs et greffés, main dans la main, échangent leurs amitiés, dans une dernière valse de fraternité.
Ainsi, sous les emblèmes d’Eros et Thanatos réunis, la Tour domine tout : ses saigneurs et ses serfs, ses remparts et ses tourelles. De Planoise en contrebas, toute une volée de passerelles rampe sur son pas.
Les cheminées d’évacuation et les feux sentinelles fument au toit. Aux alentours, les odeurs de chair humaine se mêlent à celles du bois.
Et au crépuscule, le vol immobile d’une crécerelle sonne le glas.
Princes du sang
A la table ronde des conciliabules pluridisciplinaires, sous leurs armoiries de bistouris ou de cathéters, les saigneurs s’affrontent en joutes orales passionnées, défendent leur maison ou leur chapelle puis transigent avant de partir avec leur ost pour la bataille.
--- Leurs campagnes : rebâtir les canaux vasculaires, lutter contre l’extravasation et dégorger les plaines inondées ; éventrer les barrages ischémiques, libérer le flux artériel des fleuves et irriguer les aires cérébrales asséchées
--- Leurs gloires : ligaturer les vouivres anévrysmales, sauver les noyés des lacs sanguinaires, décapiter les hydres artério-veineuses, étouffer les guivres fistuleuses.
--- Leur Sainte Mission: préserver nos corps de l’hémorragie en refondant notre calice vasculaire.
--- Leur Saint Graal : vaincre la Maladie, sans verser le sang des blessés ou des morts.
Ici, je suis.
Ici, je suis chevalier Hospitalier, moine soldat, mercenaire, vassal, dans l’allégeance à la Tour.
Ici, je sais écrire, trancher et recoudre, publier les bans, convoquer l’ost, mener mes troupes, faire fructifier mon fief, et par dessus tout, offrir ma vie au champ de bataille hospitalier.
Ici, je porte encore l’exhaustion de ces années de combats larvés pour une victoire acérée sur les terres d’un prince noir. Perfidement adoubé chevalier puis homme-lige. Dans l’Immixtio manuum, vassal aux mains choyées. In fine, féal aux doigts broyés, désavoué sous le miroir brisé, emprisonné dans le vertige des arcanes d’une autre Tour.
L’honneur en étendard et l’exil pour seule survie, je m’exfiltrai in extremis.
Ici, je suis le chevalier errant, le vainqueur inféodé venu du Nord, et personne n’imagine le trésor d’énergie vitale dont il m’avait déjà patiemment spolié.
Chaque matin
Mains heureuses d’enfant joueur qui, dans le jardin des salles opératoires, font voler des papillons en papier d’emballage stérile.
Puis la matière pensante de mon cerveau, par ces mains prolongée, opère d’autres cerveaux - éveillés.
Artisan de l’humain (neuro-chir-urgien)
Mains fermes de forgerons, elles empoignent, frappent et soudent le titaneaux colonnes écroulées. Mains calleuses de menuisier, elles redressent, chevillent et vissent le bois des nuques brisées. Mains appliquées de tuyauteur, elles détectent, calfatent et tarissent les fuites de liquide méningé. Mains blanches de mosaïste, elles récupèrent, réassemblent et jointent les puzzles de crânes éparpillés.
Mains agiles de poissonnier, elles ligaturent, sectionnent et enlèvent leurs tentacules aux hydres vasculaires. Mains féroces de volailler, elles saisissent, étranglent et asphyxient au col les crêtes anévrismales. Mains tranchantes d’équarrisseur, elles excisent, parent et ficellent les chefs aux chairs scalpées. Mains rouges de boucher, elles taillent, désossent et s’essuient au bleu des tabliers.
Mains savantes de puisatier, elles forent, pompent et drainent le fluide des nappes sous-crâniennes. Mains vigiles d’aiguadier, elles dérivent, vident et assèchent de leur sang les zones inondées. Mains créatrices et architectes, elles dessinent, déroutent et aqueduquent le cœur aux hémisphères abandonnés. Mains bleues de fontainier, elles ponctionnent, guident et recueillent l’eau de roche à la source des lombes.
Mains têtues de maraicher, elles séparent, coupent et cueillent des méningiomes gros comme des oranges. Mains soigneuses d’horticulteur, elles visent, greffent et plantent des électrodes aux noyaux gris des cerveaux. Mains cloquées de cantonnier, elles creusent, élargissent et égalisent l’os arthrosique des canaux rachidiens. Mains vertes de jardinier, elles traitent, élaguent et déracinent les ramées de gliomes cancéreux.
Mains douces de coiffeuse, elles peignent, rasent et tressent au cuir les cheveux horripilés. Mains patientes de couturière, elles découpent, cousent et rapiècent de Goretex les méninges déchirées. Mains ciseleuses de joaillière, elles assemblent et attachent des colliers de veines au cou des artères. Mains mauves de lavandières, elles lavent, rincent et essorent aux soleils scialytiques les têtes de leurs victimes.
Mains charcutières dans le ventre de la bête.
Mains ouvrières dans le rouage de la machine.
Mains téméraires dans les tréfonds de la Tour.
L’apprenti sourcier
Deux êtres tremblants, chacun dans leur tranchée, de chaque côté du lit de la rivière blanche qui les sépare. Face tournée au sol, le patient courbe l’échine, se recroqueville en serrant son coussin de misère sur ses dents. L’apprenti sourcier, lui, officie nerveusement et calcule sa trajectoire, méticuleusement.
Une bise glaciale s’abat alors sur la plaine des reins. Tressaillement dans les rangs, au premier bataillon antiseptique. Un drapeau bleu perforé a été déployé. Au centre, on aperçoit une clairière, rose comme un champ de bataille. Cercle d’effroi dans les lombes qui délimite la cible. Raidissement, au deuxième bataillon antiseptique.
Palpation appuyée d’une phalange, humide sous les gants, qui fouille profondément les ligaments. On énumère les épineuses questions. Où est la moelle ? Où trouver la voie ? Où créer la brèche ?
Puis, l’alerte d’une attaque par le ciel et la peur sur les deux fronts. Derrière celui du patient, sonnent les clairons de son instinct de survie. Se réfugier dans les galeries de son courage. Se boucher les oreilles. Fermer les yeux. Serrer les dents. Serrer les poings. Et attendre…
Le bâton aiguisé et brillant de l’apprenti sourcier tremble, tremble, tremble sous la lune pâle. Il lui indique le chemin de la source. Soudain dans le bas du dos de son patient, comme la trace stridente et acérée d’une flèche brûlante. Spasme des muscles paravertébraux suivi d’un fin craquement d’outre.
Ses yeux s’éclairent alors. Son cœur ralentit. Entre ses doigts, la joie fleurit. Dans les mains du nouveau sourcier, l’eau de roche jaillit, pure. De l’autre côté du champ de bataille, on attend encore inquiet l’annonce du cessez-le-feu par l’arrachement de terre, dans un dernier trismus, de l’étendard de la victoire.
Enfin, on pansera la plaie punctiforme du blessé.
Le chêne sacré
Elle est là, qui attend tremblante, comme la frondaison sous le vent mauvais, à l’heure du rendez-vous d’annonce.
Elle est là, qui angoisse au creux de ses cernes pour son Homme à l’écorce du crâne scarifiée. Elle pressent le Mal qui lui ronge la cervelle, comme la vermine dans l’aubier.
Lui, le grand abatteur d’arbres, autrefois libre comme la forêt comtoise, autrefois puissant comme le chêne millénaire, et à présent, posé las, à son tour, branche ballante, racines instables, fibres cérébrales entaillées, dans ce corps qui penche et menace, comme un arbre vermoulu, sous la cognée du cancer.
Elle est là, qui s’effondre au coup vil asséné par le coin de la sentence diagnostique: glioblastome, la gale du cerveau qui pousse et poussera son Homme au chablis. Condamnation à perpétuité.
Elle est là, qui pleure à nouveau la sève amère, infiltrée dans ses veines depuis la mort du petit, noyé durant trente trois lunes, autre cher de sa chair, tombé et rongé avant elle.
Dans le désespoir, je serre son bois de cœur, tendre et sombre, dans ma main, et nous buvons sa douleur à l’ombre du grand chêne.
Sur le fil
Encore une journée qui s’achève, dans le bonheur masochiste de ne pas avoir encore touché un seul instant le sol.
Imprudent funambule que je suis, en équilibre, toujours instable, sur le fil à couper le bord de ma vie, tendue au travers du gouffre hospitalier.
Encore une journée qui m‘achève.
Laurent Thines
(qu'on peut lire aussi dans le dernier n° de la revue Nouveaux délits, le 64)
21:09 Publié dans LA REVUE NOUVEAUX DELITS, RÉSONANCES | Lien permanent | Commentaires (0)
01/12/2019
Avalé avalant par Laurent Albarracin
https://revuecatastrophes.wordpress.com/2019/11/29/avale-...
.
.
Il se pourrait que le poète fût une sorte de Jonas, une sorte de prophète empêché de prophétie, qui n’ait plus rien à révéler de l’avenir aux hommes, et pour cause : il n’y a plus de dieu, plus de mission, plus de châtiment, plus d’avenir non plus ni d’absence d’avenir d’ailleurs mais un éternel présent, à la fois catastrophique et habitable, tout ensemble désastreux et confortable. Un Jonas, parce qu’il est un prophète en exil dans le cœur du présent, et parce qu’il trouve son refuge au sein du danger même, dans la gueule accueillante du grand poisson. Le poète est un renverseur de signes.
Enfermé volontaire, emprisonné satisfait, il a troqué la tour d’ivoire pour la baleine blanche et sombre. À la position de surplomb au dessus de la mêlée, il préfère se lover dans chacun des nœuds de l’emmêlement général, dans le cœur intime et obscur des choses dont il explore indéfiniment l’intimité foisonnante. Gaston Bachelard fait de Jonas la figure même du rêveur d’intimité [1]. Il est celui qui se repose et qui, se reposant, se nourrit, s’agrandit de songes. Il vit chaudement les intériorités. S’ouvre alors à lui l’horizon de la profondeur. Il ne connaît qu’un infini, celui des poupées gigognes. Il a devant lui une seule immensité, celle des emboîtements sans fin. Jeté dans le ventre du monstre, il en est paradoxalement protégé ; il jouit d’une protection maximale et absolue (car elle est paradoxale) et il récupère en quelque sorte sa force de digestion et d’assimilation. Nombre de poètes ont rêvé cette situation de dévoré heureux baignant dans un liquide amniotique et ce prestige de l’avalé avalant, avatar positif de l’arroseur arrosé. Être heureux, c’est précisément jouir d’une intimité qu’on transforme à volonté en vastitude qu’on métabolise, au sens digestif. Ainsi de Jean-Paul de Dadelsen :
Autour de nos reins les parois de la nuit sont rondes et sonores.
Dans la rumeur des artères heureuses et du sang contenté le cœur
Écoute s’ouvrir l’espace intérieur.
Les yeux fermés, regarde, telle une image dans une eau sombre,
À l’inverse de la fuite des mondes tournoyer des constellations obscures
Sous les voûtes de notre sang.
Les ténèbres du temple charnel sont vastes comme les profondeurs des cieux. [2]
Exemple parmi tant d’autres d’un avalement heureux, de l’exploration d’une intériorité océanique. Être avalé tel Jonas, c’est être pris dans un processus sans fin d’avalement, et c’est se faire soi-même avalant, avaleur. Ce n’est pas seulement être mangé, c’est aussi devenir peu à peu le mangeur, c’est participer à la lente rumination des mondes qui se fait dans toutes les intimités heureuses. Être contenu, c’est être inséré dans une chaîne continue de contenance, dans un emboîtement généralisé. Comme si être dedans les choses, c’était se découvrir au seuil d’un dedans infiniment répété, dont chacun recommence la promesse de bonheur.
Jonas est celui qui change une hostilité en une hospitalité. C’est aussi celui qui, par son inaction, par sa situation d’empêchement, est en état de réceptivité maximale. Jonas nous rappelle qu’il y a des passivités fécondes, des attentes génératrices, des végétativités nourricières, des rêveries dont on se relève rien de moins qu’accouché.
.
Accéder au sommaire
Télécharger le pdf complet de Catastrophes 22
.
[1] Cf. « Le complexe de Jonas », in La Terre et les rêveries du repos, José Corti, 1992, p. 129 sq.
[2] Jean-Paul de Dadelsen, Jonas, Poésie/Gallimard, 2005, p. 54.
13:54 Publié dans RÉSONANCES | Lien permanent | Commentaires (0)
29/11/2019
Marche avec les loups, documentaire de Jean-Michel Betrand (2019)
A la suite du film "La Vallée des loups" de Jean-Michel Bertrand, sorti en 2016, dont l'ASPAS était partenaire, plusieurs questions se sont posées sur ce que deviennent les loups qui quittent la meute et comment ils font pour survivre. C'est ainsi qu'a été imaginée "La Marche des loups". Cette suite singulière nous plonge pendant des mois aux côtés du même Jean-Michel Bertrand qui mène une véritable enquête pour comprendre comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux horizons. Ce voyage se déroule comme un road-movie à travers les régions les plus reculées des Alpes.
14:15 Publié dans FILMS & DOCUMENTAIRES A VOIR & A REVOIR | Lien permanent | Commentaires (0)
23/11/2019
AINIELLE, LA MÉMOIRE JAUNE
Je suis tombée sur cet article sur ce très beau site de Vincent Duseigne : http://tchorski.morkitu.org/2/3202.htm qui m'a aussitôt fait penser à un court mais magnifique et bouleversant roman : La Lluvia amarilla de Julio Llamazares et pour cause...
VOYAGE DANS L'ÉLOIGNEMENT
LES VILLAGES ABANDONNÉS DU SOBREPUERTO

Ce très vaste documentaire concerne les montagnes du Sobrepuerto, dans la province de Huesca, Alto Aragón, au sein des Pyrénées espagnoles. C’est un rectangle d’une immense surface, qui s’est vu désertifié dans les environs des années 60 (cela fut graduel de 1950 à 1973). Dans ces forêts subsistent des villages abandonnés relativement nombreux, comme cela est le cas dans la Sobrarbe, Soria, Zaragoza, etc.
Les lieux furent sous les feux de la rampe lorsqu’en 1988, l’écrivain Julio Llamazares réalisa un roman : La pluie jaune (La lluvia amarilla), qui décrit la vie fictionnelle du dernier habitant d’Ainielle : Andrés de Casa Sosas. Ce livre est éminemment conseillé à tout passager de ce site, pour l’intensité des propos, la vérité crue et l’immense poésie amère de ce texte. Les derniers habitants d’Ainielle furent Angel Azón et Rosalia Azón, qui ont déménagé à Sabiñanigo. Le dernier habitant à quitter le Sobrepuerto était alors domicilié à Cortillas.
Il existe une immensité de documentaires sur le Sobrepuerto, sur les pueblos deshabitados et sur la Lluvia amarilla, à tel niveau que l’on peut quasiment se dire qu’il n’y a plus rien à ajouter. Le texte de Llamazares est à ce point une épure qu’il ne faut assurément rien adjoindre, ce serait des lignes d’empoisonnement. Quant aux traits non fictionnels, les études qui furent menées sont si tant complètes qu’elles en sont remarquables (historique, ethnologie, géographie, etc). Nous conseillons à ce titre les ouvrages d’Enrique Satue Oliván, ainsi que « El guia de Sobrepuerto », un ouvrage collectif remarquablement bien documenté (José María Satué, Adolfo Castán, Enrique Satué, José Miguel Navarro, Juan Carlos Ascaso, Ánchel Belmonte, Jesús Sánchez, Ricardo Blanco).
Deux sites font le point sur le dépeuplement, celui de Cristian Laglera et celui de Faustino Calderón. Le premier site internet est assorti de deux livres sur le sujet (en 2014).
Pour autant que ce sujet ait été étudié, il existe peu – voire très peu – de photos sur le sujet. De simples recherches sur internet permettent de déterminer au minimum que c’est un thème très peu parcouru. Hormis Ainielle, les livres de souvenirs témoignent bien que sont rares les gens qui se promènent par là. Il est vrai que plus d’un accès se trouve rédhibitoire.
Ces pages présentent donc le Sobrepuerto comme un récit de passage. Je n’oserais dire de voyage – préférant passage, car le plus généralement, on voyage dans le but de visiter, voir des lieux insolites, apprendre. Ici, la finalité était relativement autre (bien que la curiosité ne soit certainement pas exempte) ; il s’agissait surtout et avant tout d’un pèlerinage. Nul de ces anciens habitants n’a besoin d’un hommage, voire même d’un piédestal. Leurs vies étaient simples, agricoles, en communion avec la nature, dure aussi certainement. Pour certains, ils ont vécu un arrachement à quitter les lieux. Jamais jamais jamais ils ne pouvaient se résoudre à partir. Mais, lorsqu’on se retrouve les derniers comme les parents d’Enrique Satué, la solitude commence à faire un peu peur. C’est vrai qu’on est loin de tout.
Nombreux furent ceux qui ont parcouru les sentiers en pèlerinage après La lluvia amarilla. Notre chemin se situe à la frontière d’un peu tout ça, à se dire ici il y eut tant de vie ; des décennies passées à paver les chemins, construire les murets et les maisons, s’occuper des terres. Aujourd’hui il n’en reste pas loin de plus rien. Quel gâchis (peut-être ?), la nature reprend ses droits, les vautours planent au-dessus des terrasses éventrées par les ajoncs, les buis sentent fort dans les pentes abruptes. Que pouvons-nous critiquer, estimer, deviner ? Quel est notre droit de regard ? Sommes-nous assez humbles ou notre vision comporte encore quelque part un soupçon de jugement ?
Nous espérons que la beauté de ces lieux vous fera vibrer. C’est bien là tout.
Ce documentaire est dédié à Pascual Sanromán Sampietro, de Casa Royo. Après tout, on lui doit bien ça !
Cela fait 16 ans que le voyage devait être effectué. De telles valeurs font peur ! Et pourtant, c’est bien cela, une longue attente à laquelle en fin de compte, on ne pense plus trop.
Au tout départ, c’est d’abord compliqué de se localiser dans cette immensité, les cartes ne sont autres que de très grands espaces verts : de la forêt, parcourue par quelques sentiers au tracé flou - quelquefois ça va nulle part. Le tunnel de Cotefablo sert de repère. Assez bêtement, on sait qu’à partir de là, quelques encablures au sud nous font plonger dans le cœur du sauvage Sobrepuerto. Les villages sont repérés un à un : Oliván, Susín, Berbusa, Ainielle, Otal, Bergua, Escartín, Cillas, Cortillas, Basaran, Sasa, Yosa. Ces noms inconnus, aux consonances sympathiques, deviennent peu à peu des toponymies habituelles et en quelque sorte des buts. Sans jamais y avoir mis un pied, on commence à se dire qu’on maitrise la situation. On voit, se projette, imagine, échafaude.
Et puis le jour arriva. Le trajet est long, c’est chose sûre. Ce n’est pas la porte à côté depuis la Belgique.
Tout est repéré depuis des lustres et lorsque l’on passe devant l’église d’Oliván, on se flatte assez stupidement de la reconnaître comme si elle était une vieille amie. Sans nul doute, la piste qui démarre vers Susín est aussi un paysage connu. A ce titre, c’est à ce point poussé loin qu’on s’étonne de ne plus voir la barrière au dessus du barranco de Oliván ; elle a disparu on ne sait où ni pourquoi. A peine passé le rio Gallego, Josette le GPS se perd complètement dans le vert. Dès à présent, on se dit que c’est bon signe. Au revoir la civilisation agitée, stressée et bruyante ! C’est d’ailleurs devenu une expression : on est dans le vert signifie qu’on est loin de tout, perdu et bien. Finalement, serait-ce quelque part dans le Sobrepuerto ?
Le sac est prêt, nous partons. Nous attendions-nous à ne voir personne durant ces grandes journées de balades ? Quelque part oui. On s’interrogeait franchement si ça allait être le cas, ce le fut.
Le chemin est long, c’est le moins qu’on puisse dire. Quel que soit l’endroit, c’est toujours très isolé. La plus grande inquiétude était de trouver des sentiers refermés par la végétation, surtout du fait que les cartes IGN espagnoles sont souvent lacunaires en matière de chemin – et franchement pas que dans El Serrable de Sobrepuerto. La végétation espagnole est de deux types : soit très-dense-du-genre-impénétrable, soit piquante-version-musclor. Autant dire qu’il faut tout de même rester attentif. De tous les parcours dans le Sobrepuerto, le paysage a été semblable : une immense immensité déserte d’activité humaine présente. C’est une merveille de forêts quasiment vierges de passages. En plus d’un lieu on se dit : mais qui vient là ? En réalité dès que l’on sort un tout petit peu des chemins, la réponse est réellement plus personne.
De ces chemins longs et très jolis, malgré les distances rédhibitoires je le redis, pas un ne fut réellement insurmontable, sauf peut-être Otal qui fut certainement quand même assez difficile. A chaque pas revient le souvenir des gens d’antan : un mur effondré qui servait à délimiter les propriétés, un muret tout joli qui servait à ce que les bêtes ne tombent pas dans le précipice, des terrasses éventrées par la végétation, par-ci ou par-là aussi souvent une petite borie. Sans exagérer, rien de plus. En fait, la nature a beaucoup regagné ses droits, peut-être même ne les a jamais-t-elle perdus.
Et puis à un moment, le village apparait.
Quelquefois tout d’un coup, après avoir passé un semblant de porte marqué par quelques pierres au sol, ou bien majestueux s’offrant sur les pentes du versant opposé.
Les hameaux ne m’ont jamais paru être la tristesse écrasante d’une pluie jaune. Les rares discussions des anciens, dans ça ou là quelques reportages, non plus. Certainement il y eut une très grande sensation d’arrachement, oui probablement ces gens ont perdu quelque chose de leurs eux-mêmes. Ils ne voulaient absolument pas partir ; pour certains, ils y furent contraints par la situation. La pluie jaune raconte la fiction de quelqu’un qui se serait entêté, jusqu’au bout, à rester après le départ des autres. Cela n’existât pas, mais combien cela aurait pu être possible.
Les villages m’ont paru être une gigantesque solitude. Avant tout c’est loin. Puis c’est silencieux. Puis il n’y a rien alentours. Puis oui, certainement, c’est totalement abandonné. Mais par-dessus ces choses là, banales en quelque sorte, il y a la solitude. Une solitude dense et palpable, un isolement du monde, un exil, une séparation du monde, un retranchement violent, vivant et volontaire. Les villages sont très loin d’être âme-morte. On est là-bas dans un ailleurs, qu’on quitte tous, je dis tous, avec peine, non pas fulgurante, mais bien présente tout de même. Jamais cela dans un village vivant : Broto, Oto, voire même la bruyante Torla. Ici on pourrait quasiment dire : Otal, Escartín, Ayerbe, on sait ce qui est perdu pour ainsi dire à tout jamais, et le peu qui reste en devient précieux. C’est en ça qu’il est dur de repartir. Et pourtant, c’est contradictoire, on n’y habiterait pas.
Ces retraites dans la solitude profonde amènent un sens à ce que l’on voit ; on n’est plus au cœur d’un bien qui appartient à tout le monde, le lieu appartient ici à ceux qui le recherchent vraiment. On n’arrive pas là, jamais ô jamais, par le fruit du hasard. La quête est longue, il y a quasiment un sentiment de mérite, même si en réalité c’est quelque chose d’un peu ridicule.
Les terres sont parcourues par des troupeaux de vaches qui sont, elles, pas loin d’être abandonnées. On a l’impression que les bêtes sont lâchées en montagne, sans soins et sans attention, et on verra bien qui rentre à la fin de la saison. Les vaches, innombrables, défoncent les portes des maisons et utilisent les rez-de-chaussée comme étables. Leurs sabots fouillent, affouillent, détruisent. Ces animaux sont meurtriers envers les maisons, qui ne cessent de souffrir. Dans ces niveaux bas, parfois quarante centimètres d’épaisseur de bouses jonchent le sol. Ces (gros) bovins achèvent ce qui est déjà fragile. Les bêtes ruminent sous des planchers en décomposition, des poutres arrachées, des toits entiers branlants.
Lorsque l’une ou l’autre périt, alors de grands groupes de vautours s’amassent sur la proie. Immenses et beaux en vol, les vautours tournoient lentement dans le ciel, s’élevant au fil des courants ascendants.
Bien des maisons sont en état de ruine. C’est quelquefois si avancé que c’est avec difficulté qu’on perçoit ce que pouvait être l’habitation. Les orties dévorent les pierres, les sureaux défoncent les murs pantelants, les ronces fabriquent d’énormes taillis impénétrables. Au sein de cette végétation luxuriante se nourrissant de la mort du village, un rouge-queue lance son cri amusant entrecoupé d’une décharge électrique. Aussi, une fauvette lance son tictictic obsédant et inquiet, tandis que sur les lauzes instables d’un toit, un corbeau nous regarde, à la fois curieux de la présence et soucieux de cet intrus peu fréquent.
Au loin, les cimes sont familières : le Pelopín, l’Erata, le Yésero, la Manchoya. Bien qu’aimées, ces montagnes ne sont jamais amies non plus. Elles sont des obstacles. Le Pelopín ressemble si tant au fond d’écran par défaut de Windows XP, on en vient à se dire qu’on fait un voyage de geek. Passée cette aparté, le voyage de retour est également très long, inévitable, lourd de beaux souvenirs. Le puerto d’Otal est un lieu d’isolement lui aussi, car qui vient en cet endroit où l’on atterrit qu’en se perdant par pure mégarde ?
Durant le long trajet de retour, je me suis demandé comment j’allais parler de ces villages. Je ne trouvais pas de solution satisfaisante. Par fiction, par description méticuleuse ? Que faire… Je me refusais à ne pas en parler, non plus, car ce serait une omission, une véritable triste omission. Non ces lieux n’ont rien fait pour mériter l’oubli. Alors, je n’ai trouvé aucune autre manière d’aborder le sujet si ce n’est ce que ce fut, le récit d’un passager attentif. Attentif au silence d’un lieu effacé. Sur les cartes, il n’apparait plus rien. Les noms ne figurent plus. On est dans le vert, comme dirait Josette.
Il y eut dans cette absence momentanée – le lieu où la carte est vide – une transfiguration, ce qui de par la définition signifie transformer en rendant beau. Il est bon de temps à autre de s’éloigner du monde, ce dont j’espère ces quelques pages témoigneront.
0:00 - Oto, un rougequeue chante brièvement sur la place du village, déserte à cette heure.
0:57 - Oto, un groupe de jeunes hirondelles réclame de la nourriture aux parents, fort affairés. Au fond, des villageois couvrent le toit d'une vieille voiture avec du bois.
2:17 - Otal, un troupeau de vaches lointain sillonne les terrasses, nous sommes à l'approche du village.
3:02 - Otal, des vaches occupent une maison abandonnée et s'en servent d'étable.
5:55 - Le moulin d'Ainielle ; on y entend le bruit du barranco del Molino et le vent dans les peupliers.
7:50 - Bergua, des oiseaux chantent dans les fourrés, alors que nous arrivons au village.
9:30 - Escartín, des veaux ont investi une ancienne aire de battage des blés, ils ruminent paisiblement dans le silence des lieux abandonnés.
11:09 - Ayerbe de Broto, une courte pluie toute fine tombe sur un champ de chardons.
14:44 - Ayerbe de Broto, des oiseaux ont investi une ancienne étable croulant sous le poids des ans.
16:38 - Artouste, un grand troupeau de moutons s'approche lentement.
18:50 - Artouste, quelques vaches paissent tranquillement dans la beauté des pentes.
21:00 - Bramatuero, dans un lieu fort sauvage, les vaguelettes du lac s'éteignent sur la pente abrupte.
22:17 - Parzán, un criquet et des grillons dans un bosquet de buis.
24:03 - Néouvielle, lac d'Aumar, des vaguelettes font un son très étrange sur la berge rocheuse.
26:15 - Parzán, circo de la Barrosa, un ruisseau descend lentement la pente bordée de gentianes.
28:07 - Broto, après plusieurs heures de menaces, un orage nocturne secoue la vallée.
Durée : 42:52
Le documentaire "Ainielle tiene memoria".
Il faut passer outre les premières secondes de musique insupportable de truc à la mode...
Sinon c'est relativement intéressant, ils ont été à la rencontre des Azón, qu'on voit dans le village.
En fait, le documentaire commence à 4mn45. Avant c'est stérile.
©Vincent Duseigne
12:37 Publié dans RÉSONANCES | Lien permanent | Commentaires (0)
La colonie pénitentiaire du Luc
Source :
http://tchorski.morkitu.org/15/luc.htm?fbclid=IwAR0b_M0SG...
L’image ci-dessus est un lien qui mène vers le reportage le plus complet réalisé à ce jour au sujet du bagne du Luc, y compris en considérant des publications plus anciennes. L’historique de ce lieu est extrêmement bien documenté par l'auteur, ce pourquoi cette page ne sera qu’un bref rappel des principaux faits historiques. Le seul apport nouveau de notre document est un essai de photographie panoramique de l’aven et une photo qualitative de l’escalier. Le document de Baguenaudes est complet dans le sens où de nombreuses recherches ont été faites et la colonie pénitentiaire a été visitée.
Cette page est un petit documentaire un peu particulier. Il s’agit d’une brève description de la colonie pénitentiaire du Luc, ou encore colonie agricole du Luc, sur la commune de Campestre-et-Luc, dans le Gard en France. Les lieux sont plus connus sous les noms de l’abîme de Saint-Ferron ou encore l’abîme de Saint-Ferréol. Ce lieu se situe au cœur du petit causse de Campestre, qui fait partie du grand causse du Larzac.
Il s’agissait d’une colonie pénitentiaire pour enfants.
Bref historique
Le Roquefort est un fromage qui s’obtient à partir du brebis au lait cru. Ce fromage est maturé en cave afin qu’il développe sa moisissure. Cette maturation lui donne son goût si particulier.
Au sein de la très petite commune du Luc, aujourd'hui intégrée dans le territoire de Campestre, quelques personnes eurent l’idée d’utiliser l’aven de Saint-Ferron (version française) ou Saint-Ferréol (version occitane) afin d’amener leur fromage à maturation. C’est un aven de 62 mètres de profondeur, qui s’ouvre sur le causse de Campestre. La salle du fond, partiellement oblique, est à -80 mètres. Dès 1863, l'idée d'utiliser cet abîme germait dans les esprits.
En 1882, il fut bâti une maison, ou disons plutôt un bâtiment à vocation industrielle, au-dessus de l’abîme. Sa situation immédiatement à l’aplomb du vide en fait un lieu extrêmement vertigineux. La ruine existe toujours. Bien qu'étant dans un état de dégradation qui commence à devenir préoccupant, elle surplombe toujours l'aven avec audace.
Dans la partie basse de cette maison, un treuil fut installé, permettant de monter et descendre dans l'abîme. Vu son utilisation malaisée, les propriétaires eurent une idée quelque peu géniale mais aussi pharaonique. A 200 et quelques mètres de la maison existe une immense doline d’effondrement karstique. Ils utilisèrent cette excavation afin de rejoindre l’abîme. Il fut creusé une galerie de 200 mètres de long, en pente douce. Ce tunnel avait vocation de faciliter les transports. Ainsi, il était possible de mener les fromages en sous-sol par wagonnets.
Cette activité fromagère eut intensément lieu de 1883 à 1929. Il est peut-être possible de dire que l’effondrement de cette industrie fut dû au classement AO (appellation d'origine) du Roquefort en 1925. Campestre se voyait dès lors exclue de la zone territoriale admise à affiner et emballer. Ceci étant, ce n’est que pure supputation car nous n’en savons rien.
Au fond de l’aven subsistent quelques vestiges très abîmés des rayonnages en bois. Dans la maison, dont l’accès est relativement périlleux en cas de pluie, il existe encore le treuil.
Mundatur culpa labore
Cette installation est ingénieuse et peu banale. L’histoire pourrait s’en arrêter là, à contempler les vestiges historiques d’une activité artisanale qui fut florissante en son époque. Ceci étant, c’est occulter l’un des aspects les plus importants de la mémoire de ce lieu. Cette installation fut un bagne pour enfants, au même titre que Le Mettray à Tours.
Comme il est expliqué dans le document mentionné dans le lien en entête, la France est au début du XIXème siècle dans un état économique, sanitaire et social terrifiant. Nombre d’enfants errants sont en situation très difficile : orphelins ou abandonnés, vivant de vols, de mendicité, voire même de prostitution.
Lorsqu’ils sont capturés, ils sont envoyés en colonie pénitentiaire agricole. Ce sont des colonies de redressement, érigées afin qu’ils rentrent dans le droit chemin, tout en étant éloignés de la promiscuité des prisons. Ces colonies sont des suites données à l’échec de « la Petite Roquette » à Paris, une prison dont les gens sortaient fort diminués pour cause de mauvais traitements. A Campestre, il était mis en avant le fait qu’il s’agit d’un lieu rural, permettant des travaux agricoles sains et vivifiants.
A Campestre surtout et au-delà d'autres colonies (c’est encore le cas aujourd’hui), les lieux sont très isolés, à l’abri de tout regard. C’est un bout du monde. A vrai dire, si c’est le cas aujourd’hui, que devait est-ce être à l’époque ?... De ce fait, de multiples travaux pouvaient se dérouler en discrétion, au contraire d'autres pénitenciers. Au Luc, il y eut 70 morts au total, ce qui est largement en dessous des valeurs des autres colonies.
Le causse est froid et venteux en hiver, brûlant et étouffant en été.
C’est de cette manière qu'environ 200 enfants furent cordialement conviés à la colonie du Luc, dont la devise était « Mundatur culpa labore », c'est-à-dire : la faute est purifiée par le travail. Deux cent est la valeur maximale du nombre d’enfants. En certaines périodes, il y en eut moins. Le camp ouvrit en 1856.
Les plus jeunes (6 à 12 ans) étaient chargés de travaux agricoles, au sein d'une terre plus qu’inculte qu’est nous le rappelons ce territoire caussenard. Les plus âgés (13 à 20 ans) étaient chargés des travaux lourds. On y relève de la construction, des déblaiements, des chargements lourds, etc. Dans l'ensemble, de terribles travaux de bagnards.
Une personne du surnom de Baguenaudes ajoute quelques précisions quant à cette galerie : D’après un ancien colon du Luc, ils mangeaient du pain blanc tous les jours, ce qui n’était pas forcément le cas des paysans du coin. Cela n’enlève rien au fait que les petites mains ont dû avoir des travaux très lourds à réaliser quand on voit les impressionnants tas de cailloux sortis des champs.
Afin d'améliorer l'accès, il fut foré ensuite la galerie de jonction, longue de 200 mètres, creusée avec grande régularité dans un calcaire tout particulièrement dur. Cette galerie est percée depuis l'effondrement karstique jusqu'à l'aven. Elle offre un cheminement horizontal aisé vers le fond du gouffre. D'après plusieurs sources, les travaux furent exécutés au pic et par les enfants, en 1882. Or, il est pouvé qu'elle fut simplement minée par des professionnels. Cette galerie est toujours visitable à ce jour. Sous l'impatience de la direction, elle fut creusée en un délai record, c'est-à-dire en moins d'un an.
Quelques précisions quant à cette galerie : Après discussion avec le propriétaire des lieux, il semblerait que le pathos entourant cet épisode a été exagéré. Le tunnel porte des traces de foration et n'a donc pas été fait uniquement au pic. Les travaux auraient été dirigés par un ingénieur d'Alès. Même si l'image du pic, souvent associée à celle du bagne, est exagérée, les enfants du Luc ont certainement participé durement au percement du tunnel.
Les plus jeunes furent de même chargés de déblayer le bas de l’aven, utilisant à cette fin le treuil placé dans la maison. Au bas de l’aven fut bâti un immense mur, ayant pour but d’isoler de la pluie la salle du fond avec le gouffre en lui-même.
A ce jour, tout cela est encore visible, bien qu'en état de ruine partielle. Un témoignage d’autant plus poignant est toujours d’actualité : les marches de l’escalier de 12 mètres de haut sont construites avec de la pierre de taille. La régularité des marches est telle qu’on en croirait un béton moulé, sans défaut. Chaque marche pèse probablement allègrement plus de 100 kilogrammes. Ahurissant…
Bien d'autres choses seraient à dire… Les photos ci-dessous sont de toute évidence banales, si ce n’est qu’elles ne seront qu’un témoignage supplémentaire en mémoire des bagnards.
Toutes les photos indiquées (GADJO) proviennent d'un visiteur des lieux.
Notre voyage débute par le passage dans le village de La Cavalerie, dans le Larzac.
Voici la ruine de la partie supérieure de la fromagerie.
Elle surplombe un aven à peine visible.

Nous sommes ici au bas du gouffre. Voyez-vous le bâtiment au sommet ?
Dès lors, vous pouvez imaginer quelle fut la folie des adultes en ce lieu...
Le bas du gouffre, à -80 mètres.
L'escalier est impressionnant.
De par le passé, il existait un mur de séparation. Celui-ci s'est effondré.
La silhouette permet de bien donner l'échelle de ce gigantisme.
Voici la galerie taillée au roc avec l'aide des jeunes colons.
A l'approche de l'aven, les terrains sont ébouleux, donc ce fut maçonné.
Non loin du jour par contre, la régularité est notoire Quel travail soigné...
D'un côté ou de l'autre, c'est cet aspect monotone impliquant l'idée d'un travail laborieux.

Le sol semble avoir été recouvert de fins stériles afin de faciliter le déplacement. Des documents évoquent qu'il existât une voie ferrée de type Decauville. A l'état actuel des recherches, il n'est pas évident d'affirmer que cela à vraiment existé. Il se pourrait que ça ne soit resté qu'à l'étape du projet. (GADJO)

Nous allons désormais rejoindre la sortie. (GADJO)

Le chemin menant à la fromagerie. (GADJO)

A l'intérieur de la fromagerie, et donc dans la partie basse du bâtiment à l'aplomb du gouffre. (GADJO)

Il reste difficile de croire que ce treuil servait à descendre le personnel au fond du gouffre au début des travaux. Même pour des fromages, cela semble risqué ! Ce treuil comporte toutefois un cliquet
anti-retour ; c'est un treuil Piat & Fils. (GADJO)

Une vue plongeante vers l'abîme. (GADJO)

La tour d'aération de la fromagerie. (GADJO)

Les chemins alentours sont bordés de murets d'une largeur impressionnante. (GADJO)

Les champs ont été épierrés, comme en témoignent encore de nombreux tas conséquents. (GADJO)

Les champs sont dès lors aussi clôturés de murs en pierres sèches. (GADJO)

Le bâtiment du Luc, qui cerne une des six citernes. Elles alimentaient en eau la colonie. L'aile gauche
du bâtiment se termine par la chapelle. (GADJO)

La ferme est en cours de rénovation en 2014, afin de faire des appartements, mais cela reste encore assez délabré à ce jour. Elle a la forme d'un U pourvu à une de ses extrémités d'une chapelle et de cinq cellules à l'autre. Un symbole ? La maison du fondateur de la colonie est devenue un gite. (GADJO)

La plaque nommant les lieux. (GADJO)
COLONIE AGRICOLE DU LUC
FONDEE EN 18(63?)
Par Mr MARQUES du LUC (...)
Doyen du Conseil Général du Gard.

L'aile gauche de la ferme avec ses quatre cellules. (GADJO)
Brefs passagers de ce lieu, nous retournerons au soleil et à la joie de la liberté.
Sans évoquer que ce lieu devrait être plus connu, disons qu'il gagnerait à être moins oublié. Habitué
du pays viganais, je n'en avais jamais entendu parler.
Les routes nous avalent vers un ailleurs, certainement confortable. Que ces quelques modestes
photos soient dédiées à la mémoire des enfants du bagne.
©Vincent Duseigne
Vincent Duseigne
12:03 Publié dans QUAND LA BÊTISE A LE POUVOIR | Lien permanent | Commentaires (0)















