Plus encore que la « crise environnementale » des années 1970 – que les acteurs pouvaient encore voir comme récente et comme un bref moment de crise de quelques décennies –, l’Anthropocène interpelle aussi les mouvements se revendiquant de l’émancipation par son ampleur massive, tant passée que future. Par ses racines profondes dans le productivisme, l’extractivisme et l’industrialisme des deux derniers siècles, il questionne un rapport au « progrès », à la technique et à l’économie qui a trop longtemps dominé la gauche [2]. L’Anthropocène apporte une réfutation massive, géologique, au projet moderne d’émancipation-arrachement, au rêve d’un devenir humain et social coupé de toute détermination naturelle : les Modernes ont cru que leur liberté impliquait de s’arracher à toute détermination naturelle et ils se découvrent aujourd’hui liés à la Terre par mille rétroactions, rattrapés par le retour de Gaïa, avec ses lois, ses limites et sa violence, dans la sphère politique et sociale. L’Anthropocène matérialise enfin ce pourquoi l’altermondialisme ne saurait se limiter à la critique du néolibéralisme dans la nostalgie implicite du bon temps du productivisme keynésien d’après-guerre, dont la facture en terme de dette écologique et d’échange inégal s’avère immense.
1. Un constat scientifique aux enjeux anthropologiques
Cette nouvelle époque géologique, débutant avec la « révolution thermo-industrielle » (Alain Gras) ou encore le « capitalisme fossile » (Elmar Altvater), et succédant à l’Holocène, a été proposée à partir de 2000 par plusieurs scientifiques des sciences du système Terre, tels Paul Crutzen, prix Nobel de chimie, spécialiste de la couche d’ozone. Depuis, le concept d’Anthropocène est devenu un point de ralliement entre scientifiques des sciences dures, intellectuels des sciences sociales et militants écologistes, pour penser cet âge dans lequel le modèle de développement actuellement dominant est devenu une force tellurique, à l’origine de dérèglements écologiques profonds, multiples et synergiques à l’échelle globale.
À la base, un constat scientifique incontestable. Premièrement, les activités humaines sont devenues la principale force agissante du devenir géologique de la Terre. Deuxièmement, en termes d’extinction de la biodiversité, de composition de l’atmosphère et de bien d’autres paramètres (cycle de l’azote, de l’eau, du phosphore, acidification des océans et des lacs, ressources halieutiques, déferlement d’éléments radioactifs et de molécules toxiques dans les écosystèmes…), notre planète sort depuis deux siècles, et surtout depuis 1945, de la zone de relative stabilité que fut l’Holocène pendant 11 000 ans et qui vit la naissance des civilisations. Dans l’hypothèse médiane de +4°C en 2100, la Terre n’aura jamais été aussi chaude depuis 15 millions d’années. Quant à l’extinction de la biodiversité, elle s’opère actuellement à une vitesse cent à mille fois plus élevée que la moyenne géologique, du jamais vu depuis 65 millions d’années. Cela signifie que l’agir humain opère désormais en millions d’années, que l’histoire humaine, qui prétendait s’émanciper de la nature et la dominer, télescope aujourd’hui la dynamique de la Terre par le jeu de mille rétroactions. Cela implique aussi une nouvelle condition humaine : les habitants de la Terre vont avoir à faire face, dans les prochaines décennies, à des situations auxquelles le genre Homo, apparu il y a deux millions et demi d’années seulement, n’avait jusqu’ici jamais été confronté, auxquelles il n’a pas pu s’adapter biologiquement et dont il n’a pu nous transmettre une expérience par la culture.
2. Récits et politiques de l’Anthropocène
Mais l’Anthropocène, méga-objet dramatique qui envahit l’espace public, n’est-il pas vecteur d’apathie et arme de dépolitisation ? Un discours surplombant, pensant les évolutions à l’échelle planétaire géologique ne fait-il pas perdre tout sens à l’engagement ? Puisque la crise écologique est désormais un problème d’ampleur géologique, alors cela nous dépasserait et il faudrait laisser le problème aux experts scientifiques ? Puisque le changement de trajectoire du système Terre est déjà quasi irréversible à l’échelle humaine [3], alors tout changement individuel, toute action collective serait inutile et il ne resterait (aux privilégiés) qu’à continuer cyniquement à « manger » la planète ? À « adapter » les sociétés aux changements globaux, en raillant la naïveté dérisoire des alternatives des militants, des décroissants, des « bio », des chasseurs-cueilleurs en extinction, des transitionneurs et autres colibris ?
On voit comment le sublime de l’Anthropocène pourrait désarmer toute velléité de changement radical des modes de production, de vie et de consommation. Pour sortir de la complaisance fataliste et post-démocratique, il s’agit de « repeupler les imaginaires » (Stengers), de nous approprier politiquement l’Anthropocène. Un pas en ce sens est de décoder les récits dominants, et de multiplier les récits alternatifs et féconds. Face à cette situation radicalement nouvelle dans l’histoire de la Terre et l’histoire humaine que représente l’Anthropocène, il existe au moins quatre visions du monde, quatre méta-récits de ce qui nous arrive, à nous et à notre Terre nourricière, quatre trames idéologiques invoquant l’Anthropocène en autant de discours et de « solutions » divergents. Les expliciter, les comparer, les critiquer, c’est déjà rouvrir le champ du politique.
2.1. L’Anthropocène naturaliste et technocratique des institutions internationales
Le premier type de discours, naturalisant, est celui qui domine dans les arènes scientifiques internationales. Les scientifiques qui ont inventé le terme d’Anthropocène n’ont pas simplement avancé des données fondamentales sur l’état de notre planète et promu un point de vue systémique sur son avenir incertain. Ils en ont aussi proposé une histoire qui explique « comment en sommes-nous arrivés là ? ». Ce récit peut être schématisé ainsi :
Nous, l’espèce humaine, avons depuis deux siècles inconsciemment altéré le système Terre, jusqu’à le faire changer de trajectoire géologique. Puis vers la fin du XXe siècle, une poignée de scientifiques nous aurait enfin fait prendre conscience du danger et aurait pour mission de guider une humanité égarée sur la mauvaise pente [4].
Ce récit du passé, qui met en avant certains acteurs (« l’espèce humaine » comme catégorie indifférenciée) et certains processus (la démographie, l’innovation, la croissance…), préconditionne une vision de l’avenir et des « solutions », qui place les scientifiques comme guides d’une humanité désemparée et ignorante et fait du pilotage du « système Terre » un nouvel objet de savoir et de pouvoir.
Mais qui est cet anthropos indifférencié ? Le Grand récit officiel de l’Anthropocène orchestre le retour en fanfare de « l’espèce humaine », unifiée par la biologie et le carbone, et donc collectivement responsable de la crise, effaçant par là-même, de manière très problématique, la grande variation des causes et des responsabilités entre les peuples, les classes et les genres : jusque récemment, l’Anthropocène fut un Occidentalocène ! La catégorie d’espèce ne peut servir de catégorie explicative qu’à des ours polaires ou des orang-outans qui souhaiteraient comprendre quelle est donc cette autre espèce qui menace ainsi leurs conditions de vie [5]… Et encore, il s’agirait là d’orangs-outans ou d’ours mal formés en « humanologie », qui ne sauraient discerner les « mâles dominants », les asymétries de pouvoir, le long de la chaîne qui relie le recul de la banquise aux sources majeures d’émission de gaz à effet de serre (seules 90 entreprises sont ainsi responsables de plus de 63 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis 1751 [6]), ou qui relie les bûcherons et travailleurs indonésiens des palmeraies, les consommateurs européens et les géants de l’agro-alimentaire.
Certes, la population humaine a grimpé d’un facteur dix depuis trois siècles, mais que signifie cette hausse globale impactant un « système Terre » lorsqu’on observe qu’un Américain du Nord possède une empreinte écologique 32 fois supérieure à celle d’un Éthiopien, que la consommation énergétique d’un soldat américain a été multipliée par 228 entre la première et la seconde guerre mondiale [7], ou que la moitié la plus pauvre de l’humanité ne détient que 1 % des richesses mondiales (contre 43,6 % pour les 1 % les plus riches) [8] ?
Et comment croire que ce n’est que depuis quelques décennies que nous « saurions » quels dérèglements nous imprimons à la planète ? Une amnésie sur les savoirs, les contestations et alternatives passées de l’industrialisme ne sert-elle pas une vision politique particulière, dépolitisante de la situation actuelle, qui place les scientifiques et leurs sponsors comme guides suprêmes d’une humanité, troupeau passif et indifférencié ? Or, l’histoire nous apprend au contraire que les alertes scientifiques sur les dégradations environnementales globales et les contestations des dégâts de l’industrialisme ne datent pas d’aujourd’hui, ni même des décennies post-1960 : elles sont aussi anciennes que le basculement dans l’Anthropocène. Il existait autour de 1800 une théorie largement partagée d’un changement climatique global causé par la déforestation alors massive en Europe de l’Ouest [9]. Certes, de telles théories sont aujourd’hui largement complétées et corrigées (de même que la science du climat du XXIe siècle corrigera celle du XXe) ; certes, les données scientifiques d’aujourd’hui sont plus denses, massives, globales, mais il est historiquement faux et politiquement trompeur de faire passer les sociétés du passé pour inconscientes des dégâts – environnementaux et sanitaires et humains – du capitalisme industriel. Ceux-ci furent contestés par mille luttes ; non seulement par les romantiques ou les classes assises sur la rente foncière, mais aussi par des lanceurs d’alerte scientifique, des artisans et ouvriers luddites, et par les multitudes rurales au Nord et au Sud qui perdaient alors les bienfaits des biens communs agricoles, halieutiques et forestiers appropriés, marchandisés, détruits ou pollués [10]. Ainsi, un précurseur du socialisme, Charles Fourier, écrivait en 1821 un essai sur « La détérioration matérielle de la planète » dont l’« industrie civilisée » (son terme pour désigner le nouveau capitalisme industriel libéral auquel il opposait un stade supérieur plus juste et harmonieux, l’« association ») était considérée comme la cause agissante.
Plutôt qu’un « on ne savait pas », nous devons donc penser l’entrée et l’enfoncement dans l’Anthropocène comme la victoire de certains intérêts qui ont fabriqué du non-savoir sur les dégâts du « progrès », comme le déploiement de grands dispositifs (idéologiques et matériels) et de « petites désinhibitions » [11] par lesquels les oligarchies productivistes de différentes époques ont pu jusqu’ici réprimer, marginaliser ou récupérer les contestations socio-écologiques.
Et, plutôt qu’une vision du monde où la société est passive et ignorante, attendant que les scientifiques sauvent la planète (avec la géo-ingénierie, les agro-carburants, la biologie de synthèse ou les drones-abeilles remplaçant la biodiversité naturelle, et autres « solutions » techno-marchandes « vertes »), il convient de reconnaître que c’est dans l’ensemble du tissu social et des peuples que se trouvent les savoirs, les initiatives et les « solutions » qui « sauveront la planète ».
En somme, ce premier récit de l’Anthropocène pose d’importants constats, mais surtout d’immenses obstacles à toute perspective d’éco-politique émancipatrice ; il s’apparente par son caractère technocratique et dépolitisant à ce qu’André Gorz avait appelé « éco-fascisme » ou à ce que Félix Guattari avait nommé « écologie machinique ».
2.2. Le « bon Anthropocène » piloté des post-environnementalistes technophiles
Un deuxième grand récit, post-environnementaliste , célèbre l’Anthropocène comme l’annonce (ou la confirmation) de la mort de la nature comme externalité. Ce récit est intéressant en ce qu’il questionne le dualisme nature/culture fondateur de la modernité occidentale et qu’il critique certaines idéologies de « protection de la nature » qui excluaient de fait les populations d’une nature supposée « vierge ». Il ouvre aussi le chantier philosophique d’une nouvelle pensée de la liberté qui ne soit pas l’illusion trompeuse d’un arrachement à tout déterminisme naturel ou d’une domination de la nature. Une pensée de la liberté qui assume ce qui nous attache et nous relie à notre Terre et qui réconcilie l’infini de nos âmes à la finitude de la planète.
Par contre, en célébrant l’ingénierie généralisée d’une techno-nature, les tenants de cette vision (de certains sociologues et philosophes post-modernes à certains idéologues du think-tank post-environnementaliste états-unien du Breakthrough Institute [12], en passant par certains écologues post-nature) prônent non pas une humilité à l’âge de l’Anthropocène, mais un nouveau « pilotage planétaire ». « Avant on a fait de la géo-ingénierie sans le savoir, mal », nous disent-ils en substance ; « mais, maintenant, on va gérer la planète avec toute notre technoscience » et forger un « bon Anthropocène ». Ainsi, pour Bruno Latour, qui a fortement inspiré cette pensée post-environnementale, le péché de Victor Frankenstein ne fut pas d’avoir créé un monstre, mais de l’avoir abandonné inachevé [13]. On va donc réparer le monstre de Frankenstein et, « promis juré », il va mieux fonctionner que le monstre initial et permettre à l’humanité d’accomplir plus avant son destin de pilote de la planète.
Prolongeant le techno-optimiste du premier grand récit, le post-environnementalisme s’éloigne de son naturalisme par son constructivisme radical. Il conçoit la nature, mais aussi l’espèce humaine, comme un construit socio-technico-économique, ouvrant la porte au trans-humanisme.
Cette vision prométhéenne et manipulatrice s’accommode également fort bien du capitalisme financier contemporain, de sa « croissance verte » et de la privatisation-marchandisation en cours des « services écosystémiques » de toute la planète. Quoi de plus constructiviste en effet que la marché, si habile à couper les objets et les sujets de leurs attachements sociaux et écologiques pour les reformater indéfiniment en marchandises circulant dans de nouveaux réseaux ? Mais que gagnera-t-on et que perdra-on à dénier toute altérité à la nature, toute antériorité engendrante à la Terre sur l’humanité ? Et à poursuivre le culte des monstres de laboratoire et à accélérer la déconstruction-reconstruction marchande du monde ? Cette idéologie post-environnementaliste et techno-béate de l’Anthropocène participe donc plus du projet néolibéral de faire du système Terre tout entier un sous-système du système financier que d’un projet d’émancipation des peuples de Gaïa et de transition juste et démocratique.
2.3. L’anthropocène comme effondrement et politique de décroissance
Une troisième lecture de l’Anthropocène, catastrophiste, insiste sur l’intangibilité des limites de la planète, à ne pas outrepasser sous peine de basculement. Cette lecture reprend les alertes des travaux des scientifiques [14] et leur appréhension non linéaire de l’évolution des systèmes complexes. On sort du régime d’historicité progressiste forgé par la modernité industrielle du XIXe siècle [15] : l’histoire n’est plus celle d’un progrès, d’une croissance indéfinie ou d’un fatum innovateur ; elle est discontinue et « désorientée » [16], faite de points de basculement et d’effondrements à anticiper collectivement (cf. l’importance des travaux sur la résilience, sur la pensée politique du mouvement des villes en transition et sur la permaculture). Cette vision fait également écho aux travaux de la « théorie politique verte » [17] et au projet politique de la décroissance, qui renouvellent la pensée de la démocratie et de l’égalité à partir du constat de la finitude. Si l’on prend au sérieux l’Anthropocène dans cette perspective, on ne peut plus penser la démocratie sans ses métabolismes énergétiques et matériels et l’on ne peut plus, dans un monde fini, différer la question du partage des richesses par le rêve d’un gâteau économique grossissant sans fin.
Si elle reprend les constats scientifiques des dérèglements écologiques globaux, cette troisième vision ne partage pas la foi en des « solutions » techno-scientifiques pour sauver la planète des deux premières visions. Elle insiste au contraire, pour éviter un anthropocène barbare, sur la nécessité de changements vers la sobriété des modes de production et de consommation : c’est donc d’initiatives alternatives, de savoirs et de changements dans tous les secteurs de la société, et non pas uniquement par en haut (techno-science, green business, ONU), que dépend l’avenir commun. Ce qui n’exclut pas la planification écologique démocratique, du local au global, d’une résilience et d’une décroissance assumée, équitable et joyeuse si possible, de l’empreinte écologique. [18]
2.4. L’Anthropocène de l’éco-marxisme comme échange écologique inégal
Une quatrième lecture de l’Anthropocène, éco-marxiste, consiste à relire l’histoire du capitalisme au prisme non seulement des effets sociaux négatifs de sa globalisation comme dans le marxisme standard (cf. la notion de « système-monde » d’Immanuel Wallerstein et celle d’« échange inégal »), mais aussi, simultanément, de ses métabolismes matériels insoutenables (fait de fuites en avant récurrentes vers l’investissement de nouveaux espaces préalablement vierges de rapport extractivistes et capitalistes) et leurs impacts écologiques.
Que nous apporte cette vision plus matérielle (comme la troisième et la première) et plus politique (comme la troisième) de l’Anthropocène ? Prenons tout d’abord la question du basculement dans l’Anthropocène au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. Le récit institutionnel-naturaliste (1er) et le récit constructiviste-technophile (2e) mettent en avant l’inventivité d’un Watt créant des machines à vapeur plus puissantes, techniquement supérieures à toutes les autres sources d’énergie et qui les aurait donc « naturellement » supplantées, requérant alors des quantités croissantes de charbon. Pourtant, on peut opposer à ce récit simpliste un autre récit, plus empiriquement fondé et plus politique. Dans Une grande divergence, Kenneth Pomeranz explique pourquoi l’Angleterre, et non la région chinoise du delta du Yangzi, a pris la voie de l’industrialisation et l’hégémonie mondiale. Les deux sociétés qu’il compare montraient un niveau de « développement » économique et technologique équivalent vers 1750 et furent confrontées à des pressions analogues (plus forte en Angleterre) sur leurs ressources (terre, bois). Une double contingence favorable explique selon Pomeranz la voie anglaise : la proximité de gisement de charbon utilisable (alors qu’ils étaient distants de plus de 1500 km de Shanghai) et la situation de l’Europe au carrefour géographique de l’Amérique, de l’Afrique et de l’Asie, situation qui avait permis une accumulation primitive aux XVIe et XVIIe siècle et qui, autour de 1800, permettait à l’Angleterre d’importer/capturer des ressources cruciales à son développement industriel : de la main-d’œuvre esclavagiste cultivant le coton (évitant ainsi des millions d’hectares de prairies pour des moutons pourvoyeurs de laine), du sucre (4 % de l’apport énergétique alimentaire en Angleterre en 1800), du bois, puis du guano, du blé et de la viande. Kenneth Pomeranz montre les liens – aux incidences écologiques majeures – entre essor industriel britannique et mise au travail d’« hectares fantômes » de la périphérie de l’empire. Ainsi en 1830, la consommation de sucre (antillais) du pays correspond à l’apport de 600 000 hectares de bonnes terres à céréale ou pomme de terre, celle de coton (américain) à 9,3 millions d’hectares de pâturages à ovins et celle de bois (Amérique et mer Baltique) à plus de 400 000 hectares de forêts domestiques. Au total, (bois, coton esclavagiste, sucre, etc.), une Angleterre maîtresse des mers. On atteint ainsi plus de 10 millions d’hectares (soit l’équivalent de la surface agricole utile anglaise) de production annuelle drainée vers l’Angleterre. [19]
C’est cet échange écologique inégal qui a placé la Grande-Bretagne au centre d’un flux de ressources qui permit son entrée dans l’ère industrielle. Ce basculement dans l’Anthropocène n’est pas sans lien, également, avec les guerres napoléoniennes qui inaugurèrent, en réponse au blocus continental, le transport massif à grande distance de bois d’Amérique du Nord, rendant ainsi possible en retour l’émigration de masse vers l’Amérique du Nord, autre facteur clé de l’augmentation de l’empreinte écologique humaine. Enfin, les guerres napoléoniennes jouèrent un rôle clé vers la dérégulation des pollutions qui permit la naissance d’un capitalisme chimique [20] qui joue depuis deux siècles un rôle « anthropocénique » considérable (acides, colorants, engrais chimiques, biocides, aérosols…).
Ainsi appréhendée, la « révolution industrielle » n’est pas le processus linéaire poussé par le génie technologique de quelques savants et entrepreneurs européens (premier récit), mais plutôt le nœud d’une configuration géopolitique globale. D’ailleurs, l’adoption des machines à vapeur n’avait rien d’évident ni de nécessaire. Au début du XIXe siècle, il n’existe que 550 machines à vapeur contre 500 000 moulins à eau en Europe, et le charbon est plus cher que l’énergie hydraulique. Ce n’est que lors de la récession de 1825-1848, couplée au métier à tisser automatisé comme réponse patronale aux « indisciplines » et aux revendications ouvrières, ainsi que dans une logique de concentration de la main-d’œuvre, que la machine à vapeur fut adoptée dans l’industrie textile. Plutôt que le produit abstrait et indifférencié d’une « entreprise humaine », l’Anthropocène résulte de choix technico-économiques faits par certains groupes sociaux, en vue d’exercer un pouvoir sur d’autres, qui souvent résistèrent [21]. Et ce basculement initié par une poignée de personnes (en 1825, la Grande-Bretagne est responsable de 80 % des émissions mondiales de CO2) entraîna l’humanité et la Terre dans un devenir anthropocénique par le jeu de la concurrence économique, de la guerre et de la domination impériale.
Prenons comme deuxième exemple la pétrolisation du monde au XXe siècle : elle est encore le résultat de choix politiques opérés pour maintenir et stabiliser le capitalisme. Tout au long du XXe siècle, le pétrole est plus cher que le charbon, qui passe pourtant de 5 % de l’énergie mondiale en 1910, à plus de 60 % en 1970. Cette pétrolisation est tout d’abord le fait de la suburbanisation et de la motorisation. Ce processus a été activement encouragé par les dirigeants américains conservateurs dès 1920. La maison de banlieue leur paraissait être le meilleur rempart contre le communisme en redéfinissant l’environnement politique et social du travailleur : elle casse les solidarités ethniques et sociales qui avaient été le support des solidarités ouvrières. La maison individuelle et la voiture qui l’accompagne jouent aussi un rôle essentiel de discipline sociale par l’intermédiaire du crédit à la consommation : dès 1926, la moitié des ménages américains sont équipés d’une voiture, mais les deux tiers de ces voitures ont été acquises à crédit.
À l’époque où dominait le charbon, les mineurs possédaient le pouvoir d’interrompre le flux énergétique alimentant l’économie (cf. le succès de la première grève générale anglaise de 1842). Acteurs clés du mouvement ouvrier, les mineurs et cheminots contribuèrent à l’émergence de syndicats et de partis de masse, à l’extension du suffrage universel et à l’adoption des lois d’assurance sociale. Dès lors, la pétrolisation de l’Amérique puis de l’Europe prend un sens politique : affaiblir les mouvements ouvriers et les luttes sociales. Le pétrole est beaucoup plus intensif en capital qu’en travail, le travail humain d’extraction se fait en surface (et en grande partie dans ce qui était le « tiers-monde »), il est donc plus facile à contrôler que les puissants syndicats de mineurs ou de cheminots. Un des objectifs du plan Marshall était ainsi d’encourager le recours au pétrole afin d’affaiblir les mineurs et leurs syndicats et d’arrimer ainsi les pays européens au bloc occidental [22].
Plus généralement, dans la lecture éco-marxiste, l’Anthropocène apparaît comme la « seconde contradiction » du capitalisme, son incapacité à maintenir les conditions écologiques d’une vie sur Terre. À condition de ne pas basculer dans un aplatissement de la question écologique dans le vieux cadre marxiste ni dans l’annonce prophétique (déjà faite par Lénine…) de l’auto-écroulement du capitalisme sous le poids de ses contradictions, cette perspective présente l’intérêt d’inscrire la matérialité des flux de matière et d’énergie et des processus écologiques dans une histoire critique du capitalisme.
Elle permet de repenser la croissance occidentale des deux derniers siècles en termes d’échange écologique inégal, selon lequel les économies dominantes du centre du système-monde capturent non seulement des heures de travail, mais aussi des hectares et des ressources finies à la périphérie tout en externalisant des dégâts écologiques et de l’entropie.
Elle permet aussi de sortir du fétichisme technologique (qui fut longtemps partagé et propagé par le marxisme) en reliant les gains de productivité technique au centre du système-monde à une dégradation environnementale et sociale au plan planétaire. Ainsi, pour un éco-marxiste comme Alf Hornborg, le développement technique est le produit d’une accumulation au centre du système-monde permis par un échange écologique inégal avec la périphérie (dans le cadre d’un « jeu à somme nulle » sur une planète finie) : dans le capitalisme fossile, le « progrès technique » au centre est la contrepartie d’une perte d’efficacité globale et d’une dégradation écologique et thermodynamique de la planète [23]. Cette lecture offre des convergences avec la troisième lecture, post-progressiste et technosceptique, de l’Anthropocène.
Enfin, la lecture éco-marxiste offre des prises théoriques et politiques pour décoder les stratégies actuelles de l’oligarchie mondiale pour « néolibéraliser » la nature et faire du système Terre dans son entier un sous-système du système financier (pénétration généralisée de l’action environnemental publique – nationale, européenne et onusienne – par les intérêts privés, durcissement de la propriété intellectuelle sur le vivant, approches néolibérales de la résilience et des « risques » environnementaux, green bonds, marchés du carbone, REDD, marchandisation-compensation écologique…).
Conclusion : multiplier les récits
Bien entendu, les troisième et quatrième lectures, les seules qui se réapproprient les alertes scientifiques dans des perspectives émancipatrices et qui pourraient se féconder l’une l’autre à travers de multiples lignes de convergences possibles, apparaissent comme les plus intéressantes pour un altermondialisme écologiquement conscient. Elles offrent une boîte à outils pour imaginer et construire collectivement des stratégies de résistance à la fuite en avant des grands projets inutiles et imposés du productivisme (dont le dernier en date est la géo-ingénierie), des alternatives systémiques au capitalisme industriel aujourd’hui financiarisé, des stratégies de résilience solidaire et de réorganisation en cas d’effondrement local (cf. la Grèce) ou global, une transition d’ambition trans-locale et trans-séculaire, mais sans posture démiurgique (acceptation d’un passé et d’un devenir communs avec notre matrice la Terre, dans l’humilité volontaire), vers une sortie de l’Anthropocène, vers un vivre ensemble dans une nouvelle époque géologique que l’on pourrait nommer « Écocène » puisque l’Oikos est la maison partagée.
Mais peut-être que même ces deux lectures, catastrophiste/décroissante ou éco-marxiste, restent encore trop surplombantes et occidentales pour prétendre constituer la base des discussions dans le mouvement « alter » au plan international. Peut-être sont-elles trop prisonnières d’une vision du monde « mono-naturaliste » de la modernité occidentale, trop prise dans un géo-savoir-pouvoir sur la Terre, héritier d’une posture de domination-extériorité, de l’entreprise coloniale et de la culture de la guerre froide. Le point de vue du long terme géologique et du « système » Terre, considéré de l’extérieur (au moyen de la technosphère spatiale notamment), ne tend-il pas à placer au pouvoir global certains groupes et à marginaliser certains peuples, certaines voix et certaines visions de la Terre ? Sans idéaliser les constructions complexes que sont la Pachamama ou le buen vivir, ni voir les peuples amérindiens en bon sauvages écologistes, il reste que le perspectivisme amérindien offre un contrepoint théorique essentiel au mononaturalisme (qui structure chacune des quatre grandes lectures discutées ici) et donne à penser d’autres perspectives possibles sur les problèmes écologiques planétaires [24].
Aussi importe-t-il de multiplier encore les récits, de permettre l’inscription/traduction des enjeux de l’Anthropocène dans une multiplicité de visions du monde et de permettre leur mise en discussion dans un dialogue interculturel ouvert au sein dans la nébuleuse « alter » (en évitant autant que possible les concepts flous aisément récupérables par le développementalisme gouvernemental comme le buen vivir menace de l’être). « Quelles paroles faut-il semer, pour que les jardins du monde redeviennent fertiles ? » se demandait la poétesse Jeanine Salesse. Sans doute, de multiples paroles plutôt qu’un seul récit du match de « l’espèce humaine (ou du capitalisme) face au système Terre » ; venant de voix multiples et ancrées dans des lieux tous uniques puisque l’hégémonie du global, de la mobilité et d’un regard dé-terrestré sur la Terre appelle au contraire à une réhabilitation du lieu et des liens.

![]() Le reportage de France 3 Centre sur la génodique :
Le reportage de France 3 Centre sur la génodique : ![]() « Les plantes bougent, sentent et réagissent mais nous ne sommes pas capables de le voir »
« Les plantes bougent, sentent et réagissent mais nous ne sommes pas capables de le voir »





 Le petit livre noir en couleurs de Dominique, de Pixel Vengeur
Le petit livre noir en couleurs de Dominique, de Pixel Vengeur
 Serge et Demi-Serge, de Geoffroy Monde
Serge et Demi-Serge, de Geoffroy Monde
 Talk Show, de Fabcaro
Talk Show, de Fabcaro sortie premier trimestre 2015
sortie premier trimestre 2015 Pixel Vengeur fait ses premières armes en bande dessinées dans les années 80 dans des journaux tels que Viper, le Petit Psikopat Illustré et Rigolo. Puis il devient graphiste en jeux vidéo et découvre l’ordinateur. Il recommence à apparaître en tant qu’illustrateur dans différents mensuels, puis par revenir définitivement en 2000 à la bande dessinée. Il travaille aujourd’hui pour Fluide Glacial, le Psikopat et Spirou.
Pixel Vengeur fait ses premières armes en bande dessinées dans les années 80 dans des journaux tels que Viper, le Petit Psikopat Illustré et Rigolo. Puis il devient graphiste en jeux vidéo et découvre l’ordinateur. Il recommence à apparaître en tant qu’illustrateur dans différents mensuels, puis par revenir définitivement en 2000 à la bande dessinée. Il travaille aujourd’hui pour Fluide Glacial, le Psikopat et Spirou. Geoffroy Monde est magique depuis 2004 et a souvent été élu meilleur espoir. Il raconte tout ça dans des albums publiés aux éditions Lapin et Warum, et sur son blog Saco : Pandemino. Des fois, il ment.
Geoffroy Monde est magique depuis 2004 et a souvent été élu meilleur espoir. Il raconte tout ça dans des albums publiés aux éditions Lapin et Warum, et sur son blog Saco : Pandemino. Des fois, il ment. Fabcaro poursuit depuis une dizaine d'années son exploration de la bande dessinée d'humour entre expérimentation, autobiographie et absurde, seul ou officiant au scénario pour d'autres, alternant les albums pour des éditions indépendantes avec notamment Le steak haché de Damoclès, L'album de l'année ou La clôture, et albums plus grand public, parmi lesquels Z comme Don Diego (avec Fabrice Erre) ou Amour, passion et CX diesel (avec James). Il a également collaboré à divers magazines ou journaux comme Tchô !, L'écho des savanes, Psikopat, ZOO, CQFD, Kramix ou Fluide Glacial pour lequel il travaille actuellement, ou des revues comme Jade et Alimentation générale. Il est aussi l'auteur d'un roman, Figurec, paru en 2006 aux éditions Gallimard.
Fabcaro poursuit depuis une dizaine d'années son exploration de la bande dessinée d'humour entre expérimentation, autobiographie et absurde, seul ou officiant au scénario pour d'autres, alternant les albums pour des éditions indépendantes avec notamment Le steak haché de Damoclès, L'album de l'année ou La clôture, et albums plus grand public, parmi lesquels Z comme Don Diego (avec Fabrice Erre) ou Amour, passion et CX diesel (avec James). Il a également collaboré à divers magazines ou journaux comme Tchô !, L'écho des savanes, Psikopat, ZOO, CQFD, Kramix ou Fluide Glacial pour lequel il travaille actuellement, ou des revues comme Jade et Alimentation générale. Il est aussi l'auteur d'un roman, Figurec, paru en 2006 aux éditions Gallimard.
















 Le 83e numéro du
Le 83e numéro du 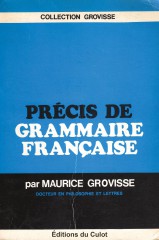
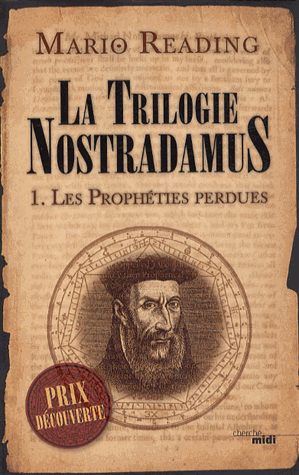







 Courte vidéo satirique en langue espagnole, avec sous-titrage en français, qui retrace avec beaucoup d’à-propos, les fondements politiques de la faillite bancaire et immobilière espagnole. Document proposé pour CHAIRECOOP par Alejandro Muchada. «
Courte vidéo satirique en langue espagnole, avec sous-titrage en français, qui retrace avec beaucoup d’à-propos, les fondements politiques de la faillite bancaire et immobilière espagnole. Document proposé pour CHAIRECOOP par Alejandro Muchada. « 






